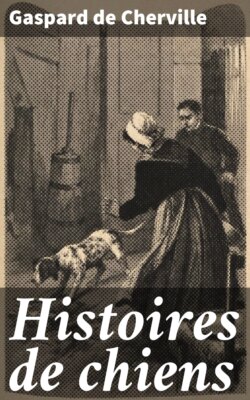Читать книгу Histoires de chiens - Gaspard de Cherville - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеCHAPITRE II
Table des matières
Les deux Invalides.
L’histoire du propriétaire du vieux donjon, M. Romuald Duval de Bourguebus, ne ressemble guère à celle de son neveu. Il avait neuf ans lorsque son père était mort. Dans le désastre de sa fortune, après le mariage de sa sœur avec M. Tuvache, on était parvenu à lui réserver la charge de conseiller, qui pouvait lui assurer un avenir convenable.
Mais l’idéal du petit bonhomme n’était pas la robe; il manifestait pour elle une aversion singulière; l’odeur de l’écritoire lui donnait des nausées. Il voulait être d’épée, et sa vocation sur ce point était si décidée que, lorsqu’il eut quatorze ans, il fallut, bon gré mal gré, pourvoir ce précoce amant de Bellone d’une lieutenance au régiment de Navarre.
Les aspirations batailleuses de M. de Bourguebus furent servies à souhait. Entré au service en 1707, il fit, en 1709, la campagne des Flandres, sous Villars, fut blessé à Malplaquet, prit sa revanche à Denain, monta des premiers à l’assaut de Pizzighettone, suivit le maréchal de Saxe en Bohême, perdit un œil à Lauterbourg et enfin fut arrêté dans sa moisson de lauriers par un boulet qui lui fracassa la jambe dans les lignes de Laufeldt.
On transporta le blessé à l’hôpital de Maëstricht. L’amputation, jugée nécessaire, fut opérée; le héros devint un invalide.
Il supporta ses souffrances avec un mâle stoïcisme, son désastre avec une véritable grandeur d’âme.
Quelques historiens ont bien rendu la justice qui leur est due à ces héroïques soldats du passé, mais le vulgaire continue de les apprécier sous les couleurs les plus fausses.
On se figure généralement que, dans ce temps-là, on ne devait son épaulette qu’à la faveur; on juge des milliers d’officiers par quelques douzaines de colonels et de maréchaux de camp, dont les campagnes les plus productives ont eu, en effet, les antichambres de Versailles pour théâtre; volontairement ou involontairement, on oublie ces milliers de pauvres et braves gentilshommes, qui endossaient le harnais à quinze ans pour ne le quitter qu’à soixante, insoucieux du grade, pourvu qu’ils eussent l’honneur de servir le roi, versant non seulement leur sang sur tous les champs de bataille, sans grand espoir d’avancement, mais écornant leur modeste patrimoine pour suppléer à l’insuffisance de la solde.
On n’a point assez mis en relief la sublime abnégation avec laquelle, après trente et quarante ans de cette existence de dévouement patriotique, lorsque les cheveux avaient blanchi sous le casque, usés, fourbus, ruinés, éclopés, ratatinés, ces glorieux vétérans regagnaient fièrement le petit manoir paternel, avec le brevet d’une maigre pension dans leur poche, et sur la poitrine, la croix de Saint-Louis, but unique de leur ambition.
Cette récompense n’avait pas manqué au capitaine du régiment de Navarre. Elle était sans doute pour quelque chose dans la sérénité d’âme avec laquelle il envisageait la retraite, cette mort anticipée du soldat; mais comme, malgré ses cinquante-quatre ans, il avait conservé une humeur des plus juvéniles et un caractère fort impétueux; comme son infirmité l’atteignait à la fois dans sa carrière et dans son goût passionné pour la chasse, peut-être ne se fût-il pas prêté avec autant de bonne grâce aux décrets de la Providence, s’il n’avait été fortifié contre son chagrin par l’exemple et par les exhortations d’un camarade que le hasard lui avait donné.
Celui-ci était autrement à plaindre que le chevalier de Bourguebus.
Blessé comme lui à l’affaire de Laufeldt, il avait été débarrassé de son bras sur le lit voisin de celui où l’on délivrait le vieux capitaine de sa jambe.
Mais cette seconde victime des hasards de la guerre, ce n’était pas au déclin d’une carrière glorieusement remplie qu’elle se voyait condamnée à l’inaction, c’était à son aurore. M. de Tancarville (ainsi se nommait le mutilé), n’avait que vingt-sept ans; de plus, il était sans parents, sans appui, n’avait d’autre fortune que son épée, désormais brisée; son malheur le laissait sans ressources.
Il était l’unique descendant d’une branche fort déchue d’une famille illustre de la Normandie. Après un mariage assez vulgaire, son père était mort, laissant sa veuve et son fils dans une véritable indigence. Un brave homme de curé avait signalé au maréchal de La Meilleraye ce représentant d’un grand nom, qui allait se trouver réduit à conduire la charrue. Fort soucieux de la dignité de la noblesse, le maréchal avait fait élever l’enfant à ses frais, .et l’avait pourvu d’une cornette dans un régiment de chevau-légers.
Depuis lors, le jeune homme avait successivement perdu son protecteur et sa mère. Forcé d’abandonner le drapeau à l’ombre duquel il avait grandi, le régiment qui était devenu sa famille, il allait se trouver isolé dans le monde et il avait devant lui un horizon autrement sombre, autrement menaçant que ne pouvaient l’être ces loisirs de la gentilhommière, auxquels M. de Bourguebus regrettait quelquefois de se voir réduit.
Quelque amères que dussent être les réflexions de M. de Tancarville, elles n’ébranlaient pas son courage; pendant les longs mois de traitement et de convalescence, la fermeté avec laquelle il soutenait cette cruelle épreuve ne se démentit pas un instant.
Quelquefois, lorsque le roulement des tambours, les mâles accents des clairons du dehors arrivaient affaiblis dans l’intérieur de l’hôpital, on pouvait surprendre une vague expression de mélancolie dans les grands yeux noirs de l’officier; mais il maîtrisait rapidement les sensations qui débordaient de son âme.
En revanche, quand il voyait son voisin disposé à mettre la conversation sur leurs mutuelles infortunes, ce qui arrivait régulièrement trois ou quatre fois par jour, il trouvait, pour détourner ces fâcheuses impressions de l’esprit de son vieux camarade, tantôt des paroles pleines de sens et de raison, tantôt une gaieté si communicative, que le capitaine de Navarre-Infanterie tardait rarement à se mettre à l’unisson.
Non content d’apporter au rétablissement du pauvre invalide ce concours d’un ordre purement moral, plus promptement guéri que son vieux camarade, il s’était fait son infirmier et lui donnait des soins qu’un fils n’eût pas désavoués.
Il n’y avait qu’un chapitre sur lequel l’éloquence consolatrice du cornette était absolument inefficace: celui de la chasse.
M. de Tancarville était, cependant, parvenu à atténuer la véhémence du désespoir cynégétique de son ami, en étendant au chien de l’invalide l’amitié qu’il avait vouée à celui-ci; M. de Bourguebus se désolait autant de ne plus pouvoir faire chasser ce chien que de ne plus chasser lui-même.
Grâce à lui, Caporal, c’était le nom de cet animal, eut au moins sa promenade quotidienne, et le chevalier fut peut-être plus sensible à cette attention qu’à celles dont lui-même avait été l’objet.
Le vieux soldat n’était ni tendre, ni démonstratif; et cependant, bien souvent, lorsque la fièvre le clouait sur son grabat, si son regard s’arrêtait sur son jeune camarade, on voyait une larme, perlant dans le seul œil qui lui restait, descendre lentement sur ses joues tannées; un éloquent serrement de main protestait de sa reconnaissance.
Bientôt, ce sentiment se manifesta plus vivement encore. Un jour, après une longue causerie, dans laquelle il avait interrogé le cornette sur sa situation, sur ses projets après leur rentrée en France, M. de Bourguebus resta pendant assez longtemps absorbé dans de graves réflexions; enfin, relevant la tète et caressant machinalement son chien, dont le museau reposait sur le genou valide de son maître:
«Mordieu!» s’écria-t-il, «mon jeune ami, je ne vous trouve pas aussi dénué que vous me semblez le croire.
— Diable!» lui répondit le jeune homme en souriant, «je vous serai obligé, chevalier, de me confier où gisent les richesses que vous venez de me découvrir.
— C’est bien facile. Il existe de par le monde un vieux soldat auquel votre philosophie a enseigné à supporter ses misères, que vous avez veillé, soigné, pansé avec un dévouement qui peut-être a fait reculer la mort, que vous avez traité, lui et son chien, comme s’ils eussent été des frères; or, ce vieux soldat possède, là-bas en Normandie, le petit castel de Bourguebus, quelques douzaines d’acres de bonne terre et un neveu qui mesure ses écus de six livres au boisseau; n’est-il pas juste et naturel que la moitié de tout cela soit à vous?
— Même du neveu?
— Du neveu surtout», s’écria le chevalier, dont l’oeil eut un rayonnement malicieux. «Ah! mon ami, quelle terre que Colleville! Des bois où foisonnent les chevreuils, les lièvres, les lapins! des champs grouillant de perdrix !...»
Comme s’il eût compris, Caporal agita sa queue.
«Sois tranquille, Caporal», reprit le vieil officier avec une nuance d’attendrissement; «tu auras, comme nous, ta part de joie dans ce paradis terrestre.»
M. de Tancarville paraissait également fort ému, bien que son émotion n’eût certainement pas les mêmes causes; il prit la main de son vieil ami et lui dit:
«Merci de votre offre, chevalier, je ne l’oublierai jamais; mais, avant de l’accepter, soyez assez bon pour m’affirmer, sur votre foi de gentilhomme, que vous ne la déclineriez pas vous-même si vous étiez à ma place et moi à la vôtre.»
Le chevalier de Bourguebus aplatit son oreiller d’un coup de poing, en accompagnant ce geste d’une imprécation.
«Par la corbleu!» s’écria-t-il, «pour une fois dans ma vie que je cède à la fantaisie d’acquitter une dette, je joue de malheur! mais je n’en aurai pas le démenti; j’y veux penser.»
Et le digne gentilhomme y pensa si bien, en effet, que pendant les deux jours qui suivirent, il fut impossible à son jeune camarade de lui arracher une parole.