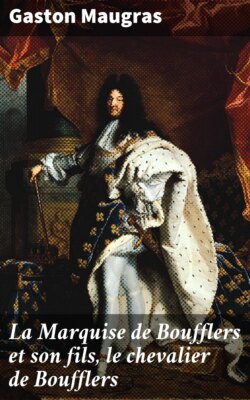Читать книгу La Marquise de Boufflers et son fils, le chevalier de Boufflers - Gaston Maugras - Страница 11
CHAPITRE VI
1769-1770
ОглавлениеMariage du duc de Chartres.—Présentation de Mme du Barry.—Mme de Mirepoix consent à voir la favorite.—Elle se brouille avec son frère.—Mme du Deffant et la marquise de Boufflers.—«Les oiseaux de Steinkerque».—Saint-Lambert.—Le poème des Saisons.—Clément au Fort l'Évêque.
En avril 1769 eut lieu le mariage du duc de Chartres. Mme de Boufflers, naturellement, y assista avec toute la Cour; mais si elle consentit à «faire de la dépense» pour se costumer «en grand gala», il n'en fut pas de même de son frère, le chevalier de Beauvau. Ce dernier, peu satisfait du Roi, refusa énergiquement de se faire habiller richement pour assister à la noce princière. Lorsqu'on lui demanda s'il irait à Versailles, il répondit par cet impromptu:
Le Roi ne vient jamais chez moi;
D'où vient que j'irais chez le Roi?
Ce n'est donc que par représailles
Que je ne vais point à Versailles.
La magnificence des habits pour la cérémonie nuptiale fut portée à un excès inconnu jusqu'alors et qui inspirait à Grimm ces réflexions, très justes:
«J'avais cru il y a une quinzaine d'années, lorsqu'on inventa pour les habits d'hommes des étoffes à trois couleurs, que cette mode paraîtrait trop frivole et ne pourrait durer longtemps. Je me suis bien trompé. On a trouvé depuis le secret de mettre sur le dos d'un homme une palette entière, garnie de toutes les teintes et nuances possibles. Aujourd'hui on met la même variété dans les broderies d'or et d'argent qu'on mêle de paillons de diverses couleurs: ces habits donnent à nos jeunes gens de la Cour un avantage décidé sur les plus belles poupées de Nuremberg...... Si j'étais roi de France, je réformerais, non par un édit, mais sur ma personne, toutes ces modes d'origine gothique, qui font d'un Français habillé le plus mesquin, le plus insipide, le plus ridicule personnage qui se soit jamais tenu sur ses deux pieds [54].»
Il se produisit à la Cour, pendant l'année 1769, un événement de la plus haute gravité, et qui allait porter le trouble dans une famille jusque-là très tendrement unie.
Depuis la mort de Mme de Pompadour, le Roi, sans renoncer aux «passades» et aux fantaisies du Parc-aux-Cerfs, avait vécu seul et il n'y avait pas eu de «maîtresse déclarée». En 1768, il rencontra Mme du Barry et il s'éprit pour cette jeune et ravissante créature d'une passion sénile que rien, pas même la possession, ne put apaiser. Quand il voulut introduire à la Cour cette femme connue par la bassesse de son extraction et la dépravation de ses mœurs, le scandale fut inouï. Mais le prince, aveuglé par son amour, n'en persista pas moins dans ses projets.
Lorsque Mme du Barry, en dépit de toutes les résistances, eut été présentée le 22 avril 1769, les duchesses de Choiseul et de Grammont firent dire au Roi qu'elles craignaient que leur présence ne lui fût moins agréable dans sa société particulière et qu'elles le priaient de les excuser à l'avenir aux soupers des petits cabinets. La duchesse de Beauvau prit le même parti que ses amies et elle refusa avec indignation toute compromission avec la favorite. Malgré la docilité de la noblesse à l'égard du monarque, presque toutes les femmes de la Cour imitèrent cet exemple. Il n'en fut malheureusement pas de même pour Mme de Mirepoix.
«La fée Urgèle», comme la surnommaient quelques mauvaises langues, était toujours avide de plaisirs, besoigneuse et endettée plus que jamais. Elle aurait bien voulu imiter la conduite de son frère et de sa belle-sœur, mais comment faire?
«Comment résister au Roi, si bon, si serviable, qui tous les ans paie pour elle 30 ou 40,000 francs de dettes et puis le cavagnole est si amusant, et on n'y joue bien que chez le Roi! C'est ainsi qu'elle en arrive de cavagnole en cavagnole à abaisser son caractère de la façon la plus humiliante, et à devenir l'amie intime de la favorite.»
L'indignation fut générale. Un tel exemple donné par une si grande dame, par la propre sœur du prince de Beauvau, motiva les plus amères critiques. On disait que la maréchale faisait partie de la charge de favorite et que les maîtresses se la repassaient comme un meuble vivant. Tous les partisans des Choiseul, et ils étaient légion, s'indignèrent de la conduite de Mme de Mirepoix et elle fut honnie de ses anciens amis; son frère, quelque chagrin qu'il en éprouvât, rompit toutes relations avec elle.
Mme de Boufflers n'avait pas les mêmes raisons pour se montrer si rigoureuse; elle conserva donc avec sa sœur la même intimité que par le passé, mais l'union de la famille fut rompue et les relations devinrent souvent plus délicates.
L'existence de Mme de Mirepoix près de sa nouvelle amie ne fut pas heureuse. Les quelques dames qui, dans des vues plus ou moins intéressées, avaient consenti à former la société de Mme du Barry, étaient toutes ensemble comme chien et chat; c'était à qui se surpasserait en dédain et en mépris l'une pour l'autre, et à qui s'en rendrait le plus digne. Mme de Mirepoix se laissait aller à des jalousies, à des bouderies et à des «rapatriages», qui étaient une honte de plus. Ces misérables querelles faisaient le désespoir de Mme du Deffant:
«Rien n'est plus digne de compassion, écrivait-elle, une grande dame, d'une très bonne conduite, beaucoup d'esprit, beaucoup d'agrément, toutes ces choses réunies, ce qui en résulte, c'est d'être l'esclave d'une infâme... mais il n'y a plus de remède, elle a perdu la cadence, elle ne peut plus retrouver la mesure.»
Elle écrivait encore:
«C'est bien dommage que le cœur et le caractère de cette femme ne répondent pas à son esprit et à ses grâces. Elle est sans contredit la plus aimable de toutes les femmes qu'on rencontre, je lui trouve beaucoup plus d'esprit qu'aux Oiseaux et ces Oiseaux valent pour le moral encore moins qu'elle.»
Pendant que les cercles de la Cour étaient bouleversés par tous ces événements, Mme de Boufflers continuait à mener une vie des plus mondaines et à fréquenter tous les salons de la capitale. Tous, cependant, ne l'accueillaient pas avec le même plaisir et ne paraissaient pas goûter au même degré le charme de son esprit et l'agrément de sa société.
Mme du Deffant, dont la demeure hospitalière s'ouvrait si volontiers devant la maréchale de Luxembourg et ses amies, ne paraît pas avoir éprouvé une sympathie très vive pour la marquise de Boufflers, pas plus du reste que pour Mme de Boisgelin et Mme de Cambis. Elle a baptisé ces trois dames «les Oiseaux de Steinkerque», probablement en souvenir de la célèbre bataille gagnée par le maréchal de Luxembourg [55]. Chaque fois qu'elle parle de l'inséparable trio, c'est sous ce vocable qu'elle le désigne, mais toujours avec un certain ton dédaigneux, et elle pousse même l'insolence jusqu'à désigner Mme de Boufflers sous le nom irrévérencieux de «la mère Oiseau». Elle ne laisse jamais échapper l'occasion de lancer quelque trait mordant sur «ces volatiles», sur «leur ramage», leur «plumage», etc. Leur conversation, qu'elle trouve frivole et sans intérêt, ne l'enchante pas plus que leur caractère: «Les opéras, les comédies, les ouvrages tant anciens que modernes, les robes, les rubans, les pompons, voilà les sujets de leurs conversations,» écrit-elle avec mépris.
Cependant, malgré le peu de sympathie qui existe entre la vieille aveugle et les Oiseaux, en apparence, conformément aux usages du monde, on est au mieux, on se fait mille politesses, mille coquetteries, on se reçoit, on soupe les uns chez les autres, on échange de petits vers louangeurs.
Un jour, les Oiseaux composent une chanson sur le célèbre tonneau de la vieille marquise:
Ce n'est pas quand on voyage
Que l'on trouve le plaisir;
Ce n'est que près du rivage
Qu'il remplit notre désir.
On a beau voguer sur l'onde,
Parcourir dans un vaisseau
Les quatre coins de ce monde,
Rien ne vaut votre tonneau.
Quelques jours après Mme du Deffant riposte par ce couplet de sa composition:
Sur l'air: Du haut en bas.
Dans son tonneau
On voit une vieille sybille,
Dans son tonneau,
Qui n'a sur les os que la peau,
Qui jamais ne jeûna Vigile,
Qui rarement lit l'Évangile,
Dans son tonneau.
Le lendemain arrive à Saint-Joseph par la petite poste ce couplet nouveau:
Dans ce tonneau
Venez puiser la vraie sagesse,
Dans ce tonneau;
Il aurait enchanté Boileau,
Car vous trouverez la justesse,
Le goût et la délicatesse
Dans ce tonneau.
Mme du Deffant donne plusieurs soupers par semaine, un entre autres le samedi; elle a de fondation ce jour-là Mmes d'Aiguillon, de Mirepoix, de Crussol, la marquise de Boufflers, MM. de Bauffremont et Pont de Veyle.
Souvent aussi elle invite Mme de Boisgelin et Mme de Cambis.
Ces Oiseaux, si dédaignés, sont du reste pleins de talents et ils deviennent à l'occasion une précieuse ressource. Souvent, pour distraire Mme du Deffant, ils récitent des vers, des comédies; un soir ils déclament devant elles plusieurs scènes du Misanthrope; une autre fois ils jouent les Femmes savantes, et avec la plus rare perfection. Mme du Deffant en est à ce point dans l'admiration qu'elle déclare n'avoir jamais rien entendu qui lui fit autant de plaisir.
Mme de Cambis possède encore une voix délicieuse et souvent elle veut bien la faire entendre après souper pour charmer les hôtes de la vieille marquise.
Malheureusement, les Oiseaux ne se bornent pas toujours à des distractions aussi innocentes. Leur passion pour le jeu est poussée à ce point qu'ils sollicitent Mme du Deffant de laisser installer chez elle des tables de vingt-et-un et de trente-et-quarante. L'austère salon de Saint-Joseph transformé en tripot! horresco referens! Désormais les familiers de la maison, les étrangers de passage admis dans le cénacle, pourront prendre part à des parties ruineuses.
Le 10 décembre 1769, «le petit Fox», celui-là même qui devait plus tard jouer dans son pays un si grand rôle, gagne 300 louis; la veille il en avait perdu 260 contre Mme de Boisgelin.
Mme du Deffant est fort irritée de ce jeu effréné; bien qu'elle n'ose s'y opposer, elle le blâme sévèrement.
Elle écrit à Walpole le 26 décembre:
«Je pense comme vous sur les Oiseaux, je ne leur trouve nul attrait. C'est une société dangereuse. Leur fureur pour le jeu est contagieuse... on joua chez moi dimanche jusqu'à cinq heures du matin; le Fox perdit 450 louis. Ce jeune homme ne sera pas quitte de son séjour ici pour 3 à 4,000 louis.»
Heureusement les Oiseaux ne tiennent pas en place, ils disparaissent souvent et leur absence, loin de chagriner Mme du Deffant, lui cause une satisfaction qu'elle ne dissimule pas à son amie Mme de Choiseul; celle-ci, fort indulgente, lui répond:
«Fontainebleau, 16 octobre 69.
«Les Oiseaux, dites-vous, sont envolés. Comment, tout de suite, comme cela, sans raison?—Cela ressemble bien en effet à des oiseaux. J'avoue que je n'en suis pas trop fâchée. Vous savez que je ne partage pas le goût de Mme de la Vallière pour les Oiseaux; tant de grâces, de légèreté, ne conviennent point à une grand'mère. Si ces Oiseaux vous amusaient cependant, je désire qu'ils vous reviennent, on ne peut disconvenir qu'ils n'aient un très joli ramage.»
Depuis qu'il habitait la capitale, Saint-Lambert, nous l'avons vu, était devenu fort à la mode; l'amitié du prince de Beauvau, une bonne fortune éclatante, des poésies fugitives fort appréciées, tout avait contribué à augmenter sa réputation et à lui faire obtenir dans la société une place des plus enviables.
Il travaillait depuis de longues années à un poème des Saisons, sur lequel il comptait pour asseoir définitivement sa réputation. Il l'avait commencé à Lunéville du temps de Mme du Chatelet, et depuis il avait fait maintes lectures dans les salons de morceaux détachés, qui tous avaient obtenu le plus grand succès.
En 1769, le poème étant enfin terminé, l'auteur le livra à l'impression.
Quand l'ouvrage parut, ce fut un cri d'enthousiasme dans le camp des philosophes; l'esprit de secte dominait tout, et Saint-Lambert étant des leurs, peu importait le mérite du poème, il fallait qu'il obtînt un éclatant succès.
Voltaire, toujours prodigue de compliments excessifs, pour les littérateurs de second ordre, écrivait à l'auteur, non sans sourire assurément: «Soyez persuadé que vos Saisons sont le seul ouvrage de notre siècle qui passera à la postérité.»
Soutenu par le prince de Beauvau et par tous ses amis, l'ouvrage ne fut pas moins bien accueilli dans la société que par les encyclopédistes.
En dehors de leurs relations d'amitié, les Beauvau avaient les meilleures raisons du monde pour défendre l'auteur. Saint-Lambert n'avait-il pas eu l'habileté de terminer le troisième chant de son poème par cet hommage à l'amitié:
Oui, je verrai, Beauvau, ta gloire et ton bonheur,
J'entendrai célébrer ta vertu bienfaisante,
Ton âme toujours pure et toujours indulgente,
Ta valeur, ta raison, ta noble fermeté,
Ton cœur, ami de l'ordre, et juste avec bonté.
Je verrai la compagne à tes destins unie,
Embellir ton bonheur, seconder ton génie,
Et pour elle, et pour toi croître de jour en jour
Du public éclairé le respect et l'amour.
Vos succès, vos plaisirs, votre union charmante,
Le spectacle si doux de la vertu contente,
Me tiendront lieu de tout, et sans les regretter
Je perdrai les plaisirs que l'hiver va m'ôter.
Mme du Deffant avec son esprit si net, appréciait peu la phraséologie vague et incertaine de Saint-Lambert. Quand les Saisons parurent, elle se les fit lire et bien qu'influencée par son entourage, son impression fut peu favorable:
«Il y a un peu trop de pourpre, d'or, d'azur, de pampres, de feuillages, écrit-elle. Je n'ai pas beaucoup de goût pour les descriptions, j'aime qu'on me peigne les passions, mais les êtres inanimés, je ne les aime qu'en dessus de porte.»
Elle envoya l'ouvrage à son cher Walpole, sans lui cacher la piètre estime en laquelle elle tenait le poème et l'auteur:
«Ce Saint-Lambert est un esprit froid, fade et faux, dit-elle; il croit regorger d'idées et c'est la stérilité même; sans les oiseaux, les ruisseaux, les ormeaux et leurs rameaux, il aurait bien peu de choses à dire.»
«Ah! que vous en parlez avec justesse, lui répond Walpole, le plat ouvrage! Point de suite, point d'imagination! une philosophie froide et déplacée... des apostrophes tantôt au bon Dieu, tantôt à Bacchus..., c'est l'Arcadie encyclopédique...»
Ravie d'un jugement qui, au fond, était le sien, la marquise répond à son ami:
«Votre analyse de Saint-Lambert a débrouillé tout ce que j'en pensais; c'est un froid ouvrage et l'auteur un plus froid personnage.» Elle ajoute méchamment: «Les Beauvau se sont faits ses Mécènes. Oh! qu'il y a des gens de village et des trompettes de bois! Peut-être y a-t-il encore quelques gens d'esprit, mais pour des gens de goût, pour de bons juges, il n'y en a point...»
Le succès de Saint-Lambert ne fut pas sans mélange et l'enthousiasme des gens de lettres ne fut pas universel. Les enfants perdus de la littérature se permirent quelques critiques, Fréron et Palissot, entre autres, ne ménagèrent pas l'auteur des Saisons. Les épigrammes pleuvaient de tous côtés, une entre autres fit fureur:
Saint-Lambert s'enroue à nous dire:
«Mon poème doit être bon
Car j'ai mis trente ans à l'écrire.
Trente ans! vous dis-je.» Et pourquoi non?
Il en faut autant pour le lire.
Ces critiques faisaient le désespoir du poète. Que devint-il quand il apprit qu'un jeune homme, M. Clément, préparait contre lui un véritable pamphlet. Non content de couvrir de ridicule les Saisons, Clément se permettait quelques plaisanteries sur la Doris du poème, or il n'était que trop facile de reconnaître dans la Doris Mme d'Houdetot [56].
Les Observations critiques allaient paraître. Saint-Lambert remua ciel et terre pour en obtenir la suppression [57].
Mme de Boufflers écrivait à ce propos à son ami Panpan:
«Paris, ce 25 octobre.
«Je viens de lire une critique imprimée des Saisons qui met Saint-Lambert au désespoir. J'aurais bien voulu pouvoir vous l'envoyer, mais il a engagé Mme de Beauvau a en empêcher le débit, ce qui ne me paraît pas d'une justice exacte, car, quoiqu'elle soit sanglante et charmante, il n'y a pas de personnalité.
«On dit qu'elle est d'un M. Clément, qui a infiniment d'esprit. Pour moi, je l'aurais crue de Palissot. Cependant je vis hier une lettre de ce Clément à Saint-Lambert, dans laquelle il se plaint du procédé violent du poète, et il ne manque pas de dire qu'il est plus aisé et plus commode de supprimer que de répondre.
«Il se plaint aussi de ce que Saint-Lambert a écrit à M. de Sartines que lui, Clément, avait été professeur de je ne sais quoi à Dijon et qu'il en avait été chassé; il lui demande une entrevue chez M. de Sartines, où il s'engage à lui prouver le contraire. Tout cela dans des termes violents.
«Je crois que Saint-Lambert, quoiqu'il affecte du mépris, est au désespoir. C'est la maréchale de Luxembourg qui a eu un exemplaire de cet ouvrage, et de la lettre, qui me les a fait voir, sans vouloir me les prêter, ni à personne, à cause de Mme de Beauvau.»
Le poète, de plus en plus irrité et abusant de son crédit, obtint, par l'influence du prince de Beauvau, que son audacieux critique serait envoyé au Fort-l'Évêque. C'était se montrer bien sensible; dans tous les cas, le procédé ne manquait pas d'être assez piquant pour un philosophe.
Clément occupa ses loisirs au Fort-l'Évêque à composer cette épigramme:
Pour avoir dit que tes vers sans génie
M'assoupissaient par leur monotonie,
Froid Saint-Lambert, je me vois séquestré.
Si tu voulais me punir à ton gré,
Point ne fallait me laisser ton poème;
Lui seul me rend mes ennuis moins amers;
Car, de nos maux, le remède suprême
C'est le sommeil... je le dois à tes vers [58].
Clément ne resta que trois jours au Fort-l'Évêque, mais il fut ensuite autorisé à publier ses Observations. Son pamphlet aurait probablement passé inaperçu, si la conduite de Saint-Lambert n'avait fait scandale et attiré l'attention.
Les encyclopédistes formaient une petite église fermée et intolérante à laquelle ils n'admettaient pas que personne pût toucher. Non contents de porter aux nues l'ouvrage de leur confrère, ils avaient tous pris parti avec violence contre son obscur blasphémateur. Ils firent plus encore. Ils décidèrent que l'Académie devait, par un éclatant témoignage, consacrer le succès des Saisons. L'abbé Trublet venait fort à propos de laisser un fauteuil vacant, Saint-Lambert fut invité à se présenter. Il fut élu sans difficulté et, le 23 juin 1770, le poète était admis au nombre des Immortels par M. du Coëtlosquet, évêque de Limoges.
Saint-Lambert, dans son discours, crut devoir louer outrageusement ceux qui l'avaient nommé et Grimm raille agréablement cette reconnaissance exagérée:
«On a, dit-il, donné à M. de Saint-Lambert, lorsqu'il est entré à l'Académie, un encensoir, à condition qu'il en dirigerait les coups, non seulement en arrière sur les fondateurs, mais encore en avant sur les principaux nez académiques. Le nouvel élu a fait son devoir d'encenseur à merveille, et il n'y a point d'habitué de paroisse qui sache mieux lancer le sien vers le porteur du Saint-Sacrement.»