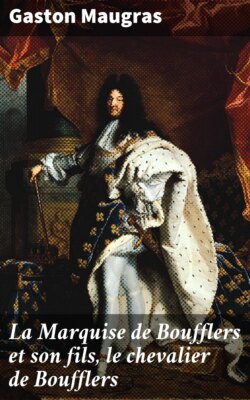Читать книгу La Marquise de Boufflers et son fils, le chevalier de Boufflers - Gaston Maugras - Страница 6
CHAPITRE PREMIER
1766-1767
ОглавлениеLa Lorraine après la mort de Stanislas.—Départ des principaux personnages de la Cour.—Le maréchal de Bercheny, le comte de Tressan, l'abbé Porquet, la marquise de Lenoncourt, etc., quittent Lunéville.
Souvent, et c'est un des plus tristes côtés de la nature humaine, nous ne comprenons la place que certains êtres tenaient dans notre vie que lorsque nous les avons perdus. C'est seulement quand ils ne sont plus que nous songeons à rendre justice à leurs mérites. C'est alors seulement que nous comprenons combien ils nous étaient chers et à quel point ils contribuaient à notre bonheur.
Il en est souvent de même pour les peuples.
Ce n'est qu'après la mort de Stanislas que la Lorraine comprit ce qu'il avait fait pour la défendre, ce qu'elle devait à sa paternelle et sage administration, en un mot tout ce qu'elle perdait en lui.
La disparition du vieux Roi de la scène du monde fut pour les habitants des deux duchés un véritable désastre. On avait appelé l'acte de Cession de 1737 la première mort du pays. L'année 1766 fut la seconde, irrémédiable cette fois.
Du jour au lendemain la Lorraine perdit son autonomie. Nancy et Lunéville, du rang de petites et brillantes capitales, tombèrent au niveau de villes de province de deuxième ordre. L'animation, la gaieté, le luxe qu'apportait la présence de la Cour, les nombreux étrangers que son éclat et sa réputation attiraient sans cesse, tout disparut en un instant. Le commerce devint languissant; les habitants désolés virent non seulement tarir les sources de leur fortune, mais aussi disparaître tout ce qui faisait la gloire et le renom de leur petit pays. La vie s'éteignit peu à peu et bientôt régna partout une morne tristesse. On voyait croître l'herbe dans les cours de tous ces palais aujourd'hui abandonnés, naguère encore retentissants du bruit des fêtes et de la joie des courtisans.
La France, il faut l'avouer, ne fit rien pour adoucir la transition, s'attacher ces nouvelles provinces et leur faire oublier par des bienfaits la perte de leur indépendance. Louis XV, au contraire, avec une dureté et une sécheresse de cœur qu'on ne saurait juger trop sévèrement, s'efforça d'effacer brutalement toutes les traces du passé. Sa conduite fut du reste d'une si rare inconvenance qu'elle souleva une réprobation universelle. Il n'eut même pas la pudeur de conserver quelques années tous ces monuments, que son beau-père avait élevés avec tant de passion et d'amour, toutes ces œuvres charmantes qui avaient fait la joie de sa vie et qui rappelaient un règne bienfaisant et glorieux.
Il décida, il est vrai, qu'on conserverait le château de Lunéville, mais on le transforma en caserne et on logea des troupes dans ces appartements illustrés par la présence de Voltaire, de Mme du Châtelet, de Mme de Boufflers et de tant d'autres.
Le château de Commercy fut moins favorisé encore. C'est en vain que Stanislas, en le léguant à sa fille, avait bien spécifié qu'il l'avait créé pour elle, à son intention spéciale, qu'il désirait le lui voir habiter; Louis XV ne tint aucun compte de dernières volontés si respectables et il décida que le château serait abandonné [3].
La fontaine royale, le château d'eau, le pont d'eau, toutes les merveilles créées à grands frais par Stanislas subirent le même sort et elles ne tardèrent pas à s'effondrer misérablement.
Il en fut de même de toutes ces résidences champêtres, de toutes ces délicieuses retraites élevées par le Roi, soit pour son usage personnel, soit pour celui de ses courtisans: la Malgrange [4], Jolivet, Einville, Chanteheu, les chartreuses du parc de Lunéville, etc. [5], tout fut démoli et les matériaux mis en vente. On ne respecta même pas les chefs-d'œuvre dont le Roi avait orné toutes ces demeures; sculptures, peintures à l'huile et à fresque, bas-reliefs, boiseries, tout fut détruit sans pitié.
Quant aux bosquets, jardins, parcs, orangeries, cascades, pièces d'eau, serres, ménageries, qui entouraient ces différentes résidences, on les abandonna complètement.
Les habitants de Lunéville gémissaient sur cette destruction générale, mais personne ne la ressentait plus douloureusement que Panpan. L'ancien lecteur du Roi avait le cœur déchiré de voir disparaître peu à peu tout ce qu'il avait chanté, tout ce qui avait été sa vie, tout ce qui rappelait son bienfaiteur. Il exhalait ses plaintes dans ces termes touchants:
Quand je peignais ainsi ces brillantes merveilles,
Et que tu me prêtais d'indulgentes oreilles,
Grand Roi, qui t'aurait dit que tes vastes châteaux
Dureraient encore moins que mes faibles tableaux.
Quel œil eût pu percer dans cet avenir sombre?
Je lis encore ces vers. Tes palais ne sont plus.
Dans ta tombe enfouis, ils sont tous disparus.
Si leur magnificence a passé comme une ombre,
A jamais dans nos cœurs survivront tes vertus! [6]
Stanislas, qui ne pouvait guère soupçonner l'usage que le légataire ferait de cette libéralité, avait naïvement légué à son gendre le mobilier de tous ses châteaux et maisons de plaisance.
Par un arrêté du 17 mars 1766, tout entier de sa propre main, Louis XV donna l'ordre de mettre en vente immédiatement tous les objets, quelsqu'ils fussent, qui garnissaient les habitations royales [7]. Les vieux amis de Stanislas eurent la douleur et l'indignation de voir vendre à l'encan, sur la place publique, et disperser au feu des enchères ces meubles magnifiques, ces véritables œuvres d'art qui avaient appartenu à leur maître vénéré.
Les appartements du château de Lunéville furent à moitié dévastés; les riches boiseries du cabinet du Roi disparurent; on les retrouva plus tard dans le grenier d'un village voisin où elles servaient de cloison [8].
La pauvre Marie Leczinska n'eut même pas le droit d'arracher aux enchères ces meubles familiers dont son père aimait à s'entourer et qui lui étaient doublement précieux par les souvenirs qui s'y rattachaient. Elle eut seulement la permission de sauver du désastre les portraits qui se trouvaient dans les appartements du feu Roi [9].
Ce ne furent pas seulement les œuvres éphémères de Stanislas qui disparurent avec lui, la société charmante qu'il avait su très habilement grouper et qui faisait tout l'agrément de sa Cour ne lui survécut pas un seul jour. Tout naturellement, en effet, et par la force même des choses, cette société dont il était le lien nécessaire, indispensable, se dispersa presque immédiatement.
Sur l'ordre de Louis XV, tous les courtisans qui habitaient le château, et ils étaient légion, durent abandonner leurs appartements. Ce fut le signal de la débâcle. Quelle raison de rester à Lunéville, quand il n'y avait plus de Cour, qu'on n'avait plus ni logement, ni charges, ni bénéfices d'aucune sorte.
Chacun agit donc suivant sa fantaisie ou les nécessités de sa situation; les uns, ceux qui avaient des fonctions à la cour de France ou l'espoir d'en obtenir, prirent la route de Versailles, les autres retournèrent dans leurs châteaux faire des économies et méditer sur l'instabilité des choses de ce monde.
Dans le petit cercle intime du Roi et de la favorite, le seul dont nous ayons à nous occuper, le plus empressé à quitter la Lorraine après la mort du Roi, fut le maréchal de Bercheny; son ami disparu, rien ne retenait plus le vieux guerrier à Lunéville. Il partit aussitôt avec toute sa famille pour la terre de Luzancy, qu'il aimait passionnément, et qu'il n'avait quittée qu'à regret pour les splendeurs de la cour de Lorraine. Il entraîna avec lui un des plus fidèles serviteurs de Stanislas, le comte de Tressan.
La mort de son bienfaiteur avait été de toutes façons pour Tressan une véritable catastrophe. Non seulement son cœur était douloureusement affecté par la perte d'un ami très sûr et très aimé, mais il perdait encore avec lui tous les bénéfices de sa situation, logement, entretien, équipages, émoluments. Pour comble de disgrâce, Stanislas ne l'avait honoré dans son testament d'aucune faveur particulière [10].
Sans ressource et dans une situation financière qui s'aggravait chaque jour, qu'allaient devenir Tressan et les siens?
Non seulement il fallait vivre, mais il fallait encore payer les dettes qui avaient été accumulées depuis des années. Harcelé par ses créanciers et ne sachant comment subvenir à l'existence de sa famille, le grand maréchal ne vit d'autre ressource que de quitter la Lorraine et d'aller chercher à la campagne un asile modeste où il pût achever l'éducation de ses enfants.
Autrefois une pareille détermination lui aurait déchiré le cœur et il n'aurait pu s'y résigner; quitter Mme de Boufflers eût été au-dessus de ses forces. Mais les temps étaient bien changés. Les rigueurs persistantes de la marquise avaient fini, l'âge aussi aidant, par triompher de la passion du vieux comte, et il envisageait maintenant avec calme une séparation que les circonstances lui imposaient impérieusement.
Mis au courant des projets de retraite du grand maréchal, M. de Bercheny pensa que le voisinage d'un homme agréable et lettré serait une précieuse ressource dans sa solitude et il chercha à l'attirer près de lui. Il y avait non loin de Luzancy, sur les bords de la Marne, un petit village, Nogent-l'Artaud, où il était facile de se loger à peu de frais. M. de Bercheny l'indiqua à Tressan. Ce dernier trouva le conseil judicieux, et bientôt il achetait à Nogent, pour 10,000 livres, une maison convenable avec de beaux jardins. Elle avait appartenu autrefois à M. Poisson, avant la singulière fortune de Mme de Pompadour.
Quelque pénible que lui fût le sacrifice, le comte, avant de s'éloigner, se décida à faire dans sa maison les réformes nécessaires. Il vendit sa bibliothèque et sa belle collection d'histoire naturelle à la margrave de Bade, il se défit de ses chevaux, de ses équipages, d'une partie de son mobilier; enfin il se réduisit à un seul valet de chambre [11].
Voltaire, qu'il avait mis au courant de ses projets, les approuvait fort:
«Vous comptez donc aller vivre en philosophe à la campagne, lui écrivait-il? Je souhaite que ce goût vous dure comme à moi. Ce n'est que dans la retraite qu'on peut méditer à son aise.»
Mais si le philosophe félicitait Tressan de sa détermination, il s'attendrissait sur le sort de Panpan, qui allait être privé de son meilleur ami, et il ajoutait gracieusement:
«Je n'oublierai jamais mon cher Panpan, c'est une âme digne de la vôtre. Que fera-t-il quand vous ne serez plus en Lorraine? Toute la Cour de votre bon roi va s'éparpiller et la Lorraine ne sera plus qu'une province. On commençait à penser; ces belles semences ne produiront plus rien; c'est vers la Marne qu'il faudra voyager... Notre lac de Genève fait bien des compliments à la Marne.
«Adieu, monsieur, conservez-moi des bontés qui sont la consolation de ma vieillesse.»
Tressan dit donc adieu à Mme de Boufflers, à Panpan, à tous ses amis, et il quitta sans esprit de retour cette Lorraine où il vivait depuis seize ans, où il avait éprouvé bien des joies, mais aussi les plus cruels tourments de l'amour malheureux.
Il vécut paisiblement pendant quelques années dans sa modeste demeure de Nogent-l'Artaud, voisinant avec le maréchal de Bercheny, faisant l'éducation de ses quatre enfants qu'il aimait tendrement, et trouvant des consolations à son isolement dans les travaux littéraires et dans la culture de son petit jardin. C'est là qu'il commença à composer ces romans de chevalerie qui bientôt le passionnèrent et l'occupèrent jusqu'à son dernier jour [12].
MM. de Bercheny et Tressan ne furent pas seuls à quitter la Lorraine. L'aumônier du Roi, cet ineffable abbé Porquet, qui avec tant de succès avait consacré ses soins à l'éducation du chevalier de Boufflers, imita bientôt leur exemple. Que lui restait-il à faire à Lunéville, maintenant que son royal pénitent n'avait plus besoin, et pour cause, de ses services? Vivre paisible et ignoré dans un petit cercle de vieux amis, végéter misérablement dans une cité morte, n'était pas du tout le fait du correct et séduisant Porquet. N'aimait-il pas toujours passionnément les spectacles, les fêtes, les plaisirs? N'était-il pas vraiment trop jeune encore pour renoncer aux joies de ce monde? Et où pouvait-il être mieux que dans la capitale pour satisfaire ses goûts mondains.
L'abbé dit donc un éternel adieu à la Lorraine et il partit pour Paris. Il n'y avait pas de situation, mais il comptait sur sa réputation, et puis il était bien convaincu que ses amis, et en particulier son ancien élève, l'aideraient à en trouver une.
En attendant, il se lança dans la société littéraire et galante de l'époque, fréquenta les philosophes et les comédiennes, en particulier Mlle Quinault, à laquelle Panpan l'avait recommandé, publia des vers dans l'Almanach des Muses, etc., etc.; bref il fit tout au monde, hors ce qui concernait son état.
Panpan avait eu le cœur serré en voyant s'éloigner cet ami si cher et cependant il rimait encore en l'honneur de l'ingrat qui l'abandonnait. Il lui adressait bientôt cette plaintive élégie où il rappelait les joies du passé qui lui rendaient plus cruelles encore les tristesses du présent:
O toi, dont la probité pure,
Le cœur dans le bien affermi,
Plus que l'heureux talent dont t'orna la nature
Pour jamais m'ont fait ton ami,
Gentil docteur que le Permesse
Plus que la Sorbonne illustra,
Toi, qui dis moins souvent la messe
Que tu ne vas à l'Opéra,
Te voilà donc fixé sur les bords de la Seine!
Jadis, aux plaisirs de Paris,
Je t'ai vu préférer nos plaisirs de Lorraine.
Dans ces lieux autrefois de Boufflers si chéris,
Aujourd'hui mon petit domaine,
Je t'ai vu rassembler les muses et les ris;
Dans mon balustre étoit la tribune aux harangues;
Là pour ton chevalier tu fis ces vers charmants
Ces vers auxquels toutes nos langues
Donnoient plus d'applaudissements
Qu'ils n'exigeaient de révérences [13].
Autres temps, autres jouissances...
Mais quels moments vaudront ces fortunés moments? [14]
La marquise de Lenoncourt, une des plus spirituelles femmes de la Cour, une des grandes amies de Panpan et de Mme de Boufflers, n'avait pas d'abord suivi l'exemple général. En dépit des ordres de Louis XV, elle avait continué à résider dans l'appartement qu'elle occupait au château, mais bientôt la solitude qui régnait dans cette vaste demeure, la tristesse qui pesait sur les bosquets du parc, assombrirent le moral de la marquise et elle fut prise de la nostalgie du bruit et du mouvement; puis elle était affligée d'un mari détestable «dont elle rougissait et dont elle avait peur». Stanislas la protégeait contre les entreprises de ce «gros monsieur», ainsi qu'elle appelait son époux. Mais le Roi n'étant plus là pour la défendre, elle ne se crut pas en sûreté à Lunéville et elle prit prétexte de son isolement pour quitter la Lorraine et chercher un refuge sur les bords de la Seine.
Panpan, désolé de voir le vide se faire chaque jour plus grand autour de lui, écrivait à sa chère marquise:
A Mme la marquise de Lenoncourt.
Quand nous l'avons perdu ce Platon couronné,
Au bonheur des Lorrains ce sage destiné,
J'ai cru que dans ces lieux, de sa Cour éplorée,
Il resteroit du moins quelque illustre débris.
Tout a fui son tombeau, tout a fui vers Paris!
Seule dans son palais, vous m'étiez demeurée;
Je comptois, comme à lui, vous y faire ma cour,
Objet de tout mon culte, illustre Lenoncourt;
Vous m'auriez tenu lieu de sa tête sacrée.
De sa présence auguste autrefois honorée,
Ma chartreuse lui dut ses embellissements,
Et d'arbres, et de fleurs, par ses ordres parée,
Fut le théâtre heureux de nos amusements.
Vous y suiviez Boufflers, quand, des jeux entourée,
Boufflers y rassembloit l'esprit, et tous les goûts.
Ils s'y seroient encor rassemblés près de vous!
Mais de ces tristes lieux, pour jamais exilées,
Les grâces avec elle, avec vous envolées,
Ont privé mes jardins de leurs plus chers appas;
Hélas! je n'y vois plus l'empreinte de vos pas
Sur le sable de mes allées! [15].
Ainsi Panpan voyait avec terreur s'éloigner peu à peu tous ses amis, tous ceux qu'il avait aimés, qui avaient été les compagnons de sa vie, qui lui rappelaient les joies des années heureuses. Bientôt il allait se trouver seul, n'ayant plus d'autre distraction que de cultiver les fleurs de son jardin, les fruits de son verger. Pour comble d'infortune il restait dans une situation fort modeste, ayant à peine de quoi vivre. C'était le moment ou jamais de faire appel à cette philosophie dont il avait lui-même si souvent vanté les bienfaisants effets.
Dans sa détresse profonde, le pauvre Panpan avait-il au moins l'espoir de conserver celle qu'il aimait par-dessus toutes choses, sa bienfaitrice, la marquise de Boufflers? Si elle lui restait, c'était encore le bonheur.
Hélas! la marquise, elle aussi, songeait à s'éloigner. Douloureusement affectée par la mort de ce vieillard pour lequel elle éprouvait une ancienne et sérieuse affection, chassée de ce château où elle régnait depuis tant d'années, elle se trouvait dans la situation la plus pénible. En perdant le Roi, elle avait tout perdu, honneurs, privilèges, situation, et comme elle s'était toujours montrée pour elle-même d'un grand désintéressement, elle restait sans la moindre fortune. Tout son patrimoine avait été follement dissipé au jeu, et elle n'avait plus pour vivre qu'une maigre pension de 18,000 livres sur le trésor royal.
Le séjour de Lunéville lui était devenu odieux. Elle aussi voulait fuir ces lieux désolés, et elle parlait d'aller s'établir momentanément dans la capitale, près de son frère de Beauvau et de sa sœur de Mirepoix qu'elle aimait beaucoup, et qui y occupaient à la Cour comme dans la société une grande situation.
A la nouvelle d'un départ prochain, Panpan jetait les hauts cris. Une fois entraînée dans la vie de Paris, ne serait-elle pas subjuguée par les succès qu'elle y obtiendrait? N'allait-elle pas oublier son vieil ami? Reviendrait-elle jamais en Lorraine? Ainsi parlait Panpan avec sa connaissance de la nature humaine, et son cœur se serrait à la pensée qu'il ne reverrait peut-être plus celle qui avait été l'idole de sa vie.
Pendant l'automne de 1766, alors que Mme de Boufflers était encore hésitante, son frère de Beauvau lui écrivit qu'il allait venir avec la princesse passer quelques jours en Lorraine pour régler plusieurs affaires urgentes, et que de là il se rendrait dans son gouvernement du Languedoc où il aurait à séjourner plusieurs mois; il pressait instamment sa sœur de faire le voyage avec eux.
Mme de Boufflers ne cherchait qu'une occasion d'échapper à ses tristes souvenirs. Elle estima qu'un voyage dans d'aussi agréables conditions serait pour elle une précieuse distraction. Puis un changement de milieu, d'horizons, d'habitudes n'était-il pas le meilleur moyen pour elle de se ressaisir. Elle verrait ensuite à réorganiser sa vie et à prendre des résolutions définitives.
Elle écrivit donc à son frère qu'elle acceptait sa proposition avec reconnaissance et qu'elle se tenait prête à partir au premier signal.