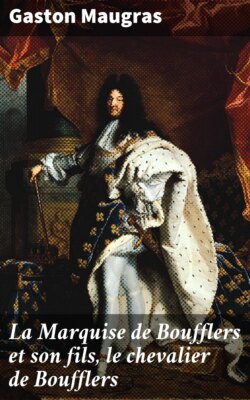Читать книгу La Marquise de Boufflers et son fils, le chevalier de Boufflers - Gaston Maugras - Страница 9
CHAPITRE IV
1768-1770
ОглавлениеSéjour de Mme de Boufflers à Paris.—Sa correspondance avec Panpan.
Quand Mme de Boufflers revint à Paris en 1767, elle descendit d'abord chez son frère, mais ce n'était là qu'une solution provisoire; elle voulait avoir sa liberté, et puis elle avait eu avec sa belle-sœur quelques difficultés qui excluaient toute idée de vie commune. Leurs caractères, en effet, après avoir beaucoup sympathisé, n'avaient pas tardé à se heurter, et dans l'intérêt de tous mieux valait vivre chacun chez soi.
Mme de Boufflers s'installa d'abord rue du Rempart, au Marais, mais c'était fort loin, la maison était laide, incommode, il fallut trouver ailleurs. Après bien des recherches, la marquise finit par découvrir dans le faubourg Saint-Honoré, à côté de l'hôtel de Duras, la maison de Mme de Lorge qui venait de mourir; elle la loua pour 4,500 livres. L'habitation était charmante, agréable et commode; «elle avait à elle seule plus de vue, de soleil et de bon air que tout Paris ensemble.» Il y avait un beau jardin, de grands arbres, mais comme la perfection n'est pas de ce monde, l'escalier était un vrai casse-cou, «un véritable escalier de blanchisseuse». Il fallut bien cependant s'en contenter.
La marquise, à cette époque, a cinquante-sept ans bien sonnés, mais elle n'a rien perdu de ses qualités intellectuelles. Son fils, qui la dépeint à cet âge, s'extasie «sur le charme, la justesse, la finesse, la gaieté, la soudaineté, disons le mot, l'originalité de cet esprit qui ne ressemblait pas plus aux esprits ordinaires que la lumière à la couleur... Jamais aucun soin, aucun apprêt, aucune recherche... Ses paroles étaient inattendues, promptes, vives, pénétrantes, comme autant d'étincelles électriques... Sa gaieté était pour son âme un printemps perpétuel, qui l'a garantie toute sa vie de trop d'ardeur comme de trop de froid et qui n'a cessé de produire des fleurs nouvelles jusqu'à son dernier jour [34].»
Mme de Boufflers retrouve d'abord avec une joie profonde ses chers amis de Lunéville, Mme de Lenoncourt et l'abbé Porquet, qui tous deux lui font fête à l'envi. Mais elle est bien vite débordée; ses parents, ses amis, tout le monde se l'arrache, tout le monde veut jouir de cet esprit charmant, si aimable et si gai.
Bientôt elle est à ce point recherchée, qu'elle ne sait auquel entendre; elle n'a plus une minute à elle, et elle devient insaisissable.
Mme de Lenoncourt fait tous ses efforts pour la voir le plus souvent possible, mais «elle échappe comme un oiseau, et c'est un véritable chagrin de la regretter toujours et de la voir si peu».
Elle n'est jamais chez elle; on prend avec elle un rendez-vous, elle y manque: «C'est une poignée de puces, écrit son amie désolée, il n'y a pas moyen de prendre des arrangements stables avec elle, elle est toujours où elle ne comptait pas être un quart d'heure auparavant.»
Ce ne sont pas seulement les joies de la famille ou de l'amitié qui absorbent si complètement Mme de Boufflers. Elle a toujours adoré le monde et elle en a peu joui pendant les dernières années si moroses du vieux Stanislas; aussi à peine arrivée dans la capitale cherche-t-elle à rattraper le temps et elle se jette à corps perdu dans une vie mondaine qui ne convient, il faut l'avouer, ni à son âge, ni à sa situation de fortune; on ne voit qu'elle à la Cour, chez tous les princes, à toutes les fêtes; elle ne manque pas un spectacle; il n'y a pas de jeune femme plus affolée de plaisirs.
«Elle s'amuse comme si elle avait quinze ans, écrit Mme de Lenoncourt qui en a trente-huit, c'est moi la grand'mère!»
Quelques jours après, elle s'écrie encore dans un moment de dépit:
«J'ai soupé trois jours de suite avec votre marquise. Peut-être vais-je être trois mois sans la voir. Il n'y a pas à Paris assez de jeu, assez de princes, assez de spectacles pour elle, jugez du temps qui lui reste. Et puis elle me soutient qu'elle m'aime! Cela me fait enrager. Je voudrais trouver une bonne raison de m'en détacher [35].»
S'en détacher! c'est plus facile à dire qu'à faire!
Tous ses amis sont furieux après elle; ils finissent par lui en vouloir véritablement et il n'y a pas de reproches qu'ils ne lui adressent, mais elle est si aimable, elle a tant d'agréments, il émane d'elle un charme si singulier qu'on ne peut lui tenir rigueur. Dès qu'on la revoit, on l'aime plus que jamais. On passe sa vie à la détester et à l'adorer.
Ce ne sont pas seulement les fêtes, les spectacles, les réceptions princières que Mme de Boufflers aime avec rage, elle a une passion terrible, irrésistible, le jeu, et rien ne l'en peut détourner. C'est un mal de famille, car ses enfants eux-mêmes, sa sœur de Mirepoix en sont également les victimes. Déjà à Lunéville, du temps de Stanislas, la marquise a commis mille folies et s'est placée souvent dans les plus terribles embarras. Mais à Paris c'est bien pire encore. D'abord les occasions sont plus fréquentes et puis l'on joue bien plus gros jeu. Il n'y a pas de réunion à la Cour ou chez les princes qui ne soit l'occasion d'un jeu effréné.
Depuis la Régence, cette passion avait pris des proportions inouïes.
«La cause de presque tous les malheurs ici, c'est la fureur du jeu, écrit en 1720 la duchesse d'Orléans. On m'a souvent dit: «Vous n'êtes bonne à rien, vous n'aimez pas le jeu.»
«Les rues de Paris étaient éclairées la nuit de pots à feu placés devant les hôtels des plus grands seigneurs, convertis en maisons de jeu. Entrait qui voulait.»
On ne jouait pas seulement dans les tripots, dans les hôtels particuliers, on jouait chez tous les princes, à la Cour, et un jeu effrayant. Cette passion amenait avec elle tous les désordres qui en sont la conséquence. Plus d'un grand seigneur, plus d'une noble dame n'hésitait pas à aider la fortune quand elle ne leur souriait pas suffisamment. On se rappelle l'aventure de Mme du Chatelet à Versailles en 1747; elle joue au jeu de la Reine et en peu de temps elle a perdu non seulement ce qu'elle a sur elle, mais encore plus de 80,000 livres sur parole. Voltaire l'entraîne de force en lui criant qu'elle joue avec des fripons! [36]
Pendant tout le dix-huitième siècle cette passion a régné sans conteste et amené dans la société une démoralisation profonde.
Mme de Boufflers allait donc trouver à Paris plus que partout ailleurs la satisfaction de son déplorable penchant. Aussi partout où l'on joue, est-on sûr de la rencontrer. Et elle ne se contente pas d'un jeu modeste, en rapport avec ses ressources. Point du tout; elle joue gros jeu et perd ou gagne facilement 1,000 louis dans sa soirée. «Du reste dans le monde on ne parle que par 1,000 louis; 4 ou 500 louis sont des bagatelles qu'on ne daigne même pas citer.» Rien ne peut détourner la marquise de sa terrible passion, ni les pertes fréquentes, ni les sages conseils de ses amis.
A Marly, à Chantilly, à Compiègne, à Villers-Cotterets, à l'Isle-Adam, au Palais-Royal, partout elle joue un jeu d'enfer. Souvent on la voit rester à la table de jeu toute une nuit et toute une journée, sans désemparer!
Comme elle ne possède pour toute fortune qu'une rente de 18,000 livres sur le trésor royal, elle est bien vite au bout de ses ressources. Alors elle emprunte à droite, à gauche, mais comme elle ne peut rendre, toutes les bourses se ferment bientôt devant elle.
Ses enfants, tout en la blâmant, imitent son exemple; à Marly, dans une seule soirée Mme de Boisgelin gagne 2,500 louis; au Palais-Royal, le chevalier perd 200 louis dont il n'a pas le premier sol [37].
C'est une folie, une démence! Il n'est pas jusqu'à l'abbé Porquet qui ne soit atteint de la maladie régnante. On le voit perdre en quelques heures 250 louis au trente-et-quarante! «L'auriez vous cru capable de cette folie? écrit Mme de Lenoncourt indignée. Il faut que l'air de la maison soit bien contagieux. Le pauvre petit fou me fait pitié!»
Ce jeu effréné de la part de gens qui sont plus que besoigneux, entraîne les conséquences ordinaires, des scènes regrettables, des suspicions humiliantes. Un soir, à l'hôtel de Luxembourg, on joue au vingt-et-un. Mme de Boisgelin est assise à côté de son frère, le chevalier. Le banquier donne à la comtesse un certain valet de cœur, mais par une étrange fatalité, ce valet se retrouve parmi les cartes du chevalier et lui fait avoir 21. Par un hasard non moins fâcheux, Mme de Boisgelin a mis beaucoup d'argent sur les cartes de son frère et fort peu sur les siennes. Celui qui tient les cartes se récrie, proteste, tout le monde baisse les yeux, mais les inculpés nient avec indignation et il n'en est rien de plus [38]. Il est juste de dire qu'au dix-huitième siècle on considérait avec une rare indulgence les joueurs qui corrigeaient la fortune.
Le chevalier de Boufflers, dans le portrait qu'il a tracé de sa mère, n'a pas caché le penchant qu'elle éprouvait pour les jeux de hasard et combien ce goût lui a été funeste.
«On lui a reproché avec trop de raison, d'aimer le jeu. Elle y a souvent été malheureuse; mais on peut dire aussi que ses amis ne l'étaient pas moins, puisque dans les heures qu'elle y perdait, Mme de Boufflers était perdue pour eux. Au reste, dans les moments les plus critiques, au milieu des plus grands orages, des naufrages mêmes, dont le gros jeu menace tous ceux qui ne craignent pas assez de s'y embarquer... on ne l'a jamais vu déroger à cette noble égalité d'humeur, à cette franche liberté d'esprit qui faisait le fonds de son caractère et la base de son bonheur; jamais abattue, jamais enivrée, elle portait en elle-même le contrepoids de toutes les inégalités de la fortune [39].»
Ce portrait, écrit pour les besoins de la cause, est beaucoup trop flatteur. La vérité est que l'existence déraisonnable et surmenante que menait Mme de Boufflers était aussi désastreuse pour sa bourse que pour son humeur et pour sa santé; elle était horriblement changée et paraissait vieillie de vingt ans depuis la mort du roi de Pologne. Quand elle perdait, elle avait beau chercher à se dominer, elle ne pouvait s'empêcher d'être d'une humeur massacrante. Ses meilleurs amis déploraient une conduite si folle et peu à peu s'éloignaient d'elle.
Mme de Lenoncourt, profondément attristée, faisait à Panpan cette navrante description:
«Paris, 18 novembre.
«Mon Veau, je n'ai que des condoléances à vous faire. Notre pauvre amie détruit sa fortune et sa santé à plaisir. Je sais par ses enfants, qui en gémissent, qu'elle a joué à Fontainebleau nuit et jour, qu'elle a perdu prodigieusement, et je sais par Mme de Grammont qu'elle s'est querellée avec sa belle-sœur, qu'il y a entre elles tant d'aigreur que cela ne peut que mal finir. Mme de Grammont en est excédée. J'ai dit tout ce que j'ai pu pour excuser sa conduite en faveur des motifs, mais vous savez bien que l'humeur ne se supporte pas, et que c'est, de tous les défauts de la société, celui qui se pardonne le moins.
«Tout cela m'afflige jusqu'au fond de l'âme. Je vois cette malheureuse femme tout près de la caducité et de la pauvreté, sans existence, sans société, sans ressources. Le jeu est son unique plaisir et son unique occupation. Quelle malheureuse passion!»
Mme de Lenoncourt serait bien désireuse de rencontrer plus fréquemment cette amie, qu'au fond elle aime si tendrement, mais c'est là chose impossible: «Elle a deux maudites rosses qui la mènent partout où l'on joue, écrit-elle avec rage, mais bien peu chez moi.»
La marquise est d'autant plus désolée de ne pas voir plus souvent Mme de Boufflers, qu'elle-même a éprouvé bien des déceptions en s'installant à Paris et qu'elle avait compté sur son amie pour lui rendre la vie plus agréable.
D'abord, au point de vue matériel, elle s'est trouvée dans des conditions déplorables. Elle a naturellement peu d'argent à mettre à son loyer et elle a dû se loger dans un chenil, «une maison culbutée de la cave au grenier, de l'huile puante partout!» Ces odeurs horribles jointes au bruit de la rue la tuent. Aussi Paris lui paraît-il laid et désagréable, et elle a peine à «s'y rhabituer». Combien elle regrette son cher Lunéville où elle était si bien logée, où elle jouissait de tant de repos!
Certes, ses amis ont été charmants pour elle, elle les a retrouvés tels qu'elle les avait quittés; ils la comblent de marques d'affection, mais la vie de province avait bien plus de charme.
Elle écrit tristement à son cher Veau:
«Je fais des visites qui me fatiguent, je ne trouve que les gens que je ne désire pas; je fais des soupers tristes, ennuyeux et dont tout le monde se plaint. Je vois mes amis souvent pour Paris, peu pour moi qui les voyais tous les jours à Lunéville, enfin, mon cher Panpan, il faut que je sois très vieillie, car je sens que cette vie ne me convient plus.»
L'été est pire encore que l'hiver, s'il est possible: «On n'y a pour toute société que quelques ennuyeux qui ne savent que devenir, les rues sont empuantées, enfin Paris est un séjour odieux.»
A force de chercher, Mme de Lenoncourt finit par trouver dans un quartier éloigné un appartement grand, gai et commode. Malgré la distance qui l'éloigne encore davantage de ses amis, elle est ravie, car elle n'y entend d'autre bruit que le chant du coq.
Cependant Mme de Boufflers, loin de se calmer, continuait à mener la même vie agitée et troublante dont nous avons fait une rapide description. La visite du jeune roi de Danemark, en octobre 1768, fut un prétexte pour elle à de nouvelles folies. Ce roi de «marionnettes [40]», à peine débarqué à Paris, fut accablé de
fêtes de tous genres, bals, comédies, opéras-comiques, jeu, on ne lui laissait pas un instant de repos: «Nous ferons crever le petit Danois, écrit Mme du Deffant, il est impossible qu'il résiste à la vie qu'il mène.»
Mme de Boufflers était de toutes ces fêtes. La plus remarquable fut celle donnée à Chantilly par le prince de Condé, elle dura trois jours pleins, le lundi, le mardi, le mercredi.
«Le lundi, il y eut un opéra, un grand souper, un jeu et un bal; le mardi, une chasse, une comédie française, un souper, un jeu et un bal; le mercredi, un opéra, un feu d'artifice, un souper, un bal masqué pour lequel il y avait 2,000 billets distribués dans Paris et un jeu à tout casser.»
Mme de Boufflers n'eut garde de laisser échapper cette occasion de faire une folie; elle joua et perdit plus de mille louis.
Enfin le petit Danois reprit la route de ses États et la société élégante de Paris retrouva un peu de calme.
Cependant la vie que menait Mme de Boufflers ne lui réussissait pas précisément. En décembre 1768, elle tomba malade et fut pendant quelques jours dans un état fort alarmant; elle avait une fièvre considérable, crachait le sang et avait un point de côté; son médecin, très inquiet, ne cachait pas à la famille ses préoccupations. Mme de Lenoncourt ne quittait pas son amie et la soignait avec autant d'intelligence que de dévouement. Enfin, le mieux se déclara et l'on put regarder la marquise comme sauvée.
Pendant sa maladie elle avait eu souvent auprès d'elle sa sœur de Bassompierre, mais la vieille dame n'avait plus que le souffle et ne songeait qu'à jouer au trictrac, qui était devenu son unique passion. Mme de Lenoncourt mandait gaiement à Panpan:
«La marquise a chez elle Mme de Bassompierre dont l'ombre joue au trictrac du matin au soir. La dernière fois que j'ai vu cette apparition, je disais: cette pauvre femme va rendre le dernier soupir en jetant les dés; elle tombera dans le trictrac et ce sera son tombeau. Je suis sûre que voilà comment elle finira.»
Mme de Boufflers se rétablit donc, mais elle restait «maigre, brûlée, desséchée», elle toussait, avait de fréquents accès de fièvre; elle aurait eu besoin d'un grand régime; au lieu de s'y résigner, elle reprit sans perdre de temps son existence ordinaire. Avant tout elle prétendait ne pas se priver des soupers et des parties de jeu qui faisaient tout son bonheur.
Ses amis s'efforçaient en vain de lui faire entendre raison:
«Prêchez-lui le lait et les ménagements, écrivait Mme de Lenoncourt à Panpan; sa poitrine s'attaquera si elle n'y prend garde. Elle est comme une bouteille d'éther; un jour le verre cassera et tout s'évaporera.»
A peine Mme de Boufflers était-elle remise qu'elle éprouva de nouveaux ennuis. Depuis quelque temps déjà elle se plaignait de sa vue; bientôt le mal empira et un de ses yeux fut sérieusement compromis. Elle ne pouvait plus ni lire ni écrire, et cette privation l'affligeait beaucoup. Les remèdes ordonnés n'amenant aucune amélioration, elle fit appeler frère Côme, le célèbre chirurgien: il conseilla du baume de Tuthie, de l'eau de fenouille et par-dessus tout d'éviter les lumières. La marquise consentit volontiers à prendre les remèdes, mais quant à renoncer à sortir le soir, on ne put l'y décider: elle préférait, disait-elle, perdre son œil que de se priver de tout l'agrément de sa vie.
Ainsi fit-elle, et elle continua à veiller, à jouer, à se brûler les yeux aux lumières, enfin «à faire cent sottises». Elle garda son œil malade fort longtemps.
En voyant cet entêtement si déraisonnable, Mme de Lenoncourt se souvenait de l'étrange façon dont la marquise, quelques années auparavant, avait soigné un crachement de sang.
«Je me rappelle toujours un crachement de sang qu'elle eut à la Malgrange, un hiver bien froid et qu'elle nous soutenait que le seul remède était de mettre les pieds dans la neige. Elle y mettrait peut-être son œil, s'il y en avait. Mais il y a du jeu, des veilles, des bougies, et c'est pire que la neige. Je la prêcherai, mais ce sera pour le repos de ma conscience.»
Dans sa colère, Mme de Lenoncourt n'appelle plus son amie que «la mère Boufflers».
Panpan se désolait des nouvelles qu'il apprenait de sa chère marquise et il ne pouvait se défendre pour l'avenir de tristes pressentiments. Il les confiait à Mme de Lenoncourt qui lui répondait:
«Vous avez bien raison, elle ne sera point heureuse. Elle me paraît comme un malade qui cherche une situation commode dans son lit et qui ne la trouve jamais. Je loue Dieu de tout mon cœur de m'avoir donné une âme calme et paisible, c'est le dédommagement de tout ce qui me manque.»
En 1768, il fut question d'un mariage pour le marquis de Boufflers, et sa mère ainsi que son frère le chevalier s'agitèrent beaucoup à cette occasion. C'était une union très brillante au point de vue de la fortune, puisqu'il s'agissait de Mlle Helvétius, mais dès qu'on parla de ce projet à la jeune fille, elle ne voulut rien entendre, disant que M. de Boufflers était «pédant». En vain on voulut la raisonner, elle résista «comme un petit diable» et il fallut céder.
Les Boufflers, assez vexés, se retournèrent alors d'un autre côté et ils songèrent à une demoiselle de province, Mlle de Morfontaine, qui était également une riche héritière. Cette fois la jeune fille ne fit aucune opposition et le mariage fut décidé. Conformément aux usages du temps, les fiancés ne s'étaient jamais vus. C'est ce qui fait écrire à Mme de Lenoncourt ces lignes si pleines de sens et de vérité:
«Savez-vous que M. de Boufflers se marie dans les premiers jours de novembre. On m'a dit que sa femme était fort laide et boiteuse; cela serait fâcheux. Mais concevez-vous qu'il ne l'ait pas encore vue? Il ne s'en est seulement pas informé. Véritablement, on aime trop l'argent dans ce siècle. On ne considère que cela.»
Le mariage n'eut pas lieu à la date indiquée, il fut remis au mois de janvier, parce que Mlle de Morfontaine n'avait pas encore fait sa première communion! «Apparemment qu'entre sacrements c'est l'Eucharistie qui a le pas, écrit Mme de Lenoncourt; leur rang est réglé comme celui des ducs, et mieux, car cela n'a pas fait de dispute. Le mari supporte ce retard très patiemment; il n'a point encore vu sa prétendue femme, mais sur la parole de l'évêque de Metz, il la soutient jolie.»
Si Mme de Boufflers abandonne momentanément la Lorraine, on ne peut lui reprocher d'oublier son vieil ami. D'elle on ne peut pas dire: «Loin des yeux, loin du cœur.» Puisque les hasards de la vie la forcent à demeurer éloignée du cher Panpan, de son «cher Veau», comme elle l'appelle en plaisantant, elle se dédommage en lui narrant les nouvelles du jour et tous les menus incidents de sa vie.
Nous citerons un grand nombre des lettres écrites par la marquise, parce qu'elles ont le rare mérite de la montrer telle qu'elle est, au naturel, sans fard et sans art.
On trouve de tout dans cette correspondance, des nouvelles politiques, des tracasseries littéraires, des recettes de cuisine, des tendresses, des reproches, enfin dans leur diversité, c'est la vérité même. Elles sont écrites à la diable, sous l'inspiration du moment, sans aucune recherche et sans aucun souci de la postérité; mais Mme de Boufflers s'y peint tout entière et nous la retrouvons telle qu'elle s'est toujours montrée à nous, nous retrouvons, à chaque ligne, sa légèreté, sa finesse, son esprit, et nous pouvons dire aussi son cœur. Toutes ces réflexions, tristes ou gaies, ironiques ou sentimentales, qu'elle jette au hasard de la plume, feront mieux connaître notre héroïne que tous les discours du monde.
On verra dans les lettres que nous reproduisons, non seulement l'extrême degré d'intimité qui existait entre la marquise et Panpan, mais aussi l'affection durable et profonde qui les unissait l'un à l'autre.
Mme de Boisgelin n'est pas moins liée avec l'ancien lecteur du Roi; c'est souvent elle qui tient la plume pour sa mère, et le ton qu'elle emploie dénote la plus étrange camaraderie.
En septembre 1768, la Reine vient de mourir [41], le marquis de Boufflers va épouser Mlle de Morfontaine, M. d'Invaut est nommé contrôleur général, etc. Toutes ces nouvelles, Mme de Boufflers les annonce à son ami; elle lui parle aussi de ses yeux dont elle souffre, de sa bourse qui est vide, de la difficulté de la remplir et de la peine qu'elle éprouve à emprunter.
«Paris, 27 septembre 1768.
«Mon charmant cœur de Veau, soyez bien sûr que ma plus grande privation est de ne pouvoir pas vous écrire, car mon œil ne se guérit pas. J'ai pourtant fait d'abord ce que M. Grandjean m'a ordonné. Ensuite, voyant que j'étais plus mal, j'ai consulté le frère Côme, qui m'a dit de me servir du baume de Tuthie, ce qui ne me fait rien du tout.»
(De la main de Mme de Boisgelin.)
«Vous saurez, vieux gueux de Veau, que M. de Laverdy [42] est renvoyé et que M. d'Invaut, intendant de Picardie, a sa place, que c'est une joie générale et que moi, en particulier, j'en suis ravie, parce que le nouveau contrôleur général est fort de mes amis.
«Vous saurez aussi que le marquis de Boufflers épouse Mlle de Morfontaine le mois prochain et que si vous ne venez pas, le mariage ne sera pas consommé de sitôt.
«Comment pouvez-vous ignorer qu'Eaubonne est la demeure de M. de Saint-Lambert? Il n'est pas permis à quelqu'un qui se croit homme de lettres, de ne pas savoir cela.
«Chilly [43] a été assez agréable; on a joué Dupuis et Desronais fort bien. M. de Lucé s'y est distingué. Malgré cela tout le monde a regretté ce bon petit vieillard qui tousse, crache, se mouche et fait le goguenard.
«Voilà la réponse qu'on m'a dit de faire à tous les articles de votre lettre.
«Il y a bien longtemps que je vous en dois une plus longue à une lettre charmante, mais je sais d'où cela vient. Depuis quelque temps je suis un peu bête, et j'attends le retour de mon esprit pour vous remercier du plaisir que m'a fait cette lettre. En attendant je dois vous assurer, mon cher Veau, que je daigne sourire à la proposition que vous nous faites d'aller habiter votre Tempé [44] l'année prochaine, et que je vivrai tout à fait quand j'aurai le plaisir d'y être et de vous y voir.»
(De la main de Mme de Boufflers.)
«N'êtes-vous pas bien aise de l'aventure du Tressan? Je croyais vous l'apprendre la première, mais Mme de Lenoncourt, que j'ai vue hier, m'a dit qu'elle vous l'avait mandée.
«On a beaucoup d'espérance pour la maison du Roi. On est sûr que Mme Adélaïde a donné des ordres pour la continuation du pain et de la viande et qu'elle veut employer 9,000 francs par an, qu'elle a de reste, pour faire des pensions.
«On dit que la mort de la Reine n'a fait aucun changement à la Cour.
«Je travaille à vous faire avoir le Mercure, mais j'aurai bien de la peine, parce que bien des gens sont après [45].
«Je n'ai pas vu l'abbé Porquet trois minutes depuis mon arrivée, à cause de son procès criminel, mais je crains que bientôt, on ne vienne le chercher ici pour le pendre.
«Savez-vous, mon Veau, que dans ma profonde misère, je n'ai pu trouver que M. Latran qui ait voulu me prêter 50 louis.
«J'ai été à un nouveau spectacle qui se nomme le Wauxhall. C'est une chose charmante.
«Adieu, le gros cochon est plus gras et plus aimable que jamais.»
Cet étrange surnom, qui paraîtra probablement assez déplacé à nos lectrices, désigne tout simplement Mme de Boisgelin. Pour apprécier cette appellation en toute connaissance de cause, il faut se rendre compte que bien des mots, d'un usage constant au dix-huitième siècle, ont depuis complètement changé de valeur. Alors qu'aujourd'hui ils ne sont plus employés que dans le langage le plus vulgaire, autrefois on s'en servait couramment dans la meilleure société, et ils ne choquaient personne. Le mot en question et beaucoup d'autres que nous pourrions citer sont dans le même cas.
Mme de Boufflers, du moins elle le prétend, voudrait bien retourner en Lorraine, mais elle en est sans cesse empêchée par un obstacle ou par un autre; tantôt par la présence de son frère de Beauvau, tantôt par celle de son fils. Elle se console de l'éloignement en continuant à écrire fidèlement à Panpan et en le comblant de petits souvenirs qui lui prouvent son affection. Au moment du nouvel an, c'est lui qu'elle charge de ses modestes libéralités pour les quelques gens de service dont elle ne veut pas être oubliée; si elle ne donne pas davantage, «c'est qu'elle n'a rien ou à peu près».
Elle lui écrit le 9 janvier 1769:
«Paris, ce 9 janvier.
«Trouvez-vous joli que je reçoive tout à l'heure votre lettre du 1er? Voilà pourtant ce que font les précautions.
«Mais voilà M. de Lanière qui part et dans un vis-à-vis tout seul; cela fait venir l'eau à la bouche. Mais il y a toujours quelque chose qui s'oppose au bonheur. C'est l'arrivée du prince de Beauvau, d'un côté, et la présence du chevalier de Boufflers, de l'autre.
«Voilà toutes nos petites bêtises. Mon cher cœur verra bien que ce n'est que pour entretenir commerce.
«J'ai pensé que le trou-madame vous amuserait quelquefois. J'en voulais un joli, mais il n'y en a point de fait, et puis les occasions manquent.
«Voilà quatre pauvre louis, dont vous en remettrez un à Fustenai, pour M. Otenin. Il faut qu'elle paie son pain et ce qu'il y aura de plus pressé pour lui. C'est Thérèse qui l'a gagné au vingt-et-un, et qui a imaginé de le donner à son père en le faisant passer par Fustenai pour qu'il n'en fasse pas un mauvais usage. Il y en a deux pour les étrennes de Fustenai, à qui vous souhaiterez la bonne année de ma part. Vous voudrez bien ensuite partager l'autre entre Marianne et Parisot. Cela est infime, mais c'est que je n'en avais pas un de plus quand M. de Lanière est parti.
«On dit des merveilles de l'abbé Terray, et même qu'il paiera [46].
«Le trictrac va fort bien, mais je joue peu. Depuis Mme du Deffant je vois jouer au trente et quarante sans aucune tentation. Enfin, je ne joue qu'au vingt-et-un et très modérément, et aux six livres au trictrac.
«Ce Latran, qui est bien plus au fait des banqueroutes que moi, vous les mande sans doute. Je sais seulement celle du trésorier de M. le prince de Conti; cela l'empêchera de donner à souper les lundi, et, par conséquent plus de Pharaon, ce qui ne me fait rien du tout.
«Il est bien sûr, mon Veau, que je ne passe pas un jour sans penser à vous et sans avoir le projet de vous le dire.
«Il faut que Fustenai fasse faire quatre paires de manchettes de mousseline brodée pour des laquais, qui soient très honnêtes, parce que ceux de Paris les portent plus hautes que ceux de Lorraine.
«Adieu, amour, nous vous aimons tous et nous vous souhaitons tous toutes les années comme la fin de l'autre.»
Il est vraiment bien singulier que Mme de Boufflers et Mme de Lenoncourt aient éprouvé pour Panpan un si vif attachement et on a peine à se l'expliquer. Toutes deux l'aiment profondément et le lui prouvent de mille manières. Plus tard nous verrons Mme Durival s'éprendre également pour le Veau d'une véritable passion. Toutes ces dames raffolent de lui et ne peuvent s'en passer. C'est une joie sans pareille quand, à force de sollicitations, il consent à venir passer quelques jours chez l'une ou l'autre de ses amies. Quel attrait, quel charme pouvait donc avoir ce vieux Panpan pour enchaîner ainsi les cœurs?
Ce n'était pas sa beauté plastique, car la nature l'avait peu favorisé sous ce rapport. Ce n'était pas davantage la chaleur de son tempérament, car il était coutumier, nous le savons, de ces défaillances intempestives qui rendaient sa conversation si décevante dans les meilleurs moments. Était-ce son esprit? Il devait en avoir, mais en même temps, il était tatillon, maniaque, et avec l'âge, il devint égoïste, exigeant, insupportable. Quoi qu'il en soit et bien qu'il eût, à notre sens, peu de qualités pour leur plaire, Panpan était adoré des dames, et c'est un fait que nous devons constater.
Mme de Boufflers, Mme de Lenoncourt, Panpan, ont la douce habitude de s'offrir des étrennes, mais naturellement les cadeaux sont modestes et en rapport avec leurs situations de fortune; des jeux, des plumes, du papier, des macarons, des dattes, des confitures de mirabelles, de coetches, des objets d'ameublement, etc. Le 1er janvier 1769, Mme de Lenoncourt, pour être sûre de mieux lui complaire, demande à Panpan ce qu'il désire:
«Ne manque-t-il rien à votre ménage? lui écrit-elle plaisamment. N'avez-vous pas besoin de quelques pots cassés et de quelques vieux paravents déchirés? Vous savez bien que Mme de Boufflers et moi, nous sommes toujours prêtes à vous faire de ces sortes de présents.»
Ce n'est pas seulement à l'époque des étrennes que nos amis échangent de petits cadeaux. Chaque fois qu'il en trouve l'occasion, le Veau fait preuve vis-à-vis de ses amies d'aimables attentions. Elles ne sont pas toujours couronnées de succès. En juin 1769, il adresse à Mme de Lenoncourt une caisse d'objets divers, mais, hélas! dans quel état arrive-t-elle?
«J'ai ouvert votre caisse avec empressement, écrit la marquise; savez-vous ce que j'ai trouvé, mon Veau? Tous les pots cassés, les écailles, les confitures, la paille, le papier, tout cela pêle-mêle. Je n'ai jamais vu un tel gâchis! Rien n'est sauvé. Cela s'appelle une vraie déconfiture.»
Comme consolation, il a fallu payer 8 francs de port, ce qui est monstrueux!
Cependant Panpan souhaiterait posséder le portrait de son amie pour le placer dans sa galerie au milieu de tous ceux qui lui sont chers. Il a même déjà composé un quatrain qui sera gravé au-dessous de la chère image. Mme de Lenoncourt ne demande pas mieux que de satisfaire un désir si légitime, mais à qui s'adresser? comment doit-elle s'habiller? Le comte de Cucé s'est fait peindre dernièrement, il a été très satisfait; elle va lui demander le nom de l'artiste, et si cela ne coûte pas «des trésors», elle le fera venir; tant pis si elle se ruine; après tout, elle «ne veut pas donner à son Veau une enseigne à bière!»
Pour mettre le comble à tous ses ennuis, la pauvre Mme de Lenoncourt «jouit» en effet d'une détestable santé. Elle se plaint sans cesse: tantôt elle a «un clou au derrière» qui la fait cruellement souffrir; tantôt, ce qui est plus grave et plus pénible, elle a des maux de tête horriblement douloureux, tantôt des rhumatismes, des vapeurs, etc., etc. Elle a voulu consulter Tronchin, qui fait courir tout Paris, mais on ne peut l'aborder. «Personne ne peut en obtenir une visite.»
L'éloignement de son ami Panpan pèse beaucoup à Mme de Lenoncourt:
«S'il n'y avait pas un qu'en dira-t-on au monde, j'irais m'établir chez vous», lui écrit-elle, et elle ajoute tristement: «Il y a huit ans que je désire d'être une bonne bourgeoise, d'aller acheter mes herbes au marché, de courir les rues à pied sans que personne y puisse trouver à redire. Il est ennuyeux d'avoir les assujettissements de son état et de n'en avoir pas l'aisance.»
Elle voudrait au moins habiter la même ville que lui: «Il me semble qu'un jour je vous serai bonne à quelque chose, lui dit-elle gracieusement. Je ne crois pas que je sois assez heureuse pour vous rendre des services, mais de petites attentions qui font tant de plaisir dans la vieillesse et qui ne pourront être aperçues que par moi, parce que certainement je suis celle qui t'aime le mieux. Il y a à parier que je mourrai avant toi, si je continue à me corrompre le sang, mais tu radoteras avant moi, et je te promets que tu ne seras ni battu ni contrarié.»
Cette idée d'un pseudo-mariage hantait Mme de Lenoncourt, et elle y revient sans cesse dans ses lettres. Mais Panpan veut rester fidèle à l'infidèle Mme de Boufflers, et il entend ne rien faire qui puisse lui déplaire. Or, une union morganatique avec Mme de Lenoncourt blesserait la marquise. Il se dérobe donc sans dissimuler les motifs; sa correspondante lui répond gaiement:
«Oui, mon Veau, je vous conviens mieux que Mme de Boufflers; elle est plus aimable que moi, mais je le suis assez pour vous. C'est une joueuse, elle vous ruinera; vos enfants n'auront pas de chausses. Vous n'êtes plus en âge de faire un mariage d'inclination; c'est un mariage de raison qu'il vous faut et je suis encore un coup votre vrai ballot. Pourquoi n'irais-je pas vous chercher à Lunéville? Quand nos feux seront légitimes, quel en serait l'inconvénient. Mais enfin, vous ne voulez pas de moi, il n'en faut plus parler. J'en suis aussi humiliée qu'affligée.»
En juin 1769 Panpan cède aux instances de ses amies, et il se décide à venir faire un voyage à Paris.
C'est dans un dîner chez Mme de Boufflers avec Helvétius et Saint-Lambert que Mme de Lenoncourt apprend cette bonne nouvelle: tout le monde s'en réjouit.
Quand le Veau arrive, ses amis lui font fête à l'envi; Mme de Boufflers, Mme de Lenoncourt, l'abbé Porquet deviennent ses gardes du corps et ne le quittent guère. Il est entraîné dans un tourbillon de plaisirs, de spectacles, de soupers, il ne sait auquel entendre, il n'a plus le temps de respirer; enfin on le surmène de telle façon qu'il finit par demander grâce! et supplier qu'on le laisse retourner dans sa chère Lorraine, où, là au moins, il mène la vie calme et paisible qui convient à son âge et à ses goûts.
Au mois de juillet il se retrouve à Lunéville, mais on dirait que tous les malheurs ont fondu sur lui pendant son absence. Il comptait louer son jardin, le locataire s'est éclipsé; ses roses sont fanées, ses fraisiers n'ont pas réussi. Peut-on imaginer plus cruels désastres? Mme de Lenoncourt, à laquelle il conte ses infortunes en termes pathétiques, le raille fort spirituellement:
«Toutes vos situations sont terribles, mon cher ami; vous quittez la vie cruelle et pénible de Paris, vous retrouvez à Lunéville les plus cuisantes peines, ni roses, ni fraises! cela est bien triste. Ajoutez à cela l'incertitude si on louera son jardin. Ces raisons sont, je crois, assez bonnes pour faire de vos lettres des espèces d'élégies. Il n'y manque que la rime, mon cher ami; avec la facilité que vous avez à faire des vers, je vous conseille de ne plus écrire en prose, car vous feriez des choses charmantes, dans le triste il est vrai.
«Dieu vous préservera de la goutte; elle ferait cependant une grande diversion à vos chagrins.»
Mme de Boufflers ne se bornait pas à envoyer à Panpan de fréquentes nouvelles; sa sollicitude pour son vieil ami était incessante. Elle le savait dans une situation de fortune fort étroite, elle savait qu'il s'inquiétait de l'avenir et qu'il redoutait par-dessus tout la misère menaçante. Sur son conseil, elle l'engagea à adresser au Roi un placet pour obtenir une pension. Panpan obéit avec empressement et dans son zèle il adressa aussi des suppliques à la Reine, à Mesdames, au duc de Choiseul. Grâce à l'intimité du chevalier avec le duc et aux instances de la marquise, Panpan finit par obtenir à sa grande joie une pension de 500 livres. Choiseul fit plus encore, il envoya au protégé de Mme de Boufflers une tabatière avec son portrait.