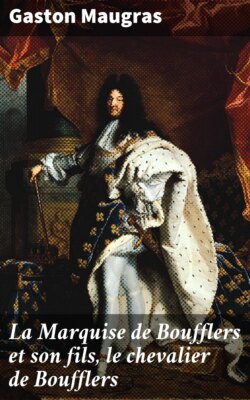Читать книгу La Marquise de Boufflers et son fils, le chevalier de Boufflers - Gaston Maugras - Страница 8
CHAPITRE III
1768-1770
ОглавлениеSéjour de Mme de Boufflers à Paris.—Ses relations: la maréchale de Mirepoix, la maréchale de Luxembourg, la comtesse de Boufflers-Rouvrel, la vicomtesse de Cambis, la comtesse de Boisgelin, Saint-Lambert, le prince de Bauffremont, Mme du Deffant, etc.—Évolution de la société.
Bien que depuis sa jeunesse Mme de Boufflers n'eût jamais fait à Paris de séjours prolongés, elle y était venue si souvent, soit avec le roi Stanislas, soit seule pour ses affaires ou les devoirs de sa charge, qu'elle y était presque aussi connue qu'en Lorraine, et qu'elle se trouvait aussi à l'aise à Versailles qu'à la cour de Lunéville. N'y retrouvait-elle pas, du reste, la majeure partie de sa famille, son frère, le prince de Beauvau; ses sœurs, la maréchale de Mirepoix, Mmes de Bassompierre, de Montrevel; ses nièces de Cambis, de Caraman; ses neveux le prince de Chimay, le prince d'Hénin, qu'on appelait aussi le nain des princes, à cause de sa taille; ses cousines, la maréchale de Luxembourg et la comtesse de Boufflers-Rouvrel, etc., etc.
Nous avons déjà eu l'occasion de citer ces différents personnages, mais ils vont maintenant intervenir si fréquemment dans notre récit, ils vont se trouver si intimement liés à la vie de Mme de Boufflers, que, pour l'édification du lecteur, il est nécessaire de tracer des principaux d'entre eux un léger crayon.
Nous connaissons déjà M. et Mme de Beauvau.
La sœur de Mme de Boufflers, la maréchale de Mirepoix, avait été charmante dans sa jeunesse et elle était alors aussi renommée par les grâces de son esprit que par le charme de sa physionomie. C'était la personne la plus naturellement aimable et la plus distinguée; elle était douce, modeste, facile, serviable, «éloignée de toute intrigue et du commerce le plus sûr».
En dépit des ans, son esprit était resté toujours jeune: «elle avait une grâce infinie et un ton parfait, une politesse aisée et une humeur égale». «Elle avait cet esprit enchanteur, dit le prince de Ligne, qui fournit de quoi plaire à chacun. Vous auriez juré qu'elle n'avait pensé qu'à vous toute sa vie. Où retrouvera-t-on jamais une société pareille?»
«Il faut vivre avec elle pour savoir tout ce qu'elle vaut, écrit Mme du Deffant, il n'y a que les occasions qui font connaître combien elle a d'esprit, de jugement et de goût.»
Certes, Mme de Mirepoix était la femme du monde agréable par excellence, mais, comme le disait Walpole, il ne fallait pas qu'il y eût un jeu de cartes dans la chambre. Le jeu était alors non seulement un usage, mais une obligation absolue dans la société, et sa place dans l'ordonnance de la vie était marquée comme celle des repas. Mme de Mirepoix en avait la passion, mais une passion absolument désordonnée; «elle aurait fait dévorer le royaume par les banquiers du passe-dix et du vingt-et-un.» Cette passion, malheureuse en général, la réduisait souvent aux expédients, et elle trouvait alors fort naturel de faire payer ses dettes par le Roi, procédé commode assurément, mais qui devait l'entraîner par la suite à des compromis de conscience bien regrettables.
Par un phénomène assez singulier, l'esprit de la maréchale rajeunissait avec les années. C'est ce qu'observait malicieusement Mme du Deffant quand elle écrivait en 1767: «Sa figure suit la marche ordinaire et elle atteindra soixante ans au mois d'avril prochain, mais son esprit rétrograde et aujourd'hui il n'a guère plus de quinze ans.»
Nous ne parlerons ni de Mme de Montrevel, ni de Mme de Bassompierre, qui n'ont joué dans la vie de leur sœur qu'un rôle très effacé [25].
En 1767, la maréchale de Luxembourg, cousine de notre héroïne, ne ressemblait guère à cette duchesse de Boufflers que nous avons vue en 1743 faire si bon accueil à sa jeune parente [26]. Au physique comme au moral,
la transformation avait été si complète qu'on ne pouvait s'imaginer avoir affaire à la même personne.
Après avoir mené pendant sa jeunesse une vie des plus légères, la maréchale, quand elle se vit obligée de renoncer à la galanterie, résolut de changer de conduite et de viser à la considération.
De l'esprit naturel, un goût sûr, une longue expérience de la Cour et du monde lui donnèrent la situation qu'elle ambitionnait, et elle s'établit bientôt arbitre souveraine des bienséances et du bon ton.
Ce pouvoir incontesté justifiait ce joli mot du prince de Ligne: à une dame qui lui demandait: «De qui dépendent les réputations?» il répondait: «Presque toujours des gens qui n'en ont pas.»
Elle-même avait complètement oublié ses erreurs passées et le monde avait imité son exemple. «Tel est ce pays-ci, dit Besenval durement, pourvu qu'on soit opulent et qu'on porte un beau nom, tout s'oublie, mais même on peut jouir d'une vieillesse considérée après la jeunesse la plus méprisable.»
Walpole faisait une plaisante allusion aux diverses transformations de la maréchale, quand il écrivait: «Elle a été fort belle, fort galante et fort méchante; sa beauté s'en est allée, ses amants aussi, et elle croit à présent que c'est le diable qui va venir. Cet affaissement moral l'a adoucie jusqu'à la rendre agréable, car elle est spirituelle et bien élevée.»
Son extérieur n'avait rien d'imposant. On était d'abord un peu surpris en voyant une petite bonne femme en robe de taffetas brun, avec le bonnet et les manchettes de gaze unie, à grand ourlet, sans bijoux, mais elle avait un visage si noble et si régulier, une attitude si digne et une si parfaite amabilité qu'on l'écoutait avec un plaisir inexprimable.
La maréchale aimait beaucoup sa cousine de Boufflers, et elle reportait même sur Mme de Boisgelin et sur le chevalier une partie de l'affection qu'elle éprouvait pour la mère. Elle les traitait l'un et l'autre avec autant de tendresse que s'ils avaient été ses propres enfants.
La marquise allait encore retrouver à Paris une cousine qui portait le même nom qu'elle et dont la destinée avait avec la sienne une singulière analogie. La comtesse de Boufflers-Rouvrel, qui avait été dame d'honneur de la duchesse d'Orléans, entretenait avec le prince de Conti une liaison avérée, publique et qui lui avait valu le surnom de l'Idole du Temple. On l'appela aussi plus tard la Minerve savante, quand la passion de l'esprit succéda chez elle aux passions d'un âge plus tendre.
C'était une des femmes les plus aimables de la société, bien qu'on lui reprochât souvent de manquer de sincérité; sa conversation était amusante, remplie d'agréments et de vivacité. Walpole, qui l'a bien connue, a laissé d'elle ce croquis: «Il y a en elle deux femmes, celle d'en haut et celle d'en bas. Je n'ai pas besoin de vous dire que celle d'en bas est galante. Celle d'en haut est fort sensée, elle possède une éloquence mesurée qui est juste et qui plaît; mais tout cela est gâté par une véritable rage d'applaudissements.»
Des goûts communs, une complète absence de scrupules, la même tournure d'esprit avaient créé entre l'Idole du Temple et la marquise de Boufflers une intimité très grande. Les deux cousines se plaisaient extrêmement et se quittaient le moins possible.
Les nièces de Mme de Boufflers, Mmes de Cambis et de Caraman, habitaient également Paris, et leur tante les voyait sans cesse. Mais elle affectionnait particulièrement Mme de Cambis dont l'esprit lui plaisait davantage. Une taille élégante, de la grâce, beaucoup d'art et de coquetterie en faisaient une femme agréable, mais elle avait souvent de l'humeur et de l'inégalité. Elle passait pour fort galante et méritait sa réputation, sans que sa situation dans le monde en fût le moindrement diminué: «Cette Cambis me plaît, écrivait Mme du Deffant, elle a un caractère à la vérité froid et sec, mais elle a du tact, du discernement, de la vérité, de la fierté. J'ai un certain désir de lui plaire qui m'anime. Ce ne sera jamais une amie, mais je la trouve piquante.»
Mme de Boisgelin avait suivi sa mère dans la capitale. Le mariage de la jeune femme, nous l'avons déjà fait entrevoir, n'avait pas mieux tourné que la grande majorité des unions de l'époque et elle vivait peu avec son mari; par suite elle s'était beaucoup rapprochée de sa mère, qu'elle accompagnait presque toujours dans ses déplacements. Lauzun a porté sur Mme de Boisgelin ce jugement plutôt sévère: «C'était un monstre de laideur, mais assez aimable, et aussi galante que si elle eût été jolie.» La vérité est qu'elle n'avait pas une figure régulière, mais elle était grande, fort bien faite, et elle avait beaucoup d'esprit. Quant aux mœurs, tout ce qu'on peut en dire, c'est qu'elle ne voulait pas se singulariser, et qu'elle vivait comme la plupart des femmes de son monde et de son temps.
La liste des plus intimes amis de Mme de Boufflers ne serait pas complète si nous ne citions quelques-uns de ceux avec qui elle vivait en Lorraine et qui l'avaient suivie ou précédée dans la capitale, la marquise de Lenoncourt, l'abbé Porquet, le chevalier de Listenay, etc. Des deux premiers nous n'avons rien à dire; à peine arrivée à Paris, la marquise reprit avec eux, nous le verrons bientôt, ses habitudes d'intimité presque journalière. Quant au chevalier, qui, par la mort de son frère, allait prendre le titre de prince de Bauffremont, nous allons le voir devenir peu à peu un des plus fervents adorateurs de Mme de Boufflers et, à ce titre, nous en devons parler avec quelques détails.
C'était un homme d'une véritable distinction, mais calme, froid et un peu indifférent.
«Je le trouve un bon homme, écrit Mme du Deffant, doux, facile, complaisant; en fait d'esprit il a à peu près le nécessaire, sans sel, sans sève, sans chaleur, un certain son de voix ennuyeux; quand il ouvre la bouche, on croit qu'il bâille et qu'il va faire bâiller; on est agréablement surpris que ce qu'il dit n'est ni sot, ni long, ni bête; et vu le temps qui court, on conclut qu'il est assez aimable [27].»
Un an plus tard, quand elle le connaît mieux, elle est beaucoup plus enthousiaste:
«Je trouve que son âme est le chef-d'œuvre de la nature: c'est son enfant favori, son prédestiné!»
«Ce que vous dites du chevalier est charmant et de toute vérité, répond Mme de Choiseul; oui, il est bien l'enfant gâté de la nature, mais comme il ne sait pas qu'il est gâté, il n'est point fat, il jouit de tous ses dons en s'y abandonnant seulement, et c'est pour cela qu'il est si aimable [28].»
Et les deux dames, dans leur enthousiasme, baptisent Bauffremont «le prince Incomparable», nom qui lui restera et qu'elles lui appliqueront à l'avenir dans leur correspondance.
Mme de Boufflers avait encore retrouvé dans la capitale un vieil ami de Lorraine que des liens fort tendres avaient un instant enchaîné à son char, le poète Saint-Lambert. Entre eux l'amour avait duré ce que durent les roses, mais ils avaient trop d'esprit pour se croire obligés de se détester par la suite, et une solide amitié avait succédé aux sentiments anciens. Ils se revirent avec un plaisir infini.
Depuis qu'il s'était éloigné de Lunéville après sa tragique aventure avec Mme du Chatelet, Saint-Lambert avait eu une étrange fortune.
Après avoir fait la guerre de Sept ans sous les ordres du maréchal de Contades et conquis plus de rhumatismes que de lauriers, il avait quitté le service avec le grade de colonel et s'était entièrement consacré à la littérature.
Dans le désir d'étendre sa réputation et de figurer sur un théâtre plus digne de ses mérites, l'ancien coryphée de la cour de Lorraine s'était établi définitivement à Paris. Grâce à son intime amitié avec le prince de Beauvau, amitié qui dura plus de cinquante ans sans le moindre nuage, il fut accueilli dans les salons aristocratiques et il devint en peu de temps fort à la mode; son aventure avec Mme du Chatelet n'était pas étrangère à l'engouement qu'il inspirait. Il crut devoir à la société qui l'accueillait si aimablement de prendre un titre qui lui manquait. Né Lambert devenu de Saint-Lambert de par la volonté paternelle, il n'hésita pas, de par sa propre volonté, à s'attribuer le titre de marquis. Il n'y avait aucun droit, on le lui donna par complaisance et il finit par y croire lui-même très sincèrement. Cela ne l'empêchait nullement de se proclamer philosophe et de faire parade d'opinions très avancées, voire même nettement anticléricales et républicaines.
Les années n'avaient pas sensiblement modifié son caractère; il était resté tel que nous l'avons connu, froid et prétentieux. «C'était le meilleur des amis, dit Mme Suard, mais il avait pour tout ce qui lui était indifférent une froideur que l'on pouvait souvent confondre avec le dédain.» On l'estimait, mais on ne l'aimait pas.
Il ne manquait pas cependant d'un certain mérite et sans que sa conversation fût piquante, «dans un entretien philosophique et littéraire, personne ne causait avec une raison plus saine ni avec un goût plus exquis [29]».
Tous les amis du prince de Beauvau étaient naturellement devenus ceux du poète; il fréquentait le meilleur monde, la maréchale de Luxembourg, la marquise du Deffant, la duchesse de Choiseul, la duchesse de Grammont, etc., etc.
Saint-Lambert n'était pas seulement intime avec la noblesse. Admis dans le salon du baron d'Holbach, il se lia très vite avec tous les encyclopédistes: Duclos, d'Alembert, Grimm, J.-J. Rousseau, Diderot, etc., etc., devinrent ses amis de chaque jour. On le rencontrait également dans les salons de Mlle Quinault, de Mme Geoffrin, de Mme Helvétius, etc., et il y retrouvait tous les hommes de lettres marquants de l'époque.
Ce fut dans une de ces réunions intimes chez Mlle Quinault que Mme d'Épinay le vit pour la première fois. Elle lui trouva «infiniment d'esprit et autant de goût que de délicatesse et de force dans les idées». Peu de jours après elle avait la fâcheuse inspiration de présenter son nouvel ami à Mme d'Houdetot, sa belle-sœur.
Mme d'Houdetot avait alors environ vingt-sept ans. Elle avait été mariée à dix-huit ans avec le comte d'Houdetot, homme de peu de valeur, et qui n'éprouva jamais pour elle qu'une simple amitié; il eut d'ailleurs le bon goût de ne pas lui demander plus qu'il ne lui donnait.
Mme d'Houdetot n'était pas jolie, mais elle avait la grâce de l'esprit; elle abondait en saillies charmantes et spontanées; et puis elle possédait «une si jolie âme, si franche, si honnête, si sensible, si personnelle!»
Diderot, que la vivacité de son esprit amusait, écrivait un jour à Mlle Volant:
«Hier, j'étais à souper à côté de Mme d'Houdetot qui disait: «Je me mariai pour aller dans le monde et voir le bal, l'Opéra et la comédie; et je n'allai point dans le monde, et je ne vis rien, et j'en fus pour mes frais!» Ces frais firent rire, comme vous pensez bien.»
Et comme la jeune femme s'animait de la gaieté de son voisin qui buvait ferme, elle lui disait en riant: «C'est mon voisin qui boit le vin et c'est moi qui m'enivre.»
Saint-Lambert fut bientôt sous le charme de cette imagination si vive, de cette âme si douce, et il s'éprit pour Mme d'Houdetot d'une passion qui dura jusqu'à sa mort.
La marquise de Boufflers n'était pas seulement liée avec sa famille; par sa naissance, par ses relations, elle se trouvait tout naturellement amenée à vivre dans un continuel commerce avec la société la plus agréable. On la rencontrait fréquemment chez Mme du Deffant, cette vieille aveugle «débauchée d'esprit», qui, au début de sa vie, avait si largement partagé les erreurs du siècle. Elle avait été la maîtresse du Régent, d'un certain Fargis dont on disait «qu'il avait tant volé qu'il en avait perdu une aile», du président Hénault et de beaucoup d'autres vraisemblablement. Puis quand elle avait perdu la vue, elle s'était rangée et avait cherché un refuge au couvent de Saint-Joseph, où elle recevait l'élite de la société spirituelle et lettrée.
Tout le petit groupe dont nous venons d'énumérer les principaux personnages forme une société intime qui ne se quitte guère. Chaque jour on se retrouve au concert, à l'Opéra, à la comédie, au jeu, à souper; c'est une fréquentation continuelle et charmante.
On rencontre Mme de Boufflers tantôt à l'hôtel de Beauvau, où le prince accueille en grand seigneur les gens de lettres et les philosophes; tantôt au Temple, où le prince de Conti donne des soupers de cent cinquante couverts, des concerts, des divertissements où figurent les premiers artistes de la capitale; tantôt chez le duc de Choiseul, chez la maréchale de Luxembourg, chez le duc de Nivernais, ce grand seigneur homme de lettres que Mme du Deffant appelait si plaisamment «le mâle de l'Idole du Temple [30]», etc., etc.
Mme de Boufflers, de par son nom et ses fonctions, appartient aussi à la Cour et on la voit sans cesse à Versailles, à Fontainebleau, à Compiègne, à Marly, chez tous les princes, à Chantilly, à Villers-Cotterets, etc.
Pendant l'été, l'existence de la marquise n'est pas moins agréable que durant l'hiver; elle est invitée dans tous les châteaux des environs; elle villégiature à droite, à gauche, partout et sans cesse elle retrouve sa famille et ses amies.
Le prince de Conti la reçoit dans son splendide domaine de l'Isle-Adam; il y vit entouré d'une société aussi galante que distinguée. On fait de la musique, on joue la comédie, on chasse. La maréchale de Luxembourg, Mme de Cambis, qui sont les plus intimes amies de l'Idole du Temple, y font d'interminables séjours; elles y entraînent Mme de Boufflers qui devient une des assidues de la maison.
La marquise n'est pas moins recherchée à Saint-Maur, chez le duc de Nivernais; à Roissy, chez les Caraman; à Auteuil, chez Mme Helvétius; à Saint-Ouen, chez Mme Necker; à Ruel, chez Mme d'Aiguillon; au Raincy, chez le duc d'Orléans; etc.
Mais c'est surtout à Montmorency, chez Mme de Luxembourg, que Mme de Boufflers aime à faire de longs séjours; là, elle se sent chez elle, là elle est heureuse, car elle y retrouve sa chère maréchale et tous les amis dont la société lui est la plus précieuse.
De tous les environs de Paris la vallée de Montmorency était assurément l'endroit le plus fréquenté et le plus apprécié de la société parisienne pendant tout le dix-huitième siècle. Ses collines verdoyantes, si riches en fleurs et en fruits de toutes sortes, ses bois séculaires, ses eaux superbes, lui avaient valu une réputation méritée. La proximité de la capitale, qui permettait à la fois de goûter les plaisirs de la campagne sans rien perdre de ceux de Paris, contribuait encore à augmenter la vogue de ce riant séjour.
A Montmorency, à Soisy, à Groslay, à Margency, à Sannois, à Andilly, à Eaubonne, à Saint-Brice, partout s'élevaient d'élégantes maisons de campagne, entourées de parcs superbes, la plupart avec une vue ravissante sur la vallée.
Le château de Montmorency appartenait au maréchal de Luxembourg, le château de Saint-Leu au duc d'Orléans [31], le château de la Chasse au prince de Condé. Les châteaux de Groslay, de Saint-Gratien, de Saint-Prix, de la Briche [32], d'Épinay, de Franconville, etc., etc., étaient tous habités par des familles de l'aristocratie ou de la haute finance.
Dès l'approche des beaux jours, les heureux propriétaires de ces belles demeures venaient y chercher le calme et le repos, et goûter au sein d'une société choisie les joies de la nature.
La vallée de Montmorency ne séduisait pas seulement les grands seigneurs; les gens de lettres paraissaient avoir fait de ce séjour leur asile préféré. A partir de 1750, Mme d'Épinay attire dans son château de La Chevrette tous les encyclopédistes [33], et son salon champêtre devient le rendez-vous d'une société de beaux esprits, d'hommes aimables et de femmes spirituelles. Les principaux habitués sont d'Holbach, Diderot, Marmontel, d'Alembert, J.-J. Rousseau, Galiani, Grimm, Saint-Lambert, etc.
La belle-sœur de Mme d'Épinay, Mme d'Houdetot, a loué, elle aussi, une habitation dans la vallée; elle s'est installée dans un joli petit village nommé Eaubonne, et elle y passe presque tout l'été.
Saint-Lambert, qui ne voulait pas quitter la femme qu'il aimait, ou du moins aussi peu que possible, acheta à son tour une propriété à Franconville, à quelques minutes de Sannois.
Nous verrons bientôt que, par un singulier hasard, Mme de Boufflers allait bientôt retrouver dans la charmante vallée tous ses meilleurs amis de Lorraine.
Son séjour dans la capitale ou dans les châteaux des environs offrait d'autant plus d'intérêt à Mme de Boufflers qu'elle était arrivée, comme nous dirions aujourd'hui, au moment psychologique. L'évolution dans les idées et dans les mœurs, qui se préparait depuis une vingtaine d'années, commençait à se manifester au dehors. Avec sa rare intelligence, avec son esprit ouvert et perspicace, la marquise de Boufflers ne pouvait manquer de s'en apercevoir, et de se passionner elle aussi pour ce mouvement des idées.
La société française se transformait de fond en comble et l'on voyait déjà poindre l'aurore des temps nouveaux. L'influence de la Cour allait s'amoindrissant et la tutelle qu'elle exerçait sur les esprits et les idées diminuait de jour en jour.
«On recherchait avec empressement, dit Ségur, toutes les productions nouvelles des brillants esprits qui faisaient alors l'ornement de la France; elles donnaient un aliment perpétuel à ces conversations où presque tous les jugements semblaient dictés par le bon goût. On y discutait avec douceur, on n'y disputait presque jamais, et comme un tact fin y rendait savant dans l'art de plaire, on y évitait l'ennui en ne s'appesantissant sur rien.
«Les idées philosophiques émises d'abord timidement gagnaient de jour en jour du terrain. L'habitude de la discussion qu'elles avaient fait naître s'appliquaient non seulement aux productions de l'esprit, mais aux actes du pouvoir, aux délibérations du Parlement, aux croyances religieuses, etc.»
A partir de la seconde moitié du dix-huitième siècle, on voit se former ces salons où toutes les classes se confondent, où les philosophes, les hommes de lettres, les financiers marchent de pair avec les courtisans, où l'on s'entretient de toutes choses, où l'on émet audacieusement les idées les plus subversives, où on les discute avec passion, où l'on fait table rase de toute l'organisation sociale, où l'on détruit tout ce qui existe, religion, morale, gouvernement, sans se soucier des conséquences.
Il semble qu'un véritable vent de folie ait poussé toute cette société à sa perte et à se détruire elle-même de ses propres mains.
Que les philosophes qui poursuivaient un idéal, qui voulaient une rénovation sociale, aient marché de l'avant envers et contre tous, cela se comprend et s'explique. Mais la noblesse, les gens de Cour, ceux qui profitaient et abusaient le plus largement de l'ordre de choses établi, par quelle aberration d'esprit, par quelle inconcevable aveuglement se montraient-ils aussi ardents à détruire que les philosophes?
Les femmes elles-mêmes ne dédaignaient pas de se mêler à ce mouvement des esprits; elles s'occupaient avec enthousiasme de philosophie et d'économie politique, et l'on entendait les plus jolies bouches prononcer des dissertations passionnées sur la sortie des blés et les droits prohibitifs. Sur les cheminées des salons comme sur les toilettes des boudoirs on ne trouvait que des ouvrages philosophiques ou les ennuyeuses élucubrations du marquis de Mirabeau, de l'abbé Baudeau et autres pédants économistes.
Mme de Boufflers partageait l'étrange aveuglement des gens de son monde; elle n'était pas moins ardente que ses amies à discuter les idées du jour, et à en adopter le plus grand nombre.