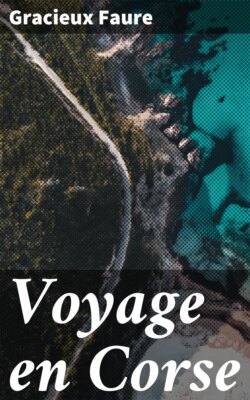Читать книгу Voyage en Corse - Gracieux Faure - Страница 10
VII Vendetta et Banditisme.
ОглавлениеNous voici au point le plus délicat de ma tâche, à la seule accusation de Sénèque, qui ne soit pas sans fondement : toutefois je l’aborderai avec la même assurance que les autres; convaincu que, s’il est impossible de contester l’existence de la vendetta et du banditisme, il sera aisé de démontrer qu’ici encore la vérité se trouve en nombreuse compagnie d’exagérations et d’erreurs.
Métastase a dit que les hommes ressemblent au pays qui les a vus naître. Sans faire de cette affirmation un axiome absolu, il est certain qu’elle a du vrai. Les gens de la plaine ne sont pas ceux de la montagne; les pays où tout abonde ont d’autres habitants que ceux où tout manque; grande est la différence entre les hommes de l’Equateur, des pôles et des zones tempérées.
La Corse est un des pays les plus accidentés, les plus saccadés, les plus tourmentés de l’Europe; tous les contrastes s’y trouvent, tous les extrêmes s’y touchent. Les habitants y participent des qualités et des défauts du climat et du sol. Ils ont l’imagination vive, le tempérament ardent, le caractère inégal, emporté, violent; mais ils sont patients, persévérants, fidèles dans l’amitié, comme dans la haine. Durs aux privations et à la souffrance, ils sont incapables de supporter la moindre injure, surtout si elle touche à l’honneur de la famille; il leur faut. une réparation éclatante, ou une vengeance terrible. Je ne les approuve, ni ne les excuse : mais quand il s’agit de juger un individu ou un peuple, il est juste, si je ne me trompe, de tenir un certain compte du climat et du tempérament, comme des préjugés et de l’éducation. Ceci d’abord.
Dès la plus haute antiquité, forcés de défendre leur indépendance contre des envahisseurs sans cesse renaissants; et, trop peu nombreux pour livrer des batailles rangées, nos pères durent longtemps se borner à la guerre de broussailles, la seule possible au faible contre le fort; rôdant, s’embusquant, attaquant les traînards, les maraudeurs et les détachements isolés. Nous y gagnâmes l’habitude d’aller toujours armés et de frapper à l’improviste.
Au [moyen âge et jusqu’en 1830, les États barbaresques n’avaient été qu’une immense caverne de voleurs qui, non contents de troubler et d’écumer la Méditerranée, dévastaient fréquemment les îles et les côtes de l’Europe. On les redoutait tellement que tous les peuples leur payaient tribut, pour qu’ils voulussent bien ne pas inquiéter leurs vaisseaux de commerce; ce qui ne les empêchait pas de continuer à l’occasion leur métier de pirates. Heureusement, le 6 juillet 1830, Charles X mit fin à cet état de choses, par la prise d’Alger; délivra de ce honteux tribut les nations commerçantes et rendit la sécurité à nos mers; mais jusque-là, placée sur la route des Sarrasins, notre Corse recevait à tout moment leurs visites et leurs insultes; nos champs étaient ravagés, nos villages brûlés, nos femmes et nos enfants emmenés en captivité; ce qui nous obligeait à être, comme nos pères, toujours armés et prêts à frapper.
Vainqueur et héritier des Lombards, Charlemagne donna la Corse aux Papes, qui la cédèrent aux Pisans, lesquels en furent violemment dépossédés par les Génois. Au lieu de lui appliquer une administration douce et paternelle, les Génois en affermèrent l’exploitation à une bande de vautours, connue sous le nom de Compagnie ou Banque de Saint-Georges. Pressée de s’enrichir comme tous les fermiers à terme, cette Compagnie multiplia, sous toutes les formes, les impôts et les charges; et nous traita comme un citron dont on veut avoir la dernière goutte de jus.
La patience n’est pas notre vertu dominante; et, si l’injure nous offense, l’injustice nous révolte. A des vexations de chaque jour, nous répondîmes par des insurrections continuelles; et nous le fîmes avec tant de succès que, désespérant de nous réduire par la force, la république génoise s’appliqua à nous diviser pour régner; et nous arma les uns contre les autres.
A ceux qui embrassèrent son parti, elle prodigua argent, terres, emplois, honneurs, privilège, immunités de tout genre, avec le droit de tout oser et de tout faire impunément. Contre ceux qui restèrent fidèles à l’indépendance nationale, elle organisa l’espionnage, la délation, le faux témoignage, la confiscation, l’emprisonnement, l’exil, l’assassinat; et si ces malheureux venaient à se plaindre, le pouvoir leur donnait toujours tort; les tribunaux les condamnaient invariablement, quelles que pussent être la bonté de leur cause et l’évidence de leur droit.
N’ayant donc ni protection, ni justice à attendre de personne, nos pères confondirent dans une haine commune les Génois et leurs partisans; et prirent le seul parti qui leur restât, celui de se protéger eux-mêmes et de se rendre justice de leurs propres mains. A cela nous gagnâmes deux choses : le mépris de la justice humaine et la pratique des luttes fratricides.
Une fois sur cette pente, nous allâmes vite et loin, les Génois soufflant de tous côtés l’incendie et la guerre. Sous ce souffle empesté, les haines, les procès, les querelles sanglantes se multiplièrent; les provinces et les villes, les villages et les familles se divisèrent en partis ennemis; la Corse s’inonda du sang de ses propres enfants! Le mal devint tel que, de 1683 à 1715, en trente-deux ans par conséquent, d’après les documents puisés aux archives de Gênes, le nombre des assassinats s’éleva à l’énorme chiffre de 28, 715! 900 en moyenne par an, sur une population qui ne devait guère dépasser 100,000 âmes.
Cela vous paraît horrible, n’est-ce pas? Mais voici qui l’est bien plus encore. Un jour, à la vue de la désolation et de la dépopulation rapide du pays, les acteurs passionnés de ces drames lugubres s’arrêtent épouvantés de leur oeuvre, se regardent et s’entendent pour y mettre un terme. Dans ce but, ils demandent au gouvernement deux choses: la prohibition absolue du port de toute espèce d’armes; la peine de mort pour tous les assassins, quels qu’ils soient.
Cette double mesure était propre à couper le mal dans sa racine; et un gouvernement digne de ce nom eût saisi avec empressement l’occasion de rétablir la paix et l’ordre: mais celui-ci ne voulait ni l’ordre ni la paix. Savez-vous ce qu’il fit?..... Ecoutez et voyez si jamais vous avez entendu rien de plus monstrueux.
Sur le premier point, après de longues réflexions, il daigna consentir à la prohibition des armes, et donna ordre qu’elles lui fussent livrées dans un délai déterminé: mais que pensez-vous qu’il en faisait? Qu’il les emmagasinait, les déportait, les détruisait? Pas du tout; il en faisait l’objet d’un infâme trafic, et revendait d’une main ce qu’il avait reçu de l’autre. Les historiens du temps citent un individu auquel le même fusil fut revendu jusqu’à sept fois!
Sur le second point, sa conduite fut plus horrible encore. Il refusa l’abolition de la peine de mort, par la raison que cela ferait perdre au Trésor public le revenu annuel, que lui procuraient les lettres de grâce et d’abolition, qu’achetaient les assassins pour se mettre à l’abri de toute poursuite!... Il est en effet certain que si, après son premier crime, chaque assassin eût été décapité ou pendu, il n’eût pas été facile de lui vendre, jusqu’à sept fois, des lettres de grâce et d’abolition.
Voilà ce que fut et fit pour nous le gouvernement génois. Avant lui, nous commettions aussi des meurtres: mais comme ils tombaient généralement sur des ennemis publics, ils avaient le caractère d’actes de légitime défense et de patriotisme; ce fut lui qui nous arma les uns contre les autres, et nous fit de la vendetta et du banditisme comme une nécessité fatale. Faut-il, après cela, s’étonner que son souvenir soit en exécration d’un bout à l’autre de l’île, et que la dernière injure que l’on y puisse jeter à l’homme que l’on veut humilier, soit de lui dire: Tu es un Génois! Pour moi, je ne puis passer en vue de Gênes la Superbe, sans lui envoyer, à défaut de boulets et de bombes, des bordées de malédictions. et si, dans ces moments-là, il me tombait sous la main un doge, un gonfalonnier, un podestat quelconque, il ne ferait pas mal de se recommander à Dieu.
En nous assurant un gouvernement paternel et une justice impartiale, l’annexion supprima deux des principales causes de nos discordes et aurait dû supprimer aussi la vendetta et le banditisme: mais, hélas! il en est des maladies morales comme des maladies physiques. Promptes à venir, elles s’en vont très lentement; et lorsque, après s’être pendant des siècles infiltrée dans les idées, les mœurs et la pratique d’un peuple, une habitude est passée chez lui à l’état de seconde nature, ce n’est pas en vingt-quatre heures qu’il est possible de la détruire par un syllogisme ou un décret.
Dans les campagnes surtout, nos populations eurent peine à croire à l’équité des tribunaux français; et si enfin elles consentirent à s’adresser à eux, pour les faits d’ordre matériel, elles continuèrent, pour les faits d’ordre moral, à ne s’en rapporter qu’à la justice personnelle. N’est-ce pas ainsi, du reste, que vous agissez vous-mêmes?... Qu’on vous vole votre cheval ou votre bourse, que faites-vous? Vous en appelez aux tribunaux, parce que vous les savez très sévères pour les attentats contre la propriété; mais si c’est l’honneur de votre femme, de votre fille ou de votre sœur qui vous a été ravi, vous recourez à votre pistolet ou à votre épée; parce qu’en ces matières, la loi est sinon indifférente, du moins impuissante, et la justice désarmée.
— Vous ne sauriez comparer le duel à la vendetta; il n’y a entre eux aucune ressemblance.
— Il y en a beaucoup plus que vous ne pensez, je vous le montrerai tout à l’heure.
Le droit de justice personnelle persista donc après l’annexion; mais il fut réglementé et réduit aux quatre cas que voici :
1° Le déshonneur ou la compromission d’une femme;
2° L’infidélité aux engagements des fiançailles;
3° L’assassinat impuni d’un parent proche;
4° Un faux témoignage, ayant fait condamner un innocent.
Dans ces quatre circonstances, l’opinion publique autorisait la vendetta, et en faisait même un devoir, comme ailleurs elle pousse parfois au duel et à la guerre.
— Et vous croyez, capitaine, que les actes humains sont bons ou mauvais, selon que l’opinion publique les juge tels? Ce serait une grave erreur. Ils sont mauvais ou bons, selon qu’ils sont contraires ou conformes à la loi de Dieu; selon que nous voudrions ou ne voudrions pas qu’ils nous fussent faits à nous-mêmes. Que tous les habitants de la terre s’accordent, par exemple, à approuver l’assassinat et le vol; est-ce qu’il sera pour cela permis d’assassiner et de voler? Non certes. Et pourquoi! Parce qu’il est écrit:
Homicide point ne seras...
et encore:
Le bien d’autrui tu ne prendras...
Non; parce que, ne voulant vous-mêmes être ni assassinés ni volés, vous n’avez pas le droit d’assassiner et de voler les autres.
Et puis, dans le cas d’une femme déshonorée ou compromise, savez-vous bien quel est le vrai coupable?... Etes-vous sûr que, au lieu d’avoir été séduite, ce n’est pas elle qui a séduit son complice?
Quoi de plus absurde, en cas de fiançailles rompues, que de s’acharner à se faire épouser de force, ou de verser le sang de l’infidèle et celui de ses proches; quand on devrait s’estimer heureux d’être débarrassé d’une personne capable de trahir ainsi ses serments?
Dans le cas d’assassinat impuni ou de faux témoignage, si la société ne peut ou ne veut pas vous rendre justice, laissez donc à Dieu le soin de le faire, et ne vous mettez pas à sa place.
Je m’attendais à voir éclater le capitaine; mais il me prit les deux mains et dit : L’opinion publique n’est pas en effet l’opinion universelle; plusieurs, et je suis du nombre, font exception à la règle et condamnent, comme vous, la vendetta sous toutes ses formes.
Quoi qu’il en soit, voici comment se passaient les choses. La famille offensée commençait par inviter le coupable à réparer sa faute, si la faute était réparable. En cas de refus, elle choisissait dans son sein un vengeur, chargé de laver dans le sang l’injure commune. Ce vengeur faisait d’ordinaire près du coupable une dernière démarche, lui notifiait la mission dont il était chargé, et lui fixait un jour et une heure pour l’ouverture des hostilités. Quand sa vendetta était accomplie, il se retirait dans les forêts pour y vivre à l’état de bandit, luttant contre la force armée et ses ennemis personnels, et finissant presque toujours par l’expatriation, le bagne ou la mort.
Après le premier empire, nos bandits étaient en grand nombre; mais dispersés sur tout le territoire, ils n’avaient entre eux ni organisation, ni lien commun, et vivaient dans un isolement presque complet. En commettant la faute de voir en eux des représentants de la cause bonapartiste, la Restauration les grandit à leurs propres yeux et aux yeux des populations, leur amena une foule d’anciens militaires, les fit s’organiser vigoureusement et s’affilier au carbonarisme.
Le marquis de Rivière marcha contre eux à la tête d’une petite armée de six mille hommes; mais cette expédition, mal combinée et mal conduite, aboutit à une retraite ridicule, à une petite garnison laissée dans Aléria et à un acte d’incroyable faiblesse, par lequel la province de Fiumorbo était reconnue comme terre libre au profit des bandits!
Cet échec et quelques autres firent renoncer à la guerre réglée contre le banditisme, et la gendarmerie fut de nouveau chargée de le réduire: mais, comme on se défiait des gens du pays, ils furent systématiquement exclus de ce corps d’élite, qui ne se trouva composé que de gendarmes continentaux. Ce fut une nouvelle et très grave faute. Ces gendarmes en effet ne connaissaient ni le pays, ni la langue; ils n’avaient parmi nous ni alliés, ni amis, ni parents qui pussent leur donner des renseignements et des secours au besoin; ils étaient, en un mot, dépourvus d’une foule d’avantages que possédaient les bandits. Aussi, malgré tout leur dévouement et leur courage, ils eurent le dessous, parce que la sympathie des populations et des autorités locales n’étaient pas pour eux. Leur désastre fut tel, que l’on dut en 1822 créer, pour leur venir en aide, un bataillon de voltigeurs corses, fort de quatre cents hommes.
Egalement enfants du pays, les voltigeurs et les bandits se partageaient l’opinion publique et avaient des chances égales. La lutte entre eux fut vive et longue, elle dura vingt-huit ans, avec un acharnement sans exemple, et les succès les plus divers: mais enfin les voltigeurs l’emportèrent sur toute la ligne; les grandes bandes se dispersèrent ou furent détruites; les contumaces en renom disparurent et il se fit comme un apaisement universel. On crut alors n’avoir plus besoin du bataillon indigène, et il fut licencié en 1850. Aussitôt les bandits reparurent; et, dès 1852, on en comptait plus de deux cents qui tenaient la campagne. Notre légion de gendarmerie fut immédiatement portée au chiffre de mille hommes; mais, malgré l’importance de cet effectif, elle n’aurait pas été plus heureuse qu’autrefois, si l’on n’eût appuyé ses efforts de deux mesures énergiques et décisives, c’est-à-dire de la prohibition du port de toute espèce d’armes, et de l’application rigoureuse de l’art. 248 du code pénal, qui assimile aux malfaiteurs eux-mêmes leurs protecteurs, leurs recéleurs et leurs guides.
Le résultat de ces mesures fut complet et prompt; le chiffre moyen des homicides, qui, depuis 1821, avait été de cent quarante-quatre, tomba aussitôt à vingt-deux! En 1853, il n’a été que de quinze, et tombera, s’il plaît à Dieu, plus bas encore.
Voilà, Monsieur, en peu de mots, ce qu’étaient notre vendetta et notre banditisme; une lutte entre deux familles, comme ailleurs le duel et la guerre sont une lutte entre deux individus ou deux peuples; lutte ayant ses règles et ses lois, auxquelles on ne pouvait manquer sans crime et sans honte. Le bandit devait respecter les femmes et les enfants, les étrangers et les voyageurs, et quiconque se trouvait en dehors de son inimitié; il devait s’abstenir du vol et autres actes contraires à la justice et à la morale, et ne pas toucher même au principal coupable, si celui-ci sortait sans armes ou portait son fusil la crosse en l’air, pour déclarer qu’il refusait l’inimitié.
A ces conditions, l’opinion publique était favorable au bandit, qu’elle regardait comme une espèce de martyr, se sacrifiant pour l’honneur de sa famille. Je suis loin d’approuver et d’excuser ces pratiques, qui ont fait tant de mal à mon pays: mais je soutiens qu’il est injuste de comparer nos bandits à ces malfaiteurs, si communs aux rives de la Seine, qui assassinent pour voler, et volent pour solder leurs débauches et leurs orgies. Non pas que je prétende qu’il n’y ait jamais eu en Corse de ces malfaiteurs, capables de vol et de crimes ordinaires: mais ceux-là étaient généralement des étrangers, qui venaient se réfugier chez nous, pour échapper à la justice de leur pays; les vrais bandits les repoussaient, l’opinion publique les condamnait, et la population les appelait non pas bandito, mais ladro publico.
J’avais été vivement impressionné par les raisonnements du capitaine, et par ses réponses à des objections, qui justement étaient les miennes; mais je ne pus m’empêcher de faire quelques réserves, et je dis:
— Le mot bandit, je le reconnais, n’a pas chez vous le même sens qu’ailleurs; votre vendetta n’a souvent été qu’une protestation contre la faiblesse ou le mauvais vouloir de l’autorité, les erreurs ou la partialité de la justice; je ne lui marchande donc pas les circonstances atténuantes: mais elle n’en faisait pas moins couler des flots de sang humain; et il est difficile d’admettre qu’un peuple, chez lequel se sont à ce point développées de semblables pratiques, n’ait pas des instincts cruels. Ailleurs aussi, il y a des défaillances de la justice et de l’autorité, des outrages à la famille, des crimes entre individus: mais on n’en vient pas à ces affreux excès, dont la Corse semble avoir le monopole.
— Si la vendetta versait le sang humain, est-ce de l’eau que font couler le duel et la guerre? Et cependant vous les autorisez et les glorifiez même! Pourquoi donc deux poids et deux mesures, lorsque le duel et la guerre ne sont après tout que des actes de vendetta, entre deux individus et deux nations?... Moi, Monsieur, tout marin que je suis, j’abhorre la guerre et le duel; et j’ai, par conséquent, le droit de condamner la vendetta: mais de quel droit la condamnerez-vous, si vous approuvez le duel et la guerre?
Vous ajoutez que la Corse en a le monopole; c’est encore une erreur. La vendetta peut changer de nom et de forme; mais elle est de tous les temps et de tous les lieux; et il ne faudrait pas, à l’heure où nous parlons, faire le tour du monde pour trouver des pays où elle est en pleine floraison. Et vous-mêmes, qui êtes si clairvoyant, pour découvrir une paille dans notre œil, est-ce que par hasard vous n’auriez pas une poutre dans le vôtre? Est-ce que cette vendetta, que vous nous reprochez avec raison, vos pères ne l’auraient pas pratiquée, plus de mille ans, avec toutes ses fureurs et toutes ses horreurs, après l’avoir reçue de la Germanie?
Qu’était-ce donc que ces guerres privées qui si longtemps couvrirent la France de deuil, de sang et de ruines? Voici, si j’ai bonne mémoire, comment les définit un de vos écrivains populaires:
« On appelait guerres privées, les guerres acharnées qui s’élevaient au moyen âge entre deux ou plusieurs familles, pour venger l’insulte faite à l’un de leurs membres, et qui se perpétuaient de génération en génération, jusqu’à ce que la destruction de l’une des parties, ou une réparation éclatante y vînt mettre un terme. Ces guerres ensanglantèrent la France et l’Allemagne jusqu’au quatorzième siècle. Elles eurent pour principale cause l’absence de lois capables de protéger es individus et de punir les crimes, ainsi que la faiblesse de l’autorité royale, en présence de feudataires puissants et indépendants dans leurs domaines. » (Bouillet.)
Cette définition de vos guerres privées n’est-elle pas, exactement et mot pour mot, celle de notre vendetta?... Elles ont, dites-vous, disparu de votre territoire, et ne sont plus qu’un souvenir. Il se peut: mais que de temps et d’efforts il a fallu pour atteindre ce résultat.
Que suit-il de là? Que ce que nous sommes aujourd’ hui, vous l’avez été autrefois; que les reproches que vous nous adressez, vous les avez mérités avant nous; et que dès lors, moins que personne, vous avez le droit d’être impitoyables à notre égard.
Mais voilà que le soleil se pose sur les eaux; la mer commence à moutonner et le navire à se balancer. Allons dîner, tant que la table se tient encore d’aplomb; puis on ira dormir; et demain au point du jour, je vous appellerai pour vous montrer la Corse.