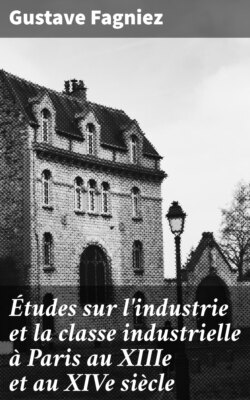Читать книгу Études sur l'industrie et la classe industrielle à Paris au XIIIe et au XIVe siècle - Gustave Fagniez - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE III
VIE PUBLIQUE DU CORPS DE MÉTIER
ОглавлениеTable des matières
Services rendus par le corps de métier en matière d’impôts et de police.—Sa participation aux fêtes et aux cérémonies publiques.—Son rôle politique.
Jusqu’ici, nous avons considéré le corps de métier en lui-même, abstraction faite de la place qu’il occupait dans l’organisation sociale; nous allons étudier maintenant la part qu’il prenait à la vie publique.
Dans un assez grand nombre de villes, les corporations d’arts et métiers concouraient au gouvernement municipal ou contribuaient à l’élection des officiers municipaux[167]. A Paris, l’administration et la police étaient concentrées dans les mains du prévôt royal et les corporations industrielles n’avaient aucun lien avec l’échevinage, dont la principale attribution consistait à surveiller le commerce fluvial. Elles n’eurent donc d’autre rôle politique que celui qu’elles usurpèrent à la faveur des circonstances, et l’autorité n’utilisait leur organisation que pour asseoir les impôts, assurer le bon ordre et rendre les fêtes et les cérémonies publiques plus brillantes.
Les corporations nommaient un ou plusieurs de leurs membres pour répartir le montant de la taille et vérifier la recette[168]. Lorsque la taille ne s’étendait pas au delà du quartier dans l’intérêt duquel elle était imposée, elle était levée non pas, comme les tailles générales, par paroisses et par quêtes, mais par corporations, et alors chaque corporation répartissait entre ses membres la somme à laquelle elle avait été imposée[169].
C’est au sein des corporations de métiers, que se recrutait la milice bourgeoise à laquelle était en partie confiée la police de la ville. Les artisans de certains métiers s’étaient spontanément chargés de faire le guet à leurs frais et à tour de rôle de trois semaines en trois semaines. On voit, par l’ordonnance du mois de décembre 1254, qu’il existait déjà un guet soldé par le roi et composé de vingt sergents à cheval et de quarante sergents à pied, sous le commandement d’un officier nommé le chevalier du guet[170]. A la différence de celui-ci, qui parcourait les rues en patrouille, le guet bourgeois était à poste fixe[171]. Les métiers soumis au service étaient un peu plus de vingt et un. On en compterait vingt et un juste si l’on s’en tenait à ce fait que le tour de chacun d’eux venait une fois en trois semaines, mais on voit que plusieurs se réunissaient quelquefois pour former le contingent qu’un seul d’entre eux n’aurait pu fournir. Ainsi, on ne comptait parmi les batteurs d’or que six maîtres tenus au guet, et ils invoquaient ce petit nombre comme motif de dispense[172]. Un arrêt du Parlement, de la Pentecôte 1271, nous montre qu’il faut ajouter à ces vingt et un métiers les changeurs, les orfévres, les drapiers, les taverniers[173]. Une ordonnance du roi Jean, du 6 mars 1364 (n. s.) parle de la convocation des gens du métier ou des métiers dont le tour est arrivé. Cette convocation devait être faite en temps opportun par deux officiers portant le titre de clercs du guet, et chargés d’enregistrer les noms de ceux qui se présentaient au Châtelet avant le couvre-feu, de remplacer les défaillants à leurs frais et de distribuer le guet par escouades de six hommes entre les différents postes. Il y en avait deux près du Châtelet; les autres étaient établis dans la cour du Palais, près de l’église de Sainte-Marie-Madeleine de la Cité, à la place aux Chats, devant la fontaine des Innocents, sous les piliers de la place de Grève et à la porte Baudoyer. L’effectif était donc de quarante-huit hommes. Quelquefois il y en avait davantage, et alors l’excédant était envoyé aux carrefours où les clercs jugeaient qu’il serait le plus utilement placé. Le service durait depuis le couvre-feu jusqu’au jour. Les bourgeois s’armaient eux-mêmes et servaient généralement en personne. Cependant les cordonniers pouvaient, dès le temps de la reine Blanche, se faire remplacer par leurs ouvriers[174], et les couteliers jouissaient depuis Philippe-Auguste du même privilége[175]. Plusieurs métiers avaient affermé du roi le revenu du guet auquel ils étaient soumis et dont ils se déchargeaient sur des remplaçants. De ce nombre étaient les tisserands. Chaque fois que leur tour était arrivé, ils fournissaient soixante hommes et payaient 20 s. parisis au roi, plus 10 s. qui se répartissaient entre leurs remplaçants, les clercs du guet et les veilleurs (gaites) du Grand et du Petit-Pont. Le maître du métier était chargé de convoquer le guet et, à ce titre, sergent juré du roi[176]. Il forçait même les fabricants de tapis de luxe à guetter en violation de leur privilége, et ceux-ci l’accusaient de s’approprier les revenus du guet au détriment du trésor royal[177]. Au XIVe siècle, les tisserands, appauvris et décimés par les guerres et les épidémies, n’avaient plus les moyens de se racheter du guet. La plupart quittèrent la terre du roi pour aller s’établir dans les seigneuries ecclésiastiques, dont les habitants jouissaient de l’immunité. Il ne resta environ que seize familles de tisserands dans le domaine royal. A la requête du maître et des jurés du métier qui avaient déterminé le retour d’un certain nombre de familles et faisaient espérer que les autres suivraient cet exemple, Charles V, au mois d’avril 1372-73, affranchit les tisserands qui viendraient s’établir sous sa juridiction immédiate de l’obligation de se racheter et leur remit même les arrérages échus, à la charge de faire le guet comme les autres corporations[178]. Ainsi, ils obtinrent comme une faveur de quitter une situation privilégiée, que les circonstances avaient rendue onéreuse, pour rentrer dans la condition commune.
Plusieurs corporations cependant se rachetaient du service par une redevance en nature ou en argent. Tel était le cas des tonneliers et des esculliers (fabricants d’écuelles, de hanaps, d’auges, etc.). Chaque escullier fournissait annuellement au cellier royal sept auges de deux pieds de long[179], et chaque tonnelier obtenait son exemption depuis la Madeleine (22 juillet) jusqu’à la Saint-Martin d’hiver (11 novembre), en payant au roi la valeur d’une journée de travail[180]. L’expression payer, que les statuts de certains métiers appliquent au guet, prouve que, pour ces métiers, le service avait été converti en une prestation pécuniaire[181]. L’usage de s’en affranchir à prix d’argent se généralisa même abusivement par la prévarication des clercs du guet, dont les bourgeois achetaient la tolérance, si bien que la ville fut privée pendant quelque temps de la garde de nuit qui veillait à sa sûreté. Le 6 mars 1364 (n. s.), le roi Jean, voulant remettre en vigueur une institution aussi utile, destitua les coupables et décida qu’à l’avenir leur office serait rempli par deux notaires du Châtelet, qui l’exerceraient concurremment avec leurs premières fonctions. Comme plusieurs s’esquivaient après avoir fait inscrire leurs noms, il ordonna que le guet des sergents visiterait les postes et prendrait les noms des absents afin de les faire connaître au prévôt de Paris, enfin il défendit aux clercs de profiter de leur position pour faire des gains illégitimes[182].
Le guet bourgeois était commandé par le prévôt ou par son lieutenant. Les changeurs, les orfévres, les drapiers, les taverniers, revendiquaient le privilége de ne guetter que sous le commandement personnel du prévôt, mais la jurisprudence constante du Parlement se montra contraire à cette prétention. Dans sa session de l’octave de la Toussaint 1264, il jugea à l’unanimité que les drapiers étaient tenus de guetter en l’absence comme en la présence de cet officier, et ce n’était pas la première fois qu’il se prononçait en ce sens[183]. Un arrêt du lundi après la Saint-Barnabé (11 juin) 1265, apprend que la même chose avait été décidée à plusieurs reprises à l’égard des bourgeois de Paris en général[184], et la question posée de nouveau à l’occasion des changeurs, des orfévres, des drapiers, des taverniers, etc., fut résolue de même en 1271, conformément à un arrêt du Parlement, de la Saint-Martin d’hiver 1258, dont l’existence fut établie par un record de cour[185].
Le privilége des corporations exemptes du guet se fondait généralement sur ce qu’elles exerçaient une industrie de luxe; travaillant surtout pour la noblesse et le clergé, elles participaient en quelque sorte à la faveur dont ces classes élevées étaient l’objet. C’est à ce titre que les haubergiers[186], les barilliers[187], les imagiers[188], les chapeliers de paon[189], les archiers[190], jouissaient de l’immunité, et que les lapidaires[191], les tapissiers de tapis imités de ceux de l’Orient[192], les tailleurs de robes[193], y prétendaient. Une tradition, transmise de père en fils chez les mortelliers et tailleurs de pierre, faisait remonter leur privilége à cet égard au temps de Charles-Martel[194]. Les maîtres et clercs du guet obligeaient les barbiers à guetter, bien que le registre des métiers ne leur imposât pas cette charge. Les barbiers s’en plaignirent à Charles V; ils représentèrent que quatorze d’entre eux sur quarante étaient exempts, soit à cause de leur âge, soit parce qu’ils demeuraient sur des terres franches ou seigneuriales; ils ajoutèrent qu’ils étaient souvent appelés la nuit par les malades à défaut des médecins et chirurgiens. Le roi manda au prévôt de Paris de consulter les registres des métiers conservés au Châtelet et à la Chambre des comptes et de faire droit, s’il y avait lieu, à la requête des barbiers. C’est ce que fit le prévôt après avoir vérifié que les registres ne contenaient rien qui s’y opposât[195]. Un document qui paraît avoir été rédigé à la suite d’une enquête ordonnée par le Parlement[196] nous offre la liste complète des corporations et des personnes exemptes du guet. Elle comprend, outre celles que nous avons déjà citées, les chasubliers, les graveurs de sceaux (seelleurs), les libraires, les parcheminiers, les enlumineurs, les écrivains, les tondeurs de draps, les bateliers, les buffetiers, les fabricants de gants de laine, de chapeaux en bonnet[197], de nattes, de haubergeons, de braies, de bijoux en verre (voirriers), les déchargeurs de vin, les sauniers, les corroyeurs de robes de vair, les corroyeurs de cordouan, les monnayeurs, les brodeurs de soie, les courtepointiers, les vanniers, les tapissiers qui se servaient de la navette, les marchands de fil (fillandriers), les calendreurs, les marchands d’oublies, les écorcheurs, les orfévres, les étuveurs, les apothicaires, les habitants de l’enceinte des églises et des monastères, les mesureurs, ceux qui remettaient les vêtements à neuf, les petits marchands qui étalaient leurs denrées aux fenêtres (touz fenestriers), les courtiers de commerce, les marchands de vin étaliers, les artisans attachés au service du roi, des princes du sang et des seigneurs, les boiteux, les estropiés, les fous, les maîtres et jurés des métiers[198]. Les sexagénaires, les absents qui n’avaient pas quitté la ville après avoir eu connaissance de la convocation, les malades, ceux dont la femme était en couches, ceux qui avaient été saignés le jour même, pourvu que la convocation n’eût pas précédé la saignée, ceux enfin qui montaient la garde sur les murs de la ville, étaient dispensés, à la condition de faire, sous serment, leur déclaration aux clercs du guet[199]. Ceux-ci, paraît-il, n’acceptaient les excuses des fripiers que lorsqu’elles étaient présentées par leurs femmes. Les fripiers représentèrent l’inconvénient qu’il y avait pour elles à attendre au Châtelet l’heure du couvre-feu et à en revenir le soir par des rues écartées et désertes, et ils sollicitèrent du roi la permission de se faire excuser par leur ouvrier, leur servante ou leur voisin[200].
Les descriptions que les chroniqueurs nous ont laissées des fêtes et des cérémonies publiques prouvent que les corps de métiers ne s’y confondaient pas avec le reste de la bourgeoisie et qu’ils y occupaient une place distincte.
Chacun d’eux était rangé à part et portait un uniforme neuf, en étoffe de prix, tel que le prévôt de Paris le lui avait assigné[201]. L’intervention du prévôt en pareille matière montre bien que leur assistance aux cérémonies publiques faisait partie du programme officiel de ces cérémonies. Mais ils ne se bornaient pas à y assister, ils contribuaient aux divertissements offerts à la foule. Jean de Saint-Victor, décrivant les fêtes célébrées à Paris, en 1313, à l’occasion de la chevalerie des trois fils de Philippe le Bel, parle du défilé de toutes les corporations avec leurs insignes particuliers; les unes, ajoute-t-il, représentèrent l’enfer, les autres le paradis, d’autres firent passer sous les yeux du public tous les personnages du Roman du Renard, se livrant à l’exercice des diverses professions[202]. Nous savons par un autre chroniqueur, que les fabricants de courroies représentèrent la vie de ce personnage alors si populaire, tandis que les tisserands jouèrent des scènes empruntées surtout au Nouveau Testament[203]. A l’époque qui nous occupe, les gens de métiers assistaient en corps aux cérémonies et aux fêtes publiques et n’y étaient pas représentés, comme ils le furent plus tard, par cette espèce d’aristocratie commerciale, composée de six corporations, qui n’apparaît pas dans l’histoire avant l’entrée de Henri VI à Paris, en 1431[204].
Si les corps de métiers n’exercèrent pas à Paris une action politique régulière, ils se jetèrent avec ardeur, et ajoutons avec discipline, dans les troubles qui agitèrent la capitale au XIVe siécle. L’émeute qui éclata en 1306, par suite du rétablissement de la forte monnaie, fut l’œuvre de la population ouvrière et marchande. Les propriétaires voulurent être payés de leurs loyers en bonne monnaie; cette prétention légitime n’en irrita pas moins les petits locataires qui voyaient tripler brusquement les loyers qu’ils payaient depuis onze ans[205]. Des gens du peuple, foulons, tisserands, taverniers et autres, envahirent la maison de campagne d’Étienne Barbète, voyer de Paris et maître de la monnaie[206], la brûlèrent, saccagèrent le jardin, enfoncèrent les portes de son hôtel de la rue Saint-Martin, mirent le mobilier en pièces, enfin poussèrent l’audace jusqu’à bloquer le roi dans le Temple. C’est le jeudi avant l’Épiphanie que se commettaient ces excès. La veille de cette fête, vingt-huit des séditieux furent pendus aux quatre portes de la ville[207]. Un autre chroniqueur porte à quatre-vingts personnes le nombre des gens de métier qui subirent ce supplice[208]. D’après un troisième, le ressentiment de Philippe le Bel ne fut satisfait que par la mort d’un maître de chaque métier[209]. Quoi qu’il en soit, le caractère de la répression ne laisse pas de doute sur la classe à laquelle appartenaient les coupables. Est-ce, comme le pense M. Leroux de Lincy[210], à la suite de cette sédition que Philippe le Bel abolit les confréries religieuses, ou ne faut-il pas plutôt faire remonter leur suppression à un mandement royal du mercredi après la Quasimodo 1305, adressé au prévôt de Paris et interdisant dans cette ville aux personnes de toute classe et de toute profession les réunions de plus de cinq personnes, publiques ou clandestines, pendant le jour ou la nuit, sous n’importe quelle forme et quel prétexte[211]? Il semble impossible que les confréries religieuses aient échappé à une mesure d’un caractère aussi général. Du reste, elle paraît n’avoir été que transitoire; dès le 12 octobre 1307, Philippe le Bel lui-même autorisait les marchands de l’eau à célébrer annuellement leur confrérie comme ils le faisaient avant sa défense[212], et le 21 avril 1309, il rétablit celle des drapiers, après s’être assuré par une enquête qu’elle ne présentait aucun danger[213]. Ses successeurs recoururent quelquefois à cette précaution avant de permettre le rétablissement d’une confrérie, et ils ne le permirent généralement qu’à la condition que les réunions auraient lieu en présence d’un délégué du prévôt de Paris[214].
Cinquante ans environ après l’émeute que nous venons de mentionner, on voit les corps de métiers engagés dans le parti d’Étienne Marcel, et formant une véritable armée à ses ordres. Le jeudi 22 février 1358 (n. s.), au matin, le prévôt des marchands les réunit tous en armes à l’abbaye de Saint-Éloi, près du Palais. Ils formaient une réunion d’environ 3,000 personnes. C’est cette foule qui massacra Regnaut d’Acy, avocat du roi au Parlement, au moment où il se rendait du Palais chez lui; c’est elle qui fournit des instruments dévoués à Marcel pour l’exécution de ses sanglants projets contre les maréchaux de Champagne et de Normandie[215]. La population laborieuse, qui obéit, en 1306, à un mouvement tout spontané, agit ici au contraire avec une discipline et un ensemble qui s’expliquent certainement par le système d’associations où elle était comme enrégimentée. Le 10 août 1358, le régent accorda une amnistie presque générale aux Parisiens compromis dans l’insurrection. Au nombre des délits et des crimes énumérés par les lettres d’abolition figure le fait de s’être affilié par serment et sans la permission du dauphin à une association illicite qui n’est autre que la confrérie Notre-Dame[216]. Cet exemple montre bien le danger que pouvaient offrir, à un moment donné, les associations les plus étrangères à la politique; on sait, en effet, que la grande confrérie aux prêtres et aux bourgeois de Notre-Dame, objet de la clémence royale, n’avait d’autre but avoué que la pratique de la dévotion et de la charité, et qu’elle avait compté la reine Blanche parmi ses membres[217].
La sédition des maillotins, qui eut lieu le 1er mars 1382 (n. s.), et les troubles dont elle fut suivie jusqu’à la rentrée de Charles VI à Paris, le 11 janvier 1383 (n. s.), se joignant au souvenir de la conduite factieuse des Parisiens sous le règne précédent[218], déterminèrent ce prince à priver la ville de son échevinage, dont il transporta les attributions au prévôt de Paris[219], et à dissoudre les corporations d’arts et métiers; il remplaça les maîtres électifs des métiers par des visiteurs à la nomination du prévôt, supprima la juridiction professionnelle exercée par plusieurs de ces corporations[220], et défendit d’une façon générale, et notamment aux confréries, de se réunir ailleurs qu’à l’église sans son autorisation ou celle du prévôt, et en l’absence de cet officier ou de son délégué. Cette défense était sanctionnée par la confiscation et la peine capitale[221]. Les biens des corporations passèrent entre les mains du roi; telle dut être au moins la conséquence de leur dissolution, et nous avons la preuve qu’en exécution de son ordonnance, Charles VI confisqua la Grande-Boucherie. Du reste, elle lui rapporta si peu, et le défaut d’entretien y nécessita des réparations si urgentes et si considérables qu’il s’en dessaisit en 1388 (n. s.), pour la restituer aux bouchers[222]. On ne saurait fixer l’époque précise à laquelle les autres communautés se reformèrent, mais cela ne tarda pas.