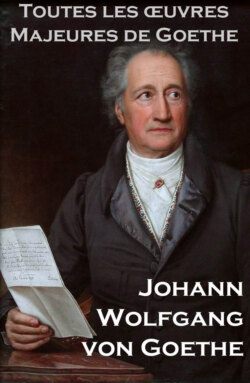Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Goethe - Johann Wolfgang von Goethe - Страница 11
ОглавлениеOù j’ai dessein d’aller ? Je vais te le dire en confidence. Je resterai ici quinze jours encore, après quoi, je me suis fait accroire que je voulais visiter les mines de… ; mais, dans le fond, il n’en est rien : je veux seulement me rapprocher de Charlotte, - voilà tout. Et je ris de mon cœur…. et je fais tout ce qu’il veut.
29 juillet.
Non, c’est bien, tout est bien !… Moi, son époux ! 0 Dieu, qui m’as-donné la vie, si tu m’avais réservé cette félicité, ma vie entière eût été une adoration continuelle. Je ne veux pas contester, mais pardonne-moi ces larmes’, pardonne-moi mes vœux inutiles…. Elle, ma femme ! Si j’avais serré dans mes bras la plus aimable créature qui soit sous le soleil !… Wilhelm, tout mon corps frissonne, lorsqu’Albert entoure de son bras cette taille élégante.
Et l’oserai-je dire ? Pourquoi pas, Wilhelm ? Elle eût été plus heureuse avec moi qu’avec lui. Oh ! il n’est pas l’homme capable de remplir tous les vœux de cet ange. Un certain défaut de sensibilité, un défaut…. prends-le comme tu voudras…. Je ne vois pas la sympathie faire battre son cœur, à quelque passage d’un livre chéri, quand le cœur de Charlotte et le mien se rencontrent, et, dans cent autres occasions, lorsqu’il nous arrive d’exprimer nos sentiments sur les actions d’autrui…. Cher Wilhelm…. il est vrai qu’il l’aime de toute son âme ; et que ne mérite pas un pareil amour ?…
Un homme insupportable m’a interrompu. Mes larmes sont séchées. Je suis distrait.
Adieu, cher ami.
4 août.
Je ne suis pas le seul : tous les hommes sont déçus dans leurs espérances, trompés dans leur attente. J’ai été voir ma bonne femme sous les tilleuls. L’aîné des enfants est accouru à ma rencontre : ses cris de joie ont amené la mère, qui m’a paru très-abattue. Sa première parole a été de me dire : « Mon bon monsieur, hélas ! mon Jean est mort ! » C’était le plus jeune de ses garçons. Je restai muet. « Et mon rnari, a-t-elle dit encore, est revenu de Suisse, et n’a rien apporté ; et, sans quelques bonnes gens, il lui aurait fallu mendier pour revenir. Il avait pris la lièvre en chemin…. » Je ne pus rien lui dire ; je donnai quelque chose au petit. Elle me pria d’accepter quelques pommes, ce que je fls, et je quittai ce lieu de triste souvenir.
21 août.
En un tour de main, je suis tout changé. Quelquefois la vie s’éclaire encore d’un joyeux sourire…. Hélas ! ce n’est que pour un moment…. Quand je me perds ainsi dans mes rêves, je ne puis écarter loin de moi cette pensée : « Quoi donc ! si Albert venait à mourir ! Tu serais, oui, elle serait…. » Et je poursuis cette vision jusqu’à ce qu’elle me conduise au bord des abîmes, devant lesquels je recule avec horreur.
Quand je sors de la ville par le chemin que je parcourus en voiture, le jour où j’allai, pour la première fois, prendre Charlotte, afin de la mener au bal, combien tout me paraît changé ! Tout est passé, tout a disparu. Nul vestige de ce monde évanoui ; pas un battement de cœur qui réponde à mes sentiments d’autrefois. Je suis comme un fantôme, qui reviendrait dans le manoir consumé, dévasté, que jadis, prince florissant, il avait bâti lui-même, décoré avec la dernière magnificence, et que, d’un cœur plein d’espoir, il avait laissé, en mourant, à son fils bien-aimé.
3 septembre.
Quelquefois je ne puis comprendre comment un autre peut l’aimer, ose l’aimer, quand je l’aime si uniquement, si profondément, si parfaitement ; quand je ne connais et ne sais et ne possède rien qu’elle.
4 septembre.
Oui, c’est ainsi. Comme la nature incline vers l’automne, l’automne se fait en moi et autour de moi. Mes feuilles jaunissent, et déjà les feuilles des arbres voisins sont tombées. Ne te parlais-je pas un jour d’un jeune paysan, dès le temps où je vins ici ? J’ai demandé de ses nouvelles à Wahlheim. On m’a dit qu’il avait été renvoyé de son service, et personne n’en savait davantage sur son compte. Hier je le rencontrai par hasard sur le chemin d’un autre village. Je lui adressai la parole, et il me conta son histoire, qui m’a touché profondément, comme tu le comprendras sans peine, quand je te l’aurai contée à mon tour. Mais à quoi bon ces détails ? Ne devrais-je pas garder pour moi ce qui m’angoisse et m’afflige ? Pourquoi t’affliger aussi ? Pourquoi te fournir toujours l’occasion de me plaindre et de me blâmer ? Soit, peut-être cela est-il aussi dans ma destinée.
Cet homme répondit à mes premières questions avec une morne tristesse, dans laquelle je crus remarquer un peu de confusion : mais bientôt, comme s’il s’était reconnu lui-même et m’avait reconnu soudain, il m’avoua ses fautes avec plus de franchise, il déplora son malheur. Que ne puis-je, mon ami, te rapporter chacune de ses paroles ! Il avouait, il racontait (en éprouvant, à ce souvenir, une sorte de jouissance et de bonheur), que sa passion pour la maîtresse de la maison avait augmenté de jour en jour ; qu’à la fin il ne savait plus ce qu’il faisait, ni, pour parler son langage, où donner de la tête. Il ne pouvait ni boire, ni manger, ni dormir ; cela le prenait à la gorge ; il faisait ce qu’il ne devait pas faire ; ce qui lui était commandé, il l’oubliait ; il avait été poursuivi comme par un mauvais esprit ; un jour, enfin, où il avait su qu’elle était dans une chambre haute, il l’avait suivie, ou plutôt il s’était senti entraîné après elle. Gomme elle ne se rendait pas à ses prières, il avait voulu employer la force. Il ne savait pas ce qui s’était passé en lui, et prenait Dieu à témoin que ses vues sur elle avaient toujours été pures, et qu’il n’avait rien désiré plus ardemment que de pouvoir l’épouser et passer sa vie avec elle. Après avoir ainsi parlé quelque temps, il hésita, comme une personne qui a quelque chose à dire encore,- et qui n’ose le proférer. Enfin il m’avoua timidement les petites familiarités qu’elle lui avait permises, et les faveurs qu’elle lui avait accordées. Il s’interrompit deux ou trois fois, et me répéta ses plus vives protestations qu’il ne disait pas cela « pour la mépriser, » selon ses expressions ; qu’il l’aimait et l’estimait comme auparavant ; que ces choses-là n’étaient jamais sorties de sa bouche, et qu’il me les disait uniquement pour me convaincre qu’il n’était pas un méchant ni un insensé…. Et maintenant, mon ami, je recommence mon vieux refrain, que je répéterai toujours : si je pouvais te dépeindre ce jeune homme, tel qu’il était, tel qu’il est encore devant moi ! Si je pouvais tout te dire parfaitement, pour te faire sentir comme je m’intéresse, comme je dois m’intéresser à son sort ! Il suffit : tu connais aussi le mien, tu me connais, et tu ne sais que trop bien ce qui m’atlire vers tous les malheureux, et particulièrement vers celui-là.
Je relis ma lettre, et je vois que j’ai oublié de te raconter la fin de l’histoire, qui se devine d’ailleurs aisément. La veuve se défendit ; son frère survint : il haïssait depuis longtemps le valet ; depuis longtemps il avait désiré le voir sortir de la maison, parce qu’il craignait qu’un nouveau mariage de sa sœur ne privât ses enfants de l’héritage, sur lequel ils avaient alors de belles espérances, la veuve n’ayant point d’enfants. Ce frère l’avait aussitôt chassé de la maison, et avait fait tant de bruit de la chose, que la maîtresse, quand même elle l’aurait voulu, n’aurait pas osé le reprendre. Maintenant elle avait un autre domestique, au sujet duquel on la disait aussi brouillée avec son frère, et l’on assurait qu’elle devait l’épouser : mais il était, lui, fermement résolu à ne pas souffrir la chose de son vivant.
Cette histoire n’est point exagérée, point embellie ; je puis dire même que je l’ai racontée faiblement, très-faiblement, et qu’elle a perdu de sa délicatesse, parce que je l’ai rapportée avec nos formes de langage usuelles et réservées.
Cet amour, cette fidélité, cette passion, n’est donc pas une fiction poétique ; elle vit, elle existe, dans sa parfaite pureté, parmi cette classe d’hommes que nous appelons incultes et grossiers, nous autres gens polis, polis jusqu’à n’être plus rien. Lis cette histoire avec recueillement, je t’en prie. Je suis calme aujourd’hui en t’écrivant ces choses ; tu le vois à mon écriture, je ne me presse ni ne barbouille comme d’ordinaire. Lis, mon cher Wilhelm, et songe bien que c’est aussi l’histoire de ton ami. Oui, voilà ce qui m’est arrivé, voilà ce qui m’arrivera, et je ne suis pas de moitié aussi courageux,, aussi résolu que ce pauvre malheureux, auquel j’ose à œine me comparer.
5 septembre.
Elle avait écrit un petit billet à son mari, qui était à la campagne, où des affaires le retenaient. Le billet commençait ainsi : « Cher, très-cher ami, reviens aussitôt que tu pourras ; je t’attends avec mille joies…. » Un ami, qui survint, apporta la nouvelle que certaines circonstances empêcheraient Albert de revenir de sitôt. Le billet resta sur la table, et, le soir, il me tomba dans les mains. Je le lus et je souris. Elle me demanda pourquoi…. * Q’ue l’imagination est un présent divin ! m’écriai-je ; j’ai pu me figurer un moment que cela m’était adressée. » Elle brisa là-dessus ; cela parut lui déplaire, et je me tus.
6 septembre.
Ce n’est pas sans peine que je me suis résolu à mettre de côté le simple habit bleu que je portais, le jour où je dansai avec Charlotte pour la première fois, mais il avait fini par être tout à fait passé. J’en ai commandé un tout pareil, collet et parements, et toujours avec la veste et la culotte jaunes.
Cela ne fera plus sans doute le même effet. Je ne sais…. avec le temps, celui-ci me deviendra, je crois, plus cher à son tour. •
12 sepiembre.
Elle avait été quelques jours absente, elle était allée chercher Albert. Aujourd’hui j’entre dans sa chambre : elle vient au-devant de moi, et je lui baise la main avec transport.
Un serin de Canarie vole du miroir sur son épaule, i C’est un nouvel ami, ditelle, puis elle l’attire sur sa main. Il est destiné à mes petits. Jlest trop charmant. Voyez ! quand je lui donne du pain, il bat des ailes et becqueté si joliment ! Il me baise aussi : voyez ! »
Elle tendit la bouche au petit oiseau, et il se pressa aussi amoureusement contre ses douces lèvres que s’il avait pu sentir la félicité dont il jouissait.
« Il faut aussi qu’il vous baise, » ditelle, et elle avança l’oiseau de mon côté. Le petit bec passa de la bouche de Charlotte à la mienne, et ses picotements étaient comme un souffle, un avantgoût d’amoureux plaisir.
« Son baiser, ai-je dit, n’est pas tout à fait désintéressé ; il cherche de la nourriture, et se retire mécontent après une caresse vide. — II mange aussi ù ma bouche, » ditelle. Elle lui présenta quelques miettes de pain avec ses lèvres, sur lesquelles souriaient avec volupté les joies d’un innocent amour.
Je détournai le visage. Elle ne devait pas faire cela ! Elle ne devait pas. enflammer mon imagination avec ces emblèmes d’innocence et de félicité céleste, et réveiller mon cœur du sommeil où le berce quelquefois l’indifférence de la vie !… Et pourquoi non ? Elle se fie à moi ; elle sait comme je l’aime.
15 septembre.
Wilhelm, on deviendrait furieux de voir qu’il y ait des hommes incapables de goûter et de sentir le peu de biens qui ont encore quelque valeur sur la terre. Tu connais les noyers sous lesquels je me .suis assis avec Charlotte, à St…, chez le bon pasteur, ces magnifiques noyers, qui, Dieu le sait, me remplissaient toujours d’une joie calme et profonde. Quelle paix, quelle fraîcheur ils répandaient sur le presbytère ! Que les rameaux étaient majestueux ! Et le souvenir enfin des vénérables pasteurs qui les avaient plantés, tant d’années auparavant !… Le maître d’école nous a dit souvent le nom de l’un d’eux, qu’il avait appris de son grand-père. Ce fut sans doute un homme vertueux, et, sous ces arbres, sa mémoire me fut toujours sacrée. Eh bien, le maître d’école avait hier les larmes aux yeux, comme nous parlions ensemble de ce qu’on les avait abattus. Abattus ! j’en suis furieux, je pourrais tuer le chien qui a porté le premier coup de hache. Moi, qui serais capable de prendre le deuil, si, d’une couple d’arbres tels que ceux-là, qui auraient existé dans ma cour, l’un venait à mourir de vieillesse, il faut que je voie une chose pareille !… Cher Wilhelm, il y a cependant une compensation. Chose admirable que l’humanité ! Tout le village murmure, et j’espère que la femme du pasteur s’apercevra au beurre, aux œufs et autres marques d’amitié, de la blessure qu’elle a faite à sa paroisse. Car c’est elle, la femme du nouveau pasteur (notre vieux est mort), une personne sèche, maladive, qui fait bien de ne prendre au monde aucun intérêt, attendu que personne n’en prend à elle. Une folle, qui se pique d’être savante ; qui se mêle de l’étude du canon ; qui travaille énormément à la nouvelle réformation morale et critique du christianisme ; à qui les rêveries de Lavater font lever les épaules ; dont la santé est tout à fait délabrée, et qui ne goûte, par conséquent, aucune joie sur la terre de Dieu ! Une pareille créature était seule capable de faire abattre mes noyers. Vois-tu, je n’en reviens pas. Figuretoi que les feuilles tombées lui rendent la cour humide et malpropre ; les arbres interceptent le jour à madame, et, quand les noix sont mûres, les enfants y jettent des pierres, et cela lui donne sur les nerfs, la trouble dans ses profondes méditations, lorsqu ’elle pèse et met en parallèle Kennikot, Semler et Michaè’lis. Quand j’ai vu les gens du village, surtout les vieux, si mécontents, je leur ai dit : « Pourquoi l’avez-vous souffert ?— A la campagne, m’ontils répondu, quand le maire veut quelque chose, que peut-on /aire ? * Mais voici une bonne aventure. : le-pasteur espérait aussi tirer quelque avantage des caprices de sa femme, qui d’ordinaire ne rendent pas sa soupe plus grasse, et il croyait partager le produit avec le maire ; la chambre des domaines en fut avertie et dit : « A moi, s’il vous plaît ! » car elle avait d’anciennes prétentions sur la partie du presbytère où les arbres étaient plantés, et elle les a vendus aux enchères. Ils sont à bas ! Oh ! si j’étais prince, la femme du pasteur, le maire, la chambre des domaines, apprendraient…. Prince !… Eh ! si j’étais prince, que m’importeraient les arbres de mon pays ?
10 octobre.
Que je voie seulement ses yeux noirs et je suis heureux ! Et ce qui me chagrine, c’est qu’Albert ne semble pas être aussi heureux qu’il…. l’espérait, que je — croyais l’être, si — Je-n’aimc pas à faire des traits de plume, mais ici je ne puis m’exprimer autrement — et il me semble que c’est assez clair.
12 octobre.
Ossian a pris la place d’Homère dans mon cœur. Quel monde que celui où me promène ce poète sublime ! Errer sur la bruyère, au murmure du vent des tempêtes, qui, dans les nues vaporeuses, emporte les fantômes des aïeux, à la pâle clarté de la lune ; entendre de la montagne, à travers le mugissement du torrent des bois, les gémiss’ements, à demi perdus dans l’orage, que les esprits exhalent de leurs cavernes, et les lamentations de la jeune fille, qui soupire sa douleur mortelle autour des quatre pierres moussues, gazonnées, du héros tombé, qu’elle aimait ! Si je rencontre ensuite le barde aux cheveux blancs, à la course vagabonde, qui cherche sur la vaste bruyère les traces de ses aïeux, et ne trouve, hélas ! que leurs tombeaux, et tourne ses regards en gémissant vers la douce étoile du soir, qui se cache dans là mer orageuse, et si les âges passés revivent dans l’âme du héros, alors que le rayon propice éclairait les périls des braves, et que la lune versait sa lumière sur le navire couronné, qui revenait vainqueur ; si je lis sur son front la dou-. leur profonde ; si je vois le dernier héros, resté seul sur la terre, marcher, accablé de lassitude et chancelant, vers la tombe, tandis qu’il puise des joies toujours nouvelles, douloureuses, brûlantes, dans l’impuissante présence des ombres de ses morts bien-aimés, et baisse les yeux sur la terre glacée, sur les hautes herbes flottantes, et s’écrie : « 11 viendra, il viendra, le voyageur qui me connut dans ma beauté, et il dira : « Où est le « barde, le noble fils de Fingal ? « son pied foulera ma tombe, et il me demandera vainement sur la terre…. » o mon ami, je tirerais volontiers l’épée, comme un noble écuyer, pour délivrer tout d’un coup mon prince des poignantes tortures d’une vie qui lentement s’exhale, et pour envoyer mon âme rejoindre le demi-dieu délivré.
19 octobre.
Ah ! ce vide, ce vide affreux, que je sens dans mon cœur !… Je me dis souvent : « Si tu pouvais une fois, une seule fois, la presser sur ton sein, tout ce vide serait comblé. »
26 octobre.
Oui, mon cher Wilhelm, je me persuade chaque jour davantage que l’existence d’une créature est peu de chose, bien peu de chose. Une amie de Charlotte était venue la voir, et je passai dans la chambre voisine pour prendre un livre, et je ne pouvais lire : alors je pris une plume pour essayer d’écrire. Je les entendais causer doucement : elles se racontaient l’une à l’autre des choses indifférentes, des nouvelles de la ville ; que l’une se mariait, que l’autre était malade, très-malade ; elle avait une toux sèche, la figure décharnée ; il lui prenait des faiblesses. « Je ne donnerais pas un sou de sa vie, » disait l’une. « N. N. est aussi fort mal, » dit Charlotte. « II est enflé, » reprit l’amie Et mon imagination me transportait vivement au chevet de ces malheureux ; je voyais avec quelle répugnance ils tournaient le dos à la vie ; avec quel…. Wilhelm, et mes deux petites dames parlaient de cela précisément comme on parle d’un étranger qui meurt…. Et quand je porte les yeux autour de moi, quand je regarde cette chambre et, tout alentour, les habits de.Charlotte et les papiers d’Albert, et ces meubles auxquels je suis maintenant si accoutumé, même cet encrier, je me dis : « Vois ce que tu es’pour cette maison ! Tout pour tous. Tes amis te considèrent ; tu fais souvent leur joie, et il semble à ton cœur, qu’il ne pourrait vivre sans eux ; et pourtant…, si tu venais à mourir, si tu disparaissais de ce cercle, sentiraient-ils, combien de temps sentiraient-ils, le vide que ta perte ferait dans leur existence ? combien de temps ?… » Ah ! l’homme est si éphémère, qu’aux lieux mêmes où il a l’entière certitude de son être, où il grave la seule véritable impression de sa présence dans le souvenir, dans l’âme de ses amis, là même, il doit s’effacer, disparaître, disparaître promptement !
27 octobre.
Je me déchirerais la poitrine, je me battrais la tête contre les murs, quand je vois combien nous pouvons peu de chose les uns pour les autres. Ah ! l’amour, la joie, l’ardeur et la volupté que je ne porte pas en moi, un autre ne saurait me les donner, et je ne rendrai pas heureux celui qui est là devant moi sans chaleur et sans force.
27 octobre, au soir.
Tant de choses en moi, et sa pensée absorbe tout-tant de choses, et, sans elle, tout ne m’est rien.
30 octobre.
Si je n’ai pas été déjà cent fois sur le point de me jeter à son cou ! Le grand Dieu sait ce que l’on souffre à voir passer et repasser devant soi tant de charmes, sans oser y porter la main ; et porter la main sur les choses est pourtant le penchant le plus naturel de l’humanité. Les enfants ne veulent-ils pas saisir tout ce qui tombe sous leurs sens ? Et moi !…
3 novembre.
Dieu le sait, je me couche souvent avec le désir, quelquefois même avec l’espérance de ne pas me réveiller, et, le matin,, j’ouvre les yeux, je revois le soleil et je suis malheureux. Oh ! si je pouvais être fantasque, si je pouvais m’en prendre au temps qu’il fait, à un tiers, à une entreprise manquée, l’insupportable fardeau du mécontentement ne pèserait sur moi qu’à demi. Malheur à moi ! Je sens trop bien que toute la faute est à moi seul…. non pas la faute ! La vérité, c’est que la source de • toutes les misères est cachée en mon sein, comme autrefois la source de toutes les félicités. Ne suis-je pas toujours ce Werther, qui flottait jadis dans un monde de sentiments ; qu’un paradis suivait à chaque pas ; qui avait un cœur capable d’embrasser dans son amour tout l’univers ? Et maintenant, ce cœur est mort ; de lui ne s’épanchent plus aucuns ravissements ; mon œil est sec, et, mes sens n’étant plus soulagés par des larmes rafraîchissantes, mon front se contracte avec angoisse. Je souffre beaucoup, car j’ai perdu ce qui était l’unique joie de ma vie, la force sainte, vivifiante, avec laquelle je créais des mondes autour de moi : elle est perdue !… Quand, de ma fenêtre, je vois la colline lointaine ; et comme, sur la cime, le soleil matinal traverse le brouillard, et illumine, au fond de la vallée, les tranquilles prairies ; comme la douce rivière serpente vers moi à travers les saules défeuillés…. oh ! quand cette magnifique nature est là sans vie devant moi, comme une estampe coloriée ; quand tous ces objets ravissants ne peuvent faire monter de mon cœur à mon cerveau une étincelle de joie, et que le misérable est là tout entier devant la face de Dieu comme une fontaine tarie, comme un seau desséché !… Souvent je me suis prosterné sur la terre, et j’ai demandé à Dieu des larmes, comme un laboureur demande la pluie, quand il voit sur sa tête le ciel d’airain et autour de lui la campagne brûlée.
Mais, hélas ! je le sens, Dieu n’accorde point la pluie et le soleil à nos prières impatientes, et ces temps, dont le souvenir me torture, pourquoi furent-ils si fortunés, sinon parce que j’attendais avec patience son esprit, et recevais avec une entière, une profonde reconnaissance les délices qu’il répandait sur moi ?
8 novembre.
Elle m’a reproché mes excès !… hélas ! avec quelle grâce !… Mes excès, parce que, d’un verre à l’autre, je me laisse parfois entraîner à boire une bouteille. « Ne faites pas cela, ditelle : pensez à Charlotte. — Penser ! lui dis-je, avez-vous besoin de me l’ordonner ? Je pense !… Je ne pense pas !… Vous êtes toujours présente à mon âme ; Aujourd’hui j’étais assis à la place où, dernièrement, vous descendîtes de voiture…. » Charlotte s’est mise à parler d’autre chose, pour ne pas me laisser approfondir ce texte davantage. Cher ami, je ne suis plus rien : elle peut faire de moi ce qu’elle voudra.
15 novembre.
Je te remercie Wilhelm, de ta cordiale affection, de tes conseils bienveillants, et je te prie d’être en repos. Laisse-moi souffrir ce mal jusqu’à la fin. Quelle que soit ma peine, j’ai encore assez de force pour aller jusqu’au bout. J’honore la religion, tu le sais ; je sens qu’elle est le bâton de plusieurs, que la fatigue accable, le rafraîchissement de plusieurs qui languissent : mais peut-elle, doit-elle l’être pour chacun ? Si tu observes le monde, tu vois des milliers d’hommes, évangélisés ou non, pour qui elle ne l’a pas été, des milliers pour qui elle ne le sera jamais. Et le doit-elle être pour moi ? Le fils de Dieu ne dit-il pas lui-même que ceux-là seront auprès de lui, que le Père lui aura donnés ? Et si je ne lui fus pas donné ? si le Père veut me garder pour lui-même, comme mon cœur me le dit ? Je t’en prie, n’explique pas mal ma pensée ; ne vois pas une raillerie dans ces paroles innocentes ; c’est mon âme tout entière que j’expose devant toi. Autrement j’aimerais mieux avoir gardé le silence : car d’ailleurs je ne trouve aucun plaisir à1 perdre une parole sur des matières que chacun entend aussi peu que moi. N’est-ce pas la destinée de l’homme, de supporter sa mesure de souffrances et de boire sa coupe tout entière ?… Et si le Dieu du ciel trouva le calice trop amer pour ses lèvres humaines, pourquoi ferais-je le magnanime, et affecterais-je de le trouver agréable ? Et pourquoi sentirais-je une fausse honte dans le moment terrible où tout mon être frémit entre l’existence et le néant ; où le passé brille comme un éclair sur le ténébreux abîme de l’avenir ; où tout s’écroule autour de moi ; où tout l’u-, nivers s’abîme avec moi… ? N’est-ce pas la voix de la créature angoissée, défaillante, entraînée dans le précipice par une force irrésistible, de s’écrier, en frémissant, dans les plus secrètes profondeurs de ses forces, épuisées par d’inutiles combats : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’avez-vous abandonné ? » Devrais-je rougir de cette parole, s’il m’arrivait de sentir de l’angoisse, en présence du moment auquel n’a pas échappé celui qui roule le ciel comme une tente ?
21 novembre.
Elle ne voit pas, elle ne sent pas qu’elle prépare un poison qui nous perdra tous deux, et moi, avec une pleine volupté, je bois jusqu’au fond la coupe qu’elle me présente pour ma perte. Que signifie le doux regard que souvent…. non, pas souvent, mais quelquefois, elle m’adresse ; sa complaisance pour accueillir une expression involontaire de mes sentiments ; sa compassion pour mes souffrances, qui se dessine sur son front ?
Hier, comme je me retirais, elle me tendit la main et me dit : * Adieu, cher Werther—•» Cher Werther ! C’était la première fois qu’elle me qualifiait ainsi, et cette parole me pénétra jusqu’à la moelle des os. Je me la suis répétée cent fois, et, comme je me couchais, et babillais avec moi de mille choses, je me suis dit tout à coup : « Bonne nuit, cher Werther, » et là-dessus je n’ai pu m’empêcher de rire de moi-même.
22 novembre.
Je ne puis dire : « MoR’Dieu, laisse-Ja-moi ! » et pourtant il”me semble souvent qu’elle est mienne. Je ne puis, dire non plus : « Mon Dieu, donne-la-moi ! » car elle appartient à un antre. Je subtilise avec mes douleurs ; si ’je voulais me le permettre, je débiterais toute une litanie d’antithèses.
24 novembre.
Elle sent ce que je souffre : aujourd’hui son regard a pénétré jusqu’au fond de mon cœur. Je l’ai trouvée seule ; je ne disais rien, et elle m’a regardé. Et je ne voyais plus en elle la beauté charmante, je ne voyais plus la lumière de la noble intelligence ; tout cela s’était évanoui devant mes yeux : un regard bien plus admirable encore agissait sur moi ; il était plein de l’intérêt le plus tendre, de la plus douce pitié. Pourquoi n’osai-je pas tomber à ses pieds ? Pourquoi n’osai-je pas me jeter à son cou et lui répondre par mille baisers ? Elle s’est réfugiée au clavecin, et, d’une voix douce et légère, elle unissait à son jeu des notes harmonieuses. Jamais je n’avais vu ses lèvres aussi séduisantes ; on eût dit qu’elles s’ouvraient avec ardeur pour boire les doux sons qui coulaient de l’instrument, et auxquels sa bouche pure répondait seulement comme un écho • céleste…. Oui, si je pouvais te le dire…. Je n’ai pas résisté plus longtemps, je me suis incliné et j’en ai fait le serment. Jamais je n’oserai imprimer sur vous un baiser, ô lèvres, sur lesquelles voltigent les esprits du ciel. Et pourtant…. je veux…. Ah ! vois-tu, c’est comme un mur de séparation devant mon âme…. Cette félicité…. et puis mourir pour expier cette faute !… Une faute ?
26 novembre.
Quelquefois je me dis : « Ta destinée est unique : estime les autres heureux…. Personne encore ne fut tourmenté comme toi. » Ensuite je lis un ancien poète, et il me semble voir dans mon propre cœur. J’ai tant à souffrir ! Hélas ! il y eut donc avant moi des hommes aussi malheureux !
30 novembre.
Jamais, non jamais je ne reviendrai à moi-même. Où que je porte mes pas, une apparition se présente, qui me met hors de moi. Aujourd’hui…. ô destinée !… pauvre humanité !
J’étais allé à la fontaine vers midi : je n’avais aucune envie de me mettre à table. Tout semblait désert ; un vent d’ouest ; humide et froid, soufflait de la montagne, et des nuages grisâtres, chargés de pluie, s’avançaient dans la vallée. J’ai vu au loin un homme vêtu d’un méchant habit vert, qui grimpait entre les rochers et semblait chercher des herbes. Quand je me fus approché de lui, et qu’au bruit que je fis, il eut tourné la tête, je vis une physionomie intéressante, dont une paisible tristesse faisait le principal caractère, mais qui d’ailleurs n’exprimait autre chose qu’un sentiment honnête et bon ; une partie de ses cheveux noirs étaient fixés en deux rouleaux avec des épingles ; les autres étaient réunis en une forte tresse qui lui descendait sur les épaules. Comme sa mise me semblait annoncer un homme do la classe inférieure, je crus qu’il ne s’oflense
• rait pas de me voir attentif à son travail, et je lui demandai ce qu’il cherchait. « Je cherche des fleurs, répondit-il avec un profond soupir, et je n’en trouve point. — Aussi n’est-ce pas la saison,dis-je en souriant. — II y a tant de fleurs ! dit-il, en descendant jusqu’à moi. Dans mon jardin, il y a des rosés et deux espèces de chèvrefeuilles, dont l’une m’a été donnée par mon père. Cela pousse comme la mauvaise herbe. Voilà deux jours que j’en cherche, et je ne puis en trouver. Là dehors, il y a toujours des fleurs aussi, des jaunes, des bleues, des rouges ; et la centaurée est une jolie petite fleur. Je n’en puis trouver aucune…. » Je remarquais chez l’homme quelque chose d’inquiet, et je lui demandai, en prenant un détour, ce qu’il voulait faire de ces fleurs. Un sourire étrange et convulsif altéra son visage. « Ne me trahissez pas, dit-il, en se posant le doigt sur la bouche : j’ai promis un bouquet à ma bien-aimée. — C’est fort bien, lui dis-je. — Oh ! reprit-il, elle a bien d’autres choses ; elle est riche. — Et pourtant, repris-je, elle fait cas de votre bouquot. — Oh ! poursuivit-il, elle a des joyaux et une couronne. — Et quel est son nom ? — Si les états généraux voulaient me payer, reprit-il, je serais un autre homme. Oui, il fut un temps où tout allait bien pour moi. Maintenant c’en est fait…. Je suis…. » Un regard humide vers le ciel avait tout dit. « Vous étiez donc heureux ? demandai-je. — Ah ! je voudrais être encore ainsi. J’étais si bien, si joyeux, a mon aise, comme un poisson dans l’eau. — Henri ! cria une vieille femme, qui venait à nous, Henri ! où es-tu fourré ? Nous t’avons cherché partout. Viens dîner. — Est-ce votre ù’is ? lui demandai-je en m’approchant d’elle. — Oui, mon pauvre fils. Dieu m’a imposé une lourde croix. — Depuis combien de temps est-il ainsi ? — Ainsi tranquille ? ditelle ; depuis six mois. Dieu soit loué, qu’il en soit du moins venu là ! Auparavant il a été furieux toute une année, et on l’a tenu à la chaîne dans la maison des aliénés. A présent il ne fait de mal à personne : seulement il a toujours affaire à des rois et des empereurs. Il était si bon, si tranquille ! il m’aidait à vivre ; il avait une belle écriture. Tout à coup il devient rêveur, il tombe dans une fièvre chaude, puis dans le délire. A présent
il est comme vous voyez. Si je vous racontais, monsieur
J’interrompis ce flux de paroles, en disant : « Quel était donc ce temps, qu’il vante si fort, où il fut, dit-il, si heureux, si content ?— Le pauvre fou ! ditelle, avec un sourire de pitié. Il veut parler du temps où il était hors de lui : c’est celui qu’il vante toujours, le temps où il était dans la maison de santé, où il ne se connaissait point. » Cette réponse me frappa comme un coup de tonnerre. Je mis une pièce d’argent dafis la main de la vieille, et la quittai bien vite.
« Le temps où tu étais heureux ! m’écriai-je, en retournant à grands pas à la ville ; où tu étais comme un poisson dans l’eau !… Dieu du ciel, est-ce là le sort que tu as réservé aux hommes, qu’ils ne soient heureux qu’avant d’être arrivés à l’âge de la raison et après l’avoir perdue ?… Infortuné ! Et pourtant j’envie ton égarement et le trouble d’esprit dans lequel tu languis. Tu sors de chez toi plein d’espérance ; tu vas cueillir des fleurs pour ta reine…. en hiver…. et tu t’affliges de n’en point trouver, et ne peux comprendre pourquoi tu n’en trouves pas : et moi…. je sors sans espérance, sans but, et je reviens comme je suis allé.,.. Tu te figures quel homme tu serais, si les états généraux te payaient : homme heureux, qui peux attribuer à un obstacle terrestre ton défaut de bonheur ! Tu ne sens pas, tu ne sens pas qu’elle réside en ton cœur brisé, en ton cerveau troublé, ta misère, dont tous les rois de la terre ne peuvent te délivrer. »
Qu’il meure dans le désespoir, celui qui se raille d’un malade parti pour les eaux lointaines, qui augmenteront sa maladie et rendront sa fin plus douloureuse ; celui qui insulte au cœur oppressé, qui, pour se délivrer de ses remords et mettre un terme aux douleurs de son âme, entreprend un pèlerinage au saint sépulcre ! Chaque pas qui déchire la plante de ses pieds sur des chemins non frayés est une goutte de baume pour son âme oppressée ; à chaque journée de marche qu’il endure, son cœur se repose, soulagé de nombreux soucis. Et vous osez appeler cela folie, vous autres marchands de paroles, assis sur vos coussins ?… Folie !… 0 Dieu, tu vois mes larmes ! Fallait-il, après avoir créé l’homme assez pauvre, lui donner encore des frères, pour lui dérober le peu qu’il possède, le peu de confiance qu’il a en toi, en toi, Amour infini ! Car la confiance dans une racine salutaire, dans les pleurs de la vigne, qu’est-ce autre chose que de la confiance en toi, et la persuasion que tu as communiqué à tout ce qui nous environne une vertu qui guérit ou qui soulage, dont nous avons besoin à toute heure ? 0 Père, que je ne connais pas, Père, qui remplissais autrefois mon âme tout entière, et qui maintenant as détourné de moi ta face, daigne m’appeler à toil Ne garde pas plus longtemps le silence ! Ton silence n’arrêtera pas cette âme altérée…. Un homme, un père, pourrait-il entrer en courroux, quand son fils, revenu à l’improviste, se jetterait à son cou et s’écrierait : « Je reviens, mon père ! Ne sois pas irrité, si j’abrège le pèlerinage, que, selon ta volonté, j’aurais dû poursuivre plus longtemps. Le monde est partout le même ; après la peine et le travail, la récompense et le plaisir : mais que m’importe cela ? Je ne suis bien qu’aux lieux ou lu es, et je veux être heureux ou malheureux en ta présence…. * Et toi, bon Père céleste, ce fils, le repousseraistu loin de toi ?
1” décembre.
Wilhelm, cet homme dont je t’ai parlé, cet heureux infortuné, était commis chez le père de Charlotte, et une passion qu’il nourrissait pour elle, qu’il dissimulait, qu’il découvrit, et pour laquelle il fut congédié, l’a rendu fou. A ces sèches paroles, figuretoi dans quel égarement cette histoire m’a plongé, lorsqu’Albert me l’a racontée aussi froidement que tu la liras peut-être.
4 décembre.
Je t’en prie…. Vois-tu, c’en est fait de moi ; je ne puis le souffrir plus longtemps. Aujourd’hui j’étais assis près d’elle…. j’étais assis, elle jouait du clavecin ; c’étaient diverses mélodies, et toujours avec une expression !… Que dirai-je ? Sa petite sœur habillait sa poupée sur mon genou. Les larmes me • sont venues aux yeux. Je me suis baissé et son anneau de mariage a frappé ma vue…. Mes pleurs ont coulé…. Et tout à coup elle a commencé cette ancienne mélodie, d’une douceur céleste, tout à coup…. Et il s’éveille au fond de mon âme un délicieux sentiment et un sauvenir du passé, des temps où j’avais entendu cette mélodie, des sombres intervalles qui suivirent, du chagrin, des espérances trompées, et puis…. J’allais et venais dans la chambre, mon cœur se brisait. « Au nom de Dieu, lui dis-je avec véhémence, en courant à elle, au nom de Dieu, finissez. » Elle cessa, et me regarda fixement. Werther, » ditelle, avec un sourire qui me pénétra, «Werther, vous êtes bien malade ; vos mets favoris vous répugnent. Allez, calmez-vous, je vous prie. » Je me suis arraché d’auprès d’elle, et…. Dieu, tu vois ma souffrance et tu y mettras fin.
6 décembre.
Comme cette image me poursuit ! Que je veille ou que je rêve, elle remplit toute mon urne. Ici, quand je ferme les yeux, ici, dans mon front, où se concentre la vision intérieure, sont toujours ses yeux noirs. Ici ! Je ne puis t’exprimer cela. Si je ferme mes paupières, ils sont là ; ils sont devant moi, dans moi, comme un abîme ; ils possèdent tous mes sens.
Qu’est-ce que l’homme, ce demi-dieu si vanté ? Les forces ne lui manquent-elles pas précisément quand elles lui sont le plus nécessaires ? Et qu’il prenne l’essor dans la joie ou qu’il s’abîme dans la douleur, n’est-il pas arrêté soudain, ramené soudain au sentiment froid et borné de lui-même, quand il aspirait à se perdre dans l’océan de l’infini ?
L’ÉDITEUR AU LECTEUR.
J’aurais vivement désiré qu’il nous fût resté, sur les derniers jours, si remarquables, de notre ami, assez de renseignements écrits de sa main, pour ne pas être obligé d’interrompre par le récit la suite des lettres qu’il a laissées.
Je me suis attaché à recueillir d’exactes informations de la bouche des personnes qui pouvaient être bien instruites de son histoire ; elle est simple, et toutes les relations s’accordent entre elles, sauf dans quelques détails insignifiants. C’est seulement sur les caractères des personnages que les opinions sont diverses et les jugements partagés. Que nous reste-t-il à faire, sinon de raconter fidèlement ce que nos recherches multipliées ont pu nous apprendre ; d’insérer dans le récit les lettres qui restent du défunt, sans dédaigner le plus petit billet qu’on a pu retrouver ? d’autant qu’il est bien difficile de découvrir les propres et vrais mobiles même d’une seule action, quand elle se passe parmi des” hommes qui sortent de la ligne commune !
Le découragement et la tristesse avaient jeté dans l’urne de Werther des racines toujours plus profondes ; elles s’étaient . entrelacées plus fortement et s’étaient emparées par degrés de tout son être. L’harmonie de son esprit était complètement détruite ; une ardeur et une violence secrètes, qui agitaient confusément toutes ses facultés, produisirent les plus fâcheux effets,, et ne lui laissèrent à la fin qu’un abattement auquel il ne s’arrachait plus qu’avec des angoisses plus pénibles que tous les maux contre lesquels il avait lutté jusqu’alors. L’angoisse de son cœur consuma les dernières forces de son esprit, sa vivacité, sa pénétration ; il devenait morose, toujours plus malheureux, et, à proportion, toujours plus injuste. C’est là du moins ce que disent les amis d’Albert ; ils soutiennent que Werther, qui consumait, pour ainsi dire, chaque jour tout son bien, pour éprouver, le soir, la souffrance et la disette, n’avait pu apprécier ni cet homme pur et paisible, qui était parvenu à jouir d’un bonheur longtemps désiré, ni sa conduite pour s’assurer ce bonheur dans l’avenir. Albert, disentils, n’avait point changé en si peu de temps ; c’était toujours l’homme que Werther avait connu dès l’origine, qu’il avait tant estimé et honoré. Il aimait Charlotte par-dessus tout ; il mettait en elle son orgueil, et il souhaitait que chacun la reconnût pour la plus parfaite des créatures. Pouvait-on le blâmer, par conséquent, s’il désirait écarter loin d’elle toute apparence de soupçon ? s’il n’était alors disposé à partager avec personne, même de la manière la plus innocente, un si précieux trésor ? Ils avouent qu’Albert quittait souvent la chambre de sa femme q’uand Werther était chez elle, mais ce n’était ni par haine, ni par éloignement pour son ami ; c’était seulement parce qu’il avait senti que Werther était gêné par sa présence.
Le père de Charlotte fut pris d’une indisposition qui l’obligea de garder la chambre ; il envoya sa voiture à sa fille, qui se rendit chez lui. C’était un beau jour d’hiver ; la.première neige était tombée en abendance, et couvrait tout le pays. Werther la rejoignit le lendemain, pour la ramener chez elle, si Albert ne venait pas la chercher. La sérénité du ciel produisit peu d’effet sur son humeur sombre ; une morne tristesse pesait sur son cœur ; de lugubres images s’étaient emparées de lui, et son esprit ne savait plus que passer d’une idée douloureuse à une autre. Comme il vivait dans un mécontentement perpétuel de luimême, la situation des autres lui semblait aussi plus critique et plus troublée ; il croyait avoir détruit la bonne intelligence • entre Albert et sa femme ; il s’en faisait des reproches, auxquels se mêlait un dépit secret contre le mari. En chemin, ses pensées tombèrent aussi sur ce sujet. « Oui, oui, se disait-il, avec une sourde colère, voilà cette union intime, affectueuse, tendre et toujours sympathique ! cette paisible et constante fidélité ! Ce n’est que satiété et indifférence. L’affaire la plus misérable ne l’occupe-t-elle pas plus que cette chère et précieuse femme ? Sait-il apprécier son bonheur ? Sait-il estimer Charlotte comme elle le mérite ? Elle est à lui ! fort bien, elle est à lui !… Je sais cela, comme je sais autre chose. Je crois être accoutumé à cette pensée : elle me rendra furieux, elle me tuera…. Et son amitié pour moi, a-t-elle persisté ? Déjà ne voit-il pas, dans mon attachement à Charlotte, une atteinte à ses droits ; dans mes attentions pour elle, un secret reproche ? Je le sais bien, je le sens, il me voit de mauvais œil, il désire que je m’éloigne : ma présence lui pèse. »
Souvent il ralentissait sa marche rapide, souvent il s’arrêtait, et semblait vouloir retourner sur ses pas, mais il poursuivait toujours son chemin ; et, avec ces pensées et ces monologues, il était enfin arrivé, comme malgré lui, à la maison de chasse.
Il entra, il demanda des nouvelles du vieillard et de Charlotte. Il trouva dans la maison quelque mouvement. L’aîné des fils lui dit qu’il était arrivé u-n malheur à Wahlheim ; un paysan venait d’être assassiné…. Cela ne fit sur lui aucune impression particulière…. 11 entra dans la chambre, et trouva Charlotte occupée à dissuader le vieillard, qui, malgré sa maladie, voulait se transporter sur les lieux pour faire l’enquête. Le coupable était encore inconnu ; on avait trouvé la victime le matin devant la porte de la maison. On formait des conjectures : le mort était le domestique d’une veuve, qui en avait eu auparavant un autre, lequel était sorti de la maisen en mauvais termes.
A cette nouvelle, Werther tressaillit. «Est-ce possible ? s’écria-t-il. J’y vais, il le faut : je ne puis tarder un moment. » II courut à Wahlheim. Tous ses souvenirs se réveillèrent, et il ne douta pas un instant que le coupable ne fût ce jeune homme auquel il avait parlé souvent, et qui lui était devenu si cher.
Comme il passait sous les tilleuls, pour se rendre au cabaret où l’on avait déposé le corps, il fut saisi d’horreur, à la vue de cette place, qu’il avait tant aimée. Le seuil sur lequel les enfants du voisin avaient joué tant de fois était souillé de sang. L’amour et la fidélité, les plus beaux sentiments de l’homme, s’étaient transformés en violence et en assassinat. Les grands arbres étaient sans feuillage et couverts de frimas ; les belles haies qui se courbaient par-dessus les petits murs du cimetière étaient défeuillées, et les pierres des tombeaux, couvertes de neige, paraissaient dans les places dégarnies.
Comme Werther approchait du cabaret, devant lequel tout le village était rassemblé, un cri se fit entendre soudain. On voyait au loin une troupe de gens armés, et chacun s’écria qu’on amenait le meurtrier. Werther jeta les yeux sur lui, et ne resta pas longtemps dans le doute. Oui, c’était le valet qui aimait tant cette veuve, celui qu’il avait rencontré naguère, courant la campagne, avec une morne fureur, avec un secret désespoir.
« Qu’as-tu fait, malheureux ! » cria Werther, en s’approchant du prisonnier.
Il jeta sur Werther un regard tranquille, garda un moment le silence, et répondit enfin sans s’émouvoir :
« Personne ne l’aura, elle n’aura personne. »
On fit entrer le prisonnier dans le cabaret, et Werther s’éloigna.
Cette affreuse et violente émotion lui avait causé une révolution générale. Il fut arraché pour un moment à sa tristesse, à son découragement, à sa résignation indifférente ; la compassion s’empara de lui avec une force irrésistible, et il fut saisi d’un indicible désir de sauver cet homme. Il le sentait si malheureux, il le trouvait même, comme meurtrier, si excusable, il se mettait si bien à sa place, qu’il croyait fermement persuader aussi les autres. Déjà il désirait pouvoir parler en sa faveur ; déjà le plus vif plaidoyer se pressait sur ses lèvres ; il courut à la maison de chasse, et, chemin faisant, il ne pouvait s’empêcher de débiter à demi-voix ce qu’il voulait représenter au bailli.
A son entrée dans la chambre, il se trouva en présence d’Albert. Cela le déconcerta un moment, muis il se remit bientôt, et il exposa avec chaleur ses sentiments au bailli, qui secouati la tête par moments ; et, quoique Werther présentât, avec la vivacité, la passion, Ta vérité la plus grande, ce qu’un homme peut dire pour en excuser un autre, le vieillard, comme on l’imagine aisément, n’en fut point ébranlé, et même il ne laissa pas notre ami aller jusqu’au-bout : il le contredit vivement, et le blâma de prendre un meurtrier sous sa protection ; il lui représenta que, de la sorte, toutes les lois seraient violées, que toute sûreté sociale serait anéantie ; il ajouta que d’ailleurs, dans un cas pareil, il ne pouvait rien faire sans se charger de la plus grande responsabilité ; tout devait se passer dans l’ordre et suivre la marche prescrite.
Werther ne se rendit pas encore, mais il se réduisit à demander que le bailli voulût bien fermer les yeux, si l’on facilitait l’évasion du jeune homme. Le bailli refusa encore. Albert, qui finit par se mêler à la conversation, se rangea à l’avis du vieillard ; Werther fut réduit au silence, et il se mit en chemin navré de douleur, après que le bailli lui eut dit plusieurs fois encore :
« Non, il ne peut être sauvé. »
Ces paroles le saisirent vivement, et nous pouvons en juger par un petit billet qui se trouva parmi ses papiers, et qui fut sans doute écrit le même jour.
« On ne .peut te sauver, malheureux ! Je vois bien qu’on ne peut nous sauver. »
Ce qu’Albert avait fini par dire sur l’affaire du prisonnier, en présence du bailli, avait blessé Werther au plus haut point ; il avait cru y remarquer une certaine animosité contre lui. Après de plus mûres réflexions, son esprit pénétrant ne manqua pas de reconnaître que ces deux hommes pouvaient avoir raison ; mais il lui sembla qu’il ne pouvait l’avouer, en convenir, sans renoncer à ses plus intimes sentiments.
Nous trouvons dans ses papiers une petite note qui se rapporte à ce sujet, et qui peut-être exprime le fond de ses. sentiments pour Albert :
« A quoi sert-il que je me dise et me dise encore : « II est « honnête et bon, » si tout mon cœur est déchiré ? Je ne puis être juste. »
La soirée était douce, le temps commençait à tourner au dégel, et’Charlotte revint à pied avec Albert. Chemin faisant, elle regardait par moments autour d’elle, comme si la compagnie de Werther lui avait manqué. Albert se mit à parler de l’absent : il le blâmait, tout en lui rendant justice. Il toucha sa malheureuse passion, et il exprima le désir qu’il fût possible de l’éloigner.
« Je le désire aussi pour nous, ajouta-t-il, et, je t’en prie, tâche de donner à ses façons d’agir avec toi une autre direction ; tâche de rendre plus rares ses trop fréquentes visites. Le monde commence à les remarquer, et je sais qu’on en a parlé en quelques lieux. »
Charlotte ne répondit rien, et Albert parut avoir entendu son silence : du moins, dès ce moment, il ne parla plus de Werther devant elle, et, lorsqu’elle en parlait, il laissait tomber la conversation ou la détournait sur un autre sujet.
La tentative inutile que Werther avait faite pour sauver le malheureux fut le dernier éclair d’une lumière qui s’éteint ; il, retomba plus profondément dans la langueur et la mélancolie ; il fut presque hors de lui, lorsqu’il ouït dire qu’on l’appellerait peut-être comme témoin contre l’homme, qui avait pris le parti dernier.
Tout ce qui lui était jamais arrivé de désagréable dans sa vie active, ses ennuis à l’ambassade, ses autres échecs, ses chagrins, lui revenaient sans cesse à l’esprit. Il se trouvait par tout cela com’rne autorisé à rester inactif ; il se voyait sans aucune perspective, incapable de prendre une de ces résolutions avec lesquelles on conduit les affaires de la vie ordinaire ; ainsi, entièrement livré à ses sentiments, à ses pensées étranges, à une passion sans espérance, dans l’éternelle monotonie d’une douloureuse société avec une femme aimable et chérie, dont il troublait le repos, luttant contre ses forces, les consumant sans but et sans objet, il s’approchait toujours plus d’une triste fin.
Quelques lettres, qu’il a laissées, et que nous insérons ici, attestent, plus fortement que tout le reste, son trouble, sa passion, ses efforts, ses combats sans trêve et son dégoût de la vie.
12 décembre.
« Cher Wilhelm, je suis dans l’état où doivent avoir été ces malheureux que l’on croyait possédés d’un esprit malin. Cela me prend quelquefois : ce n’est pas angoisse, ce n’est pas désir…. c’est un tumulte intérieur, inconnu, qui menace de déchirer ma poitrine, qui me serre la gorge. Hélas ! hélas ! Alors je cours à l’aventure, au milieu des affreuses scènes nocturnes de cette saison ennemie des hommes.
« Hier au soir je ne pus tenir au logis. Le dégel était survenu tout à coup ; on m’avait dit que la rivière était débordée, tous les ruisseaux enflés, et que, depuis Wahlheim, ma vallée chérie était inondée. J’y courus entre onze heures et minuit. C’était un effrayant spectacle, de voir, du rocher, les vagues furieuses tourbillonner au clair de lune, sur les champs, les prairies et les clôtures, et la grande vallée tout entière ne former plus qu’une mer soulevée au murmure du vent. Et quand la lune se montrait de nouveau et reposait sur le noir nuage, et que, devant moi, les flots, avec un reflet terrible et magnifique, roulaient retentissants, j’étais saisi d’un frissonnement et puis d’un désir. Ah ! les bras ouverts, je me penchais sur le gouffre, et j’aspirais à l’abîme, et me perdais dans la pensée ravissante de précipiter là-bas mes douleurs, mes souffrances, de rouler en mugissant comme les vagues ! Oh !… Et tu ne pouvais détacher ton pied de la terre, et finir tous tes maux !… Mon sablier n’est pas encore écoulé, je le sens. 0 Wilhelm, que j’aurais donné volontiers mon existence d’homme, pour déchirer les nues avec ce vent d’orage, pour soulever les flots ! Et cette joie ne sera-t-elle point un jour le partage du prisonnier ?
« Avec quelle douleur j’abaissai mes regards vers une petite place, où je m’étais reposé sous un saule avec Charlotte, pendant la chaleur du jour, dans une promenade !… La place était aussi submergée, et je reconnus à peine le saule. « Et ses prai« ries, me disaisje, et la campagne autour de sa maison de « chasse !… Comme notre berceau est dévasté maintenant par « les eaux dévorantes ! » Et le rayon de soleil du passé brilla dans mon sein, comme sourit au prisonnier un rêve de troupeaux, de prairies, ou d’honneurs et de gloire. J’étais là !… Je ne m’accuse point ; car j’ai le courage de mourir…. J’aurais…. Et maintenant me voilà comme une vieille femme, qui ramasse brin à brin son bois le long des haies, et qui mendie son pain aux portes, afin de prolonger encore un moment et de soulager sa languissante et misérable vie.
14 décembre.
« Qu’est-ce que j’éprouve, mon ami ? J’ai peur de moi-même. . Mon amour pour elle n’est-il pas l’amour le plus saint, le plus pur, le plus fraternel ? Ai-je senti jamais dans mon âme un désir coupable ?… Je ne veux pas jurer…. Et maintenant, des rêves !… Oh ! qu’il était vrai, le sentiment des hommes qui attribuaient ces effets contradictoires à des puissances étrangères ! Cette nuit, . je tremble de le dire, je la tenais dans mes bras, étroitement serrée contre ma poitrine, et je couvrais de baisers sans nombre sa bouche qui balbutiait l’amour ; mes yeux nageaient dans l’ivresse des siens. Dieu, suis-je coupable d’éprouver, à cette heure encore, un ravissement céleste, à me rappeler avec toute ma tendresse ces ardentes voluptés ? Charlotte ! Charlotte !… C’est fait de moi : mes sens s’égarent ; voilà huit jours que je n’ai plus la force de penser ; mes yeux sont pleins de larmes ; je ne suis bien nulle part et je suis bien partout ; je ne souhaite rien, Je ne demande rien. Le meilleur pour moi serait de partir. »
Cependant, au milieu de ces circonstances, la résolution de quitter la vie avait pris toujours plus de force dans l’urne de Werther. Depuis son retour auprès de Charlotte, cette résolution avait toujours été sa perspective et son espérance suprême ; mais il s’était dit que ce ne devait pas être une action soudaine, précipitée ; qu’il voulait faire ce pas avec la plus sérieuse conviction, avec la résolution la plus calme.
Ses doutes, ses combats intérieurs se révèlent dans un petit billet, qui paraît être le commencement d’une lettre à Wilhelm, et qui s’est trouvé, sans date, parmi ses papiers.
« Sa présence, sa destinée, l’intérêt qu’elle prend à la mienne, expriment la dernière larme de mon cerveau calciné.
« Lever le rideau et passer derrière…. voilà tout ! Et pourquoi craindre et balancer ? Parce qu’on ne sait pas ce qu’il y a derrière ? parce qu’on n’en revient pas ? et que c’est le propre de notre esprit d’imaginer que tout est confusion et ténèbres, aux lieux dont nous ne savons rien de certain ? »
Enfin il s’accoutuma et se familiarisa toujours plus avec cette triste pensée, et l’on trouve un témoignage de sa résolution ferme et irrévocable dans cette lettre ambiguë, qu’il écrivait à son ami :
20 décembre.
« Je rends grice à ton amitié, Wilhelm, d’avoir entendu ce mot comme tu l’as fait. Oui, tu as raison : le meilleur pour moi serait de partir. La proposition que tu me fais de retourner auprès de vous ne me plaît pas tout à fait ; du moins je voudrais faire encore un détour, d’autant plus que nous pouvons espérer une gelée soutenue et de bons chemins. Il m’est aussi trèsagréable que tu veuilles venir me chercher : seulement, laisse encore passer quinze jours, et attends encore une lettre de moi avec d’autres avis. Il ne faut rien cueillir avant qu’il soit mûr, et quinze jours de plus ou de moins font beaucoup. Tu diras à ma mère de prier pour son fils, et de vouloir bien me pardonner tous les chagrins que je lui ai faits. C’était ma de.stinée d’affliger ceux que le devoir m’appelait à rendre heureux. Adieu, mon très-cher ami. Que le ciel répande sur toi toutes ses bénédictions ! Adieu. »
Ce qui se passait alors dans l’âme de Charlotte, quels étaient ses sentiments pour son mari, pour son malheureux ami, à peine osons-nous l’exprimer ; quoique, d’après la connaissance de son caractère, nous puissions nous en faire une secrète idée, et que toute femme d’une belle âme puisse descendre dans celle de Charlotte et sentir avec elle.
Ce qu’il y a de certain, c’est qu’elle était fermeroent résolue à tout faire pour éloigner Werther, et, si elle hésitait, c’était l’effet d’un ménagement tendre et bienveillant, parce qu’elle savait combien la chose coûterait à son ami, et même qu’elle lui serait presque impossible. Cependant elle se sentait plus vivement pressée d’agir sérieusement ; son mari gardait sur cette liaison le silence absolu qu’elle-même avait toujours observé ; elle en souhaitait davantage de lui prouver en ’effet qu’elle avait des sentiments dignes des siens.
Le jour morne où Werther écrivit à son ami la lettre que nous venons de rapporter (c’était le dimanche avant Noël), il se rendit le soir auprès de Charlotte et la trouva seule. Elle était occupée à mettre en ordre quelques jouets, qu’elle avait destinés pour étrennes à ses petits frères et ses petites sœurs. Il parla du plaisir que les enfants allaient goûter, et du temps où l’ouverture soudaine d’une porte et l’apparition d’un arbre1 décoré de bougies, de bonbons et de pommes, faisaient éclater les joies du paradis.
« Vous aussi, dit Charlotte, en cachant son embarras sous un gracieux sourire, vous aurez votre cadeau, si vous êtes bien sage : une petite bougie et quelque chose encore.
— Et qu’appelez-vous être sage ? s’écria-t-il : comment dois-je l’être ? comment puis-je l’être, bonne Charlotte ?
— Jeudi soir, ditelle, est la veille de Noël ; les enfants viendront, mon père viendra, chacun recevra son cadeau : venez aussi…. mais pas auparavant. »
Werther fut interdit.
« Je vous en prie, poursuivit-elle, c’est comme cela ; je vous en prie pour mon repos : cela ne peut, non, cela’ne peut rester ainsi….»
Elle détournait les yeux, allait et venait dans la chambre et murmurait tout bas :
« Cela ne peut rester ainsi. »
1. L’arbre de Noël, qui, originaire d’Allemagne, commence à s’acclimater en France. C’est un petit sapin, cuuptf par le pied et fixé sur une base. On l’éclairé de nombreuses bougies, et l’on suspend à ses branches des bonbons et des cailcaux de toute sorte. Charlotte, qui sentait dans quel horrible état ces paroles avaient jeté-Werther, chercha par diverses questions à détourner ses pensées, mais ce fut inutile. . « Non, Charlotte, s’écria-t-il, je ne vous reverrai plus.
— Pourquoi cela ? reprit-elle ; Werther, vous pouvez, vous devez nous revoir : seulement, modérezvous. Oh ! pourquoi le ciel vous a-t-il fait naître avec cette violence, cette passion irrésistible, obstinée ; pour tout ce qui vous attache une fois ! Je vous en prie, poursuivit-elle, en le prenant par la main, modérezvous ! Votre esprit, vos connaissances, vos talents, quelles jouissances diverses ne vous offrent-ils pas ? Soyez un homme ; re-, noncez à ce malheureux attachement pour une personne qui ne peut rien que vous plaindre. »
Il grinçait les dents et regardait Charlotte d’un air sombre. Elle le tenait par la main.
« Un moment de sang-froid, Werther, lui ditelle ; ne sentezvous pas que vous vous trompez, que vous courez volontairement à votre perte ? Pourquoi donc moi, Werther, justement moi, qui appartiens à un autre ? pourquoi cela justement ? Je le crains, je le crains, c’est.l’impossibilité de me posséder, qui seule irrite votre désir. »
II dégagea sa main, en regardant Charlotte d’un œil fixe et mécontent.
« Sage, très-sage pensée ! dit-il. Est-ce Albert peut-être qui a fait cette observation ? Elle est profonde, très-profonde !
— Chacun peut la faire, reprit-elle. Eh quoi ! ne se trouvera-t-il dans le monde entier aucune femme qui puisse remplir les vœux de votre cœur ? Prenez cela sur vous, cherchez, et,’je vous le jure, vous trouverez. Car depuis longtemps je m’afflige pour vous et pour nous de l’isolement dans lequel vous vous êtes vous-même confiné. Prenez cela sur vous. Un voyage ne peut manquer de vous distraire. Cherchez, trouvez un digne objet de votrç amour, et revenez, et jouissons ensemble des douceurs d’une amitié véritable.
— On pourrait imprimer cela, dit-il avec un froid sourire, et le recommander à tous les gouverneurs. Konne Charlotte, laissez-moi prendre encore un peu de repos. Tout s’arrangera.
— Mais, je vous en prie, Werther, ne revenez pas avant la veille de Noël. »
Il allait répondre, lorsque Albert entra : ils se saluèrent l’un l’autre d’une manière glaciale, et se promenèrent de long en large dans la chambre, avec une contenance embarrassée. Werther commença un discours insignifiant, qu’il eut bientôt fini ; Albert fit de même, puis il demanda à sa femme où en étaient certaines commissions, et, apprenant qu’elles n’étaient pas faites encore, il lui dit quelques mots, que Werther trouva froids et même durs. Il voulait s’en aller et ne pouvait pas, et tarda jusqu’à huit heures, son dépit et sa mauvaise humeur ne faisant que s’accroître : enfin, comme on vint mettre le couvert, il prit sa canne et son chapeau. Albert le pria de rester ; mais lui, qui ne voyait dans ces paroles qu’une politesse insignifiante, il remercia froidement et sortit.
Arrivé chez lui, il prit la lumière des mains de son domestique, qui voulait l’éclairer, et se retira seul dans son appartement. Il sanglotait, se parlait à lui-même avec véhémence, allait et venait dans sa chambre à grands pas, et finit par se jeter tout habillé sur son lit, où le domestique le trouva, lorsqu’il se permit d’entrer, vers onze heures, pour lui demander s’il ne devait pas le déboîter. Il le laissa faire, et lui défendit d’entrer dans sa chambre le lendemain avant d’être appelé.
Le lendemain matin, 21 décembre, il écrivit la lettre suivante, qu’après sa mort on trouva cachetée sur son secrétaire, et qui fut remise à Charlotte. Je la citerai par fragments, comme il paraît, par les circonstances, qu’elle fut écrite.
« C’est résolu, Charlotte, je veux mourir, et je te l’écris sans exaltation romanesque, tranquillement, le matin du jour où je te verrai pour la dernière fois. Quand tu liras ceci, mon amie, déjà la froide tombe couvrira la dépouille insensible de l’homme inquiet, infortuné, qui, pendant les derniers moments de sa vie, ne connaît pas de plus grande douceur que de s’entretenir avçc toi. J’ai passé une horrible nuit, hélas ! une nuit bienfaisante ; c’est elle qui a fortifié, déterminé ma résolution. Je veux mourir. Hier, lorsque je me fus arraché de ta présence, dans l’affreuse révolte de mes sens ; que tout cela se pressait sur mon cœur, et que, désespéré, inconsolable, auprès de toi, je sentais avec horreur l’existence me saisir de son étreinte glacée, j’eus de la peine à gagner ma chambre ; hors de moi, je tombai à genoux, ô Dieu, et tu m’accordas le suprême soulagement des larmes les plus amères ! Mille projets, mille perspectives se combattaient dans mon âme, et à la fin elle y demeura, immuable, entière, l’unique, la dernière pensée : « Je * veux mourir !…» Je me suis couché, et, ce matin, dans le calme du réveil, elle est encore arrêtée, encore tout affermie dans mon cœur. « Je veux mourir !… » Ce n’est point désespoir, mais certitude que j’ai achevé de porter mon fardeau, et que je me sacrifie pour toi. Oui, Charlotte, pourquoi devrais-je le taire ? Il faut que l’un de nous trois s’en aille, et, je le veux, ce sera moi. 0 ma chère, dans ce cœur déchiré s’est glissée souvent la furieuse pensée…. de tuer ton mari !… toi !… moi !… C’est résolu…. Quand tu monteras sur la colline par un beau soir d’été, souviens-toi de moi ; rappelle-toi comme je montai souvent cette vallée ; porte ensuite tes regards vers le cimetière, vers ma tombe ; vois comme le vent balance les hautes herbes aux rayons du soleil qui décline…. J’étais tranquille quand j’ai commencé, et voilà, voilà que je pleure comme un enfant, à voir tout cela plein de vie autour de moi, »
Sur les dix heures, Werther appela son domestique, et, pendant qu’il se faisait habiller, il lui dit qu’il partirait dans quelques jours ; qu’il fallait donc nettoyer les habits, et préparer tout pour faire les malles ; il lui donna aussi l’ordre de demander partout les notes à payer, de retirer quelques livres prêtés, et de compter deux mois d’avance à quelques pauvres, auxquels il avait coutume de donner une aumône chaque semaine.
Il se lit apporter à manger dans sa chambre, et, après dîner, il se rendit à cheval chez le bailli, qu’il ne trouva pas à la maison. Il se promena au jardin, plongé dans la rêverie, et semblait vouloir amasser encore une fois dans son cœur toute la mélancolie des souvenirs.
Les enfants ne le laissèrent pas longtemps en repos ; ils le poursuivirent, grimpèrent sur lui, lui dirent comment, après un jour et encore un jour et encore un autre, ils iraient chez la sœur Charlotte recevoir les présents de Noël, et débitèrent les merveilles que se promettait leur imagination enfantine.
« Un jour ! s’écria-t-il, et encore un jour ! et encore un !… »
Il les embrassa tous tendrement, et se disposait à les quitter, quand le plus jeune voulut encore lui dire quelque chose à l’oreille. Il lui confia que ses grands frères avaient écrit de beaux compliments de bonne année, mais si grands !… Il y en avait un pour papa, un pour Albert et Charlotte, un aussi pour M. Werther. Ils les présenteraient le matin du jour de l’an. Ce dernier trait l’accabla. Il fit un petit cadeau à chacun des enfants, monta à cheval, fit saluer le père et partit, les larmes aux yeux.
Il rentra chez lui vers cinq heures, et commanda à la servante d’avoir soin du feu et de l’entretenir jusqu’à la nuit. Il donna l’ordre au domestique de serrer les livres et le linge au fond de la malle, et d’empaqueter les habits. C’est alors vraisemblablement qu’il écrivit le passage suivant de sa dernière lettre à Charlotte :
« Tu ne m’attends pas ! tu crois que j’obéirai et ne te reverrai pas avant la veille de Noël ! ô Charlotte, aujourd’hui ou jamais ! La veille de Noël, tu tiendras ce papier dans ta main, tu trembleras et tu le mouilleras de tes larmes. Je le veux, il le faut. Oh ! que je me trouve bien d’avoir pris ma résolution ! »
Cependant Charlotte se voyait dans une étrange situation. Après son dernier entretien avec Werther, elle avait senti combien elle aurait de ppine à se séparer de lui, ce qu’il souffrirait quand il devrait s’éloigner d’elle.
On avait dit, comme en passant, en présence d’Albert, que Werther ne reviendrait pas avant la veille de Noël, et Albert était monté à cheval, pour se rendre chez un fonctionnaire du voisinage, avec lequel il avait des affaires à régler, et chez qui il devait passer la nuit.
Charlotte se trouvait seule ; aucun de ses frères et sœurs n’était autour d’elle ; elle s’abandonnait à ses réflexions, qui passaient doucement sa situation en revue. Elle se voyait pour jamais unie à un homme dont elle connaissait l’amour et la fidélité, à qui elle était dévouée, dont le calme, la solidité, semblaient destinés par le ciel même à fonder, pour la vie, le bonheur d’une honnête femme ; elle sentait ce qu’il serait toujours pour elle et pour sa famille. D’un autre côté, Werther lui était devenu bien cher ; dès le premier moment où ils avaient appris à se connaître, la sympathie de leurs caractères s’était révélée de la manière la plus heureuse ; leur longue liaison, tant de situations diverses où ils s’étaient trouvés, avaient fait sur le cœur de Charlotte une impression ineffaçable. Tous les sentiments, toutes les pensées qui l’intéressaient, elle était accoutumée à les partager avec lui, et le départ de Werther menaçait de faire dans toute son existence un vide, qui ne pourrait plus être comblé. Oh ! si elle avait pu dans ce moment le changer en un frère ! qu’elle se serait trouvée heureuse !… Si elle avait osé le marier avec une de ses amies, elle aurait pu espérer de rétablir tout à fait la bonne intelligence entre Albert et lui.
Elle avait passé en revue toutes ses amies, et trouvait à chacune quelque défaut ; elle n’en voyait aucune à qui elle eût donné Werther volontiers.
En faisant toutes’ces réflexions, elle finit par sentir profondément, sans se l’expliquer d’une manière bien claire, que le secret désir, de son cœur était de le garder pour elle, et elle se disait en même temps qu’elle ne pouvait, qu’elle ne devait pas le garder ; son âme pure et belle, jusqu’alors si libre et si courageuse, sentit le poids d’une mélancolie à laquelle est fermée la perspective du bonheur. Son cœur était oppressé, et un sombre nuage couvrait ses yeux.
Le temps se passait, il était six heures et demie, lorsqu’elle entendit Werther monter l’escalier, et reconnut bientôt son pas, sa voix, qui demandait après elle. Oh ! que, pour la première fois, nous pouvons presque le dire, le cœur lui battit à son arrivée ! Elle lui aurait volontiers fait dire qu’elle n’était pas à la maison, et, lorsqu’il entra, elle s’écria, dans une sorte de trouble passionné :
« Vous n’avez pas tenu parole !
— Je n’ai rien promis, répondit-il.
— Vous deviez du moins avoir égard à ma prière, répliqua Charlotte : je vous le demandais pour notre repos à tous deux. »
Elle ne savait trop ce qu’elle disait, tout aussi peu ce qu’elle faisait, lorsqu’elle envoya chercher quelques amies, pour ne pas être seule avec Werther. Il posa sur la table des livres, qu’il avait apportés, et il en demanda d’autres. Charlotte souhaitait et craignait tour ù tour de voir paraître ses amies.
La servante revint, et dit que les deux amies se faisaient excuser.
Elle voulait que la servante se tînt avec son ouvrage dans la chambre voisine, puis elle changea d’idée. Werther allait et venait dans la chambre. Charlotte se mit au clavecin et commença un menuet. Le menuet n’allait pas. Elle reprit du sang-froid, et s’assit tranquillement auprès de Werther, qui avait pris sa place accoutumée sur le canapé.
« N’avez-vous rien à lire ? » ditelle.
Il n’avait rien. .
« Là, dans mon tiroir, reprit-elle, se trouve votre traduction de quelques chants d’Ossian : je ne les ai pas encore lus, parce que j’espérais toujours vous les entendre lire vous-même ; mais, depuis, cela n’a jamais pu s’arranger ni se mettre à exécution. »
Il sourit, il alla prendre le poëme ; un frisson le saisit, lorsqu’il tint le cahier dans ses mains ; ses yeux se remplirent de larmes, en le parcourant ; il s’assit et commença la lecture.
« Étoile du soir, ta belle lumière scintille au couchant ; tu lèves du sein de la nue ta tête rayonnante ; tu avances sur ta colline avec majesté : que regardes-tu dans la bruyère ? Les vents orageux se sont apaisés ; de loin arrive le murmure du torrent ; les vagues mugissantes se jouent au pied de la roche lointaine ; les insectes du soir bourdonnent dans les campagnes. Que regardes-tu, belle lumière ? Mais tu souris et tu passes ; les flots joyeux t’environnent et baignent ta gracieuse chevelure. Adieu, paisible clarté ! Et toi, parais, magnifique lumière de l’âme d’Ossian !
« Elle se montre dans tout son éclat. Je vois mes amis trépassés : ils se rassemblent sur Lora, comme dans les jours d’autrefois…. Fingal s’avance, comme une colonne de vapeur humide ; autour de lui sont ses héros, et voici les bardes du chant : Ullin aux cheveux blancs, le majestueux Ryno, Alpin, l’aimable chanteur, et toi, douce et plaintive Minona !… Que vous êtes changés, mes amis, depuis les jours de Selma, ces jours de fête, où nous disputions le prix du chant, comme les vents printaniers, caressant tour à tour la colline, font plier l’herbe murmurante !
« Alors Minona s’avança dans sa beauté, les paupières baissées et les yeux pleins de larmes ; son abondante chevelure flottait au vent vagabond qui s’élançait de la montagne…. Une sombre tristesse saisit l’âme des héros, quand sa douce voix s’éleva ; car ils avaient vu souvent le tombeau de Salgar, souvent la sombre demeure de la blanche Colma, de Colma, délaissée sur la colline avec sa voix mélodieuse ! Sal’gar avait promis de venir, mais la nuit se répandait alentour. Écoutez la voix de Colma, lorsqu’elle était seule, assise sur le rocher.
COLMA.
« Il est nuit…. Je suis seule, égarée sur l’orageuse colline. Le vent gémit dans les montagnes ; le torrent tombe du rocher en mugissant ; aucune cabane ne m’abrite contre la pluie,’moi, délaissée sur l’orageuse colline.
« O lune, sors de tes nuages ! paraissez, étoiles de la nuit ! Qu’un rayon me conduise aux lieux où mon amant se repose des fatigues de la chasse, ayant auprès de lui son arc détendu, autour de lui ses chiens haletants !
« Pourquoi tarde-t-il, mon Salgar 1 A-t-il oublié sa promesse ? Voilà le rocher et l’arbre, et voici le torrent qui gronde. Tu avais promis d’être en ce lieu à l’approche de la nuit : hélas ! où mon Salgar s’est-il égaré ? Je voulais fuir avec toi, quitter mon père et mon frère, les orgueilleux ! Dès longtemps nos races sont ennemies, mais nous, ô Salgar, nous ne sommes pas ennemis.
« O vents, faites un peu de silence ; 6 torrent, cesse un moment de gronder, afin que ma voix retentisse à travers la vallée ! que mon voyageur m’entende ! Salgar, c’est moi qui t’appelle. Voici l’arbre et le rocher ; Salgar, mon bien-aimé, me voici : pourquoi tarder à venir ?
« Voici, la lune paraît, les flots brillent dans la vallée, les rochers grisâtres se dressent sur la colline, mais je ne le vois pas sur les sommets ; ses chiens ne le devancent point,“pour annoncer sa venue. Il faut que je reste ici solitaire.
« Mais qui sont-ils, ceux que je vois-la bas couchés dans la bruyère ?… mon amant ? mon frère ?… Parlez, ô mes amis ! Ils ne répondent pas. Que mon dme est angoissée !… Ah ! ils sont morts ! Leurs glaives sont teints de sang ! 0 mon frère, mon frère, pourquoi as-tu frappé de mort mon Salgar ? 0 mon Salgar, pourquoi as-tu frappé de mort mon frère ? Vous m’étiez tous les deux si chers ! Oh ! tu étais beau entre mille sur la colline. Il était terrible dans le combat. Répondez-moi ! Entendez ma voix, mes bien-aimés ! Mais, hélas ! ils sont muets, muets pour toujours ; leur sein est froid comme la terre.
« Oh ! des rochers sauvages, du sommet de la montagne orageuse, parlez, esprits des morts, parlez, je ne frémirai pas…. Où êtes-vous allés chercher le repos ? Dans quelle caverne des montagnes vous trouverai-je ?… Je n’entends pas une faible voix dans le souffle du vent, pas une réponse, qui vole avec l’orage de la colline.
« îe demeure dans ma détresse, j’attends le matin dans les larmes. Creusez la tombe, amis des morts, mais ne la fermez pas avant que je vienne. Mes jours s’évanouissent comme un songe. Comment pourrai-je leur survivre ? Je veux habiter avec mes amis vers le torrent de la roche bruyante…. Lorsqu’il fera nuit sur les monts, et que l’orage passera sur la bruyère, mon ombre s’arrêtera dans l’orage et pleurera la mort de mes amis. Le chasseur m’entendra de sa feuillée ; il craindra, il aimera ma voix ; car ma voix sera douce pour pleurer mes amis : ils m’étaient tous les deux si chers ! »
« C’est ainsi que tu chantais, ô Minona, fille de Thorman, aux joues de rosés. Nos pleurs coulèrent pour Colma, et notre dme fut saisie de tristesse.
« Ullin parut avec sa harpe et accompagna le chant d’Alpin…. La voix d’Alpin était douce, l’âme de Ryno était un rayon de feu. Mais déjà ils reposaient dans l’étroite maison, et leur voix ne s’entendait plus dans Selma. Un jour Ullin revenait de la chasse, avant que les héros fussent tombés : il entendit leurs chants rivaux sur la colline. Leur voix était douce, mais triste : ils pleuraient le trépas de Morar, le premier des héros. Son urne était comme l’âme de Fingal ; son glaive, comme le glaive d’Oscar…. Mais il tomba, et son père gémit, et les yeux de sa sueur se remplirent de larmes ; ils se remplirent de larmes, les yeux de Minona, la sœur du beau Morar. Elle recula devant les chants d’Ullin, comme la lune au couchant, quand elle prévoit la tempête, et cache sa belle tête dans un nuage. Avec Ullin, j’accompagnai de la harpe le chant de douleur.
RYNO.
« Le vent et la pluie sont passés, le midi est serein, les nuages se dispersent, le soleil inconstant éclaire en fuyant les cimes ; coloré de ses feux, le torrent de la montagne coule dans la vallée. Il est doux ton murmure, ô torrent ; mais elle est plus douce la voix d’Alpin : il chante, il pleure le mort. Sa tête est courbée de vieillesse et son œil est rouge de pleurs. Alpin, noble barde, pourquoi seul sur les monts silencieux ? pourquoi gémir comme un tourbillon dans la forêt, comme une vague sur la plage lointaine ?
ALPIN.
« Mes larmes, Ryno, sont.pour les morts, mes chants, pour les habitants de la tombe. Ta haute taille brille sur la colline, tu es beau parmi les fils de la bruyère, mais tu succomberas comme Morar, et l’affligé s’assiéra sur ta tombe ; les collines t’oublieront ; ton arc détendu reposera dans la salle du festin.
« Tu étais rapide, ô Morar, comme un chevreuil sur le rocher, terrible, comme une flamme nocturne dans le ciel. Ta colère était un orage ; ton glaive, dans le combat, était comme l’éclair dans la bruyère ; ta voix, comme le torrent de la forêt après la pluie, comme le tonnerre grondant des montagnes lointainesMille tombèrent sous ton.bras, la flamme de ton couroux les consuma. Mais, quand tu revenais des combats, comme ta voix était douce ! Ton visage était comme le soleil après la tourmente, comme la lune dans la nuit silencieuse ; ton sein était tranquille comme le lac, quand le bruit du vent s’est apaisé.
« Elle est désormais étroite ta demeure, elle est obscure ta retraite ; avec trois pas je mesure ta tombe, ô toi, qui fus si grand ! Quatre pierres, aux têtes moussues, sont ton unique monument ; un arbre défeuillé, de longues herbes qui murmurent au vent, indiquent à l’œil du chasseur le tombeau du puissant Morar. Tu n’as point de mère qui te pleure ; aucune jeune fl%ne te donne les larmes de l’amour ; elle est morte celle qui t’a enfanté ; elle est tombée la iille de Morglan.
« Quel homme s’avance appuyé sur son bâton ? Sa tête est blanchie par les années, ses yeux sont rouges de larmes…. C’est ton père, ô Morar ! ton père, qui n’eut point d’autre fils que toi. Il apprit ta vaillance dans le combat ; il apprit la défaite des ennemis ; il apprit la gloire de Morar : hélas ! ne sut-il rien de sa blessure ? Pleurez, père de Morar, pleurez…. mais votre fils ne vous entend pas. Il est profond, le sommeil des morts ; il est couché bien bas, leur oreiller de poussière. Jamais ton fils n’écoutera ta voix ; il ne s’éveillera plus à ton appel. Oh ! quand fera-t-il jour dans la tombe, pour crier à celui qui sommeille : « Réveille-toi ! »
« Adieu, ô le plus noble des hommes, invincible sur le champ de bataille ! Mais le champ de bataille ne te verra plus ; la foret sombre ne brillera plus des éclairs de ton glaive. Tu ne laisses aucun ’fils après toi, mais le chant du barde maintiendra ton nom, les âges futurs entendront parler de toi ; on leur dira le trépas de Morar.
« Elles furent bruyantes, les plaintes des héros ; ils éclatèrent surtout, les soupirs d’Armin, oppressé de douleur. Ce chant lui rappelait la mort de son fils, tombé dans les jours de la jeunesse. Cannor s’était assis près du héros, Carmor, le prince de Galmal aux échos sonores.
« Pourquoi, dit-il, éclatent les sanglots d’Armin ? Pourquoi pleurer ici ? La musique et le chant ne résonnent-ils pas pour attendrir l’âme et la réjouir ? Ils sont comme une vapeur légère, qui, montant du lac, se répand sur la vallée et baigne de rosée les fleurs épanouies : mais le soleil revient dans sa force et la vapeur s’exhale. Pourquoi es-tu si affligé, Armin, maître de Gorma que les flots environnent ?
— Affligé ! Je le suis, et la cause de ma douleur n’est pas légère. Carmor, tu n’as point perdu de fils, tu n’as point perdu de fille florissante : le vaillant Colgar est vivant ; elle est vivante, Arnira, la plus belle des vierges. Les rameaux de ta tige fleurissent, ô Carmor ; mais Armin est le dernier de sa race. Ta couche est ténébreuse, ô Daura ; il est profond ton sommeil dans la tombe…. Quand te réveilleras-tu avec tes chants, avec ta voix mélodieuse ? Levez-vous, vents d’automne, levez-vous, déchaînez-vous sur la bruyère sombre ! Torrents des bois, grondez ; mugissez, tempêtes, dans la cime des chênes ! Chemine à travers les nuages déchirés, 6 lune, et montre par moments ton pâle visage ! Rappelle-moi la nuit horrible où mes enfants succombèrent, où le puissant Arindal tomba, où l’aimable Daura cessa de vivre.
« Daura, ma fille, tu étais belle, belle comme la lune sur la colline de Fura, blanche comme la neige nouvelle, douce comme le souffle de l’air. Arindal, ton arc était fort, ta lance, rapide sur le champ de bataille, ton regard, comme la nue sur le flot, ton bouclier, un nuage de feu dans la tempête.
« Armar, guerrier fameux, rechercha l’amour de Daura ; elle ne résista pas longtemps : elles étaient belles, les espérances de ses amis.
« Mais Erath, fils d’Odgal, frémissait de rage : Armar avait tué son frère. Il vint déguisé en matelot. Sa barque était belle sur les ondes, ses cheveux étaient blanchis par l’ ;1ge ; sa figure était calme : « 0 la plus belle des vierges, dit-il, aimable fille d’Ar« min, là sur le rocher, non loin du rivage, Armar attend Daura : « je viens pour passer sa bien-aimée sur les vagues roulantes. »
« Elle le suivit, elle appela Armar : seule la voix du rocher lui répondit. * Armar, mon bien-aimé, mon bicn-aimé, pour« quoi me tourmenter ainsi ? Écoute, fils d’Arnath ! écoute ! c’est « Daura qui t’appelle. »
« Erath, le traître, fuyait en riant vers la terre. Elle éleva la voix, elle appela son père et son frère. « Arindal ! Armin ! aucun » de vous ne viendra-t-il sauver sa Daura ? »
« Sa voix traversa la mer. Arindal, mon fils, descendait de !a colline, ardent et chargé du butin de la chasse ; ses flèches résonnaient à son côté, il portait son arc à la main, cinq dogues noirs étaient autour de lui. Il vit l’audacieux Erath sur le rivage ; il le saisit et l’attacha au tronc d’un chêne ; il entoura ses flancs de liens solides ; le captif remplissait l’air de ses plaintes.
« Arindal s’embarque pour délivrer Daura. Armar survient plein de fureur ; il décoche la flèche aux plumes grises ; elle siffle, elle perce ton cœur, Arindal, ô mon fils ! Tu succombas, au lieu d’Erath, le traître ; la barque atteignit le rocher ; Arindal tomba et mourut. A tes pieds coulait le sang de ton frère, ô Daura : quelle fut ta douleur !
« Les vagues brisèrent la barque ; Armar s’élança dans la mer, pour sauver sa Daura ou mourir. Soudain un coup de vent fondit de la colline sur les flots : Armar fut englouti et ne revint pas de l’abîme.
« Mais j’entendais ma fille gémir sur le rocher battu des ondes ; ses cris répétés venaient jusqu’à moi, et son père ne pouvait la sauver. Toute la nuil je restai sur le rivage ; je la voyais aux faibles rayons de la lune ; toute la nuit j’entendis ses plaintes : le vent grondait, et la pluie s’élançait à flots impétueux vers la montagne. La voix de Daura s’affaiblit avant la naissance du jour ; elle s’exhala comme la brise du soir parmi les herbes des rochers. Accablée de douleur, elle mourut et laissa Armin désolé. Il n’est plus, celui qui était ma force dans la guerre ; elle est tombée, celle qui était mon orgueil parmi les vierges.
« Quand viennent les orages de la montagne, quand le nord soulève les flots, je m’assieds sur le rivage sonore, je regarde l’affreux rocher : souvent, dans les rayons de la lune penchante, je vois les ombres de mes enfants ; environnées d’une douteuse lumière, elles passent ensemble dans un triste concert. »
Un torrent de larmes, qui s’échappa des yeux de Charlotte, et soulagea son cœur oppressé, interrompit la lecture de Werther. Il jeta de côté le cahier, il prit la main de Charlotte, et versa des larmes amères. Elle appuyait sa tête sur son autre main, et couvrait ses yeux de son mouchoir. Leur émotion à tous deux était affreuse. Ils sentaient leur propre infortune dans la destinée de ces héros ; ils la sentaient ensemble, et leurs larmes s’unirent. Les lèvres et les yeux de Werther brûlaient le bras de Charlotte, un frissonnement la saisit ; elle voulut s’éloigner : la douleur et la pitié l’accablaient et la tenaient enchaînée. Elle exhala un soupir, essayant de se remettre, et pria Werther en sanglotant de continuer sa lecture. Elle le priait d’une voix toute céleste : il trembla, son cœur éclatait ; il prit le cahier, et lut, d’une voix entrecoupée :
« Pourquoi me réveilles-tu, souffle du printemps ? Tu me caresses, et tu dis : « Je baigne la terre de la rosée du ciel. « Mais il approche, le temps où je dois me flétrir ; elle approche, la tempête qui dévastera mon feuillage. Demain le voyageur viendra ; il viendra, celui qui vit ma beauté ; ses yeux me chercheront dans la campagne, et ne me trouveront pas. »
Toute la force de ces paroles saisit l’infortuné. Il se jeta aux pieds de Charlotte, dans le dernier désespoir ; il lui prit les mains, les pressa contre ses yeux, contre son front, et un pressentiment de son affreux dessein sembla traverser l’âme de Charlotte. Hors d’elle-même, égarée, elle pressa les mains de Werther, elle les pressa contre son sein, se pencha vers lui avec une douloureuse émotion, et leurs joues brûlantes se touchèrent. Le monde n’existait plus pour eux. Il entoura Charlotte de ses bras, la pressa contre son cœur, et couvrit de baisers furieux ses lèvres tremblantes.
« Werther ! s’écria-t-elle, d’une voix étouffée, en se détournant, Werther !… »,
Et, d’une main faible, elle l’écartait de son sein.
« Werther ! » s’écria-t-elle encore, avec le ton contenu du plus noble sentiment.
Il ne résista point, il la laissa échapper de ses bras, et se prosterna devant elle, comme égaré. Elle se leva avec violence, et, dans un égarement douloureux, palpitante d’amour et de colère, elle dit :
« C’est la dernière fois, Werther ! vous ne me verrez plus.»
Et jetant sur le malheureux un regard plein d’amour, elle courut dans la chambre voisine et la ferma sur elle. Werther lui tendait les bras : il n’osa pas la retenir. Il était gisant sur le plancher, la tête sur le canapé, et il resta dans cette position plus d’une demi-heure. Enfin quelque bruit vint le rappeler à lui-même. C’était la servante qui se disposait à mettre la table. Il allait et venait dans la chambre, et, lorsqu’il se vit seul de nouveau, il s’approcha de la porte du cabinet, et dit à voix basse :
« Charlotte, Charlotte, encore un mot seulement, un adieu ! »
Elle garda le silence. Il pria, il attendit, puis il s’arracha de cette place, en s’écriant :
« Adieu, Charlotte ! Pour jamais, adieu ! »
II gagna la porte de la ville. Les gardes, qui étaient accoutumés à le voir, le laissèrent passer sans lui rien dire. Il tombait de la neige fondue. Il était près de onze heures lorsqu’il heurta à sa porte. Son domestique fut frappé de voir qu’il revenait sans chapeau, et n’osa pas lui dire un mot. Il le déshabilla. Tous ses vêtements étaient trempés. On trouva plus tard son chapeau sur un rocher qui s’élève au penchant du coteau et domine la vallée. C’est une chose inconcevable que, par cette nuit pluvieuse et sombre, il ait gravi ce rocher sans se précipiter.
Il se coucha et dormit longtemps. Le lendemain, le domestique le trouva occupé à écrire, quand il lui apporta son café., II ajoutait le passage suivant à sa lettre pour Charlotte :
« Ainsi donc, pour la dernière fois, pour la dernière fois, j’ouvre les yeux ! Hélas ! ils ne verront plus le soleil ; un jour triste et nébuleux le tient caché. Oui, prends le deuil, ô nature ; ton fils, ton ami, ton bien-aimé, approche de sa fin. Charlotte, c’est un sentiment sans pareil, mais qui ressemble à un songe confus plus qu’à toute autre chose, de se dire : « Voilà mon der« nier jour ! » Le dernier ! Charlotte, je ne puis absolument le comprendre, ce mot : « Le dernier ! » Ne suis-je pas debout dans toute ma vigueur ? Et demain je serai gisant sans force sur la terre ! Mourir ! Qu’est-ce que cela signifie ? Crois-moi, nous rêvons, quand nous parlons de la mort. J’ai vu souvent mourir : mais les bornes de l’humanité sont si étroites, qu’elle n’a aucune idée sur le commencement et la fin de son existence. Maintenant je suis encore à moi, à toi ! à toi, ô bien-aimée ! Et un moment de plus…. séparé, passé…. peut-être pour jamais !… Non, Charlotte ! non ! Comment puis-je périr ? Comment peux-tu périr ? Nous sommes !… Eh bien, périr !… Qu’est-ce que cela veut dire ? C’est encore un mot, un son vide, qui n’a point de sens pour mon cœur. Mort, Charlotte, enfoui sous la froide terre, dans un lieu si étroit ! si noir !… J’avais une amie, qui fut tout pour moi dans ma jeunesse dépourvue : elle mourut, et je suivis son convoi, et je me tins au bord de la fosse, au moment où l’on descendait le cercueil, où les cordes coulèrent dessous en murmurant et remontèrent ; puis la première pelletée de terre roula dans la fosse, et le coffre funèbre rendit un bruit sourd, plus sourd et plus sourd encore, et il fut couvert enfin. Je rne prosternai à côté de la fosse…. saisi, ébranlé, oppressé, déchiré au fond de l’âme, mais sans savoir ce qui m’était arrivé…. ce qui m’arrivera…. La mort ! La tombe ! Je n’entends pas ces mots.
« Oh ! pardonne-moi ! pardonne-moi ! Hier !… Ce devait être le dernier moment de ma vie. 0 mon ange, pour la première fois, pour la première fois, et sans aucun doute, il a pénétré, embrasé mon cœur, ce délicieux sentiment : elle m’aime ! elle m’aime ! Il brûle encore sur mes lèvres, le feu sacré qui coulait des tiennes par torrents ; une nouvelle, une ardente ivresse est dans mon cœur. Pardonne-moi ! pardonne-moi !
« Ah ! je le savais bien que tu m’aimais ; je le savais, à tes premiers regards, où se montrait ton âme, à ton premier serrement de main ; et pourtant, quand je t’avais quittée, quand je voyais Albert à tes côtés, je retombais dans mes doutes fiévreux.
« Te souvient-il des fleurs que tu m’envoyas, dans cette maudite assemblée où tu ne pus me dire un seul mot ni me toucher la main ? Ah ! je passai la moitié de la nuit à genoux devant elles, et elles furent pour moi le sceau de ton amour. Mais, hélas ! ces impressions passaient, comme s’efface peu à peu dans l’âme du fidèle le sentiment de la grâce de son Dieu, qu’il a reçue, avec une plénitude céleste, dans des signes visibles et sacrés.
« Tout cela est passager, mais l’éternité même ne saurait éteindre la flamme de vie que je recueillis hier sur tes lèvres et que je sens en moi. Elle m’aime ! Ce bras l’a pressée, ces lèvres ont tremblé sur ses lèvres ; cette bouche a balbutié sur la sienne. Elle est à moi ! Tu es à moi, Charlotte, pour toujours !
« Et qu’importé qu’Albert soit ton mari ? Ton mari ! C’est bon pour ce monde…. et pour ce monde, le péché de t’aimer, de vouloir te ravir de ses bras. Le péché ! Soit ! Je m’en punis. Je l’ai savouré, ce péché, dans toute sa volupté céleste ; j’ai puisé pour mon cœur le baume et la force de la vie. Dès ce moment, tu es à moi, à moi, Charlotte. Je te précède, je vais vers mon père, vers ton père. Je me plaindrai à lui, il me consolera, en attendant que tu viennes, et je volerai au-devant de toi, et je te prendrai, et je resterai auprès de toi, devant la face de l’Infini, dans des embrassernents éternels.
« Je ne rêve point, je ne délire point : près de la tombe un nouveau jour m’éclaire. Nous serons ! nous nous reverrons ! Nous verrons ta mère ; je la verrai, je la trouverai, et je répandrai tout mon cœur devant elle. Ta mère, ta parfaite image ! »
Vers onze heures, Werther demanda à son domestique si Albert était revenu. Le domestique répondit que oui, et qu’il avait vu ramener son cheval à l’écurie. Là-dessus Werther lui donna un billet non cacheté portant ces mots :
« Voulez-vous bien me prêter vos pistolets pour un voyage que je projette ? Adieu, portez-vous bien. »
La bonne Charlotte avait peu dormi la nuit précédente : ce qu’elle avait craint s’était réalisé, réalisé d’une manière qu’elle n’avait pu ni craindre ni pressentir. Son sang, jusqu’alors si pur et si paisible, était dans une fiévreuse agitation ; mille sentiments divers bouleversaient ce noble cœur. Était-ce le feu des embrassements de Werther qu’elle sentait dans son sein ? Étaitce indignation de sa témérité ? Était-ce la comparaison pénible de son état présent avec ces jours de naïve et libre innocence et de tranquille confiance en elle-même ? Comment devait-elle accueillir son mari ? comment lui révéler la scène qu’elle pouvait avouer si bien, et qu’elle n’osait pourtant s’avouer à ellemême ? Ils avaient si longtemps gardé le silence l’un avec l’autre ! serait-elle la première à le rompre, et, dans un si fâcheux moment, ferait-elle à son mari cette révélation inattendue ? Elle craignait déjà que la seule nouvelle de la visite de Werther ne fît sur son mari une impression désagréable : que serait-ce de cette catastrophe inattendue ? Pouvait-elle bien espérer qu’il la verrait sous son vrai jour, qu’il la jugerait sans prévention ? et pouvait-elle désirer qu’il parvînt à lire dans son âme ? D’un autre côté, pouvait-elle dissimuler avec l’homine aux yeux duquel elle avait toujours été ouverte et transparente comme le cristal ? à qui elle n’avait jamais caché ni pu cacher aucun de ses sentiments ? Toutes ces choses la remplissaient de souci et de perplexité ; et ses pensées revenaient toujours à Werther, qui était perdu pour elle, qu’elle ne pouvait quitter, qu’elle devait, hélas ! abandonner à lui-même, et auquel il ne resterait plus rien, une fois qu’il l’aurait perdue.
Combien lui était pénible, quoiqu’elle ne pût se l’expliquer alors, le refroidissement survenu entre Albert et Werther ! Ces hommes, si intelligents et si bons, avaient, pour quelques dissentiments secrets, commencé par se renfermer dans un mutuel silence ; chacun songeait à Soh droit et au tort de l’autre, et les rapports s’étaient brouillés et envenimés, au point qu’il devint impossible de délier le nœud dans le moment critique, duquel tout dépendait. Si une heureuse intimité les avait rapprochés plus tôt ; si l’amitié et l’indulgence s’étaient ranimées chez eux, et avaient ouvert les cœurs, peut-être notre ami pouvait-il encore être sauvé.
Ajoutons à cela une singulière circonstance : Werther, comme nous l’avons appris par ses lettres, n’avait jamais fait un secret du désir qu’il avait de quitter la vie ; Albert l’avait souvent combattu, et Charlotte en avait parlé quelquefois avec son mari ; Albert, qui sentait pour le suicide une aversion décidée, avait fort souvent exprimé, avec une certaine vivacité, tout à fait peu naturelle à son caractère, ses doutes sur la sincérité d’un pareil projet ; il s’était même permis là-dessus quelques plaisanteries, et avait fait partager à Charlotte son incrédulité : elle en était, il est vrai, tranquillisée, quand ses pensées lui présentaient cette funeste image ; mais, d’un autre côté, elle se sentait par là empêchée de communiquer à son mari les inquiétudes qui la tourmentaient dans ce moment.
Albert revint, et Charlotte alla au-devant de lui avec une vivacité embarrassée. Il n’était pas gai : son affaire n’était pas terminée ; il avait trouvé dans le bailli, son voisin, un homme inflexible et minutieux ; les mauvais chemins avaient contribué à lui donner de l’humeur.
Il demanda s’il ne s’était rien passé de nouveau, et Charlotte répondit avec précipitation que Werther était venu la veille au soir. Il demanda s’il était arrivé des lettres : elle répondit qu’il y avait des lettres et des paquets dans sa chambre. Il y passa, et Charlotte resta seule. La présence du mari qu’elle aimait et qu’elle honorait avait fait sur son cœur une impression nouvelle. Le souvenir de sa générosité, de son amour et de sa bonté, lui avait donné plus de calme ; elle sentit un secret désir de le suivre ; elle prit son ouvrage et monta chez lui, comme elle faisait souvent. Elle le trouva occupé h ouvrir les paquets et h lire. Quelques-uns semblaient ne pas apporter des nouvelles fort agréables. Charlotte lui fit diverses questions, auxquelles il répondit brièvement, puis il se mit à son bureau pour écrire.
Ils avaient passé de la sorte une heure, à côté l’un de l’autre, et Charlotte devenait toujours plus sombre ; elle sentait combien il lui serait diflicile d’avouer à son mari, fût-il même de l’humeur la plus gaie, ce qu’elle avait sur le cœur. Elle tomba dans une mélancolie d’autant plus douloureuse, qu’elle s’efforçait de la cacher et de dévorer ses larmes.
L’apparition du domestique de Werther la jeta dans la plus grande perplexité ; elle tendit le billet à Albert, qui se tourna tranquillement vers sa femme et lui dit :
« Donne-lui les pistolets. Vous lui souhaiterez de ma part un bon voyage, » ajouta-t-il, en s’adressant au domestique.
Ce fut pour Charlotte comme un coup de foudre. Elle se leva chancelante ; elle ne savait ce qui se passait en elle ; elle s’avança lentement vers la cloison ; elle y prit les pistolets d’une main tremblante, en essuya la poussière, hésita, et aurait tardé longtemps encore, si Albert ne l’avait pressée, en l’interrogeant du regard. Elle donna au domestique ces armes funestes, sans pouvoir articuler un mot, et, lorsqu’il fut sorti, elle plia son ouvrage, et se retira chez elle dans un état d’inexprimable incertitude. Son cœur lui présageait toutes les horreurs. Tantôt elle était sur le point de se jeter aux pieds de son mari, de lui tout avouer, l’histoire de la veille, sa faute et ses pressentiments ; tantôt elle ne voyait à cette démarche aucun résultat, et surtout elle ne pouvait espérer de résoudre son mari à se rendre chez Werther. On mit le couvert, et une amie, qui n’était venue que pour s’informer de quelque chose, qui voulait s’en aller d’abord, et…. qui resta, rendit, pendant le repas, l’entretien supportable : on se contraignit, on causa, on s’oublia.
Le domestique apporta les pistolets à Werther, qui les prit dans ses mains avec transport, lorsqu’il apprit que Charlotte les avait donnés elle-même. Il se fit apporter du pain et du vin, il dit au domestique d’aller dîner et se mit à écrire.
« Us ont passé par tes mains, tu en as essuyé la poussière ; je les couvre de baisers : tu les as touchés. Toi-même, ange du ciel, tu favorises ma résolution ; toi-même, Charlotte, tu fournis les armes à celui qui désirait recevoir la mort de tes mains, et qui la reçoit, hélas ! aujourd’hui. Oh ! j’ai interrogé mon domestique : tu tremblais en lui remettant ces armes ; tu n’as prononcé aucun adieu !… Malheur ! malheur ! aucun adieu !… Devais-tu me fermer ton cœur, à cause du moment qui m’a enchaîné à toi pour l’éternité ? Charlotte, les siècles des siècles n’effaceront pas cette impression, et, je le sens, tu ne peux haïr celui qui brûle ainsi >pour toi. »
Après le repas, il ordonna au domestique d’achever les malles ; il déchira beaucoup de papiers, il sortit, et régla quelques petites dettes. Il revint à la maison, sortit encore de la ville, et, malgré la pluie, il se rendit au jardin du comte ; il alla se promener plus loin dans la campagne ; il revint à la nuit tombante et il écrivit :
« Wilhelm, j’ai vu pour la dernière fois les champs, les bois et le ciel. A toi aussi mes adieux !… Pardonnez-moi, bonne mère !… Console-la, Wilhelm ! Dieu veuille vous bénir ! Adieu ! Nous nous reverrons, plus heureux.
« Albert, je t’ai mal récompensé, et tu me pardonnes. J’ai troublé la paix de ta maison ; j’ai fait naître la défiance entre vous. Adieu ! Je veux y mettre fin. Oh ! puissiez-vous être heureux par ma mort ! Albert, Albert, rends heureux cet ange ! Ainsi repose sur toi la bénédiction de Dieu ! »
Il passa une partie de la soirée à fouiller encore dans ses papiers ; il en déchira beaucoup et les jeta dans le poêle ; il cacheta quelques paquets adressés à Wilhelm. Ils contenaient de petites dissertations, des pensées détachées, dont j’ai vu plusieurs ; et, vers dix heures, après avoir ordonné qu’on remît du, bois dans le poêle et qu’on lui apportât une bouteille de vin, il envoya coucher le domestique, dont la chambre, comme celles des autres personnes de la maison, était fort loin sur les derrières. Le domestique se coucha tout habillé, pour être tout prêt de bon matin : car son maître lui avait dit que les chevaux de poste seraient à la porte avant six heures.
« Après onze heures.
« Tout est calme autour de moi, et mon âme est tranquille. Je te remercie, mon Dieu, de donner à mes derniers moments cette chaleur et cette force.
« Je vais à ma fenêtre, chère amie, et je vois, je vois encore à travers les nues, que l’orage emporte, quelques étoiles des cieux éternels. Non, vous ne tomberez pas ! L’Éternel vous porte dans son cœur, comme il me porte aussi. Je vois les premières étoiles du Chariot, la plus aimable des constellations. La nuit, quand je sortais de chez toi, quand je franchissais le seuil de ta porte, elle était là-haut devant moi. Avec quelle ivresse je l’ai souvent contemplée ! Que de fois, levant les mains, je l’ai prise pour témoin, pour signe sacré de ma félicité présente ! Et puis…. ô Charlotte, qu’est-ce qui ne me fait pas souvenir de toi ? Ne suis-je pas entouré de ta présence î Et, comme un enfant, n’ai-je pas dérobé avidement mille bagatelles que tu avais touchées, ô ma sainte ?
« Silhouette chérie !… Je te la donne, Charlotte, et je te prie de l’honorer. Elle a reçu de moi mille et mille baisers • mille fois je l’ai saluée, lorsque je sortais ou que je rentrais à la maison.
i J’ai prié ton père, par un petit billet, de protéger mon corps. Dans le cimetière sont deux tilleuls, derrière, dans le coin qui donne sur la campagne : c’est là que je souhaite reposer. Il peut le faire et le fera pour son ami. Unis ta prière à.la mienne. Je ne veux pas exiger de pieux chrétiens qu’ils déposent leur cendre à côté d’un pauvre malheureux. Ah ! je voudrais être par vous enseveli au bord du chemin ou dans la vallée solitaire ; le prêtre, le lévite, passeraient, en se signant, devant la pierre marquée, et le Samaritain y verserait une larme.
« Je m’arrête, Charlotte ! Je ne frémis point de prendre en main l’horrible et froid calice, où je vais boire l’ivresse de la mort. Tu me l’as présenté et je n’hésite point. Voilà donc comme sont accomplis tous les vœux, toutes les espérances de ma vie ! Je frappe d’une main glacée à la porte de bronze de la mort !
« Oh ! si j’avais eu le bonheur de mourir pour toi, Charlotte, de me dévouer pour toi !… Je saurais mourir avec courage, avec joie, si je pouvais te rendre le repos, le bonheur de tes jours. Mais, hélas ! il ne fut donné qu’à un petit nombre d’hommes généreux de répandre leur sang pour ceux qu’ils aimaient, «t d’allumer pour eux, par leur mort, le flambeau d’une vie nouvelle et féconde.
« Je veux, Charlotte, qu’on m’ensevelisse avec ces habits : tu les as touchés, consacrés. J’en fais aussi la demande à ton père. Mon âme planera sur le cercueil : que l’on ne fouille pas dans mes poches. Ce nœud rosé, que tu portais sur ton sein quand je te vis pour la première fois, au milieu de tes enfants…. Oh ! embrasse-les mille fois, et raconte-leur l’histoire de leur malheureux ami ! Chers enfants !… Ils se pressent autour de moi ! Comme je te fus attaché ! Dès le premier instant, je ne pouvais plus te quitter !… Ce nœud, je veux qu’on l’ensevelisse avec moi. Tu me le donnas pour mon jour de naissance ! Comme je recevais avidement toutes ces choses !… Ah ! je ne pensais pas que ce chemin me conduirait là !… Calme-toi, je t’en prie, calme-toi !
Ils sont chargés…. Minuit sonne : que mon sort s’accomplisse ! Charlotte, Charlotte, adieu ! adieu ! »
Un voisin vit l’éclair et entendit le coup : mais, comme tout resta tranquille, il n’y songea plus.
Le lendemain, vers six heures, le domestique entrait dans la chambre avec de la lumière : il trouve son maître gisant sur le plancher ; il voit le pistolet et le sang. 11 l’appelle, il le prend dans ses bras : point de réponse ; seulement il râlait encore…. Il court chez le médecin, chez Albert. Charlotte entend sonner : un tremblement la saisit dans tous ses membres. Elle éveille son mari ; ils se lèvent ; le domestique, pleurant et balbutiant, annonce la nouvelle : Charlotte tombe évanouie aux pieds d’Albert.
Quand le médecin arriva près du malheureux, il le trouva dans un état désespéré ; le pouls battait encore, tous les membres étaient paralysés. Il s’était tiré le coup au-dessus de l’œil droit ; la cervelle avait sauté. Pour ne rien négliger, on lui ouvrit la veine du bras ; le sang jaillit : il respirait encore.
Le sang qu’on voyait au dossier du fauteuil put faire juger qu’il s’était tiré le coup, étant assis devant son secrétaire : puis il était tombé, et avait roulé convulsivement autour du fauteuil. Il était gisant vers la fenêtre, couché sur le dos, sans mouvement ; il était entièrement habillé, botté, en habit bleu et veste jaune.
La maison, le voisinage, la ville, s’émurent. Albert arriva. On avait placé Werther sur le lit, le front bandé ; son visage était celui d’un mort, il ne faisait aucun mouvement. Le raie était encore effrayant, tântôt’faible, tantôt plus fort. On attendait sa fin.
11 n’avait bu qu’un verre de vin. Le drame d’Émilia Galotti ’ était ouvert sur son bureau.
La consternation d’Albert, la douleur de Charlotte, ne peuvent s’exprimer.
Le vieux bailli monta à cheval et vint au galop, à la nouvelle de ce malheur. Il embrassa le mourant et le baigna de larmes.
Les aînés de ses fils arrivèrent à pied, bientôt après lui. Ils se prosternèrent auprès du lit, avec les signes de la plus violente douleur ; ils baisaient les mains et la bouche de leur ami ; l’aîné, qui lui avait toujours été le plus cher, s’attacha à ses lèvres jusqu’à son dernier soupir, et l’on dut l’entraîner par force. Werther mourut vers midi. La présence du bailli et les mesures qu’il prit calmèrent l’effervescence. Vers onze heures de la nuit, il fit ensevelir son ami à la place qu’il avait choisie. Le père et les fils suivirent le convoi ; Albert en fut incapable. On craignit pour la vie de Charlotte. Des ouvriers portèrent le corps. Aucun ecclésiastique ne l’accompagna.