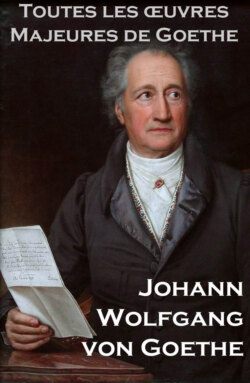Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Goethe - Johann Wolfgang von Goethe - Страница 18
1780 - Torquato Tasso
ОглавлениеJohann Wolfgang von Goethe
Torquato Tasso
Traduction par Jacques Porchat.
Librairie de L. Hachette et Cie, 1860 (Œuvre de Goethe, volume III, pp. 286-375).
Torquato Tasso
PERSONNAGES.
ALPHONSE H, duc de Ferrare. ÉLÉONORE D’ESTE, sa sœur.
ÉLÉONORE S AN VITALE, comtesse de Scandiano. TORQUATO TASSO.
ANTONIO MONTECATINO, secrétaire d’État.
La scène est à Belriguardo, château de plaisance. TORQUATO TASSO
DRAME ’.
ACTE PREMIER.
SCÈNE I.
Un jardin, orné des bnsles des poêtes épiques. Sur le devant de la scène, à droite, Virgile, à gauche, l’Aiioste.
La Princesse, élëonore.
LA PRINCESSE.
Tu me regardes en souriant, Êléonore, et tu te regardes toimême et tu souris encore. Qu’as-tu donc ? Apprends-le à toi} amie ! Tu parais pensive, et pourtant tu parais satisfaite.
ÊLÉONORE.
Oui, princesse, je me plais à nous voir toutes deux ici sous cette parure champêtre. Nous semblons de bienheureuses bergères, et nous sommes aussi occupées que ces fortunées jeunes filles : nous tressons des couronnes. Celle-ci, émaillée de fleurs, s’enfle de plus en plus dans ma main ; mais toi, avec un sen 1. Goethe a écrit ce drame, ainsi que la Fille naturelle et [phige’nie, en vers iambiques de cinq pieds.
liment plus élevé et un plus grand cœur, tu as choisi l’élégant et flexible laurier.
LA PRINCESSE.
Ces rameaux, que j’ai entrelacés en rêvant, ont trouvé d’abord une digne tête : je les place, avec reconnaissance, sur celle de Virgile. (La princesse couronne le buste de Virgile.) ÉLÉOiNORE.
Et moi, je nresse de ma riche et riante couronne le vaste front de maître Ludovico. (Elle couronne k buste de l’Arioste.) Lui, dont les grâces badines ne se flétriront jamais, qu’il reçoive d’abord sa part du nouveau printemps.
LA PRINCESSE.
Mon frère est charmant de nous avoir amenées dès à présent à la campagne. Nous pouvons être à nous-mêmes, et passer des heures à vivre en songe dans l’âge d’or des poêles. J’aime ce Uelriguardo, où j’ai passé dans la joie plus d’un jour de ma jeunesse ; et cette verdure nouvelle et ce soleil me rendent les impressions d’un temps qui n’est plus.
ÉLEONORE.
Oui, un nouveau inonde nous environne. L’ombre de ces arbres toujours verts déjà devient agréable ; déjà nous récrée de nouveau le murmure de ces fontaines ; les jeunes rameaux se balancent, bercés parle vent matinal ; les fleurs des parterres nous sourient de leurs yeux enfantins ; le*jardinier ouvre avec confiance la maison d’hiver des citronniers et des orangers ; le ciel bleu est calme sur nos têtes ; et, à l’horizon, la neige des montagnes lointaines se résout en légères vapeurs.
LA PRINCESSE.
Je verrais avec une vive joie l’arrivée du printemps, s’il ne m’enlevait pas mon amie.
ÉLEONORE.
Ne me fais pas souvenir dans ces belles heures, ô princesse, qu’elle est si proche, celle où je dois te quitter.
LA PRINCESSE.
Ce que tu auras laissé, tu le retrouveras au double dans cette grande ville.
ÉLEONORE.
Le devoir m’appelle, l’amour m’appelle auprès de l’époux qui est privé de moi depuis si longtemps. Je lui ramène son fils, que cette année a vu grandir et se former rapidement, et je partagerai sa joie paternelle. Florence est grande et magnifique, mais le prix de tous ses trésors entassés n’égale pas les joyaux de Ferrare. C’est le peuple qui a fait de Florence une illustre cité : Ferrare est devenue grande par ses princes.
LA PRINCESSE.
Plus encore par les hommes excellents qui s’y sont rencontrés par hasard et heureusement réunis.
É.LÉONORE.
Le hasard disperse aisément ce qu’il rassemble. Un noble esprit attire de nobles esprits, et sait les fixer, comme vous
• faites. Autour de ton frère et de toi, se réunissent des cœurs qui sont dignes de vous, et vous égalez vos illustres. ancêtres. Ici s’alluma heureusement la belle lumière de la science et du libre penser, quand la barbarie enveloppait encore le monde de son ombre pesante. Dès mon enfance, le nom d’Hercule d’Este, le nom d’Hippolyte d’Este, retentirent à mon oreille. Ferrare était, avec Rome et avec Florence, beaucoup vantée par mon père. Je souhaitai souvent de la voir, et j’y suis maintenant. Ici Pétrarque fut accueilli, fut entouré de soins, et l’Arioste y trouva ses modèles. L’Italie ne cite pas un grand nom que cette maison n’ait appelé son hôte ; et il est avantageux d’accueillir chez soi le génie ; pour le don de l’hospitalité, que nous lui offrons, il nous en laisse un plus beau. Le séjour que visita un grand homme est consacré. Après des siècles, ses paroles et ses actions retentissent chez les descendants.
LA PRINCESSE.
Les descendants !… S’ils sentent vivement comme toi ! Bien souvent je t’enviai ce bonheur….
ÉLÉONORE.
Dont tu jouis, comme peu de gens, sans bruit et sans mélange. Si mon cœur, qui déborde, me presse d’exprimer soudain ce que je sens vivement, tu le sens mieux, tu le sens profondément, et…. en silence ! L’éclat du moment ne t’éblouit point ; les saillies ne te séduisent pas ; vainement la flatterie se • glisse avec adresse vers ton oreille ; ton sentiment garde sa fermeté et ton goût sa justesse, ton jugement sa rectitude ; toujours CŒTHK. — TH. Il 11
ta sympathie est grande pour ce qui est grand, où tu te retrouves toi-même.
LA PRINCESSE.
Tu ne devais pas prêter à cette extrême flatterie le voile de l’intime amitié.
ÉLÉONORE.
L’amitié est juste ; elle seule peut apprécier toute l’étendue de ton mérite. Et, s’il te plaît que j’attribue aussi aux circonstances, à la fortune, une part dans ta culture, cependant tu la possèdes ; enfin, voilà ce que tu es ; et le monde t’honore, avec ta sœur, au-dessus de toutes les femmes illustres de votre temps.
LA PRINCESSE.
Cela ne peut guère me toucher, Éléonore, quand je réfléchis combien l’on est peu de chose ; et, ce qu’on est, on s’en trouve redevable à d’autres. La connaissance des langues anciennes et des plus beaux ouvrages que nous a laissés l’antiquité, c’est à ma mère que je la dois ; cependant aucune de ses deux filles ne lui fut jamais égale en science, en jugement ; et, si même l’une de nous lui doit être comparée, c’est Lucrèce assurément qui en a le droit. Aussi puis-je te l’assurer, je n’ai jamais regardé comme un titre et comme une propriété, ce que la nature, ce que la fortune m’ont dispensé. Je me félicite, quand les sages parlent, de pouvoir comprendre leurs opinions. Que ce soit un jugement sur un homme de l’antiquité et sur le mérite de ses actions ; que l’on s’entretienne d’une science, qui, développée par l’usage, est utile aux hommes, en les élevant…. quelque direction que prenne l’entretien de-ces nobles esprits, je le suis volontiers, parce qu’il m’est facile de le suivre. J’assiste avec plaisir aux débats des sages, quand la voix de l’orateur joue agréablement avec les forces, si douces et si terribles, qui agitent le cœur de l’homme ; quand la passion des princes pour la gloire et les conquêtes devient la matière du penseur, et quand la fine politique, ingénieusement développée par un homme habile, au lieu de nous tromper, nous instruit.
ÉLÉONORE.
Et puis, après ces sérieux entretiens, notre oreille et notre cœur se reposent doucement aux chants du poëte, qui. par ses suaves accents, fait passer dans les âmes les plus intimes et les plus aimables sentiments. Ton esprit élevé embrasse un vaste domaine : je m’arrête plus volontiers dans l’île de la poésie, sous les bosquets de lauriers.
LA PRINCESSE.
Dans ce beau pays (on a voulu me l’assurer), plus que les autres plantes, le myrte aime à fleurir. Et, bien que les muses soient nombreuses, on cherche plus rarement à choisir entre elles une amie, une compagne, qu’à rencontrer le poëte, qui semble nous éviter et même nous fuir ; qui semble chercher quelque chose que nous ne connaissons pas, et qu’enfin peutêtre il ne connaît pas lui-même. Aussi serait-ce une chose toute charmante, s’il nous rencontrait à l’heure favorable ; si, tout à coup ravi, il nous reconnaissait pour le trésor qu’il avait cherché longtemps en vain dans le vaste univers !
ÉLÉONORE.
Je dois me prêter à la plaisanterie ; le trait a porté, il est vrai, mais l’atteinte n’est pas profonde. J’honore en tout homme le . mérite, et je ne suis que juste envers le Tasse. Son œil s’arrête à peine-sur cette terre ; son oreille saisit l’harmonie de la nature ; ce que fournit l’histoire, ce que présente la vie, son cœur le recueille aussitôt avec empressement ; son génie rassemble ce qui est au loin dispersé, et son sentiment anime les choses inanimées. Souvent il ennoblit ce qui nous paraissait j vulgaire, et ce qu’on estime s’anéantit devant lui. Cet homme prodigieux s’avance dans ce cercle magique, qui lui est propre, et nous engage à marcher avec lui, à sentir avec lui : il semble s’approcher de nous, et il en demeure éloigné ; il semble nous regarder, et peut-être, à notre place, lui apparaissent de merveilleux génies.
LA PRINCESSE.
Tu as tracé une fine et délicate peinture du poëte, qui plane dans les régions des aimables songes. Mais la réalité me semble aussi l’attirer et le retenir puissamment. Les beaux vers que nous trouvons parfois attachés à nos arbres, et qui, semblables aux pommes d’or, nous représentent, avec ses parfums, un nouveau jardin des Hespérides,’ne les reconnais-tu pas tous pour les fruits gracieux d’un véritable amour ?
ÉLÉONORE.
Je prends aussi plaisir à ces belles poésies. Avec un esprit varié, il célèbre-un objet unique dans tous ses chants. Tantôt il l’élève, dans line brillante auréole, jusqu’au ciel étoilé, et, comme les anges, il se courbe, avec respect, sur les nues devant cette image ; tantôt il se glisse sur sa trace à travers les tranquilles campagnes, et, de toutes fleurs, il tresse une couronne. L’image adorée s’éloigne-t-elle, il consacre le sentier que ses jolis pieds ont parcouru d’une marche légère. Caché dans le buisson, comme le rossignol, le cœur malade d’amour, il fait résonner de ses plaintes mélodieuses les airs et le bocage. Sa douleur charmante, sa délicieuse mélancolie, captivent toutes les oreilles, et tous les cœurs sont entraînés.
LA PRINCESSE.
Et, s’il nomme l’objet de sa flamme, il lui donne le nom d’Éléonore.
ÉLÉONORE.
C’est ton nom comme le mien. Je serais choquée, s’il en célébrait un autre. Je suis charmée que, sous cette équivoque, il puisse cacher ses sentiments pour toi. Je veux bien qu’au doux bruit de ce nom, il se souvienne aussi de moi. Ce n’est point ici un amour qui veuille s’emparer de son objet, le posséder exclusivement, en interdire, avec jalousie, la vue à tout autre ; lorsque, dans une contemplation ravissante, il s’occupe de ton mérite, il peut bien aussi se plaire à moi, créature légère. Ce n’est pas nous qu’il’aime, pardonne-moi de le dire ! De toutes les sphères, il reporte ce qu’il aime sur un nom, qui est le nôtre, et il nous fait éprouver ce qu’il éprouve : nous semblons aimer l’homme, et, avec lui, nous aimons uniquement l’objet le plus sublime que nous puissions aimer.
LA PRINCESSE.
Tu as bien approfondi cette science, Éléonore ; tu me dis des choses qui ne font guère qu’effleurer mon oreille, et qui ont peine à pénétrer jusqu’à mon âme.
ÉLÉONORE.
Toi, disciple de Platon, ne pas comprendre ce qu’une novice se hasarde à bégayer devant toi ? Quand il serait vrai que je me suis trop abusée, cependant je ne m’abuse pas tout à fait, je le sais bien. L’amour, dans cette noble école, ne se montre pas, comme ailleurs, sous les traits d’un enfant gâté ; c’est l’adolescent, qui fut l’époux de Psyché, qui a siége et voix dans le conseil des dieux. Il ne porte pas çi et là ses coupables fureurs d’un cœur dans un autre ; il ne s’attache pas soudain, avec une douce erreur, à la beauté et à la figure, et n’expie point, par le dégoût et l’ennui, une rapide ivresse.
LA PRINCESSE.
Voici mon frère. Ne lui laissons pas deviner le cours que, cette fois encore, la conversation a^f pris ; nous aurions à souffrir ses plaisanteries, comme notre habillement a essuyé ses discours moqueurs.
SCÈNE’ II.
LA PRINCESSE, ALPHONSE, ÉLÉONORE.
ALPHONSE.
Je cherche le Tasse, que je ne trouve nulle part, et ne le rencontre pas même…. auprès de vous. Ne pouvez-vous me donner de ses nouvelles ?
LA PMNCESSE.
Je l’ai peu vu hier et point aujourd’hui.
ALPHONSE.
C’est chez lui un ancien défaut de rechercher la solitude plus que la société. Si je lui pardonne, lorsqu’il fuit la foule tumultueuse des hommes, et qu’il préfère s’entretenir librement en silence avec son génie, je ne puis l’approuver de fuir même un cercle d’amis.
ÉLÉONORE.
O prince, si je ne me trompe, tu changeras bientôt le blâme en un joyeux éloge. Je l’ai vu aujourd’hui de loin ; il tenait un livre et des tablettes ; il écrivait, il marchait, il écrivait. Un mot qu’il me dit hier en passant semblait m’annoncer la fin de son ouvrage. Il ne songe plus qu’à polir quelques petits détails, pour offrir enfin un digne hommage à ta bienveillance, dont il a reçu tant de marques.
ALPHONSE.
Il sera le bienvenu quand il me l’offrira, et je le tiendrai quitte pour longtemps. Autant je m’intéresse à son travail, et autant ce grand ouvrage me charme et doit me charmer à plusieurs égards, autant s’augmente aussi à la (in mon impatience. Il ne peut finir, il ne peut achever ; il change sans cesse, il avance lentement, il s’arrête encore…. il trompe l’espérance. On voit avec chagrin reculée bien loin la jouissance que l’on croyait prochaine.
LA PRINCESSE.
J’approuve la réserve, la précaution avec laquelle il marche pas à pas vers le but. C’est par la seule faveur des Muses que tant de vers se peuvent enchaîner pour former un ensemble ; et son âme ne nourrit pas d’autre désir ; il faut que son poëme s’arrondisse en un tout régulier ; il ne veut pas entasser contes sur contes, qui amusent par leurs agréments, et, se perdant enfin dans les airs, comme paroles vaines, ne font que nous abuser. Laisse-le, mon frère, car le temps, n’est pas la mesure d’un bon ouvrage, et, pour que la postérité puisse en jouir à son tour, il faut que les contemporains de l’artiste s’oublient.
ALPHONSE.
Agissons de concert, ma chère sœur, comme nous l’avons fait souvent pour l’avantage de tous deux. Si mon ardeur est trop vive, tu me calmeras, et si tu es trop calme, je te presserai. Alors peut-être le verrons-nous soudain arrivé au but où nous avons depuis longtemps souhaité de le voir. Alors la patrie, alors le monde s’étonnera de voir quelle œuvre s’est accomplie. Je prendrai ma part de cette gloire, et le poëte entrera dans la vie. Un noble esprit ne peut acquérir dans un cercle étroit son développement. Il faut que la patrie et le monde agissent sur lui ; il faut qu’il apprenne à supporter la louange et le blâme. Il est forcé de bien connaître et lui-même et les autres. La solitude ne le berce plus de ses illusions flatteuses. L’ennemi ne veut pas…. l’ami ne doit pas le ménager. Ainsi le jeune homme exerce ses forces en luttant ; il sent ce qu’il est, et sent bientôt qu’il est homme.
ÉLÉONORE.
Ainsi, monseigneur, tu feras désormais tout pour lui, comme tu as déjà beaucoup fait jusqu’à présent. Un talent se forme dans le silence, un caractère, dans le torrent du monde. Oh ! puisse-t-il former son caractère, comme son art, à tes leçons, ne pas éviter plus longtemps les hommes, et puisse sa défiance ne pas se changer à la fin en crainte et en aversion !
\ ALPHONSE.
Celui-là seul craint fes hommes, qui ne les connaît pas, et* celui qui les évite doit bientôt les méconnaître. Tel est le Tasse, I et, de la sorte, un cœur’\libre peu à peu s’égare et s’enchaîne. C’est ainsi que souvent il s’inquiète de ma faveur bien plus qu’il ne devrait ; il nourrit de la méfiance contre beaucoup de gens qui, je le sais fort bien, ne sont pas ses ennemis. S’il arrive qu’une lettre s’égare, qu’un valet passe de son service à celui d’un autre, qu’un papier sorte de ses mains, aussitôt il voit un dessein, il voit une trahison et une ruse qui travaillent sourdement à sa perte.
LA PRINCESSE.
N’oublions pas, mon cher frère, que l’homme ne peut se’sé- ^ parer de lui-même. Si un ami, qui devait cheminer avec nous, se blesse le pied, nous préférons ralentir notre marche et lui prêter, de bon cœur, une main secourable.
ALPHONSE.
Il vaudrait mieux pouvoir le guérir, essayer d’abord un traitement, sur l’avis fidèle du médecin, et puis prendre gaiement, avec le malade guéri, le nouveau chemin d’une florissante vie. Toutefois j’espère, mes amies, ne mériter jamais le reproche d’être un médecin rigoureux. Je fais ce que je puis pour imprimer dans son cœur la sécurité et la confiance. Je lui donne souvent, en présence de nombreux témoins, des marques décisives de ma faveur. S’il m’adresse quelque plainte, je la fais examiner, comme je fis dernièrement, lorsqu’il supposa qu’on avait forcé sa chambre. Si l’on ne découvre rien, je lui expose avec calme comment je vois l’affaire, et, comme il faut s’exercer à tout, je m’exerce à la patience avec le Tasse, parce qu’il le mérite, et vous, je le sais, vous me seconderez volontiers. Je vous ai amenées à la campagne, et je, retournerai ce soir à la ville. Vous verrez un moment Antonio : il arrive de Rome, et viendra me chercher. Nous avons beaucoup de choses à dire, à terminer ; -des résolutions à prendre, beaucoup de iettres à écrire : tout cela me force de rentrer à la ville.
LA PRINCESSE.
Nous permets-tu de t’accompagner ?
ALPHONSE.
Restez à Belriguardo, passez ensemble à Consandoli ; jouissez des beaux jours au gré de votre désir.
LA PRINCESSE.
Tu ne peux rester avec nous ? Tu ne peux régler ici les affaires aussi bien qu’à la ville ?…
ÉLÉONORE.
Tu nous enlèves d’abord Antonio, qui devait nous conter tant de choses de Rome ’ ?
ALPHONSE. i* _
Cela ne se peut, enfants que vous êtes ; mais je reviendrai avec lui aussitôt que possible ; alors il vous fera ses récits, et vous m’aiderez à récompenser l’homme qui vient encore de prendre tant de peine pour mon service ; et, quand nous aurons tout dit entre nous, que la foule des courtisans vienne alors animer nos jardins, et, comme de raison, m’offrir aussi, sous l’ombrage, quelque beauté, dont j’aurai cherché la trace.
ÉLÉONORE.
En amies, nous saurons fermer les yeux.
ALPHONSE.
Vous savez, en revanche, que je suis indulgent.
La Princesse, se tournant vers le fond de la scène.
Depuis longtemps je vois le Tasse approcher. Il marche à pas lents ; quelquefois il s’arrête tout à coup, comme irrésolu, puis il vient à nous d’un pas plus rapide et s’arrête encore.
ALPHONSE.
S’il médite et compose, ne le troublez pas dans ses rêves, et laissez-le poursuivre son chemin.
ÉLÉONORE.
Non, il nous a vus, il vient ici.
SCÈNE III. ;
LES PRÉCÉDENTS, LE TASSE.
Ia-tasse. Il tient un livre relié en parchemin. Je viens lentement t’apporter un ouvrage que j’hésite toujours à t’offrir. Je sais trop bien qu’il reste encore imparfait, quand même il pourrait sembler terminé ; mais, si j’ai craint de te l’offrir inachevé, une nouvelle crainte me fait violence aujourd’hui : je ne voudrais pas sembler trop inquiet, je ne voudrais pas sembler ingrat ; et, de même que l’homme, pour satisfaire ses amis et gagner leur indulgence, ne peut que leur dire : « Me voici ! » à mon tour, je ne puis que dire : * Accepte mon ouvrage. » (Il offre le volume.) ALPHONSE.
Ton présent me cause une surprise, et tu me fais de ce beau jour une fête. Je le tiens donc enfin dans mes mains, et je puis, dans un ceTîain sens, dire qu’il est à moi ! Dès longtemps je souhaitais de te voir te résoudre et dire enfin : « Arrêtons-nous ; c’est assez ! »
I48ljasse.
Si vous êtes contents, l’ouvrage est parfait ; car il vous appartient à tous les titres. Quand je considérais le travail qu’il m’a coûté ; quand j’observais les traits de ma plume, je pouvais dire : <* C’est mon ouvrage ; » mais, quand j’observe de plus ” près ce qui donne à ce poëme sa valeur propre et sa dignité, je reconnais bien que je le tiens de vous seuls. Si la nature bienveillante m’a dispensé, avec un généreux caprice, l’heureux don de la poésie, la fortune bizarre m’avait repoussé loin d’elle avec une violence barbare, et, si le bel univers attirait, avec toute sa richesse et sa magnificence, les regards de l’enfant, bientôt son jeune cœur fut attristé par la détresse imméritée de parents bien aimés. Mes lèvres s’ouvraient-elles pour chanter, il s’en échappait une douloureuse mélodie, et j’accompagnais de faibles accents les douleurs de mon père et les tourments de ma mère. Toi seul tu m’élevas de cette, vie étroite à une belle liberté ; tu banuis tout souci de ma pensée ; tu me donnas l’indépendance,
en sorte que mon âme put s’ouvrir et faire entendre d’héroïques accents ; et maintenant, quelques louanges qu’obtienne mon ouvrage, je vous en suis redevable, car il vous appartient.
ALPHONSE.
Pour la seconde fois, tu mérites tous nos éloges, et, par ta modestie, tu t’honores toi-même et nous avec toi.
LO-TASSE.
Oh ! si je pouvais dire comme je sens vivement que je tiens de vous seuls ce que je vous présente ! Le jeune homme obscur a-t-il puisé en lui-même la poésie ? L’habile conduite de la guerre impétueuse, l’a-t-il imaginée ? La science des armes, que chaque héros déploie avec énergie au jour marqué, la sagesse du chef, le courage des chevaliers, la lutte de la ruse et de la vigilance, n’est-ce pas toi, ô sage et valeureux prince,. qui m’as tout inspiré, comme un génie, qui mettrait son plaisir à révéler par la voix d’un mortel sa sublime et inaccessible nature ?
« LA PRINCESSE.
Jouis maintenant de l’œuvre qui fait notre joie.
ALPHONSE.
Sois heureux du suffrage de tous les nobles cœurs.
ÉLÉONORE.
Sois heureux de ta gloire universelle.
U4. TASSE.
Cet instant me suffit. Je ne pensais qu’à vous, en méditant et en écrivant ; vous plaire était mon suprême désir ; vous récréer était mon dernier but. Celui qui ne voit pas le monde dans ses amis ne mérite pas que le monde s’occupe de lui. Ici est ma patrie, ici le cercle dans lequel mon âme se plaît à s’arrêter. Ici j’entends, ici je respecte le moindre signe ; ici parle l’expérience, le savoir, le goût : oui, j’ai devant mes yeux le monde présent et le monde à venir. La foule égare et intimide l’artiste : celui qui vous ressemble, celui qui peut comprendre et sentir, celui-là seul doit juger et récompenser.
ALPHONSE.
Et si nous représentons le monde présent et le monde à venir, nous ne devons pas recevoir froidement ton offrande. Le glorieux insigne qui honore le poëte, que les héros euxmêmes, qui ont toujours besoin de lui, voient sans envie ceindre sa tête, je le rencontre ici, sur le front de ton devancier. (Il indique le buste de Virgile.) Est-ce le hasard, est-ce un génie qui a tressé et apporté cette couronne ? Ce n’est pas en vain qu’elle s’offre à nous ici. J’entends Virgile me dire : « Pourquoi honorez-vous les morts ? Ils ont eu, lorsqu’ils vivaient, leur récompense et leur joie. Et, si vous nous admirez, si vous nous honorez, donnez aussi aux vivants leur part. Mon marbre est déjà couronné : le rameau vert appartient à la vie. » (Alphonse fait un signe à sa sœur ; elle prend la couronne sur le buste de Virgile et s’approche du Tasse, qui fait un pas en arrière.)
ÉLÉONORE.
Tu refuses ! Vois quelle main te présente la belle, l’impérissable couronne !
L© TASSE.
Ah ! laissez-moi hésiter ! Car je ne vois pas comment je pourrai vivre après une heure pareille.
ALPHONSE.
Dans la jouissance du noble trésor qui t’effraye au premier moment.
La Princesse, en élevant la couronne. 0 Tasse, ne m’envie pas le rare plaisir de te dire sans paroles ce que je pense.
UL TASSE.
Je reçois à genoux, de tes mains chéries, ce noble fardeau sur ma faible téte. ( Le Tasse plie les genoux, la Princesse le couronne.)
éléonore, applaudissant. Vive celui que l’on vient de couronner pour la première fois ! Que la couronne sied bien à l’homme modeste ! (Le Tasse se lève.)
ALPHONSE.
Ce n’est qu’un présage de celle qui doit ceindre ton front au Capitole.
LA PRINCESSE.
Là te salueront des voix éclatantes ; ici l’amitié te récompense à petit bruit. • <U~<. .^4.-«
” - LO.TASSE.
V\ Oh ! reprenez-la de mon front, reprenez-la ! Elle me brûle les cheveux, et, cojnme un rayon de soleil trop ardent, qui frapperait ma tête, elle consume dans mon cerveau la puissance de la pensée. Une fiévreuse ardeur agite mon sang. Grâce ! C’en est trop !
ÉLÉ0N0RE.
Ce rameau protége au contraire la tête de l’homme qui doit marcher dans les brûlantes régions de la gloire, et il rafraîchit le front.
I^TASSE.
Je ne suis pas digne de sentir le rafraîchissement, qui ne doit récréer de son haleine que le front des héros. O dieux, enlevezla cette couronne, et la transfigurez au sein des nuages ; qu’elle plane à des hauteurs immenses, inaccessibles ; que ma vie soif une marche continuelle vers ce but.
ALPHONSE.
Celui qui obtient de bonne heure apprend de bonne heure à estimer la haute valeur des biens aimables de cette vie ; celui qui jouit de bonne heure ne renonce jamais volontairement à ce qu’il posséda une fois ; et celui qui possède doit être armé.
iflTASSE.
Et celui qui veut prendre les armes doit sentir dans son cœur une force qui ne lui manque jamais. Ah ! elle me manque à cet instant même. Elle me délaisse dans le bonheur la force native, qui m’apprit à lutter constamment avec le malheur, fièrement avec l’injustice. La joie, les transports de ce moment ont-ils consumé la moelle de mes os ? Mes genoux fléchissent. O princesse, tu me vois encore prosterné devant toi. Exauce ma prière ; ôte-moi cette couronne. Comme réveillé d’un beau songe, que je sente une vie fortifiée, une vie nouvelle !
IA. PRINCESSE.
Si tu sais porter avec une tranquille modestie le talent que les dieux font donné, apprends aussi à porter ces rameaux, le plus beau don que nous puissions te faire. Celui qu’ils ont une fois couronné dignement les verra toujours se balancer autour de son front.
Lfl TASSE.
Eh bien, souffrez que, dans ma confusion, je m’éloigne d’ici. Soutirez que je cache mon bonheur dans ce bocage épais’, comme j’y cachais autrefois mes douleurs. Là je veux errer solitaire ; là nul regard ne me rappellera mon bonheur immérité. Et, si par hasard une claire fontaine me montre dans son miroir limpide un homme, qui, merveilleusement couronné, repose rêveur, dans le reflet du ciel, au milieu des arbres, au milieu des rochers : il me semblera que je vois l’Élysée représenté dans ce miroir magique ; je me consulterai en silence et me demanderai qui peut être cette ombre, ce jeune homme des siècles passés, si gracieusement couronné. Qui me dira son nom, ses mérites ? J’attendrai longtemps, et je me dirai : « Oh ! s’il en venait un autre et un autre eiwore, pour se joindre à lui dans un agréable entretien ! Oh ! si je voyais les héros, les poëtes des jours antiques, rassemblés autour de cette fontaine ! Si je les voyais ici toujours inséparables, comme ils furent pendant leur vie étroitement unis !… » Comme l’aimant, par sa puissance, unit le fer avec le fer, la même tendance unit le héros et le poëte. Homère s’oublia lui-même ; toute sa vie fut consacrée à la contemplation de deux guerriers ; et Alexandre, dans l’Élysée, s’empresse de chercher Achille et Homère. Oh ! fussé-je auprès d’eux, pour voir ces grandes âmes désormais réunies !
ÉLÉ0N0RJE.
Réveille-toi ! réveille-toi ! Ne nous fais pas sentir que tu méconnais tout à fait le présent.
LÛ.TASSE.
C’est le présent qui élève mes pensées. Je parais absent : je suis ravi !
LA PRINCESSE. ^ t,K
J’aime à voir que, dans ton commerce-avec >es génies, tu parles un langage humain, et j’ai du plaisir à l’entendre. (Un Page s’approche du Prince et lui parle bas.) ALPHONSE.
Il est arrivé !… C’est bien à propos…. Antonio !… Qu’il vienne !… Le voici.
SCÈNE IV.
LES PRÉCÉDENTS, ANTONIO.
ALPHONSE. «- -|-©>—<ï«3 •
Sois le bienvenu, toi qui nous rends un ami, et nous apportes «n même temps une bonne nouvelle.
LA PRINCESSE.
Nous te saluons.
ANTONIO. €- Au^oy^-B^ *’~
J’ose à peine vous dire quelle joie me ranime en votre présence. A votre aspect, je retrouve tout ce que j’ai si longtemps regretté. Vous semblez contents de ce que j’ai fait, de ce que j’ai accompli, et par là je suis récompensé de tous mes soins, de mainte journée, tantôt passée dans une pénible attente, tantôt perdue avec dessein. Nous avons enfin ce que nous désirons, et tous débats sont finis.
ÉLÉONORE.
Je te salue aussi, bien que je sois fâchée : tu n’arrives qu’à l’heure même où je dois partir.
ANTONIO.
Afin que mon bonheur ne soit pas complet, tu m’en retranches d’abord une belle part.
LCLTASSE.,, ’
Reçois aussi mon salut ! J’espère jouir à mon tour du «oaumerce d’un homme si plein d’expérience.
Antonio. £-f <2-_*_U= <-*.s-“s r
Tu me trouveras sincère, si jamais tu veux regarder de ta sphère dans la mienne.
ALPHONSE. £o~«.c«S \
Bien que tu m’aies déjà annoncé par tes lettres ce que tu as fait et ce qui t’est arrivé, j’ai plusieurs choses encore à te demander sur les moyens par lesquels l’affaire a réussi. Dans ce singulier pays, il faut marcher d’un pas bien mesuré pour arriver enfin à son but. Celui qui songe purement aux intérêts de son maître a dans Rome une position fort difficile : en effet, Rome veut tout prendre et ne donner rien, et, si l’on y va pour obtenir quelque avantage, on n’obtient rien, à moins qu’on n’y porte soi-même une otïrande : heureux encore, si l’on obtient quelque chose. f
ANTONIO. £ e^Ui*©’.’” Ce n’est ni par ma conduite, ni par mon adresse, monseigneur, que j’ai accompli ta volonté. En effet, quel politique ne trouverait son maître au Vatican ? Bien des choses se sont rencontrées, que je pouvais employer à notre avantage. Grégoire te considère et te salue et te bénit. Ce vieillard, le plus digne qui fut jamais de porter une couronne, se souvient avec joie du temps où il te serrait dans ses bras. Cet homme, qui sait juger les hommes, te connaît et te célèbre hautement. Il a fait beaucoup pour l’amour de toi.
ALPHONSE.
Je me réjouis de son estime, pour autant qu’elle est sincère. Mais, tu le sais bien, du haut du Vatican on voit déjà les royaumes bien petits à ses pieds : que sera-ce des princes et des hommes ? Avoue seulement ce qui t’a le plus aidé.
ANTONIO.
Eh bien ! puisque tu le veux, c’est le grand sens du pape. Il voit petit ce qui est petit, et grand ce qui est grand ; afin de régner sur le monde, il cède volontiers et amicalement à ses voisins. Il sait bien apprécier, comme ton amitié, l’étroit territoire qu’il t’abandonne. ll veut que l’Italie soit tranquille ; il veut voir des amis dans son voisinage, maintenir la paix à ses frontières, afin que les forces de la chrétienté, qu’il dirige de sa main puissante, détruisent ici les Turcs, là les hérétiques.
LA PRINCESSE.
Connaît-on les hommes qui sont, plus que d’autres, l’objet de sa faveur, ceux qui sont admis à sa familiarité ?
ANTONIO.
L’homme expérimenté possède seul son oreille ; l’homme actif, sa confiance, sa faveur. Lui, qui a servi l’État dès sa jeunesse, il le gouverne aujourd’hui, et il agit sur les cours qu’il a vues autrefois comme ambassadeur, qu’il a connues et souvent dirigées. Le monde est aussi nettement devant ses yeux que l’avantage de ses propres États. Quand on le voit agir, on le loue ; et l’on est réjoui, quand le temps découvre ce qu’il a longuement pré paré et accompli en silence. Il n’est pas au monde un plus beau spectacle que de voir un prince qui gouverne sagement ; de voir un royaume où chacun est fier d’obéir, où chacun croit ne servir que soi-même, parce qu’on ne lui commande que des choses justes.
ÉLÉONORE.
Que je souhaiterais passionnément voir ce monde un jour de tout près !
ALPHONSE.
Mais sans doute pour y prendre ta part d’influence ? Car jamais Éléonore ne sera simple spectatrice. Ce serait charmant, en vérité, mon amie, si nous pouvions aussi mêler parfois ces mains délicates dans le grand jeu de la politique !… N’est-ce pas ?
ÉLÉONORE.
Tu veux me piquer : tu ne pourras y réussir.
ALPHONSE.
Je suis depuis quelque temps bien en reste avec toi.
ÉLÉONORE.
Soit, je demeure aujourd’hui ta débitrice. Pardonne et ne trouble pas mes questions. (A Antonio .) A-t-il fait beaucoup pour ses neveux ?
y, ANTONIO.
Ni plus ni moins qu’il n’est convenable. Un homme puissant, qui ne sait pas s’occuper des siens, est blâmé du peuple même. Grégoire sait faire du bien, avec réserve et mesure, à ses parents, qui servent l’État en hommes de mérite, et, d’un seul coup, il remplit deux devoirs qui se touchent de près.
LE TASSE.
Les sciences, les arts, ont-ils à se louer aussi de sa protection ? Est-ce qu’il rivalise avec les grands princes des temps passés ?
ANTONIO.
Il honore la science, en tant qu’elle est utile, qu’elle enseigne à gouverner l’État, à connaître les peuples ; il estime les arts, en tant qu’ils décorent, qu’ils embellissent sa ville de Rome, et qu’ils font de ses palais et de ses temples des merveilles du monde. Près de lui, nul n’ose rester oisif. Qui veut être estimé, doit agir et doit servir.
ALPHONSE. •
Et crois-tu que nous puissions bientôt terminer cette affaire ; qu’enfin ils ne nous élèveront pas encore çà et là des obstacles ?
ANTONIO.
Je serais fort trompé, si ta signature, si quelques lettres de toi, ne mettaient pas fin pour toujours à ce débat.
ALPHONSE.
Je célèbre donc ces jours de ma vie comme un temps de bonheur et de conquêtes. Je vois s’agrandir mes domaines ; je les sens tranquilles pour l’avenir. Sans coup férir, tu m’as valu cet avantage : tu as bien mérité une couronne civique. Il faut que, dans le plus beau jour, nos dames la tressent des premiers rameaux de chêne et la posent sur ton front. Cependant le Tasse m’a aussi enrichi ; il a conquis pour nous Jérusalem, et il a couvert ainsi de confusion la chrétienté moderne ; avec un joyeux courage et une ferme persévérance, il a atteint un but placé bien haut et bien loin : tu le vois couronné pour ses travaux.
ANTONIO.
Tu m’expliques une énigme. A mon arrivée, j’ai vu, avec étonnement, deux fronts couronnés.
LOJASSE.
Si tes yeux sont témoins de mon bonheur, je voudrais que cemême regard pût voir la confusion de mon âme.
ANTONIO.
Je savais depuis longtemps que, dans ses récompenses, Alphonse ne connaît point de bornes, et tu éprouves ce que chacun des siens a déjà éprouvé.
LA PRINCESSE.
Quand tu connaîtras le présent qu’il nous a fait, tu nous trouveras justes et modérés. Nous ne sommes ici que les premiers et secrets témoins des applaudissements que le monde ne lui refusera pas, et que lui donneront au centuple les âges futurs.
ANTONIO.
Il est déjà assuré par vous de sa gloire. Qui oserait douter, quand vous pouvez applaudir ? Mais, dis-moi, qui a placé cette couronne sur le front de l’Arioste ?
ÉLÉONORE.
Cette main.
GŒTHE. — TH. il 20
ANTONIO.
Et certes elle a bien fait ! Ces fleurs le parent mieux que le laurier même ne saurait le parer. Comme la nature couvre d’une robe verte, diaprée, les secrets trésors de son sein,’ il enveloppe du brillant tissu de la fable tout ce qui peut rendre l’homme digne de respect et d’amour. Le contentement, l’expérience et la raison et la force d’esprit, le goût et le sens pur du vrai bon, idéalisés,.et pourtant personnifiés dans ses chants, semblent reposer comme sous des arbres fleuris, couverts de la neige des corolles légères, couronnés de roses, capricieusement entourés par les danses et la magie des folâtres amours. La source de l’abondance murmure à leur côté, et nous laisse voir des poissons merveilleux aux diverses couleurs ; l’air est peuplé d’oiseaux rares ; les prairies et les buissons, de troupeaux étrangers ; la ruse est aux aguets, à demi cachée dans la verdure ; d’un nuage d’or, la sagesse fait retentir quelquefois des sentences sublimes ; tandis que, sur un luth harmonieux, la folie semble se livrer à des écarts sauvages, et se maintient pourtant dans la plus parfaite mesure. Celui qui ose se risquer auprès d’un tel homme, mérite déjà la couronne pour son audace. Pardonnez-moi, si je me sens moi-même inspiré ; si, comme en «extase, je ne puis bien considérer ni le temps, ni le lieu, ni ce que je dis : c’est que tous ces poetes, ces couronnes, ce costume tout nouveau de nos belles, me transportent hors de moi-même dans un monde étranger.
LA PRINCESSE.
Celui qui sait si bien apprécier l’un de ces mérites ne méconnaîtra pas l’autre. Un jour tu nous signaleras dans les chants du Tasse ce que nous avons senti, et que tu peux seul approfondir.
ALPHONSE.
Viens, Antonio ! J’ai bien des choses encore sur lesquelles je suis très-impatient de t’interroger. Ensuite, jusqu’au coucher du soleil, tu appartiendras aux dames. Viens ! adieu ! (Antonio suit le Prince, le Tasse suit les dames.)
ACTE DEUXIÈME.
Un salon.
SCÈNE I.
LA PRINCESSE, LE TASSE.
TASSE.
Je te suis, ô princesse, d’un pas incertain, et des pensées sans ordre et sans mesure s’agitent dans mon âme. La solitude semble m’appeler, me dire tout bas, d’une voix caressante : « Viens, je dissiperai les doutes nouveaux qui se sont élevés dans ton cœur. » Cependant, si je jette un regard sur toi, si mon oreille attentive recueille un mot de tes lèvres, un nouveau jour se lève autour de moi, et tous mes liens se détachent. Je te l’avouerai volontiers, cet homme arrivé soudainement auprès de nous m’a brusquement réveillé d’un beau rêve. Ses manières, ses paroles, m’ont si étrangement affecté, que je sens plus que jamais deux hommes en moi, et que je suis de nouveau avec moi-même dans un pénible combat.
T.X PRINCESSE.
Il est impossible qu’un ancien ami, qui, longtemps éloigné, a vécu d’une vie étrangère, au moment où il nous rejoint, se trouve d’abord tel qu’autrefois. Il n’est pas changé au fond ; vivons seulement quelques jours avec lui, nous nous mettrons d’accord de part et d’autre, jusqu’à ce qu’une heureuse et belle harmonie nous unisse de nouveau. Quand lui-même il connaîtra mieux l’ouvrage que tu viens de produire, il te placera certainement à côté du poëte qu’il t’oppose aujourd’hui comme un géant.
LolTASSE.
Ah ! ma princesse, l’éloge de l’Arioste dans sa bouche m’a réjoui bien loin de me blesser. Il est consolant pour nous d’entendre célébrer l’homme qui se présente à nous comme un grand modèle. Nous pouvons nous dire, dans le secret du cœur : « Si tu peux atteindre à une part de son mérite, une part de sa gloire ne saurait non plus te manquer. » Non, ce qui m’a ému, jusqu’au fond du cœur, ce qui remplit encore toute mon âme, ce sont les figures de ce monde, qui, plein de vie, infatigable, immense, tourne exactement autour d’un homme, seul grand, seul sage, et accomplit la course que le demi-dieu ose lui prescrire. J’écoutais avidement, je recueillais avec plaisir les fermes paroles de l’homme expérimenté. Mais, hélas ! plus j’écoutais, plus je m’abîmais à mes propres yeux ; je craignais de disparaître comme la nymphe Écho, le long des rochers, et de me perdre comme une vaine résonnance, comme un néant.
LA PRINCESSE.
Et, peu auparavant, tu paraissais encore sentir si nettement comme le héros et le poëte vivent l’un pour l’autre, comme le héros et le poëte se cherchent l’un l’autre, sans que l’un doive jamais regarder l’autre avec envie ! Certes elle est magnifique l’action digne d’amour ; mais il est glorieux aussi de transmettre à la postérité, par de dignes chants, les actions, avec toute leur grandeur et leur force. Qu’il te suffise, au sein du petit duché qui te protêge, de contempler tranquillement, comme du rivage, le cours orageux du monde.
L«ltasse.
Et n’ai-je pas vu ici, pour la première fois, comme on récompense magnifiquement l’homme brave ? J’arrivai, enfant sans expérience, dans le temps où fêtes sur fêtes paraissaient faire de cette ville le centre de l’honneur. Oh ! quel spectacle ! La vaste place, où la vaillance exercée devait se montrer dans tout son éclat, était environnée d’une assemblée telle que le soleil n’en éclairera pas de sitôt une semblable. Là étaient assises en foule les plus belles femmes, en foule les premiers hommes de nos jours. Le regard parcourait avec étonnement cette noble multitude. On s’écriait : « C’est la patrie, la patrie seule, l’étroite péninsule, qui les a tous envoyés ici. Ils forment ensemble le plus auguste tribunal qui ait jamais prononcé sur l’honneur, le mérite et la vertu. Si tu les passes en revue l’un après l’autre, tu n’en trouveras aucun qui doive rougir de son voisin….s Alors les barrières s’ouvrirent : les chevaux battaient du pied ; les casques et les boucliers étincelaient ; les écuyers se pressaient ; les trompettes sonnaient et les lances fracassées volaient en éclats ; les casques et les boucliers résonnaient sous les coups ; les tourbillons de poussière enveloppaient, pour un instant, la gloire du vainqueur et la honte du vaincu. Oh ! laissemoi tirer le rideau devant ce spectacle trop brillant pour moi, afin qu’en ce beau moment mon indignité ne me soit pas trop cruellement sensible.
LA PRINCESSE.
Si cette noble assemblée, si ces exploits t’enflammaient d’une généreuse émulation, je pouvais, jeune ami, t’offrir en même temps la secrète leçon de la patience. Les fêtes que tu vantes, que cent témoins me vantaient alors, et m’ont vantées bien des années après, je ne les ai pas vues. Dans un secret asile, où, presque sans cesse, le dernier écho de lajoie pouvait s’évanouir, j’avais à supporter bien des douleurs et bien des tristes pensées. Avec ses larges ailes, l’image de la mort planait devant mes yeux, et me cachait la vue du monde toujours nouveau. Cette image ne s’éloigna que peu à peu, et me laissa entrevoir, comme à travers un crêpe, pales encore, mais agréables, les mille couleurs de la vie. Je voyais de nouveau se mouvoir doucement des formes vivantes. Pour la première fois, encore soutenue par mes femmes, je sortis de ma chambre de douleur ; Lucrèce, pleine d’allégresse et de vie, vint à moi, te conduisant par la main. Tu fus le premier étranger, le premier inconnu, que je rencontrai dans cette vie nouvelle. J’en espérai beaucoup pour toi et pour moi ; et jusqu’ici l’espérance ne nous a pas trompés.
LflUTASSE.
Et moi, troublé par le tourbillon de la foule, ébloui par tant d’éclat, et agité de maintes passions, le long des tranquilles galeries du palais, je marchais en silence à côté de ta sœur, puis j’entrai dans la chambre, où bientôt, appuyée sur tes femmes, tu parus devant nous…. Quel moment pour moi que celui-là !… Oh ! pardonne ! Ainsi que l’homme égaré par de vains prestiges est aisément et doucement guéri par l’approche de la divinité, je fus de même guéri de toute fantaisie, de tout égarement, de tout désir trompeur, aussitôt que mon regard eut rencontré le tien. Tandis qu’auparavant mes vœux sans expérience s’égaraient entre mille objets, pour la première fois, je rentrai avec confusion en moi-même, et j’appris à connaître le bien désirable. C’est ainsi qu’on cherche vainement, dans le vaste sable des mers, une perle, qui repose cachée dans l’écaille, sa retraite solitaire.
LA PRINCESSE.
Alors commencèrent de beaux jours, et, si le duc d’Urbin ne nous avait pas enlevé ma sœur, les années se seraient écoulées pour nous dans un bonheur pur et charmant. Mais hélas ! il nous manque trop aujourd’hui, le caractère enjoué, le cœur plein de force et de vie, l’esprit fécond de cette aimable femme.
I4LTASSE.
Je ne le sais que trop, depuis le jour où elle quitta ces lieux, personne n’a pu te rendre la joie pure. Que de fois cette pensée a déchiré mon cœur ! Que de fois, à ton sujet, ai-je confié mes plaintes aux bois silencieux ! « Hélas ! m’écriais-je, la sœur at-elle donc seule le bonheur, le droit, d’être appréciée de cette femme chérie ? N’est-il donc plus de cœur qui mérite qu’elle veuille se confier à lui ? N’est-il plus aucune âme qui réponde à la sienne ? L’esprit et l’enjouement sont-ils éteints ? Et cette seule femme, si excellente qu’elle fut, était-elle donc tout ? » 0 princesse, pardonne ! je pensais.alors quelquefois à moi-même, et je souhaitais de pouvoir être quelque chose pour toi ; bien peu sans doute, mais quelque chose ; je souhaitais de l’être non pas en paroles, mais en effet, et de te montrer, dans la vie, comme mon cœur s’est consacré à toi en secret. Mais cela-ne m’a point réussi, et je n’ai fait que trop souvent, par erreur, ce qui devait t’affliger ; j’offensais l’homme que tu protégeais ; j’embrouillais, par imprudence, ce que tu voulais démêler ; et, dans le moment où je voulais m’approcher, je me sentais plus loin, toujours plus loin.
LA PRINCESSE.
Ami, je n’ai jamais méconnu tes intentions, et je sais comme tu prends à tâche de te nuire à toi-même. Au lieu que ma sœur sait vivre avec chacun, quel qu’il soit, tu peux à peine, même après beaucoup d’années, te retrouver dans un ami.
UQ.TASSE.
Condamne-moi ; mais dis-moi ensuite où est l’homme, où est la femme, avec qui je puisse risquer de parler à cœur ouvert comme avec toi.
LA PRINCESSE.
Tu devrais te fier à mon frère.
LO, TASSE.
Il est mon prince !… Ne crois pas toutefois qu’un souffle sauvage de liberté gonfle mon cœur. L’homme n’est pas fait pour être libre, et, pour un noble esprit, il n’est point de sort plus beau que de servir un prince qu’il honore. Mais enfin il est mon maître, et je sens toute l’étendue de ce grand mot. Je dois apprendre à me taire quand il parle, et à faire ce qu’il ordonne, mon cœur et ma raison voulussent-ils même vivement le contredire.
LA PH1NCESSE.
Cela n’arrive jamais avec mon frère, et maintenant, que nous avons Antonio, tu es assuré d’un sage ami de plus.
LÏ^TASSE.
Je m’en flattais autrefois : maintenant je suis près d’en désespérer. Que son commerce me serait profitable, et ses conseils utiles en mille rencontres ! Il possède, je’puis bien le dire, tout ce qui me manque. Mais…. si tous les dieux se sont réunis pour offrir leurs dons à son berceau, les Grâces, par malheur, ne sont pas venues, et celui à qui manquent les dons de ces immortelles peut sans doute beaucoup posséder, beaucoup donner, mais on ne pourra jamais reposer sur son sein.
LA PRINCESSE.
On peut du moins se fier à lui, et c’est beaucoup. Il ne faut pas tout exiger d’un seul homme, et celui-ci donne ce qu’il promet. S’est-il une fois déclaré ton ami, il veillera pour toi, quand tu te feras défaut à toi-même. Il fàût que vous soyez unis. Je me flatte d’accomplir en peu dé temps ce bel ouvrage. Seulement, ne résiste pas, comme c’est ta coutume. Nous avons, par exemple, possédé longtemps Éléonore, qui est pleine de finesse et d’élégance, avec laquelle il est facile de vivre, et jamais tu n’as consenti non plus à te rapprocher d’elle, comme elle l’aurait désiré.
IiX TASSE.
Jetai obéi ; autrement je me fusse éloigné d’elle, au lieu de m’en rapprocher. Si aimable qu’elle puisse paraître, je ne sais comment il s’est fait que j’ai pu rarement être entièrement ouvert avec elle ; et, lors même qu’elle a l’intention d’obliger ses amis, l’intention se fait sentir et l’on est choqué.
LA PRINCESSE.
O mon ami, par ce chemin nous ne trouverons jamais de société. Ce sentier nous séduit et nous entraîne à travers les bois solitaires et les secrètes vallées ; l’âme s’égare de plus en plus, et l’âge d’or, qu’elle ne trouve pas au dehors, elle s’efforce de le reproduire dans son sein, si peu que la tentative lui réussisse.
L© TASSE.
Oh ! quelle parole a prononcée ma princesse ! Où s’est-il envolé cet âge d’or, après lequel tous les cœurs soupirent en vain ; cet âge, où, sur la terre libre, les humains, comme de joyeux troupeaux, se répandaient pour jouir ; où un arbre antique, dans la prairie émaillée de fleurs, offrait son ombre au berger et à la bergère ; où de plus jeunes arbrisseaux entrelaçaient discrètement leurs branches flexibles, pour abriter les transports de l’amour ; où, tranquille et transparente, sur un sable toujours pur, l’onde obéissante embrassait mollement la nymphe ; où le serpent craintif se perdait, sans nuire, dans le gazon ; où le faune hardi s’enfuyait, bientôt châtié par une vaillante jeunesse ; où chaque oiseau, dans le libre espace de l’air, où chaque animal, errant par les monts et les vallées, disait à l’homme : « Ce qui plaît est permis ! »
LA PRINCESSE.
Mon ami, l’âge d’or est passé sans doute, mais les nobles cœurs le ramènent. Et, s’il faut t’avouer ce que je pense, l’âge d’or, dont le pôet ? a coutume de nous flatter, ce beau temps exista, ce me sgmble, aussi peu qu’il existe ; et, s’il fut jamais, il n’était assurément que ce qu’il peut toujours redevenir pour nous. Il est encore des âmes sympathiques, qui se rencontrent et jouissent ensemble de ce bel univers. Il ne faut, mon ami, que changer un seul mot dans la devise : « Ce qui est convenable est permis. »
LO.TASSE.
Ah ! si un tribunal universel, composé seulement d’hommes nobles et bons, décidait de ce qui convient, au lieu que chacun juge convenable ce qui lui profite !… Nous le voyons en effet, tout sied bien à l’homme puissant, à l’homme habile, et il se permet tout.
LA PRINXESSE.
Veux-tu apprendre parfaitement ce qui convient, ne le demande qu’aux nobles femmes ; car il leur importe plus qu’à personne, que tout ce qui se passe soit bienséant. La convenance entoure.d’un rempart le sexe faible, aisément vulnérable. Où règne la moralité, les femmes régnent ; où domine la licence, elles ne sont rien ; et, si tu veux interroger l’un et l’autre, tu verras que l’homme aspire à la liberté, la femme à la décence.
LOJASSE.
Tu nous déclares indomptables, grossiers, insensibles ?
LA PRINCESSE.
Non pas ! Mais vous poursuivez des biens éloignés, et il faut que votre poursuite soit violente. Vous hasardez d’agir pour l’immortalité, tandis que nous ne pouvons posséder sur cette terre qu’un unique bien, étroitement limité, et nous souhaitons qu’il nous reste fidèle. Nous ne sommes jamais sûres du cœur d’un homme, avec quelque ardeur qu’il se soit donné à nous une fois. La beauté est passagère, et vous semblez n’avoir des hommages que pour elle. Ce qui reste ensuite ne charme plus, et ce qui ne charme plus est mort. S’il y avait des hommes capables d’apprécier un cœur de femme, de reconnaître quel précieux trésor d’amour et de fidélité le sein d’une femme peut recéler ; si le souvenir des heures les plus belles pouvait rester vivant dans vos âmes ; si votre regard, d’ailleurs pénétrant, pouvait aussi percer le voile que jette sur nous l’âge ou la maladie ; si la possession, qui doit rendre paisible, ne vous rendait pas désireux de biens étrangers : alors certes un beau jour aurait lui pour nous, et nous pourrions célébrer notre âge d’or.
L0 TASSE.
Tu me tiens des discours qui réveillent vivement dans mon cœur des craintes déjà presque endormies.
LA PRINCESSE.
O Tasse, quelle est ta pensée ? Parle-moi librement.
UÛ,TASSE.
J’ai entendu souvent, et, ces jours derniers, j’entendais encore, et, quand même je ne l’aurais pas appris, encore le devrais-je imaginer…. de nobles princes aspirent à ta main ! Ce que nous devons prévoir, nous le craignons, et nous en sommes presque au désespoir. Tu nous quitteras, c’est une chose naturelle, mais comment nous le supporterons, c’est ce que j’ignore.
LA PRINCESSE.
Pour le moment, soyez tranquilles. Je pourrais presque dire, soyez tranquilles pour toujours. Je me vois ici volontiers, et volontiers j’y resterai. Je ne sais encore aucune liaison qui puisse m’attirer ; et, si vous.voulez en effet me retenir, montrez-le-moi par la concorde ; faites-vous à vous-mêmes une vie heureuse, et à moi par vous !
ItfXjASSE.
Oh ! enseigne-moi à faire ce qui est possible ! Tous mes jours te sont consacrés. Quand mon cœur s’ouvre pour te louer, pour te rendre grâce, alors seulement je goûte la félicité la plus pure que l’homme puisse sentir ; la plus divine, je ne l’éprouvai qu’en toi. Les dieux de la terre se distinguent des autres hommes, autant que le destin suprême se distingue du jugement et de la volonté des hommes même les plus sages. Quand nous voyons flots sur flots se heurter violemment, les princes laissent beaucoup de murmures passer inaperçus à leurs pieds, comme des ondes légères ; ils n’entendent pas l’orage qui gronde autour de nous et nous renverse ; nos prières parviennent à peine a leurs oreilles, et, comme nous le faisons envers de pauvres enfants tenus dans la contrainte, ils nous laissent remplir les airs de soupirs et de cris. Pour toi, ô femme divine, tu m’as souvent supporté, et, comme le soleil, ton regard a séché la rosée de mes paupières.
LA PRINCESSE.
Il est bien juste que les femmes t’accueillent avec l’amitié la plus vive : ton poëme les célèbre de *usieurs manières. Tendres “ou courageuses, tu as su toujours les représenter nobles et charmantes. Et, si Armide nous paraît digne de haine, ses attraits et son amour nous réconcilient bientôt avec elle.
MUTASSE.
Tous les échos qui retentissent dans mes chants, c’est à une seule femme, à une seule, que je les dois. Ce que je vois planer devant mon front n’est point une image idéale, indécise, qui tantôt s’approche de l’âme avec un éclat éblouissant, tantôt se retire. Je l’ai vu de mes yeux le modèle de chaque vertu, de chaque beauté. Ce que j’ai peint d’après ce modèle subsistera. L’amour héroïque de Tancrède pour Clorinde, la silencieuse et secrète fidélité d’Herminie, la grandeur de Sophronie et la souffrance d’Olinde : ce ne sont pas des ombres que l’illusion enfanta, ce sont des choses immortelles, je le sais, parce qu’elles existent. Et qui a plus le droit de vivre des siècles, et de perpétuer son influence secrète, que le mystère d’un noble amour discrètement confié à l’aimable poésie ?
LA PRINCESSE,
Et dois-je te dire encore un privilége que la poésie sait surprendre à notre insu ? Elle nous attire par degrés ; nous prêtons l’oreille ; nous écoutons et nous croyons comprendre ; ce que nous comprenons, nous ne pouvons le blâmer, et par là cette poésie nous subjugue à la fin.
LSLTASSE.
Quels cieux ouvres-tu devant moi, ô princesse ? Si leur éclat ne m’aveugle point, je vois un bonheur éternel, inespéré, descendre avec magnificence sur des rayons d’or.
LA PRINCESSE.
O Tasse, ne va pâs plus avant !… Il est beaucoup de choses que nous devons saisir avec ardeur ; mais il en est d’autres que nous ne pouvons nous approprier que par la modération et le renoncement. Il en est ainsi de la vertu, nous dit-on, ainsi de l’amour, qui est son frère…. Songes-y bien. (Elle sort.)
SCÈNE II.
l£TASSE, seul.
Est-ce qu’il t’est permis d’ouvrir les yeux ? Oses-tu regarder autour de toi ? Tu es seul. Ces colonnes ontelles entendu ce qu’elle disait ? Et dois-tu craindre ces témoins, ces muets témoins de ta félicité suprême ? Il se lève le soleil du nouveau jour de ta vie, qui ne se peut comparer avec ceux qui l’ont précédé. En descendant jusqu’au mortel, la déesse l’élève soudain jusqu’à elle. Quelle sphère nouvelle se découvre à mes yeux ! Quel empire ! Que mon ardent désir est richement comblé ! Je rêvais que j’approchais du bonheur suprême, et ce bonheur est au-dessus de tous les rêves. Que l’aveugle-né se figure la lumière, les couleurs, comme il voudra : quand le nouveau jour lui apparaît, c’est pour lui un nouveau sens. Plein de courage et d’espérances, ivre de joie et chancelant, j’entre dans cette carrière. Tu me donnes beaucoup ; tu donnes, comme la terre et le ciel nous versent, sans mesure, leurs dons à pleines mains, et tu demandes en échange ce qu’un tel présent t’autorise seul à me demander. Il faut que je renonce, il faut que je me montre modéré, et qu’ainsi je mérite que tu te confies à moi. Qu’ai-je fait jamais, pour qu’elle ait pu me choisir ? Que dois-je faire pour être digne d’elle ? Elle a pu se fier à moi, et par là je le suis. Oui, princesse, que mon âme soit pour jamais absolument vouée à tes paroles, à tes regards. Oui, demande ce que tu veux, car je suis à toi ! Qu’elle m’envoie dans les pays lointains chercher le travail et le danger et la gloire ; que, dans un secret bocage, elle me présente la lyre d’or ; qu’elle me consacre au repos et à son culte : je suis à elle ; qu’elle me possède pour me former. Mon cœur gardait pour elle tous ses trésors. Oh ! si un dieu m’avait accordé mille facultés nouvelles, elles suffiraient à peine pour exprimer mon ineffable adoration. Je me souhaiterais le pinceau du peintre et les lèvres du poëte, les plus douces que jamais ait nourries le miel nouveau. Non, le Tasse n’ira plus à l’avenir se perdre solitaire, faible et troublé, dans les forêts, parmi les hommes ! Il n’est plus seul ; il est avec toi. Oh ! si la plus noble des entreprises s’offrait ici devant mes yeux, environnée d’affreux dangers !… Je courrais au-devant, et risquerais volontiers la vie, que je tiens désormais de ses mains ; j’inviterais les plus vaillants hommes à me suivre, ! pour accomplir l’impossible avec ces nobles guerriers, sur son ordre et son geste. Homme impatient, pourquoi ta bouche n’at-elle pas caché ce que tu sentais, jusqu’au jour où, digne et toujours plus digne d’elle, tu aurais pu tomber à ses pieds ? C’était ton dessein, c’était ton sage désir. Mais soit !… Il est bien plus beau de recevoir purement et sans titre un pareil don, que d’imaginer, en quelque façon, qu’on aurait pu y prétendre. Regarde avec joie !… Ce qui est devant toi est si grand et si vaste ! et là jeunesse, riche d’espérance, t’appelle de nouveau dans le mystérieux et brillant avenir. Oh ! gonfle-toi, mon cœur ! Secrètes influences du bonheur, favorisez une fois cette plante ! Elle s’élance vers le ciel ; mille rameaux sortent de sa tige, et s’épanouissent en fleurs. Oh ! qu’elle produise des fruits ! qu’elle produise la joie ! Qu’une main chérie cueille la parure d’or sur ses frais et riches rameaux !
SCÈNE III.
LR TASSE, ANTONIO.
MUASSE.
Sois le bienvenu, toi qu’il me semble voir en ce moment pour la première fois ! Jamais homme ne me fut annoncé sous de plus beaux présages. Sois le bienvenu ! Je te connais maintenant, et tout ce que tu vaux. Je t’offre, sans hésiter, mon amitié et ma main, et toi aussi, je l’espère, tu ne me dédaigneras pas.
ANTONIO.
Tu m’offres libéralement de nobles dons, et j’en reconnais le prix comme je dois. C’est pourquoi, laissemoi réfléchir avant de les accepter. Je ne sais pas si je pourrais t’offrir en échange quelque chose qui les égale. Je voudrais bien ne paraître ni inconsidéré ni ingrat. Permets que je sois sage et prudent pour tous deux.
I4XJASSE.
Qui blâmera la prudence ? Chaque pas dans la vie montre combien elle est nécessaire ; mais il est plus beau que le cœur sache nous dire quand nous n’avons pas besoin de subtile prévoyance.
ANTONIO.
Que chacun consulte là-dessus ses sentiments ; car c’est luimême qui doit expier la faute.
MUTASSE.
Soit !… J’ai fait mon devoir ; j’ai suivi avec respect les ordres de la princesse, qui désire que nous soyons amis, et je me suis offert à toi. Je ne devais pas rester en arrière, Antonio ; mais, assurément, je neveux pas t’importuner. Qu’il en soit donc ainsi ! Le temps et la fréquentation t’engageront peut-être à réclamer plus chaudement le don que tu écartes aujourd’hui avec froideur, et que tu sembles presque dédaigner.
ANTONIO.
L’homme modéré est souvent appelé froid par ceux qui se croient plus chauds que les autres, parce qu’une ardeur soudaine les saisit en passant.
LfiLTASSE.
Tu blâmes ce que je blâme, ce que j’évite. Je sais bien aussi, tout jeune que je suis, préférer la durée £ la vivacité.
ANTONIO.
Parole très-sage ! Reste toujours dans ce sentiment.
l£> TASSE.
Tu as droit de me conseiller, de m’avertir, car l’expérience demeure à ton côté, comme une amie longtemps éprouvée ; mais crois bien qu’un cœur tranquille écoute les avis de chaque jour, de chaque heure, et s’exerce en secret à chacune des vertus que ton esprit sévère croit lui enseigner comme nouvelles.
ANTONIO.
Il peut être agréable de s’occuper de soi-même : il faudrait seulement que ce fût profitable. Ce n’est point en lui-même que l’homme apprend à connaître le fond de son cœur ; car il se juge avec sa propre mesure, quelquefois trop petite et souvent, hélas ! trop grande. L’homme ne se connaît que dans les hommes ; la vie peut seule apprendre à chacun ce qu’il est.
IA.TASSE.
Je t’écoute avec approbation et respect.
ANTONIO.
Et cependant tu entends sous ces paroles tout autre chose que je ne veux dire.
I^TASSE.
De cette manière nous ne pouvons nous rapprocher. Il n’est pas sage, il n’est pas équitable de méconnaître, à dessein, un homme, quel qu’il soit. Les ordres de la princesse étaient à peine nécessaires ; je t’ai deviné aisément. Je sais que tu veux et que tu fais le bien. Ta propre fortune te laisse sans inquiétude ; tu penses aux autres ; tu viens à leur aide, et ton cœur demeure inébranlable sur le flot inconstant de la vie. C’est ainsi que je te vois. Et que serais-je, si je n’allais pas au-devant de toi ; si je ne recherchais pas aussi avec ardeur une part du trésor caché que tu tiens en réserve ? Je sais que tu n’as pas regret de t’ouvrir ; je sais que tu seras mon ami, quand tu me connaîtras ; et depuis longtemps j’avais besoin d’un pareil ami. Je ne rougis point de mon inexpérience et de, ma jeunesse. Le nuage doré de l’avenir repose encore doucement autour de ma tête. O noble Antonio, prends-moi sur ton cœur ; initie le jeune homme fougueux, inexpérimenté, à l’usage modéré de la vie.
ANTONIO.
Tu demandes en un moment ce que le temps n’accorde qu’après mûre réflexion.
IA.TASSE.
L’amitié accorde en un moment ce que le travail obtient à peine au bout d’un long temps. Je n’implore pas cette faveur de toi, j’ose la réclamer. Je t’adjure, au nom de la vertu, qui s’empresse d’unir les belles âmes. Et dois-je te nommer encore un nom ? La princesse l’espère, elle le veut…. Éléonore veut nous conduire l’un à l’autre. Allons au-devant de ses vœux ! Montrons-nous unis devant la déesse ; offrons-lui nos services, toute notre âme, afin de faire ensemble pour elle ce qui sera le plus digne de lui plaire. Encore une fois, voici ma main !… Prends-la ! Ne recule pas, et ne refuse pas plus longtemps, noble Antonio, et accorde-moi la joie, la plus grande pour l’honnête homme, de se donner avec confiance et sans réserve à l’homme qui vaut mieux que lui !
ANTONIO.
Tu vogues à pleines voiles ! Il parait bien que tu es accoutumé à vaincre, à trouver partout les voies larges, les portes ouvertes. Je te souhaite volontiers tous les mérites, tous les succès ; mais, je le vois trop bien, nous sommes encore à une trop grande distance l’un de l’autre.
Uî. TASSE.
Par les années, par le mérite éprouvé, je le veux bien : pour le joyeux courage et la bonne volonté, je ne le cède à personne.
ANTONIO.
La bonne volonté n’entraîne pas les actions ; le courage se figure les chemins plus courts. Celui qui est arrivé au but est couronné, et souvent un plus digne n’obtient pas la couronne. Mais il est des couronnes faciles ; il est des couronnes d’espèces très-diverses ; elles s’obtiennent parfois commodément, au milieu d’une promenade.
LÉltasse.
Ce qu’une divinité accorde à l’un librement et refuse sévèrement à l’autre, un tel avantage, chacun ne l’obtient pas comme il voudrait.
ANTONIO.
Attribue-le à la fortune plutôt qu’aux autres dieux : j’y souscrirai volontiers, car son choix est aveugle.
UBt. TASSE.
La justice porte aussi un bandeau, et ses yeux se ferment à tout prestige. •
ANTONIO.
Que l’homme fortuné se plaise à célébrer la fortune ; qu’il lui suppose cent yeux pour le mérite et un choix sage et des soins attentifs ; qu’il l’appelle Minerve ; qu’il l’appelle comme il voudra ; qu’il tienne une pure grâce comme une récompense, une parure de hasard comme un ornement bien mérité !
MUTASSE.
Tu n’as pas besoin de parler plus clairement. Il suffit ! Je lis au fond de ton cœur et te connais pour toute la vie. Oh ! si ma princesse te connaissait de même ! Ne prodigue pas les traits que lancent tes yeux et ta langue ! Tu les diriges vainement vers cette couronne impérissable, posée sur ma tête. Sois d’abord assez grand pour ne pas me l’envier ! Peut-être ensuite oseras-tu me.la disputer. Je la regarde comme sacrée et comme le bien suprême : cependant montre-moi l’homme qui soit parvenu où je m’efforce d’arriver ; montre-moi le héros dont les histoires m’aient parlé seulement ; présente-moi le poëte qui se puisse comparer à Homère, à Virgile ; oui, pour dire plus encore, montre-moi l’homme qui ait mérité trois fois cette récompense, et que cette belle couronne ait, plus que moi, fait trois fois rougir : alors tu me verras à genoux devant la Divinité qui m’a fait ce don ; je ne me lèverai pas, avant qu’elle ait fait passer cet ornement de mon front sur celui de ce vainqueur.
ANTONIO.
Jusque-là tu en es digne assurément.
Ht, TASSE.
Que l’on me juge, je ne veux point m’y soustraire ; mais je n’ai pas mérité le mépris. La couronne, dont mon prince m’a jugé digne, que la main de ma princesse a tressée pour moi, nul ne m’en fera un sujet de doute et de raillerie.
ANTONIO.
Ce ton hautain, cette ardeur impétueuse, ne te sied pas avec moi, ne te sied pas dans ce lieu.
IÔJTASSE.
Ce que tu te permets dans ce lieu me sied aussi à moi. Et la vérité en est-elle donc bannie ? L’esprit indépendant est-il prisonnier dans ce palais ? Ici, un noble cœur n’a-t-il plus qu’à souffrir l’oppression ? Il me semble que la grandeur, la grandeur de l’ame, est ici surtout à sa place. Ne peut-elle obtenir l’avantage d’approcher les puissants de la terre ? Elle le peut, elle le doit. Nous n’approchons du prince que par la noblesse, J qui nous est venue de nos pères - : pourquoi pas par le cœur, que la nature n’a pas donné grand à chaque homme, de même qu’elle ne pouvait donner à chacun une suite de grands ancêtres ? La seule petitesse devrait ici se sentir gênée ; l’envie, qui se montre à sa honte, de même que la toile impure GCETHE. TH. — Il 21
d’aucune araignée, ne doït jamais s’attacher à ces murs de marbre.
ANTONIO.
Tu me montres toi-même mon droit à te dédaigner. L’enfant inconsidéré veut arracher de force la confiance et l’amitié de l’homme. Incivil comme tu l’es, te crois-tu bon ?
UÛ.TASSE.
J’aime bien mieux ce que vous appelez incivil que ce qu’il me faudrait appeler ignoble.
ANTONIO.
Tu es encore assez jeune pour qu’une bonne discipline te puisse enseigner une meilleure voie.
Ifi. TASSE.
Pas assez jeune pour me courber devant les idoles, et assez mûr pour réprimer l’orgueil par l’orgueil.
ANTONIO.
Où les lèvres et la lyre décideront, tu pourras sortir du combat en héros, en vainqueur.
MUTASSE.
Je serais téméraire de vanter mon bras, car il n’a rien fait ; mais je me fie à lui.
ANTONIO.
Tu te fies aux ménagements qui ne t’ont que trop gâté dans la marche insolente de ta fortune.
LÉ^ TASSE.
Je suis homme, je le sens maintenant. C’est avec toi que j’aurais le moins souhaité d’essayer le sort des armes : mais tu attises braise sur braise. Je brûle jusqu’à la moelle. Le douloureux désir de la vengeance bouillonne écumant dans mon sein. Si tu es l’homme que tu prétends être, fais-moi tête !
ANTONIO.
Tu sais aussi peu qui tu es que le lieu où tu es.
LSUTASSE.
Aucun sanctuaire ne nous commande de supporter l’outrage. C’est toi qui insultes, qui profanes ce lieu ; ce n’est pas moi, moi qui venais t’offrir confiance, respect, amitié, le plus bel hommage ; c’est ton esprit qui infecte ce paradis, et tes paroles cette salle pure, et non les sentiments tumultueux de mon cœur, qui se soulève à l’idée de souffrir la moindre tache.
ANTONIO.
Quel esprit hautain dans un cœur étroit !
Mutasse, posant la main sur sa poitrine.
Il est encore ici de l’espace pour mettre ce cœur à l’aise.
ANTONIO.
Le vulgaire se met aussi à l’aise avec des mots.
Iffl. TASSE.
Si tu es gentilhomme ainsi que moi, fais-le voir.
ANTONIO.
Je le suis certes, mais je sais où je suis.
LO, TASSE.
Viens avec moi là-bas, où nous pourrons user de nos armes.
ANTONIO.
Comme tu ne devais pas m’appeler, je ne te suivrai pas,
llS, TASSÉ.
Un pareil obstacle est bienvenu pour la lâcheté.
ANTONIO.
Le lâche ne menace qu’en lieu sûr.
Œl. Tasse.
Je puis renoncer avec joie à cette sauvegarde.
ANTONIO.
Ménage-toi du moins, si tu ne ménages pas le lieu où nous sommes.
LUTTASSE.
Que ce lieu me pardonne de l’avoir souffert ! (Il met l’épée à la main.) En garde ! ou suis-moi, si tu ne veux pas que je te méprise éternellement, comme je te hais !
SCÈNE IV.
ANTONIO, ALPHONSE, LE TASSE.
ALPHONSE.
Dans quel déliât vous trouvé-je soudain ?
ANTONIO.
Tu me vois tranquille, ô prince, devant un homme que la fureur a saisi.
Iffl^ TASSE.,
Je t’adore comme une divinité, et, d’un seul regard, tu m’avertis, tu m’enchaînes.
ALPHONSE.
Parle, Antonio ; dis-moi, Tasse, comment la discorde a pénétré dans ma maison. Comment vous a-t-elle saisis ? Comment vous a-t-elle entraînés dans son délire, vous, hommes sages, loin du sentier des convenances et des lois ? Je suis confondu.
TASSE.
Tu ne nous connais pas tous deux, je le vois bien. Cet homme que voici, renommé comme sage et moral, s’est conduit envers moi avec grossièreté et malice, en homme sans noblesse et sans éducation. Je l’ai abordé avec confiance, il m’a repoussé ; je l’ai sollicité avec instance, avec amitié, et lui, amer et toujours plus amer, il n’a pas eu de repos qu’il n’eût changé en fiel le plus pur de mon sang. Pardonne ! Tu m’as trouvé ici comme un furieux. A lui tout le crime, si je me suis rendu criminel. Il a, par sa violence, attisé la flamme qui m’a saisi et qui nous a blessés tous deux.
ANTONIO.
Le sublime élan poétique l’a entraîné. O prince, tu t’es d’abord adressé à moi ; tu m’as interrogé : qu’il me soit permis de parler à mon tour après ce fougueux orateur.
L»_TASSE.
Oh oui ! rapporte, rapporte mot pour mot ; et, si tu peux exposer devant ce juge chaque syllabe, chaque geste, ose-le seulement ! ose te flétrir une seconde fois toi-même, et témoigne contre toi ! Je ne veux pas démentir un souffle, un battement d’artère. ANTONIO.
Si tu as quelque chose à dire encore, parle ; sinon, tais-toi et ne m’interromps pas. Si c’est moi, mon prince, ou cette tête chaude qui a commencé la querelle, quel est celui qui a tort : c’est une grande question, qui, préalablement, demeure encore indécise.
VX TASSE.
Comment cela ? Il me semble que la première question est de savoir qui de nous deux a tort ou raison.
ANTONIO. •
Pas tout à fait, comme peut le supposer l’esprit sans retenue.
ALPHONSE.
Antonio !
ANTONIO.
Monseigneur, je respecte un signe de ta volonté, mais fais qu’il se taise. Quand j’aurai parlé, il pourra répondre ; tu décideras. Je dirai donc seulement que je ne puis lutter avec lui ; je ne puis ni l’accuser ni me défendre, moi-même, ni m’offrir à lui donner maintenant satisfaction ; car, tel que le voilà, il n’est pas libre. Il est dominé par une loi sévère, que ta bonté pourra tout au plus adoucir. Il m’a menacé dans ce lieu, il m’a défié. C’est à peine s’il a caché devant toi son épée nue ; et, si tu n’étais pas survenu entre nous, seigneur, moi-même je paraîtrais maintenant coupable, complice et humilié devant toi.
Alphonse, ’ùm Tasse. Tu n’as pas bien agi.
LJ)^ TASSE.
O prince, mon propre cœur m’absout, et sans doute aussi le tien. Oui, c’est vrai, je l’ai menacé, défié, j’ai tiré l’épée. iMais avec quelle perfidie sa langue m’a blessé par des mots adroitement choisis ; comme ses dents acérées et rapides ont versé le subtil poison dans mon sang ; comme il a de plus en plus allumé la fièvre…. tu ne peux l’imaginer ! Impassible et froid, il m’a rebuté, il m’a poussé aux dernières limites. Oh ! non, tu ne le connais pas, et tu ne le connaîtras jamais. Je lui dirais avec chaleur l’amitié la plus belle ; il a jeté mes présents à mes pieds, et, si mon âme n’eût été révoltée, j’étais à jamais indigne de ta faveur, de ton service. Si j’ai oublié la loi et ce lieu, pardonne-moi ! Nulle part au monde je ne puis être vil ; nulle part je ne puis souffrir l’avilissement. Si ce cœur, en quelque lieu que ce soit, peut te manquer et se manquer à lui-même, alors punis-moi, alors chasse-moi, et ne permets pas que je revoie jamais ton visage.
ANTONIO.
Avec quelle aisance ce jeune homme porte un pesant fardeau et secoue ses fautes, comme la poussière de son vêtement ! Il y aurait de quoi s’étonner, si l’on connaissait moins le pouvoir magique de la poésie, qui aime tant à jouer avec l’impossible. Mais toi, mon prince, mais tous tes serviteurs, jugerez-vous de même cette action si insignifiante ? J’ai quelque, peine à le croire. La majesté étend sa protection sur tout homme qui s’approche d’elle, comme d’une divinité et de son inviolable demeure. Comme au pied de l’autel, chaque passion s’apaise sur lej»|nil. La ne brille aucune épée, là n’échappe aucune parole menaçante, là l’offensé même ne demande point vengeance. Les vastes campagnes offrent encore un assez grand espace pour la colère et l’implacable haine. Là aucun lâche ne menacera, aucun brave ne fuira. Mais tes ancêtres ont bâti ces murailles sur la sécurité ; ils ont fondé ce sanctuaire pour leur dignité ; ils ont sagement et sévèrement maintenu ce repos avec des châtiments rigoureux : le bannissement, la prison, la mort, atteignaient le coupable. On n’avait point égard à la personne ; la clémence n’arrêtait point le bras de la justice, et le coupable lui-même se sentait effrayé. Maintenant nous voyons, après une longue et belle paix, une fureur brutale reparaître en délire dans l’asile des mœurs. Seigneur, décide, châtie ! Qui peut en effet marcher dans les bornes étroites de son devoir, si la loi, si le pouvoir du prince ne le protégent ?
ALPHONSE.
Plus que vous ne le dites et ne pouvez le dire tous deux, mon cœur me permet d’écouter d’une manière impartiale. Vous eussiez mieux fait votre devoir, si je n’avais pas à prononcer cet arrêt ; car ici le tort et le droit se touchent de bien près. Si Antonio t’a offensé, il devra, de quelque manière, te donner satis-, faction, comme tu le demanderas. Il me serait agréable que vous me choisissiez pour arbitre. Cependant, ô Tasse, ta faute mérite la prison. Comme je t’excuse, j’adoucis la loi en ta faveur. Laissenous ; reste dans ta chambre, seul et sans autre garde que toi-même.
IA.TASSE.
Est-ce là, ô prince, ta sentence ?
ANTONIO.
Ne reconnais-tu pas la douceur d’un père ?
Le Tasse, à Antonio.
Je n’ai plus, pour le moment, à parler avec toi. (A Alphonse :) O prince, ta parole sévère me condamne, moi, homme libre, à la captivité. Soit ! Tu le crois juste. Respectant ton ordre sacré, j’impose à mon cœur le plus profond silence. Ceci est nouveau pour moi, si nouveau, que je reconnais à peine et mon prince et moi-même et ce beau lieu. Mais cet homme, je le connais bien !… Je veux obéir, quand même je pourrais dire et devrais dire ici bien des choses encore. Mes lèvres restent muettes. Était-ce un crime ? ll paraît du moins que je suis considéré comme un criminel, et, quoi que mon cœur me dise, je suis prisonnier.
ALPHONSE.
O Tasse, tu prends la chose plus sérieusement que moi-même.
MUTASSE.
Elle reste incompréhensible pour moi…. Non pas incompréhensible !… Je ne suis pas un enfant ; je crois même que j’aurais pu me la figurer. Tout à coup une clarté me luit, mais elle disparaît aussitôt. Je n’entends que mon arrêt : je m’incline. Voilà déjà trop de paroles inutiles ! Accoutume-toi désormais à obéir, chétive créature ! Tu oubliais en quel lieu tu te trouves. Le palais des dieux te semblait au niveau de la terre, et une chute rapide t’entraîne. Obéis de bon cœur, car il sied à l’homme de faire sans répugnance, même une chose pénible. (A Alphonse :) Reçois d’abord l’épée que tu me donnas quand je suivis le cardinal en France. Je l’ai portée sans gloire, mais sans honte, même aujourd’hui. Ce don, plein d’espérance, je m’en dépouille, avec un cœur profondément ému.
ALPHONSE.
Tu ne sens pas comme je. suis disposé pour toi.
LgITASSE.
Mon lot est d’obéir et non de penser ! Hélas, et le sort exige de moi que je renonce à un plus magnifique présent. La couronne n’est pas l’insigne du prisonnier : j’enlève moi-même de mon front l’ornement qui me semblait décerné pour l’immortalité. Il me fut dispensé trop tôt ce suprême bonheur, et, comme si je m’en étais prévalu, il ne m’est que trop tôt ravi. Tu t’enlèves à toi-même ce que nul ne pouvait t’enlever, et ce qu’un Dieu ne donne pas deux fois. Nous sommes merveilleusement éprouvés, nous autres hommes ! Nous ne pourrions le supporter, si la nature ne nous avait accordé la bienfaisante légèreté d’esprit. La nécessité nous instruit à jouer négligemment, comme des prodigues, avec des biens inestimables. Nous ouvrons les mains sans contrainte, pour laisser irrévocablement échapper un trésor…. A ce baiser s’unit une larme, qui te consacre à la fragilité ! Il est permis, ce tendre signe de notre faiblesse ! Qui ne verserait des pleurs, à voir que les biens immortels ne sont pas eux-mêmes à l’abri de la destruction ? Joins-toi à cette épée, qui malheureusement ne t’avait pas conquise. Entrelacée autour d’elle, repose, comme sur le cercueil du brave, sur le tombeau de mon bonheur et de mon espérance ! Je les dépose l’une et l’autre volontairement à tes pieds. Car quel homme est assez armé contre ta colère ? Et quel ornement, monseigneur, sied à celui que tu méconnais ? Je vais en prison, j’exécute la sentence. (Le Tasse se retire. Sur un signe du Prince, un Page ramasse et emporte l’épèe et la couronne.) SCÈNE V.
ALPHONSE, ANTONIO.
ANTONIO.
Où s’égare ce jeune homme ? Avec quelles couleurs se représente-t-il son mérite et son sort ? Bornée et sans expérience, la jeunesse se regarde comme une nature excellente et choisie, et se permet tout avec chacun. Qu’il se sente puni. Punir, c’est faire du bien au jeune homme, pour qu’il nous en remercie dans l’âge mûr.
ALPHONSE.
Sa punition, je le crains, n’est que trop sévère.
ANTONIO.
Si tu veux le traiter avec indulgence, ô prince, rends-lui sa liberté, et que l’épée décide notre querelle.
ALPHONSE.
Si l’opinion l’exige, je le veux bien. Mais dis-moi comment tu as excité sa colère.
ANTONIO.
A peine saurais-je dire comment cela s’est fait. Comme homme je l’ai peut-être mortifié ; comme gentilhomme je ne l’ai pas offensé ; et, dans sa plus grande colère, aucune parole outrageante ne s’est échappée de ses lèvres.
ALPHONSE.
C’est ainsi que j’avais jugé votre débat, et, ce que j’avais supposé d’abord, tes paroles me le confirment encore. Quand deux hommes se querellent, on regarde avec raison le plus sage comme le coupable. Tu ne devais pas t’échauffer.avec lui ; il te siérait mieux de le diriger. Il en est temps encore. Il n’y a pojnt ici de circonstance qui vous oblige de combattre. Aussi longtemps que la paix me demeure, je souhaite d’en jouir dans ma maison. Rétablis le calme : tu le peux facilement. Éléonore Sanvitale peut chercher d’abord à l’apaiser par son doux langage : va le joindre ensuite ; rends-lui, en mon nom, une entière liberté, et gagne sa confiance par de nobles et sincères paroles. Termine cette affaire aussi promptement que lu pourras. Tu lui parleras comme un ami et un père. Avant notre départ, je veux savoir la paix conclue ; et, si tu le veux, il n’est rien d’impossible pour toi. Nous resterons, s’il le faut, une heure de plus,- et nous laisserons ensuite les dames achever doucement ce que tu auras commencé ; et, quand nous reviendrons, elles auront effacé la dernière trace de ces rapides impressions. Il semble, Antonio, que tu veuilles t’entretenir la main : tu viens à peine de terminer une affaire, tu reviens, et aussitôt tu t’en fais une nouvelle. J’espère qu’elle te réussira également.
ANTONIO.
Je suis confus, et je vois ma faute dans tes paroles, comme dans le miroir le plus clair. On obéit bien aisément à un noble maître, qui persuade en même temps qu’il nous commande.
ACTE TROISIÈME.
SCÈNE I.
LA PRINCESSE, seule.
Où s’arrête Ëléonore ? A chaque instant l’inquiétude agite plus douloureusement le fond de mon cœur. Je sais à peine ce qui s’est passé ; je sais à peine lequel des deux est coupable. Oh ! qu’elle vienne ! Je ne voudrais pas parler à mon frère, à Antonio, avant d’être plus calme, avant d’avoir apuris où en sont les choses et ce qui en peut arriver.
SCÈNE II.
LA PRINCESSE, ËLÉONORE.
LA PRINCESSE.
Que viens-tu m’apprendre, Éléonore ? Dis-moi, que deviennent nos amis ? Que s’est-il passé ’ !
ÉLÉONORE.
Je n’en ai pas appris plus que nous ne savons. Ils se sont querellés ; le Tasse a mis l’épée à la main ; ton frère les a séparés : mais il semble que le Tasse a commencé cette querelle. Antonio se promène librement et parle avec son prince : le Tasse, au contraire, est relégué dans sa chambre et solitaire.
LA PRINCESSE.
Sans doute Antonio l’a provoqué ; il a offensé cette âme fière par sa froideur et son indifférence.
ÉLÉONORE.
Je le crois aussi ; car, lorsqu’il s’est présenté à nous, un nuage enveloppait déjà son front.
LA PRINCESSE.
Ah ! pourquoi négligeons-nous si fort de suivre la pure et secrète voix du cœur ! Un Dieu parle tout bas dans notre sein, tout bas, mais distinctement ; il nous indique ce qu’il faut choisir, ce qu’il faut éviter. Antonio m’a paru ce matin beaucoup plus âpre encore que jamais, plus renfermé en lui-même. Mon cœur m’avertissait, quand le Tasse s’est placé auprès de lui. Observe seulement l’extérieur de l’un et de l’autre, le visage, le ton, le regard, la démarche : tout se repousse ; ils ne pourront jamais faire échange d’amitié. Cependant l’espérance m’a persuadée ; la flatteuse me disait : « Ils sont raisonnables tous deux ; ils sont nobles, éclairés, ils sont tes amis : et quel plus sûr lien que celui des cœurs vertueux ? » J’ai encouragé ce jeune homme ; il s’est donné tout entier. Avec quelle grâce, quelle chaleur, il s’est donné à moi tout entier ! Ah ! si j’avais d’abord prévenu Antonio ! J’hésitais ; je n’avais que peu de temps ; je me faisais un scrupule de lui recommander, dès les premiers mots et trop vivement, ce jeune homme. Je me suis reposée sur les mœurs et la politesse, sur l’usage du monde, qui s’entremet si doucement même entre les ennemis ; je n’appréhendais pas de l’homme éprouvé cet emportement de la fougueuse jeunesse. La chose est faite. Le mal était loin de moi : le voilà maintenant ! Oh ! donne-moi un conseil ! Que faut-il faire ?
ÉLÉONORE.
Combien le conseil est difficile, tu le sens toi-même, d’après ce que tu as dit. Ce n’est pas ici une brouillerie entre des caractères sympathiques, à laquelle des paroles, au besoin même les armes, donnent une issue heureuse et facile. Ce sont deux hommes, je l’ai senti depuis longtemps, qui sont ennemis, parce que la nature n’a pas formé un seul homme des deux. Et, s’ils entendaient sagement leur intérêt, ils s’uniraient d’amitié : alors ils seraient comme un seul homme, et traverseraient la vie avec puissance et bonheur et joie. Je l’espérais moi-même : maintenant je vois bien que c’était en vain. Le débat d’aujourd’hui, quel qu’il soit, peut être apaisé, mais cela ne nous rassure pas pour l’avenir, pour le lendemain. Le mieux serait, je crois, que le Tasse s’éloignât d’ici quelque temps ; il pourrait se rendre à Rome et à Florence ; je l’y trouverais dans quelques semaines, et pourrais agir sur son cœur comme une amie. Ici cependant tu rapprocherais de toi et de tes amis Antonio, qui nous est devenu si étranger : ainsi le temps salutaire, qui peut beaucoup donner, ferait peut-être ce qui semble impossible aujourd’hui.
LA PRINCESSE.
Tu veux t’assurer la jouissance, ô mon amie, et m’imposer la privation : est-ce là être juste ?
ÉLÉONORE.
Tu ne seras privée que d’un bien dont tu ne pourrais d’ailleurs jouir dans cette conjoncture.
LA PRINCESSE.
Dois-je si tranquillement bannir un ami ?
ÉLÉONORE.
Dis plutôt conserver celui que tu ne banniras qu’en apparence.
LA PRINCESSE.
Mon frère ne le laissera point partir de bon gré.
ÉLÉONORE.
S’il voit la chose comme nous, il cédera.
LA PRINCESSE.
i| Il est si pénible de se condamner dans un ami !
ÉLÉONORE.
Et cependant tu sauves ton ami par ce sacrifice.
LA PRINCESSE.
Je ne donne pas mon consentement à ce départ.
ÉLÉONORE.
Attends-toi donc à un plus grand mal.
LA PRINCESSE.
Tu m’affliges, sans savoir si tu me rends service.
ÉLÉONORE.
Nous apprendrons bientôt qui se trompe.
LA PRiNCESSE.
Si cela doit être, ne me consulte pas plus longtemps.
ÉLÉONORE.
Qui peut se résoudre triomphe de la douleur.
LA PRINCESSE.
Je ne suis point résolue ; mais soit : s’il ne s’éloigne pas pour longtemps !… Et prenons soin de lui, Éléonore, en sorte qu’il n’ait pas à souffrir par la suite quelques privations ; que le duc veuille pourvoir à son entretien, même pendant l’absence. Parle à Antonio ; car il peut beaucoup sur mon frère, et il ne voudra pas nous garder rancune de cette querelle à nous et à notre ami.
ÉLÉONORE.
Un mot de toi, princesse, aurait plus d’effet.
LA PRINCESSE.
Je ne puis, tu le sais, mon amie, comme ma sœur d’Urbin, solliciter quelque faveur pour moi et pour les miens. J’aime à vivre sans bruit, au jour le jour, et je reçois de mon frère, avec reconnaissance, ce qu’il peut et ce qu’il veut me donner. Autrefois je me suis fait là-dessus à moi-même plus d’un reproche : maintenant j’ai pris mon parti. Une amie m’en blâmait souvent. «Tu es désintéressée, disait-elle, cela est fort beau ; mais tu l’es au point de ne pouvoir bien sentir les besoins même de tes amis. » Je laisse les choses suivre leur cours, et dois par conséquent souffrir le même reproche. Je me félicite d’autant plus de pouvoir actuellement offrir à notre ami des secours efficaces : la succession de ma mère m’est échue, et j’aiderai avec joie à l’entretien de l’exilé.
ÉLÉONORE.
Moi-même, é princesse, je me trouve en position de pouvoir aussi me montrer comme amie. Il n’est point un hôte facile- : si quelque chose lui manque, je saurai bien y pourvoir avec adresse.
LA PRINCESSE.
Eh bien, emmène-le : s’il faut me passer de lui, je te le cède plus volontiers qu’à tout autre. Je le vois bien, ce sera mieux ainsi. Faut-il donc que je prenne en gré cette nouvelle douleur, comme bonne et salutaire ? Ce fut mon sort dès l’enfance ; j’y suis désormais accoutumée. La perte du bonheur le plus doux est moins sensible de moitié, quand nous n’avons pas compté sur la possession.
ÉLÉONORE.
J’espère te voir heureuse, comme lu le mérites si bien.
LA PRINCESSE.
Heureuse, Éléonore ?… Qui donc est heureux ?… Mon frère sans doute, devrais-je dire, parce que son grand cœur porte sa destinée avec un courage toujours égal ; mais il n’obtint jamais ce qu’il mérite. Ma sœur d’Urbin est-elle heureuse ? Cette belle femme, au grand et noble cœur, elle ne donne point d’enfants à son jeune époux. Il la respecte et ne lui fait point expier sa stérilité ; mais auc ine joie n’habite dans leur maison. Eh ! que servit à notre mère sa sagesse, ses connaissances en tout genre, son grand sens ? A-t-il pu la préserver des erreurs étrangères ? On nous emporta loin d’elle. Maintenant, elle n’est plus : elle n’a pas laissé à ses enfants la consolation de la voir mourir réconciliée avec son Dieu.
ÉLÉONORE.
Ah ! ne regarde pas ce qui manque à chacun ; considère ce qui lui reste encore. Que de biens ne te restent pas, ô princesse !
LA PRINCESSE.
Ce qui me reste ? La patience, Éléonore ! J’ai pu l’exercer dès mon premier âge. Quand nos amis, quand mon frère et ma sœur se livraient ensemble à la joie dans les fêtes et les jeux, la maladie me tenait chez moi prisonnière, et, dans la compagnie de nombreuses douleurs, je dus m’exercer de bonne heure aux privations. Une seule chose me charmait dans la solitude, le plaisir du chant ; je m’entretenais avec moi-même ; je berçais par de doux accents ma douleur et ma mélancolie et tous mes vœux ; ainsi la peine devenait souvent une jouissance, et même les tristes sentiments une harmonie : ce plaisir ne me fut pas longtemps permis ; le médecin me le ravit encore. Son ordre sévère me prescrivit le silence ; il me fallut vivre et souffrir ; il me fallut renoncer à cette unique et faible consolation.
ÉLÉONORE.
Tant d’amis étaient auprès de toi !… Et maintenant tu es guérie, tu jouis de l’existence.
LA PRINCESSE.
Je suis guérie, c’est-à-dire que je ne suis pas malade ; et j’ai quelques amis, dont la fidélité me rend heureuse. J’en avais un aussi….
ÉLÉONORE.
Tu l’as encore.
LA PRINCESSE.
Et je le perdrai bientôt. Le moment où je le vis pour la première fois fut bien mémorable. Je me relevais à peine de nombreuses souffrances ; la douleur et la maladie venaient de céder à peine ; je portais de nouveau sur la vie un regard silencieux et timide ; je recommençais à jouir de la lumière, de mon frère et de ma sœur ; et, reprenant courage, je respirais le baume le plus pur de la douce espérance ; j’osais porter mes regards plus avant • dans la vie, et de gracieuses images venaient à moi de ce lointain : ce fut alors, ô mon amie, que ma sœur me présenta ce jeune homme. Il s’avançait en lui donnant la main, et, pour te l’avouer, mon cœur le choisit soudain et ne s’en détachera jamais.
ÉLÉONORE.
O ma princesse, n’en aie point de regret : sentir ce qui est noble est un avantage qu’on ne peut jamais nous ravir.
LA PRINCESSE.
Le beau, l’excellent est à craindre comme une flamme, qui rend de si précieux services, tant qu’elle brûle sur notre foyer, tant qu’elle nous éclaire d’un flambeau. Qu’elle est bienfaisante !,Qui voudrait, qui pourrait s’en passer ? Et si, n’étant pas surveillée, elle dévore ce qui l’entoure, qu’elle peut faire de maux !. Laissemoi maintenant. Je parle trop, et je ferais mieux de te cacher à toi-même combien je suis faible et souffrante.
ÉLÉONORE.
La souffrance de l’àme ne se peut mieux dissiper que par la plainte et la confiance.
LA PRINCESSE.
Si la confiance guérit, je guérirai bientôt. J’ai mis la mienne en toi, je l’ai mise pure et entière. Ah ! mon amie, il est vrai, je suis décidée. Qu’il parte ! Mais déjà je sens quelle sera la longue, l’immense tristesse des jours, quand je serai privée de ce qui faisait ma joie. Le soleil ne chassera plus de mes paupières sa brillante image, transfigurée dans mes songes ; l’espérance de le voir ne remplira plus d’une douce mélancolie mes sens à peine éveillés ; mon premier regard là-bas dans nos jardins le cherchera vainement sous les humides ombrages. Qu’il se sentait doucement satisfait, mon désir de passer avec lui chaque belle soirée ! Que, dans ces entretiens, s’augmentait le besoin de mieux se connaître, de mieux se comprendre ! Et chaque jour nos cœurs s’unissaient plus doucement dans une harmonie plus pure. Quelles ombres descendent maintenant devant moi ! La splendeur du soleil, le joyeux sentiment du grand jour, la brillante présence du magnifique univers est vide et profondément plongée dans le nuage qui m’environne. Autrefois chaque journée était pour moi toute une vie ; le souci se taisait ; le pressentiment lui-même était muet ; heureux passagers, le fleuve nous emportait sans rames sur ses vagues légères : maintenant. dans la triste contemplation de l’avenir, l’effroi saisit secrètement mon cœur.
ÉLÉONORE.
L’avenir te rendra tes amis, et t’apportera de nouveaux plaisirs, un nouveau bonheur.
LA PRINCESSE.
Ce que je possède, j’aime à le garder ; le changement amuse, mais rarement il profite. Jamais, avec l’ardeur de la jeunesse, je ne plongeai avidement la main dans l’urne d’un monde étranger, afin de saisir au hasard un objet pour mon cœur agité de besoins inconnus. Mais lui, il me fallut l’honorer : c’est pourquoi je l’aimai ; il me fallut l’aimer, parce qu’avec lui je vivais d’une vie telle que je n’en avais jamais connu. D’abord je me dis : * Éloigne-toi de lui. » Je fuyais, je fuyais, et ne faisais que m’approcher toujours davantage, si doucement attirée…. si durement punie !. . Un bien véritable et pur s’évanouit pour moi ; un mauvais génie dérobe à mes désirs le bonheur et la •joie, et met à leur place les douleurs, qui les touchent de près.
ÉLÉONORE.
Si les paroles d’une amie ne peuvent te consoler, la secrète puissance du bel univers, du temps salutaire, te ranimeront insensiblement.
LA PRINCESSE.
Oui, le monde est beau ! Tant de biens flottent çà et là dans son étendue ! Mais, hélas ! ces biens semblent toujours s’éloigner de nous d’un pas seulement, et attirent de même, pas à pas, nos désirs inquiets, à travers la vie, jusqu’au bord du tombeau. Il est si rare que les hommes trouvent ce qui leur semblait pourtant destiné ; si rare qu’ils conservent même ce que leur main fortunée put saisir une fois ! Ce qui venait seulement de se livrer à nous s’arrache de nos bras ; nous délais GŒTHE. — TH. I’. Tl
sons ce que nous avions saisi avec ardeur : le bonheur existe, mais nous ne le connaissons pas ; que dis-je ? nous le connaissons, et nous ne savons pas l’estimer.
SCÈNE III.
ÉLËONORE, seule.
Que je plains cette âme noble et belle ! Quel triste sort est échu à sa grandeur ! Ah ! elle perd !… et crois-tu de gagner ? Est-ce donc si nécessaire qu’il s’éloigne ’ ! Le dis-tu nécessaire, pour posséder, à toi seule, le cœur et les talents que jusqu’ici tu partages avec une autre, et d’une manière inégale ? Est-ce loyal d’agir ainsi ? N’es-tu pas assez riche ? Que te manque-t-il encore ? Un époux, un fils, la fortune, le rang et la beauté, tous ces biens t’appartiennent, et tu veux le posséder encore avec tout cela ? L’aimes-tu ? D’où vient, sans cela, que tu ne saurais plus te passer de lui ? Ose te l’avouer…. c’est un charme de se contempler soi-même dans ce beau génie ! Le bonheur n’est-il pas doublement grand et magnifique, lorsque ses chants nous portent et nous élèvent comme sur les nuées du ciel ? C’est alors que tu es digne d’envie. Non-seulement tu possèdes ce que la foule désire, mais aussi chacun sait, chacun connaît ce que tu possèdes. Ta patrie te célèbre et te contemple. C’est le faîte suprême du bonheur. Le nom de Laure est-il donc le seul que doivent redire les bouches de tous les amants, et Pétrarque seul avait-il le droit de diviniser la beauté inconnue ? Où est l’homme qui ose se comparera mon ami ? Comme ses contemporains l’honorent, la postérité le nommera avec respect. Quel triomphe de l’avoir à ses côtés dans la gloire de sa vie ! de s’avancer avec lui d’un’pas léger vers l’avenir ! Alors le temps, la vieillesse, ne peuvent rien sur toi, et rien l’insolente renommée, qui pousse çà et là le flot de la louange : ce qui est périssable, ses chants le maintiennent. Tu es belle encore, heureuse encore, quand le tourbillon des choses humaines t’a depuis longtemps emportée avec soi. Oui, tu le posséderas, le poëte, sans le ravir à la princesse ; car son inclination pour ce grand homme est semblable à ses autres passions : elles brillent comme, dans la nuit, la lune paisible éclaire faiblement le sentier du voyageur ; elles brillent, elles n’échauffent pas, et ne répandent autour d’elles aucun plaisir, aucune allégresse. Elle sera satisfaite de le savoir heureux loin d’elle, comme elle jouissait de le voir tous les jours. D’ailleurs je ne veux pas me bannir, avec mon ami, loin d’elle et de celte cour. Je reviendrai et je le ramènerai. Il faut qu’il en soit ainsi !… A’oici notre farouche ami : voyons si nous pourrons l’apprivoiser.
SCÈNE IV.
ÉLÉONORB, ANTONIO.
ÉLÉONORE.
Tu nous apportes la guerre au lieu de’la paix ! On dirait que tu arrives d’un camp, d’une bataille, où la force commande, où le bras décide, et non de Rome, où une sagesse solennelle lève les mains pour bénir, et voit à ses pieds un monde qui lui obéit avec joie.
ANTONIO. •
Il faut, belle amie, que je soutire ce blâme : cependant mon excuse n’est pas loin. Il est dangereux d’avoir à se montrer trop longtemps sage et modéré ; le mauvais génie veille à nos côtés, et veut aussi de temps en temps nous arracher un sacrifice. Par malheur, je l’ai offert cette fois aux dépens de mes amis.
ÉLÉONORE.
Tu t’es si longtemps contraint pour des hommes étrangers et réglé sur leur volonté : maintenant que tu revois tes amis, tu les méconnais et tu contestes comme avec des étrangers.
ANTONIO.
Voilà le péril, chère amie ! Avec des étrangers on se recueille, on observe, on cherche son but dans leurs bonnes grâces, afin qu’ils nous servent ; mais, avec les amis, on s’abandonne librement ; on se repose sur leur affection ; on se permet un caprice ; la passion agit sans frein, et par là nous offensons plus tôt ceux que nous aimons le plus tendrement.
ÉLÉONORE.
Dans ces réflexions tranquilles, mon cher ami, déjà je te retrouve avec joie tout entier.
ANTONIO.
Oui, j’ai regret, je le confesse, d’avoir perdu la mesure aujourd’hui comme j’ai fait. Mais, tu l’avoueras, quand un brave homme revient, le front brûlant, de son pénible travail, et qu’il espère enfin, le soir, se reposer, pour de nouvelles fatigues, sous l’ombrage souhaité ; s’il trouve alors la place largement occupée par un oisif, ne doit-il pas aussi sentir dans son cœur quelque faiblesse humaine ?
ÉLÉONORE.
S’il est vraiment humain, il partagera volontiers l’ombrage avec un homme qui, par son entretien, par de suaves accents, lui rendra le repos agréable et le travail facile. Il est vaste, mon ami, l’arbre qui donne l’ombrage, et nul n’a besoin de déplacer les autres.
ANTONIO.
Éléonore, ne jouons pas l’un et l’autre avec une image. Il est beaucoup de choses dans ce monde que l’on cède à un autre et que l’on partage volontiers ; mais il est un trésor qu’on ne peut céder avec plaisir qu’au mérite éminent ; il en est un autre que jamais on ne partagera de bon gré avec le mérite suprême ; et, si tu me demandes quels sont ces deux trésors, l’un est le laurier, l’autre la faveur des femmes.
ÉLÉONORE.
Cette couronne, sur le front de notre jeune poëte, a-t-elle offensé l’homme grave ? Tu n’aurais pu cependant trouver toimême pour ses travaux, pour sa belle poésie, une plus modeste récompense ; car un mérite qui n’a rien de terrestre, qui plane dans les airs, qui amuse seulement notre esprit par des sons, par des images légères, n’est récompensé non plus que par une belle image, par un signe gracieux ; et, si lui-même il effleure ’ à peine la terre, cette suprême récompense effleure à peine son front. Un stérile rameau est le don que la stérile affection des admirateurs lui fait volontiers, pour acquitter, aussi aisément que possible, sa dette. Tu n’envieras guère à l’image du martyr l’auréole dorée qui entoure sa tête chauve ; et assurément la
couronne de laurier est, sur le front où tes yeux la voient, un signe de souffrance plus que de bonheur.
ANTONIO.
Ta bouche aimable veut-elle peut-être m’enseigner à mépriser les vanités du monde ?
ÉLÉONORE.
Estimer chaque bien à sa valeur, c’est ce qu’il n’est pas nécessaire que je t’apprenne. Il semble néanmoins que le sage ait parfois besoin, autant que les autres, qu’on lui montre dans leur vrai jour les biens qu’il possède. Toi, noble Antonio, tu ne prétendras nullement à un fantôme de faveur et de gloire. Le service par lequel tu enchaînes et toi-même à ton prince et à toi tes amis, est réel, est vivant, et la récompense en doit être aussi réelle et vivante. Ton laurier est la confiance du prince, fardeau chéri, qui pèse sur tes épaules, plus grand chaque jour et légèrement porté ; ta gloire, c’est la confiance publique.
ANTONIO.
Et la faveur des femmes, n’en dis-tu rien ? Te neveux pas cependant me la peindre comme une chose dont on se puisse passer.
ÉLÉONORE.
C’est comme on l’entend. Car elle ne te manque point, et il te serait plus facile de t’en passer qu’à ce bon jeune homme. En effet, dis-moi, une femme réussirait-elle, si elle voulait prendre soin de toi à sa manière ; si elle entreprenait de s’occuper de toi ? Chez toi règne en toutes choses l’ordre, la sûreté ; tu songes à toi, comme tu songes aux autres ; tu possèdes ce qu’on voudrait te donner : le Tasse nous occupe dans notre propre domaine. Il manque de cent bagatelles, qu’une femme se donne avec plaisir la tâche de procurer. Il aime à porter le plus beau linge, un habit de soie avec quelque broderie ; il aime à se voir paré, même il ne peut souffrir sur sa personne l’étoffe grossière qui ne sied qu’à un valet ; il faut que sur lui tout soit délicat et bon et noble et beau. Et cependant il n’a aucun savoir-faire pour se procurer tout cela, et pour le conserver quand il le possède. Sans cesse il manque d’argent, d’attention. Il laisse tantôt ici, tantôt là, quelque pièce de son ajustement ; il ne revient jamais d’un voyage, qu’un tiers de ses effets ne lui fnanque ; quelquefois un domestique le vole : ainsi, Antonio, on a toute l’année à prendre soin de lui.
ANTONIO.
Et ces soins le font chérir toujours davantage. Heureux jeune homme, à qui l’on compte ses défauts comme des vertus ; à qui il est si doucement permis de jouer, étant homme, le rôle d’un enfant, et qui peut se faire honneur de sa gracieuse faiblesse ! Tu devrais me pardonner, belle amie, si je ressentais encore ici quelque amertume. Tu ne dis pas tout ; tu ne dis pas ce qu’il ose, et qu’il est plus habile qu’on ne pense. Il se glorifie de deux flammes ; il serre et délie les nœuds tour à tour, et, avec de tels artifices, il fait de telles conquêtes !… Est-ce croyable ?
ÉLÉONORE.
Bon ! Cela même prouve déjà que c’est la seule amitié qui nous anime. Et, quand nous rendrions amour pour amour, ne serait-ce pas l’équitable récompense de ce noble cœur, qui s’oublie lui-même entièrement, s’abandonne, et vit, pour ses amis, dans d’aimables songes ?
ANTONIO.
Eh bien, gâtez-le de plus en plus ; faites passer son égoïsme pour de l’amour ; offensez tous vos amis, qui se consacrent à vous avec une âme fidèle ; payez à l’orgueilleux un tribut volontaire ; brisez enfin le cercle charmant d’une familière confiance.
ÉLÉONORE.
Nous ne sommes pas aussi partiales que tu le crois : nous reprenons notre ami dans bien des cas ; nous désirons le former, pour qu’il jouisse davantage de lui-même, et qu’il puisse en faire jouir davantage les autres. Ce qui est blâmable en lui ne nous reste point caché.
ANTONIO.
Mais vous louez beaucoup de choses qu’il faudrait blâmer. Je le connais depuis longtemps : il est facile à connaître, et il est trop fier pour se cacher. Tantôt il s’abîme en lui-même, comme si tout l’univers était dans son sein, comme si lui-même se suffisait dans son univers, et tout ce qui l’environne disparaît à ses yeux. Il laisse passer, il laisse tomber, il repousse tout bien loin, et se repose en lui-même. Tout à coup, comme une étincelle inaperçue embrase la mine, que ce soit douleur ou joie,, colère ou caprice, il éclate avec violence : alors il veut tout saisir, tout posséder ; alors doit s’accomplir tout ce qu’il imagine. En un moment doit naître ce que des années devraient préparer ; en un moment, disparaître ce que le travail des années pourrait à peine abolir. Il exige de lui l’impossible, aun de pouvoir l’exiger des autres. Son esprit veut embrasser à la fois les dernières extrémités de toutes choses, ce qui réussit à peine à un seul homme entre des millions, et il n’est pas cet homme-là : enfin il retombe sur lui-même, sans être du tout corrigé.
ÉLÉONORE.
Il ne fait pas tort aux autres : il se fait tort à lui-même.
ANTONIO.
Et cependant il ne blesse que trop les autres. Peux-tu nier que, dans le moment de la passion, qui le saisit soudain, il n’ose invectiver, s’emporter contre le prince, contre la princesse elle-même, contre qui que ce soit ? Ce n’est qu’un moment, il est vrai, mais c’est bien assez : cet instant revient. Il gouverne aussi peu sa langue que son cœur.
ÉLÉONORE.
Je suis disposée à croire que, s’il s’éloignait d’ici pour un peu dé temps, cela serait bon pour lui et pour les autres.
ANTONIO.
Peut-être, mais peut-être aussi que non. Au reste, pour le moment, il ne faut pas y songer : car je ne veux pas en porter le blâme sur mes épaules. Il pourrait sembler que je le chasse, et je ne le chasse point. Pour ce qui me regarde, il peut demeurer tranquille à la cour. Et, s’il veut se réconcilier avec moi, et s’il veut suivre mon conseil, nous pourrons vivre tout à fait tolérablement.
ÉLÉONORE..
Ainsi tu espères toi-même agir sur un caractère qui, tout à l’heure encore, te semblait sans ressource ’.’
ANTONIO.
Nous espérons toujours, et en toutes choses l’espérance vaut mieux que le désespoir, Car qui peut mesurer le possible ? Il est précieux à notre prince. Il faut qu’il nous reste. Et, si nous essayons vainement de le former, il n’est pas le seul que nous supporterons.
ÉLÉONORE.
Je ne te croyais pas si exempt de passion, si impartial. Tu t’es promptement converti.
ANTONIO.
Il faut bien que l’âge ait une prérogative ; que, lors même qu’il n’échappe pas à l’erreur, il puisse du moins se remettre sur-le-champ. Tu t’efforçais d’abord de me réconcilier avec ton ami : maintenant clest moi qui t’en prie. Fais ce que tu pourras pour que cet homme revienne à lui, et que tout soit bientôt calmé. J’irai moi-même auprès de lui, aussitôt que je saurai par toi qu’il est tranquille ; aussitôt que tu croiras que ma présence n’augmentera pas le mal. Mais, cevque tu feras, fais-le à l’heure même ; car Alphonse repartira dès ce soir et je l’accompagnerai. En attendant, adieu !
SCÈNE V.
ÉLÉONORE, seule.
Tour cette fois, cher ami, nous ne sommes pas d’accord ; mon intérêt et le tien ne marchent pas aujourd’hui la main dans la main. Je vais profiter de ce moment et chercher à gagner le Tasse. Hâtons-nous. .
ACTE QUATRIÈME.
Une chambre.
♦
SCÈ NE I.
LE TASSE, seul.
Te réveilles-tu d’un songe, et cette belle illusion t’a-t-elle abandonné soudain ? Dans un jour de félicité suprême, es-tu saisi d’un sommeil qui retient et tourmente ton âme dans ses chaînes pesantes ? Oui, tu veilles et tu rêves. Où sont les heures qui jouaient autour de ton front avec des couronnes de fleurs ; les jours où ton esprit pénétrait, avec une libre ardeur, dans le vaste azur des cieux ? Et cependant tu vis encore, et tu as le sentiment de toi-même ; tu te sens et tu ne sais si tu existes. Est-ce ma faute, est-ce la faute d’un autre, si je me trouve ici maintenant comme coupable ? Ai-je failli, pour que je doive souffrir ? Toute ma faute n’est-elle pas un mérite ? Je le vis et fus entraîné par la bienveillance, par la confiante illusion du cœur, qu’il était un homme celui qui portait la figure humaine. Je courus à lui les bras ouverts, et je sentis une serrure et des verrous, mais point de cœur. Et pourtant j’avais sagement réfléchi à la manière dont je devais accueillir cet homme, qui dès longtemps m’était suspect ! Mais, quoi qu’il te soit arrivé, attache-toi fermement à la certitude : je l’ai vue ; elle était devant moi ; elle m’a parlé : je l’ai comprise ! Le regard, l’accent, le sens aimable de ses paroles, sont à moi pour toujours ; rien ne peut me les ravir, ni le temps, ni le sort, ni l’injurieuse fortune. Et si mon esprit s’est trop vite emporté, et si j’ai trop brusquement livré passage en mon sein à la flamme, qui maintenant me dévore moi-même, je ne puis m’en repentir, le bon. heur de ma vie fùt-il à jamais perdu. Je me suis dévoué à la princesse ; j’ai suivi avec joie le signe qui m’appelait à ma perte. Soit ! Je me suis du moins montré digne de la précieuse confiance qui me fortifie, qui me fortifie, à l’heure même où la porte noire d’un long avenir de deuil s’ouvre violemment devant moi !… Oui, c’en est fait ! Le soleil disparaît soudain avec la faveur la plus belle ; le prince détourne de moi son gracieux . regard, et me laisse égaré dans un sentier étroit et sombre ; l’affreux volatile à la double nature, funeste satellite de l’antique Nuit, prend son essor et voltige autour de ma tête. Où donc, où porterai-je mes pas, pour fuir la hideuse troupe que j’entends frémir ; pour éviter l’abîme qui s’ouvre devant moi ?
SCÈNE II.
ËLÉONORE, LE TASSE.
ÉLÉONORE.
Que s’est-il passé ? Cher Tasse, ton ardeur, ta défiance, ontelles pu femporter ainsi ? Comment cela est-il arrivé ? Nous sommes tous consternés. Et ta douceur et tes manières prévenantes, ton coup d’œil rapide, la droite raison avec laquelle tu rends à chacun ce qui lui appartient ; ton humeur égale, qui supporte ce qu’une âme généreuse apprend bien vite à supporter, ce qu’une âme vaine apprend rarement ; ce sage empire sur ta langue et tes lèvres…. Mon cher ami, j’ai peine à te reconnaître.
WJTASSE.
Et si tout cela était perdu maintenant ? Si un ami, que tu avais cru riche un jour, se trouvait être tout à coup comme un mendiant ? Tu as bien raison ; je ne suis plus moi-même, et pourtant je le suis aussi bien que je l’étais. Cela semble une énigme, et toutefois ce n’en est pas une. Cette lune paisible, qui te charme pendant la nuit, dont la lumière attire invinciblement tes yeux et ton cœur, elle passe pendant le jour comme un petit nuage, pâle et insignifiant. Je suis effacé par l’éclat du jour ; vous me connaissez : je ne me connais plus.
É LÉONORE.
Ce que tu me dis, mon ami, je ne comprends pas comment tu peux le dire. Explique-toi : l’offense de cet homme dur a-t-elle pu si fort te blesser, que tu veuilles méconnaître absolument et nous et toi-même 1 Ouvre-moi ton cœur.
L©.TASSE.
Je ne suis pas l’offensé : tu me vois puni comme auteur de l’offense. L’épée délie bien aisément et bien vite les nœuds de mille paroles, mais je suis prisonnier. Tu le sais peut-être à peine…. (ne t’effraye pas, tendre amie) tu trouves ton ami dans une prison. Le prince me châtie comme un écolier. Je ne veux pas contester avec lui ; je ne peux.
ÉLÉONORE.
Tu parais plus ému que de raison.
l£L TASSE.
Me crois-tu si faible, si enfant, qu’un pareil accident puisse d’abord me troubler ? Ce qui est arrivé ne m’afllige pas si profondément : ce qui m’afflige, c’est l’augure que j’en tire. Laisse seulement agir mes envieux, mes ennemis ! Le champ est libre et ouvert.
ÉLÉONORE.
Tu as de faux soupçons sur beaucoup de gens : j’ai pu m’en convaincre. Antonio lui-même n’est pas ton ennemi, comme tu l’imagines. Le démêlé d’aujourd’hui….
LOkTASSE.
Je le laisse entièrement de côté ; je me contente de prendre Antonio pour ce qu’il était, pour ce qu’il est encore. J’ai toujours été choqué de sa sagesse empesée, et de ce qu’il ne cesse •dejouer le rôle de pédant. Au lieu de s’enquérir si l’esprit de celui qui l’écoute ne marche pas déjà par lui-même dans de bonnes v,oies, il vous enseigne maintes choses que vous sentez mieux et plus profondément, et n’entend pas un mot de ce que vous lui dites, et vous méconnaîtra toujours. Être méconnu,, méconnu par un orgueilleux, qui croit vous dominer en souriant ! Je ne suis pas encore assez Vieux et assez sage, pour me contenter d’en sourire à mon tour patiemment. Tôt ou tard…. cela ne pouvait durer…. il fallait rompre. Plus tard cela eût été pire encore. Je ne reconnais qu’un maître, le maître qui me nourrit ; je lui obéis volontiers, mais je ne veux point de pédagogue. Je veux être libre dans mes pensées et mes inspirations : le monde ne nous gêne que trop dans notre conduite.
ÉLÉONORE.
Antonio parle assez souvent de toi avec estime.
l^JASSE.
Avec ménagement, veux-tu dire, par finesse et par prudence. Et c’est justement ce qui me fâche ; car il sait parler avec tant de politesse et de précautions, que son éloge finit par devenir une véritable censure, et que rien ne blesse plus vivement, plus profondément, qu’une louange de sa bouche.
ÉLÉONORE.
Si tu avais entendu, mon ami, comme il parlait de toi et du talent que la nature favorable t’a dispensé par préférence à la foule ! Assurément, il sent ce que tu es, ce que tu possèdes, et il sait l’estimer aussi.
Idltasse.
Ah ! crois-moi, un cœur égoïste ne peut échapper au tourment de l’étroite envie. Un tel homme pardonnera peut-être à un autre la richesse, le rang et les honneurs, parce qu’il se dit : « Tu possèdes cela toi-même ; tu le posséderas, si tu veux, si tu persévères, si la fortune te favorise. » Mais, ce que dispense la seule nature, ce qui reste à jamais inaccessible à tout labeur, à tout effort ; ce que ni l’or, ni l’épée, ni l’habileté, ni la persévérance, ne peuvent conquérir, il ne le pardonnera jamais. Il ne me l’envie pas ? Lui, qui, avec son esprit guindé, pense extorquer la faveur des Muses, et, lorsqu’il ramasse les pensées de quelques poëtes, se croit poëte lui-même ? Il me cédera bien plutôt la faveur du prince, qu’il serait charmé pourtant de concentrer sur lui, que le talent dont ces filles célestes ont doué le jeune et pauvre orphelin.
ÉLÉONORE.
Oh ! que ne vois-tu la chose aussi clairement que je la vois ! Tu te trompes sur Antonio : il n’est pas comme cela.
HkJASSE.
Et si je me trompe sur lui, je me trompe volontiers ! Je le regarde comme mon plus perfide ennemi, et je serais inconsolable, si je devais maintenant me le figurer plus doux. C’est une folie d’être -équitable de tout point : c’est vouloir détruire sa propre nature. Les hommes sont-ils donc si équitables pour nous ? Non, oh ! non. Dans sa nature bornée, l’homme a besoin de deux sentiments, l’amour et la haine. N’a-t-il pas besoin de la nuit comme du jour, du sommeil comme de la veille ? Oui, je dois désormais tenir cet homme pour l’objet de ma haine la plus profonde ; rien ne pourra m’arracher le plaisir de penser mal et toujours plus mal de lui.
ÉLÉONORE.
Si tu ne veux pas, cher ami, changer de sentiments, j’ai peine à comprendre que tu veuilles rester plus longtemps à la cour. Tu sais comme il est considéré, et comme il doit l’être !
LB. TASSE.
A quel point, et depuis longtemps, ma belle amie, je suis ici de trop, je le sais fort bien,
ÉLÉONORE.
Tu ne l’es point, tu ne le seras jamais ! Tu sais, au contraire, combien le prince, combien la princesse aiment à vivre avec toi ; et, quand la duchesse d’Urbin vient ici, elle y vient presque autant pour toi que pour sa sœur et son frère. Ils te sont tous attachés et tous également ; et chacun d’eux se fie en toi sans réserve.
A. TASSE.
Êléonore, quelle confiance !… M’a-t-il jamais dit un mot, un mot sérieux de ses affaires d’État ? S’il survenait un incident, sur lequel il conférait, même en ma présence, avec sa sœur, avec d’autres, il ne m’a jamais consulté. On n’avait alors qu’une parole à la bouche : « Antonio vient ! Il faut écrire à Antonio ! Consultez Antonio ! »
ÉLÉONORE.
Tu te plains et tu devrais le remercier ; s’il veut te laisser dans une liberté absolue, c’est qu’il t’honore comme il peut t’honorer.
Lft. TASSE.
Il me laisse en repos, parce qu’il mejuge inutile.
ÉLÉONORE.
C’est précisément parce que tu te reposes, que tu n’es pas inutile. Peux-tu nourrir si longtemps dans ton cœur, comme un enfant chéri, le souci et le chagrin ? Je l’ai souvent observé, et je puis l’observer comme je le veux, dans ces beaux lieux, où le bonheur semblait t’avoir transplanté, tu ne prospères point. O Tasse !…. te le conseillerai-je ? dois-je le dire ?… Tu devrais t’éloigner !
Ifï. TASSE.
N’épargne pas le malade, aimable médecin ! Offre-lui le remède ; ne songe point s’il est amer…. Pourra-t-il guérir, voilà ce qu’il te faut bien considérer, ô sage et bienveillante amie ! Je vois tout cela moi-même : c’est fini ! Je peux bien lui pardonner : il ne me pardonnera pas. Hélas ! et l’on a besoin de lui et non pas de moi. Il est sage, hélas ! et je ne le suis pas. H travaille à ma perte, et je ne puis, je ne veux pas lutter contre lui. Mes amis laissent aller la chose ; ils la voient autrement ; ils résistent à peine, et ils devraient combattre. Tu crois qu’il faut que je parte : je le crois aussi. Adieu donc ! Je supporterai encore cela. Vous vous êtes séparés de moi…. Que la force et le courage me soient aussi donnés pour me séparer de vous !
ÉLÉONORE.
Dans l’éloignement se montre aussi avec plus de pureté tout ce qui nous trouble en présence de l’objet. Tu reconnaîtras peut-être quelle affection t’environnait partout, quelle valeur a la fidélité de véritables amis, et que le vaste monde ne remplace point l’intimité.
MUTASSE.
Nous en ferons l’épreuve ! Cependant je connais le monde dès ma jeunesse ; je sais comme aisément il nous laisse dénués, solitaires, et passe son chemin, ainsi que le soleil et la lune et les autres dieux.
ÉLÉONORE.
Veux-tu m’en croire, mon ami, tu ne répéteras jamais cette triste expérience. Si je puis te donner un conseil, tu te rendras d’abord à Florence, et une amie prendra soin de toi avec la plus grande affection. Sois tranquille : c’est moi-même. Je pars, pour y rejoindre mon mari au premier jour ; je ne puis rien ménager de plus agréable pour lui et pour moi que de t’introduire dans nos foyers. Je ne dis rien de plus ; tu sais toi-même de quel prince tu vas approcher, et quels hommes cette belle cité renferme dans son sein et quelles femmes !… Tu gardes le silence ? Songes-y bien ! Décide-toi !
ia£ TASSE.
Ce que tu me proposes est bien séduisant et tout à fait conforme au désir que je nourris en secret ; mais c’est trop nouveau. Je t’en prie, laissemoi réfléchir : je me résoudrai bientôt.
ÉLÉONORE.
Je pars avec la plus belle espérance pour toi et pour nous et aussi pour cette maison. Songes-y seulement ! et, si tu y songes bien, tu imagineras diflicilement quelque chose de meilleur.
L©. TASSE.
Encore un mot, chère amie !… Dis-moi, comment la princesse est-elle disposée à mon égard ? Était-elle irritée contre moi ? Que disait-elle ?… Elle m’a beaucoup blâmé ?… Parle librement !
ÉLÉONORE.
Comme elle te connaît, elle t’a facilement excusé.
Lô. TASSE.
Ai-je perdu dans son esprit ? Ne me flatte point !
ÉLÉONORE.
On ne perd pas si aisément la faveur des femmes.
L©,TASSE.
Me laissera-t-elle aller de bon gré, si je pars ?
ÉLÉONORE.
Assurément, si cela tourne à ton bien.
Lft. TASSE.
Ne perdrai-je pas les bonnes grâces du prince ?
ÉLÉONORE.
Tu peux te reposer avec confiance sur 3a générosité.
US TASSE.
Et laisserons-nous la princesse toute seule ? Tu t’en vas, et, si peu que je sois, je sais pourtant que j’étais quelque chose pour elle.
ÉLÉONORE.
Un ami absent nous est encore une très-agréable compagnie, quand nous le savons heureux. Et cela ira bien ; je te vois satisfait. Tu ne partiras pas d’ici mécontent. Sur l’ordre du prince, Antonio te cherche, il condamne lui-même les paroles amères par lesquelles il t’a offensé. Je t’en \>rie, reçois-le de sang-froid, comme il viendra lui-même.
TASSE.
De toute manière, je puis me montrer devant lui.
ÉLÉONORE.
Et qu’avant ton départ, cher ami, le ciel m’accorde de te faire voir que personne, dans toute la patrie, ne te.poursuit et ne te hait, ne t’opprime et ne te persécute secrètement ! Tu te trompes assurément, et, comme tu inventes souvent pour le plaisir des autres, tu inventes, hélas ! dans cette circonstance, une trame bizarre, pour t’affliger” toi-même. Je veux tout faire pour la rompre, afin que tu puisses parcourir librement le beau chemin de la vie. Adieu, j’espère bientôt une heureuse réponse.
SCÈNE III.
LE TASSE,-seul.
Je devrais reconnaître que personne ne me hait, que personne ne me persécute ; que toute la ruse, toute la trame secrète est filée et ourdie uniquement dans ma tête ! Je devrais avouer que j’ai tort et que je fais tort à des gens qui ne l’ont pas mérité de moi ! Et cela, à l’heure où mon plein droit, comme leur malice, se montre clairement à la face du soleil ! Il faut que je sente profondément comme, d’un cœur ouvert, le prince m’assure sa faveur, m’en dispense les dons avec une large mesure, au moment où il est assez faible pour souffrir que mes ennemis lui obscurcissent la vue, et sans doute enchaînent aussi sa main ! Il est trompé, et il ne peut le voir ; ils sont les trompeurs, et je nè puis le prouveV. Et seulement pour qu’il se trompe d’un cœur tranquille, pour que mes ennemis puissent le tromper à leur aise, je dois me taire, je dois même quitter la place ! Et qui me donne ce conseil ? Qui me presse sagement, avec un sentiment affectueux et fidèle ? Éléonore elle-même, Eléonore Sanvitale, la tendre amie ! Ah ! je te connais maintenanti Pourquoi me suis-je fié jamais à ses lèvres ? Elle n’était pas sincère, si vivement qu’elle me témoignât, par de douces paroles, sa bienveillance, sa tendresse ! Non, elle avait, elle a toujours le cœur perfide ; elle se tourne, d’une marche habile et légère, vers la faveur…. Que de fois me suis-je plu moimême à me tromper aussi sur elle ! Et cependant, au fond, c’est la vanité seule qui m’a trompé. Oui, je la connaissais et je me flattais moi-même. « Elle est ainsi avec les autres, me disais-je ; mais avec toi son cœur est ouvert et fidèle. » Maintenant je le vois bien, et je le vois trop tard, j’étais en faveur et elle s’attachait tendrement…. à l’homme heureux. Aujourd’hui je tombe, et, comme la fortune, elle me tourne le dos…. Elle vient à moi maintenant comme instrument de mon ennemi ; elle s’approche en rampant, et, de sa langue flatteuse, la petite vipère, elle siffle un chant magique. Comme elle semblait aimable ! Plus aimable que jamais ! Comme chaque mot de ses lèvres était caressant ! Mais la flatterie n’a pu longtemps me cacher l’intention perfide : sur son front paraissait trop clairement écrit le contraire de tout ce qu’elle disait. Je le sens bientôt, lorsqu’on cherche le chemin de mon cœur, et que l’on n’a pas des sentiments sincères. Il faut que je parte ? Il faut que je me rende à Florence aussitôt que possible ? Pourquoi donc à Florence ? Je le vois bien. Là règne la nouvelle maison de Médicis ; elle n’est pas, il est vrai, en hostilité ouverte avec Ferrare, mais la secrète jalousie sépare, avec sa main glacée, les plus nobles cœurs. Si je recevais de ces illustres princes des marques signalées de faveur, comme j’oserais certainement les attendre, le courtisan rendrait bientôt suspectes ma fidélité et ma reconnaissance : cela lui réussirait aisément…. Oui, je partirai, mais non comme vous voulez ; je partirai, et j’irai plus loin que vous ne pensez. Que fais-je ici ? Qui me retient ? Ah ! j’ai bien compris chaque parole que je tirais des lèvres d’Ëléonore. J’arrachais à peine syllabe par syllabe, et, cette fois, je sais parfaitement ce que pense la princesse…. Oui, oui, cela aussi est vrai : ne te désespère pas. « Elle me laissera aller de bon gré, si je pars, puisque c’est pour mon bien. » Ah ! si elle sentait dans le cœur une passion qui détruisît mon bonheur et moi-même !… Bien venue la mort, qui me saisirait, plutôt que cette main qui
UŒTHE. — TH. H
m’abandonne avec froideur et sécheresse !… Je pars…. Maintenant observe-toi, et ne te laisse séduire par aucun dehors d’amitié ou de bienveillance. Nul ne t’abusera cette fois, si tu ne t’abuses toi-même.
SCÈNE IV.
ANTONIO, LE TASSE.
ANTONIO.
Je viens, Tasse, pour te dire quelques mots, si tu veux et si tu peux m’écouter tranquillement.
i*L Tasse.
L’action, tu le sais, me demeure interdite : mon rôle est d’attendre et d’écouter.
ANTONIO.
Je te trouve tranquille, comme je souhaitais, et je te parlerai, avec plaisir, d’un cœur sincère. D’abord je brise, au nom du prince, le faible lien qui semblait te tenir captif.
UBJASSE.
Le bon plaisir me délivre comme il m’enchaîna : j’accepte et ne demande point de jugement.
ANTONIO.
Je te dirai ensuite en mon nom : Je t’ai offensé, semble-t-il, profondément par mes paroles et plus que je ne l’ai senti moimême, étant agité de diverses passions. Mais aucune parole injurieuse ne s’est échappée inconsidérément de mes lèvres ; le gentilhomme n’a rien à venger, et l’homme ne refusera pas le. pardon.
I0LTASSE.
Ce qui blesse le plus de l’humiliation ou de l’insulte, je ne veux pas l’examiner ; l’une pénètre jusqu’à la moelle et l’autre égratigne la peau. Le trait de l’insulte rejaillit contre celui qui croit nous blesser ; l’épée, bien maniée, satisfait aisément l’opinion : mais un cœur humilié guérit avec peine.
ANTONIO.
C’est à moi maintenant de te dire avec instance ne recule pas ; remplis mon désir, le désir du prince, qui m’envoie auprès de toi.
Wl Tasse.
Je connais mon devoir et je cède. Que tout soit oublié, autant que la chose est possible ! Les poëtes nous parlent d’une lance qui, par son attouchement salutaire, pouvait guérir les blessures qu’elle avait faites. La langue de l’homme a cette vertu : je ne veux pas lui résister avec aigreur.
ANTONIO.
Je te remercie et je souhaite que sur-le-champ tu veuilles avec confiance me mettre à l’épreuve, ainsi que ma volonté de te servir. Parle, puis-je t’être utile ? Je le montrerai volontiers.
Lft. TASSE.
Tu m’offres justement ce que je pouvais souhaiter. Tu m’as rendu la liberté : à présent, je t’en prie, procure-m’en l’usage.
ANTONIO.
Que veux-tu dire ? Explique-toi clairement.
LOJASSE.
Tu sais que j’ai fini mon poëme : il s’en faut beaucoup encore qu’il soit achevé. Je l’ai présenté aujourd’hui au prince ; j’espérais, en même temps, lui adresser une prière. Je trouverai maintenant beaucoup de mes amis réunis à Rome. Déjà chacun à part m’a ouvert ses avis par lettres sur plusieurs passages : j’en ai pu souvent profiter ; bien des choses me semblent devoir être encore méditées ; il est divers endroits que je n’aimerais pas à changer, si l’on ne peut me convaincre mieux qu’on ne l’a fait. Tout cela ne se peut faire par lettres ; une entrevue lèvera bientôt ces difficultés. Je songeais donc à demander moimême aujourd’hui cette grâce au prince ; je n’en ai pas trouvé l’occasion : maintenant je n’ose pas le risquer, et je n’espère plus cette permission que par toi.
ANTONIO.
l1 ne me semble pas sage que tu t’éloignes au moment où ton poëme achevé te recommande au prince et à la princesse. Un jour de faveur est comme un jour de moisson : il faut être à l’œuvre aussitôt qu’elle est mûre. Si tu t’éloignes, tu ne gagneras rien, et tu perdras peut-être tes premiers avantages. La présence est une puissante déesse : apprends à connaître son
influence ; reste ici !
ia^ TASSHT.
Je n’ai rien à craindre : Alphonse est généreux ; il s’est montré toujours grand à mon égard, et, ce que j’espère, je veux le devoir uniquement à son cœur, et ne surprendre aucune grâce. Je ne veux rien recevoir de lui qu’il pût regretter d’à- ’ voir donné.
ANTONIO.
Alors ne lui demande pas de te laisser partir maintenant : il le fera à regret, et je crains même qu’il ne le fasse pas.
TASSE.
Il le fera volontiers, s’il en est prié comme il faut, et tu le pourras sans doute, aussitôt que ta voudras.
ANTONIO.
Mais quel motif, dis-moi, présenterai-je ?
1£{ Tasse .
Laisse parler mon poëme par chacune1 de ses stances. Ce que j’ai voulu faire est louable, quand même le but resterait inaccessible à mes>efforts. L’ardeur et le travail n’ont pas manqué : la course brillante de maints beaux jours, la paisible durée de maintes nuits profondes, furent consacrées uniquement à ce pieux ouvrage. J’espérais, sans orgueil, m’approcher des grands maîtres de l’antiquité ; j’espérais, dans mon audace, réveiller, pour d’illustres exploits, nos contemporains d’un long sommeil, et peut-être partager, avec une noble armée de chreV tiens, le péril et la gloire de la guerre sainte. Et, si mon poëme doit enflammer l’élite des guerriers, il faut aussi qu’il soit digne d’elle. Je suis redevable à Alphonse de ce que j’ai fait : je voudrais lui devoir aussi l’achèvement.
ANTONIO.
Et ce même prince est ici avec d’autres hommes, qui pourront te guider aussi bien que les Romains. Achève ici ton ouvrage. C’est ici le lieu. Et, pour agir, cours ensuite à Rome.
I^.JASSE.
C’est Alphonse qui m’inspira le premier : il sera certainement
1. Nous lisons jeder.
mon dernier guide. Et tes conseils, les conseils des hommes sages que rassemble notre cour, je les estime hautement. Vous déciderez, quand mes amis de Rome ne m’auront pas entièrement convaincu. Cependant il faut que je les voie. Gonzague a réuni pour moi un tribunal devant lequel je dois d’abord me présenter. A peine puis-je attendre. Flaminio de Nobili, Angelio de Barga, Antoniano et Sperone Speroni !… Tu dois les connaître !… Quels noms que ceux-là ! Ils inspirent à la fois la confiance et la crainte à mon esprit, qui se soumet volontiers.
ANTONIO.
Tu ne songes qu’à toi et tu ne songes pas au prince. Je te l’ai dit, il ne te laissera point aller ; et, s’il le fait, il ne cédera pas volontiers. Tu ne veux pas demander ce qu’il ne peut t’accorder qu’à regret. Et dois-je ici m’employer pour une chose que je ne puis moi-même approuver ?
14^ TASSE.
Me refuses-tu le premier service, quand je veux mettre à l’épreuve l’amitié que tu m’as offerte ?
ANTONIO.
La véritable affection se montre en refusant à propos ; et l’amitié accorde bien souvent un funeste avantage, quand elle considère le désir plus que le bien de celui qui la sollicite. Tu me sembles, dans ce moment, juger avantageux ce que tu désires avec passion, et tu exiges, à l’instant même, ce que tu désires. Celui qui est dans l’erreur remplace par la vivacité ce qui lui manque en vérité et en force. Mon devoir m’oblige à modérer, autant que je puis, la fougue qui t’égare.
1^ TASSE.
Je connais dès longtemps cette tyrannie de l’amitié, qui de toutes les tyrannies me parait la plus insupportable. Tu penses autrement, et, par cela seul, tu crois penser juste. Je reconnais volontiers que tu désires mon bien ; mais ne demande pas que je le cherche par ton chemin.
ANTONIO.
Et dois-je sur-le-champ, de sang-froid, te nuire, avec une évidente et pleine persuasion ?
LfiLTASSE.
Je veux te délivrer de ce souci. Tu ne m’arrêteras point par ces discours. Tu m’as déclaré libre ; elle m’est donc ouverte, cette porte qui conduit chez le prince. Je te laisse le choix. Toi ou moi ! Le prince va partir ; il n’y a pas un moment à perdre. Choisis promptement. Si tu ne vas pas, j’irai moi-même, quel que puisse être l’événement.
ANTONIO.
Que du moins j’obtienne de toi quelques moments ; attends jusqu’au retour du prince ; laisse seulement passer aujourd’hui.
IA, TASSE.
Non, à cette heure même, s’il est possible ! Les pieds me brûlent sur ce pavé de marbre ; mon esprit ne peut trouver de repos, avant que la poussière des routes ouvertes enveloppe mes pas précipités. Je t’en prie ! Tu vois comme je suis incapable, en ce moment, de parler à mon maître ; tu vois (comment te le cacherai-je ?) que je ne puis dans ce moment me commander à moi-même ; qu’aucune force humaine ne le pourrait. Des chaînes seulement peuvent me retenir. Alphonse n’est pas un tyran : il m’a déclaré libre. Avec quelle joie j’obéissais autrefois à ses ordres 1 Aujourd’hui je ne puis obéir. Aujourd’hui seulement laissez-moi en liberté, afin que mon esprit se retrouve. Je reviendrai bientôt à mon devoir.
ANTONIO.
Tu me fais chanceler. Que dois-je faire ? Je le vois bien, l’erreur est contagieuse. .
Il* TASSE.
Si tu veux que je te croie, si tu me veux du bien, fais ce que je désire, ce que tu peux. Alors le prince me donnera congé, et je ne perdrai pas sa faveur ; je ne perdrai pas son secours. Je t’en serai redevable, et le reconnaîtrai avec joie. Mais, si tu gardes dans le cœur une vieille haine ; si tu veux me bannir de cette cour ; si tu veux détruire à jamais ma fortune, m’exiler sans ressource dans le vaste monde : reste dans ton sentiment et résiste-moi.
ANTONIO.
O Tasse, puisqu’il faut donc que je te nuise, je choisirai le moyen que tu choisis. Le résultat décidera,qui se trompe. Tu veux partir ! Je te l’annonce, tu auras à peine tourné le dos à cette maison, que ton cœur t’y rappellera, et que l’obstination te poussera en avant. La douleur, le trouble, la tristesse, t’attendent à Rome, et tu manqueras ton but ici et là-bas. Mais je ne dis plus cela pour te conseiller ; je te prédis seulement ce qui arrivera bientôt, et je t’invite aussi d’avance à te confier en moi, quelque malheur qui t’arrive. Je vais maintenant parler au - prince, comme tu l’exiges.
SCÈNE V.
LE TASSE, seul.
Oui, va, va, persuadé que tu me fais croire ce que tu veux. J’apprends à me déguiser ; car tu es un grand maître, et je saisis promptement. Ainsi la vie nous force .de paraître et même d’être semblables à ceux que nous pouvions hardiment et fièrement mépriser. Je vois désormais clairement tout l’artifice de cette trame de cour. Antonio veut me chasser d’ici, et ne veut pas qu’il paraisse que c’est lui qui me chasse. Il joue l’homme indulgent, l’homme sage, afin qu’on me trouve bien malade et bien déraisonnable. Il se pose en tuteur, pour me réduire à n’être qu’un enfant, moi qu’il n’a pu forcer d’être esclave. Il couvre ainsi de nuages le front du prince et les yeux de la princesse. Il faut me retenir, dit-il ; après tout, la nature m’a départi un beau talent ; mais elle a, par malheur, accompagné ce don excellent de maintes faiblesses, d’un orgueil effréné, d’une sensibilité outrée et d’une sombre obstination. C’est comme cela ; la destinée a formé de la sorte cet homme unique : il faut maintenant le prendre comme il est, le souffrir, !e supporter, et peut-être, dans ses bons jours, recevoir, comme un gain inattendu, ce qu’il peut procurer de plaisir ; du reste, tel qu’il est né, il faut le laisser vivre et mourir…. Puis-je reconnaître encore la ferme volonté d’Alphonse, qui brave ses ennemis et protége fidèlement ses amis ? le reconnaître dans la manière dont il me traite aujourd’hui ? Oui, je vois bien maintenant tout mon malheur. C’est dans ma destinée, que celui qui demeure fidèle et sûr pour les autres, se change pour moi seul, se change aisément, au moindre souffle, en un instant…, La seule arrivée de cet homme n’a-t-elle pas, en une heure, détruit toute ma fortune ? N’a-t-il pas renversé, jusqu’à ses derniers fondements, l’édifice de mon bonheur ? Ah ! me faut-il éprouver tout cela ! l’éprouver aujourd’hui ! Oui, comme tout se pressait de venir à moi, maintenant tout m’abandonne ; comme chacun s’efforçait de m’enfralner à soi, de s’emparer de moi, chacun me repousse et m’évite. Et pourquoi cela ? Le seul « Antonio l’emporte-t-il donc dans la balance sur mon mérite et sur tout l’amour que j’ai possédé dans une si large mesure ?… Oui, tout me fuit maintenant. Toi aussi !… Toi aussi, chère princesse, tu te dérobes à moi ! Dans ces tristes heures, elle ne m’a pas envoyé le moindre signe de sa faveur. L’aide mérité de sapait ?… Pauvre cœur, pour qui c’était une chose si naturelle de l’honorer !… i^rsque j’entendais sa voix, quel ineffable sentiment pénétrait mon sein ! Quand je la voyais, la claire lumière du jour me semblait obscure ; son œil, sa bouche, m’attiraient irrésistiblement ; mes genoux me soutenaient à peine, et il me fallait toute la force de ma volonté pour demeurer debout et ne pas tomber à ses pieds. A peine pouvais-je dissiper cette ivresse. Sois ferme, mon cœur. Lumineuse raison, ne te laisse pas obscurcir. Oui, elle aussi !… Osé-je le dire ? Je le crois à peine…. Ah ! je le crois, et je voudrais me le dissimuler. Elle aussi !… elle aussi ! Pardonne-lui entièrement, mais ne te flatte pas ! Elle aussi !… elle aussi !… Ah ! ce mot, dont je devrais douter, tant que vivra dans mon cœur un souffle de foi, il se grave, comme un suprême arrêt du sort, sur le bord de / la table d’airain que remplissent les souvenirs de mes douleurs. C’est seulement de cette heure, que mes ennemis sont puissants ; de cette heure, que toute force m’est pour jamais ravie. Comment puis-je combattre, lorsqu’elle est dans l’armée ennemie ? Comment puis-je attendre avec patience, lorsqu’elle ne me tend pas la main de loin, que son regard ne vient pas au-devant du suppliant ? Tu as osé le penser, tu l’as dit, et, il faut l’avouer, avant que tu pusses le craindre ! Et maintenant, avant que le désespoir déchire ton cœur avec ses gritfes d’airain, oui, n’accuse que le sort cruel, et répète seulement : <■ Elle aussi ! elle aussi ! »
ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE I.
Un jardin.
ALPHONSE, ANTONIO.
ANTONIO.
Sur ton ordre, je suis retourné auprès du Tasse, et je viens de le quitter. Je l’ai exhorté, et même sollicité, mais il ne change pas de pensée, et te prie instamment de permettre qu’il aille passer quelque temps à Rome.
ALPHONSE.
Je suis fâché, à te parler sans détour, et j’aime mieux te le dire que de cacher et d’augmenter ainsi mon chagrin. Il veut partiF, bien ! je ne le retiens pas. Il veut partir ; il veut se rendre à Rome : soit ! Pourvu que Scipion Gonzague, que le sage Médicis, ne me l’enlèvent pas ! Ce qui a rendu l’Italie si grande, c’est que chaque prince lutte avec son voisin pour posséder, pour mettre en œuvre les meilleurs esprits. Il me semble un général sans armée, le prince qui ne rassemble pas autour de lui les talents ; et celui qui est sourd à la voix de la poésie est un barbare, quel qu’il soit. J’ai trouvé ce poëte et je l’ai choisi ; je suis fier de lui, comme de mon serviteur ; et, après avoir tant fait pour lui, je ne voudrais pas le perdre sans nécessité.
ANTONIO.
Je suis embarrassé ; car, à tes yeux, je suis responsable de ce qui s’est passé aujourd’hui. Aussi veux-je de bon cœur avouer ma faute ; elle attend que ta grâce l’excuse. Mais, si tu pouvais croire que je n’ai pas fait mon possible pour me réconcilier avec lui, je serais tout à fait inconsolable. Oh ! jette-moi un regard favorable, afin que je puisse me remettre, que je reprenne confiance en moi.
ALPHONSE.
Non, Antonio, sois tranquille, je ne t’attribue ceci en aucune façon. Je connais trop bien le caractère de l’homme, et ne sais que trop ce que j’ai fait, combien je l’ai épargné, comme j’ai complêtement oublié que j’ai sur lui de véritables droits. L’homme peut se rendre maître de bien des choses : la nécessité et la longueur du temps triomphent à peine de son caractère.
ANTONIO.
Quand les autres hommes font beaucoup pour un seul, il est juste aussi qu’à son tour il se demande avec attention ce qui est utile aux autres. Celui qui a tant cultivé son esprit, celui qui amasse avidement tous les trésors du savoir et des connaissances qu’il nous est permis d’embrasser, ne serait-il pas doublement tenu de se dominer ?… Et y songe-t-il ?
ALPHONSE.
Nous ne «levons jamais goûter le repos !… Lorsque nous croyons en jouir, un ennemi nous est donné soudain pour exercer notre courage ; un ami, pour exercer notre patience.
ANTONIO.
Le premier devoir des hommes, de choisir leur boisson et leur nourriture, puisque la nature ne le borne pas aussi étroitement que les animaux, ce devoir, le remplit-il ? Et ne se laisse-t-il pas plutôt séduire, comme un enfant, par tout ce qui flatte son palais ? Quand mêle-t-il de l’eau avec son vin ? Mets épicés, friandises, boissons fortes, satisfont tour à tour son avidité ; et puis il se plaint de sa mélancolie, de son sang échauffé, de son humeur impétueuse, et invective contre la nature et le sort. Avec quelle amertume et quelle folie ne l’ai-je pas vu souvent disputer avec son médecin ! C’était presque risible, si l’on pouvait rire de ce qui tourmente un homme et fatigue les autres. « Je suis malade, dit-il, inquiet et tout chagrin. Pourquoi vantez-vous votre art ? Guérissez-moi ! — Bien ! reprend le médecin ; évitez donc ceci et cela. —Je ne puis. — Prenez donc ce breuvage. — Oh ! non, le goût en est détestable : il me répugne. — Eh bien, buvez de l’eau. — De l’eau ? Jamais ! Je crains l’eau comme un hydrophobe. — On ne peut donc vous secourir. — Et pourquoi ? — Un mal s’ajoute sans cesse aux autres maux, et, s’il ne peut vous tuer, du moins il vous tourmentera chaque jour davantage. —Fort bien ! Pourquoi êtesvous médecin ? Vous connaissez mon mal, vous devriez aussi connaître les remèdes, les rendre aussi savoureux, afin que je n’eusse pas d’abord à souffrir pour être délivré de la souffrance. » Tu souris toi-même, et pourtant cela est vrai ; tu l’as peut-être entendu de sa bouche.
ALPHONSE.
Je l’ai entendu souvent et souvent excusé.
ANTONIO.
Il est certain que, tout comme une vie intempérante nous donne d’affreux et pénibles songes, elle nous fait à la fin rêver en plein joiir. Sa défiance, qu’est-elle autre chose qu’un rêve ? Où qu’il paraisse, il se croit environné d’ennemis. Personne ne peut voir son talent qui ne l’envie ; personne ne peut l’envier qui ne le haïsse et ne le persécute cruellement. C’est ainsi qu’il t’a fatigué souvent de ses plaintes : serrures brisées, lettres surprises, et le poison et le poignard ! Tout ce qu’il peut rêver ! Tu as ordonné des recherches, tu les as faites, et qu’as-tu trouvé ? A peine des apparences. La protection d’aucun prince ne le rassure ; le sein d’aucun ami ne le console. Et veux-tu promettre à un tel homme le repos et le bonheur ? Veux-tu t’en promettre à toi-même quelque plaisir ?
ALPHONSE.
Tu dirais vrai, Antonio, si je voulais chercher en lui mon avantage prochain. C’est, il est vrai, déjà mon avantage, en ce que je n’attends pas l’utilité directe et absolue. Tout ne nous sert pas de même sorte. Qui veut employer de nombreux ressorts doit user de chacun selon sa nature : c’est ainsi qu’il est bien servi. Voilà ce que les Médicis nous ont enseigné ; voilà ce que nous ont appris les papes eux-mêmes. Avec quelle indulgence, quelle longanimité, quelle douceur de prince, ces hommes ont-ils supporté plus d’un grand talent, qui semblait n’avoir pas besoin de leur faveur libérale et en avait pourtant besoin !
ANTONIO.
Qui ne sait, mon prince, que les peines de la vie nous apprennent seules à en estimer les biens ? Si jeune, il a déjà trop obtenu pour être capable de jouir modérément. Ah ! s’il devait d’abord gagner ce qui lui est maintenant offert à pleines mains, il emploierait courageusement ses forces, et pas à pas il se sentirait satisfait. Un pauvre gentilhomme touche au but de son plus beau souhait, dès qu’un noble prince veut bien le choisir pour son courtisan, et, d’une main bienfaisante, le tire de la pauvreté…. Lui accorde-t-il encore sa confiance et sa faveur, et daigne-t-il l’élever à son côté au-dessus des autres, soit dans les armes, soit dans les affaires ou dans, sa familiarité : il me semble que l’homme modeste pourrait jouir hum’blement de son bonheur avec une tranquille reconnaissance. Et, avec tout cela, le Tasse possède encore ce qui est pour un jeune homme le plus bel avantage, que déjà sa patrie le connaît et qu’elle espère en lui. Oh ! crois-moi, son capricieux mécontentement repose sur le large oreiller de son bonheur. Il vient, donne-lui congé avec bienveillance ; donne-lui le temps de chercher à Rome ou à Naples, où il voudra, ce qui lui manque chez toi, et qu’il ne peut retrouver que chez toi.
ALPHONSE.
Veut-il retourner d’abord à Ferrare ?
ANTONIO.
Il désire séjourner à Belriguardo ; il se fera envoyer par un ami les choses’ les plus nécessaires pour son voyage.
ALPHONSE.
J’y consens. Ma sœur va retourner à la ville avec son amie ; j’y vais à cheval et serai avant elles à la maison. Tu nous suivras bientôt, quand tu te seras occupé du Tasse. Donne au châtelain les ordres nécessaires, en sorte qu’il puisse rester au château aussi longtemps qu’il voudra, en attendant ses effets, que lui enverront ses amis, et les lettres que je me propose de lui donner pour Rome. Il vient. Adieu ! (Antonio s’éloigne.)
SCÈNE II.
ALPHONSE, LE TASSE.
L^tasse, avec réserve. La faveur que lu m’as si souvent témoignée brille aujourd’hui pour moi dans tout son jour. Tu as pardonné la faute que, sans réflexion et témérairement, j’ai commise dans ta demeure ; tu m’as réconcilié avec mon adversaire ; tu veux bien permettre que je m’éloigne quelque temps de ta présence ; tu veux généreusement me conserver ta faveur : je pars donc avec une pleine confiance, et j’ai l’espoir secret que ce court intervalle me guérira de tout ce qui m’oppresse maintenant. Mon esprit s’élèvera de nouveau, et dans la route où, encouragé par ton regard, je m’avançai d’abord plein de joie et d’audace, je me rendrai de nouveau digne de ta faveur.
ALPHONSE.
Je souhaite que ton voyage soit heureux, et j’espère que tu reviendras à nous joyeux et en pleine santé. Alors, satisfait, tu nous dédommageras doublement pour chaque heure que tu nous dérobes. Je te donnerai des lettres pour mes serviteurs et pour mes amis de Rome, et je souhaite fort que tu saches témoigner partout aux miens de la confiance, de même que, malgré ton absence, je te regarde assurément comme étant à moi.
LOJTASSE.
0 prince ! tu combles de faveurs celui qui s’en juge indigne, et qui même ne sait pas en ce moment t’exprimer sa reconnaissance. Au lieu de remercîments, je t’adresse une prière. Mon poëme est l’objet de ma plus vive sollicitude. J’ai fait beaucoup, et n’ai épargné aucune peine et aucun soin : mais je . le juge encore trop imparfait. Je voudrais, dans les lieux où plane encore le génie des grands hommes, où il exerce encore son influence, je voudrais retourner à leur école. Mon poëme en deviendrait plus digne de ton suffrage. Oh ! rends-moi les feuilles que je ne puis sans confusion savoir en tes mains.
ALPHONSE.
Tu ne voudras pas me reprendre aujourd’hui ce qu’aujour
d’hui même tu viens à peine de me” présenter. Laissemoi me placer, comme médiateur, entre ton poëme et toi ; garde-toi d’altérer, par une étude sévère, l’aimable naturel qui respire dans tes vers, et n’écoute pas les conseils de toutes parts. Ces mille pensées diverses de tant d’hommes différents, qui se contredisent dans leur vie et dans leurs opinions, le poete en forme habilement un ensemble, et ne craint pas de déplaire aux uns, afin de pouvoir plaire aux autres d’autant mieux. Je ne dis pas toutefois que tu ne doives passer çà et là ta lime avec précaution ; je te promets aussi que, dans peu de temps, tu recevras une copie de ton poëme. L’exemplaire de ta main restera dans les miennes, afin que je puisse d’abord en jouir pleinement avec mes sœurs. Si tu rapportes ensuite l’ouvrage plus parfait, nous y trouverons une jouissance plus grande encore, et, comme amis seulement, nous te donnerons nos avis sur quelques passages.
L© .TASSE.
Je ne répète qu’avec confusion ma prière : fais que je reçoive promptement la copie. Mon âme est maintenant tout entière à cet ouvrage. C’est maintenant qu’il faut que mon poëme devienne ce qu’il peut devenir.
ALPHONSE.
J’approuve le zèle qui t’anime. Mais, cher Tasse, s’il était possible, tu devrais d’abord jouir quelque temps du monde en liberté, te distraire, te rafraîchir le sang par un bon régime. Alors la belle harmonie de tes sens renouvelés te donnerait ce que, dans ton ardeur inquiète, tu cherches vainement aujourd’hui.
I© TASSE.
Mon prince, cela semble ainsi ; mais j’ai la santé, quand je puis me livrer à mon travail, et c’est ainsi que mon travail me rend à son tour la santé. Tu me connais depuis longtemps : je ne me sens pas bien dans une oisive mollesse. C’est le repos même qui me laisse le moins de repos. Ce cœur, je le sens, hélas ! ne fut pas destiné par la nature à voguer joyeusement, sur le flot paisible des jours, vers l’immense océan des âges.
ALPHONSE.
Tout ce que tu penses et ce que tu poursuis te ramène au fond de ton être. Il est autour de nous de nombreux abîmes, que le sort a creusés ; mais le plus profond est dans notre cœur, et c’est un charme de s’y plonger. Je t’en prie, arrache-toi à toimême. L’homme y gagnera ce que perdra le poëte.
Ifl» TASSE.
Je réprime vainement cette ardeur, qui s’agite jour et nuit dans mon sein. Si je ne puis ni méditer ni composer, la vie n’est plus une vie pour moi. Défends au ver de filer sa soie, quand même en filant il avance sa mort. De sa propre substance, il développe la trame précieuse, et ne cesse pas avant de s’être enfermé dans son tombeau. Ah ! veuille, quelque jour, un Dieu favorable nous accorder aussi le sort de l’insecte digne d’envie, de déployer, vifs et joyeux, nos ailes dans la vallée, aux rayons d’un nouveau soleil !
ALPHONSE.
Écoute-moi ! Tu sais doubler pour tant de mortels les jouissances de la vie : apprends, je t’en conjure, à connaître le prix de l’existence, que tu possèdes encore, riche de mille trésors. Adieu ! Plus tôt tu reviendras à nous, plus tu seras chez nous le bienvenu. (Il s’éloigne.) SCÈNE III.
LE TASSE, seul.
Courage ! Tiens ferme, mon cœur ! C’était bien ainsi ! Cela t’est difficile ; c’est la première fois que tu veux et que tu peux dissimuler ainsi. Tu l’as bien entendu : ce n’était pas son cœur ; ce n’était pas son langage. Il me semblait n’entendre encore que la voix d’Antonio. Oh ! prends garde ! Tu continueras à l’entendre ainsi de tous côtés. Courage ! courage ! Encore un moment de combat. Celui qui apprend tard à dissimuler conserve l’apparence de la franchise. Cela ira bien : exerce-toi seulement avec eux. ( Après une pause.) Tu triomphes trop tôt. Elle vient ici ! Elle vient, l’aimable princesse ! Oh ! quels sentiments ! La voici : le dépit et la défiance se changent en douleur dans mon sein.
SCÈNE IV.
LA PRIN’CESSE, LE TASSE, et, vers la fin de la scène, les autres personnages.
l LA PRINCESSE.
O Tasse, tu songes à nous quitter, ou plutôt tu restes à Belriguardo, et puis tu t’éloigneras de nous ? J’espère que c’est pour peu de temps. Tu vas à Rome ?
UH TASSE.
C’est là que je porterai d’abord mes pas, et, si mes amis m’accueillent avec bonté, comme j’ose l’espérer, là peut-être mettrai-je, avec soin et patience, la dernière main à mon poëme. Je trouverai rassemblés dans cette ville beaucoup d’hommes, qui, en tout genre, se peuvent appeler maîtres. Et dans cette ville, la première du monde, chaque place, chaque pierre, ne nous parlent-elles pas ? Quelle foule d’instituteurs muets nous attirent doucement avec une sérieuse majesté ! Si je n’achève pas en ce lieu mon poëme, je ne pourrai jamais l’achever. Mais, hélas ! déjà je le prévois, aucune entreprise ne me réussira. Je changerai mon ouvrage, et ne l’achèverai jamais. Oui, je le sens, l’art sublime, qui nourrit tout le monde, qui fortifie et restaure une âme saine, me détruira ; il me bannira. Je me hâte de fuir. J’irai bientôt à Naples.
LA PRINCESSE.
L’oseras-tu ? L’arrêt sévère qui t’a proscrit, en même temps que ton père, n’est pas encore aboli.
L©-TASSE.
Ton avis est sage : j’y ai déjà pensé. J’irai déguisé ; je prendrai le pauvre vêtement du pèlerin ou du berger. Je me glisse à travers la ville, où le mouvement de la foule cache un homme aisément. Je cours au rivage, j’y trouve d’abord une barque avec de bonnes gens, des paysans, venus au marché, qui retournent chez eux, des gens de Sorrente : car je veux me hâter de passer à Sorrente. Là demeure ma sœur, qui fut avec moi la douloureuse joie de mes parents. Dans la barque, je reste tranquille, et, toujours silencieux, j’aborde au rivage ; je monte
doucement le sentier, et, à la porte de la ville, je m’informe et je dis : « Où demeure Cornélie, Cornélie Sersale ? Indiquez-lemoi. » Une fileuse me montre la rue avec complaisance ; elle me désigne la maison. Je monte encore. Les enfants courent à mes côtés, et observent le sombre étranger, sa chevelure en désordre. J’arrive ainsi vers le seuil…. Déjà la porte est ouverte ; j’entre dans la maison LA PRINCESSE.
O Tasse, ouvre les yeux ! Reconnais, s’il est possible, le péril qui t’environne. Je te ménage ; sans cela, je te dirais : Est-ce généreux de parler comme tu parles ? Est-ce généreux de ne penser qu’à soi, comme si tu n’affligeais pas les cœurs de tes amis ? Ignores-tu ce que pense mon frère ? comme les deux sœurs savent t’estimer ? Ne l’as-tu pas éprouvé et reconnu ? Tout est-il donc changé en quelques instants ? O Tasse, si tu veux partir, ne nous laisse pas la douleur et l’inquiétude. (Le Tasse détourne la tête.) Qu’il est doux d’offrir à l’ami qui s’éloigne pour un peu de temps un modeste cadeau, ne fût-ce qu’un manteau neuf ou une arme ! A toi, on ne peut plus rien te donner, car tu rejettes avec chagrin ce que tu possèdes. Tu choisis pour ton partage les coquilles, la robe brune et le bourdon du pèlerin, et tu t’en vas, pauvre par ton choix, et tu nous emportes les biens que tu ne pouvais goûter qu’avec nous.
UJv TASSE.
Tu ne veux donc pas me chasser tout à fait ? O douce parole ! ô belle et chère consolation ! Prends ma défense ! Prends-moi sous ta protection !… Laissemoi ici à Belriguardo ; transportemoi à Consandoli, où tu voudras ! Le prince a tant de châteaux magnifiques, tant de jardins, qui sont gardés toute l’année, et que vous visitez à peine un seul jour, une heure peut-être. Oui, choisissez le plus éloigné, que vous ne visitez pas de toute l’année, et qui maintenant reste peut-être sans soins. Envoyezmoi dans cette retraite. Li, que je sois à vous ! Comme je soignerai tes arbres ! Comme, en automne, je couvrirai de plan 1. On sait que le Tasse, errant et fugitif, a fait réellement la visite dont le poêle lui prêle ici le projet.
ches et de tuiles les citronniers, et les préserverai bien avec des nattes de roseaux ! Les belles fleurs pousseront de larges racines dans le parterre ; chaque allée, chaque retraite, sera propre et bien tenue. Et laissez-moi aussi le soin du palais. J’ouvrirai à propos les fenêtres, afin que l’humidité ne gâte point les tableaux ; les murs, élégamment décorés d’ouvrages en stuc, j’aurai soin d’en chasser la poussière. Les pavés brilleront de blancheur et de propreté ; pas une pierre, pas une tuile, qui se déplacent ; pas une ouverture où l’on voie germer un brin d’herbe.
LA PRINCESSE.
Je ne trouve nul conseil dans mon cœur, et je n’y trouve aucune consolation pour toi…. et pour nous. Mon œil cherche de tous côtés, si quelque dieu ne viendra pas à notre secours ; s’il ne me découvrira point une plante salutaire, un breuvage, qui rende la paix à tes sens, qui nous rende la paix ! La plus sincère parole qui s’échappe de nos lèvres, le glus doux moyen de salut n’a plus de pouvoir. Il faut que je te laisse, et mon cœur ne peut te laisser.
14k. TASSE.
0 dieux, est-ce bien elle qui te parle, et qui prend pitié de toi ? Et pouvais-tu méconnaître ce noble cœur ? Était-il possible qu’en sa présence le découragement te saisit et se rendît maître de toi ? Non, non, c’est toi, et maintenant c’est aussi moi. Oh ! poursuis et laissemoi recueillir de ta bouche toutes les consolations ! Ne me refuse pas tes conseils ! Oh ! parle, que dois-je faire, pour que ton frère puisse me pardonner ; pour que tu veuilles bien me pardonner toi-même ; pour que vous puissiez encore me compter avec joie parmi les vôtres ? Parle !
LA PRINCESSE.
Ce que nous te demandons est très-peu de chose, et pourtant il semble que ce soit beaucoup trop. Il faut te livrer toi-même à nous avec amitié. Nous n’exigeons point de toi ce que tu n’es pas ; tout ce que nous voulons, c’est que tu sois satisfait de toimême. Tu nous donnes la joie quand tu l’éprouves, et tu nous affliges quand tu la fuis ; et, si tu nous causes aussi de l’impatience, c’est seulement parce que nous voudrions te secourir, et que nous voyons, hélas ! tout secours impossible, si tu ne saisis toi-même la main d’un ami, la main qui s’offre avec ardeur et qui ne peut arriver jusqu’à toi.
JETASSE.
Tu es toujours celle qui m’apparut, dès le premier moment, comme un ange sacré. Pardonne au regard troublé du mortel, s’il t’a méconnue quelques instants. Il te reconnaît ! Son âme s’ouvre tout entière pour t’adorer toi seule à jamais. Tout mon cœur se remplit de tendresse…. C’est elle ; elle est devant moi. Quel sentiment !… Est-ce un délire qui m’entraîne vers toi ? Est-ce une frénésie, ou un sens plus relevé, qui saisit, pour la première fois, la plus haute, la plus pure vérité ? Oui, c’est le sentiment qui seul peut me rendre heureux sur cette terre ; qui seul m’a laissé si misérable, quand je lui résistais, et voulais le bannir de mon cœur. Cette passion, je songeais à la combattre ; je luttais, et je luttais contre le fond de mohétre ; je détruisais ma propre nature, à laquelle tu appartiens si complêtement.
LA PRINCESSE.
Si tu veux, ô Tasse, que je t’écoute plus longtemps, modère ces transports qui m’effrayent.
LC. TASSE.
Le bord de la coupe retient-il un vin qui bouillonne et déborde à flots écumants ? A chaque parole, tu augmentes mon bonheur ; à chaque parole, ton œil brille d’un plus vif éclat. Je me sens transformé au dedans de moi ; je me sens délivré de toute souffrance, libre comme un dieu, et c’est à toi que je dois tout. Une puissance ineffable, qui me domine, découle de tes lèvres ; oui, tu t’empares de tout mon être. Rien de tout ce que je suis ne m’appartient plus désormais. Mon œil se trouble dans le bonheur et la lumière ; mes sens vacillent, mon pied ne me retient plus ! Tu m’entraînes par une force irrésistible, et mon cœur me pousse invinciblement vers toi. Tu m’as absolument subjugué pour jamais ; eh bien, prends donc aussi tout mon être ! (Il saisit la Princesse dans ses bras et la presse contre spn sein.) La Princesse. Elle repousse le Tasse et recule avec précipitation.
Loin de moi !
éléonore, qui s’est montrée depuis quelques moments dans le fond
du théâtre.
Qu’est-il arrivé ? O Tasse ! ô Tasse ! (Elle suit la Princesse.) Icltasse, sur le point de les suivre.
O Dieu !
Alphonse, qui s’est approché, avec Antonio, depuis quelques instants. Il perd l’esprit ! Qu’on l’arrête ! (Alphonse s’éloigne.)
SCÈNE V.
ANTONIO, LE TASSE.
ANTONIO.
Ah ! si quelqu’un des ennemis dont tu te crois sans cesse environné était maintenant auprès de toi, comme il triompherait ! Infortuné ! J’en reviens à peine ! Si un spectacle tout à fait inattendu se présente à nous ; si nos yeux voient quelque chose de monstrueux, notre esprit reste un moment immobile ; nous ne savons à quoi comparer ce que nous voyons.
TA.Tasse, après une longue pause.
Remplis ton office ! Je vois qu’il t’est réservé…. Oui, tu mérites la confiance du prince…. Remplis donc ton office, et, puisque le bâton est brisé pour moi ’, torture-moi lentement jusqu’à la mort. Arrache, arrache le trait, afin que je sente douloureusement la pointe recourbée qui me déchire ! Tu es un précieux instrument du tyran : sois le chef des geôliers, sois le valet du bourreau ! Comme l’un et l’autre emploi te vont bien ! comme ils t’appartiennent ! (Il s’avance vers la rampe.) Va, va, tyran ! Tu n’as pu feindre jusqu’au bout : triomphe ! Tu as bien enchaîné ton esclave ; tu l’as bien réservé pour des tourments médités. Va ! Je te hais, je sens toute l’horreur qu’inspire la force, quand elle se montre injuste et violente. (Après une pause.) Je me vois donc enfin banni, rejeté et banni comme un mendiant ! On m’a donc couronné pour me conduire à l’autel, paré comme une victime ! On m’a donc, au dernier jour, soustrait mon unique bien, mon poëme, par de flatteuses paroles, et on 1. Allusion à l’ancienne coutume de briser un blton en signe de conlamnation à mort.
l’a gardé pour jamais ! Il est à présent dans vos mains, mon unique trésor, qui m’aurait recommandé en tout lieu ; qui me restait encore pour me sauver de la faim. Je vois bien maintenant pourquoi on veut que je me livre au repos. C’est une conjuration et tu en es le chef. Afin que mon poëme ne puisse être porté à sa perfection ; que mon nom ne se répande pas davantage ; que mes envieux trouvent mille endroits faibles ; qu’on m’oublie enfin tout à fait : il faut que je m’accoutume à l’oisiveté ; il faut que je ménage ma personne et mes facultés. O digne amitié ! chère sollicitude ! Je me la figurais affreuse, la conjuration, qui, invisiblement et sans relâche, m’enveloppait de ses trames, mais elle s’est montrée plus affreuse encore…. Et toi, sirène, qui m’as si tendrement, si délicieusement séduit, je te connais maintenant tout d’un coup ! O Dieu, pourquoi si tard ?… Mais nous aimons à nous tromper nous-mêmes, et nous honorons les misérables qui nous honorent. Les hommes ne se connaissent point entre eux. Les seuls esclaves des galères se connaissent, qui gémissent, étroitement enchaînés au même banc ; aucun n’ayant rien à demander et aucun n’ayant rien à perdre, ils se connaissent ; chacun se donnant pour un scélérat, et prenant aussi pour des scélérats ses pareils. Mais nous ne méconnaissons les autres que par politesse, afin qu’ils nous méconnaissent à leur tour…. Comme ta sainte image me cacha longtemps la coquette, qui met en œuvre ses petits artifices ! Le masque tombe : je vois Armide maintenant, dépouillée de tous ses charmes…. Oui, c’est toi ! c’est toi, que, par divination, mes vers ont chantée ! Et la rusée, la petite médiatrice ! Que je la vois profondément abaissée devant moi ! J’entends maintenant le bruit de ses pas légers ; je connais maintenant le cercle autour duquel elle rampait. Je vous connais tous ! Que cela me suffise ! Et, si l’infortune m’a tout ravi, je l’apprécie encore : elle m’apprend la vérité !
ANTONIO.
Je t’écoute, ô Tasse, avec étonnement, quoique je sache avec quelle facilité ton esprit impétueux passe d’un extrême à l’autre. Reviens à toi !• Commande à cette fureur ! Tu invectives, tu te permets paroles sur paroles, qu’il faut pardonner à ta douleur, mais que tu ne pourras toi-même jamais te pardonner.
145, TASSE.
Oh ! ne me parle pas d’une voix douce ! Ne me fais ouïr de toi aucune parole sage ! Laissemoi ce triste bonheur, afin que je ne retrouve pas ma raison pour la perdre encore. Je me sens déchiré jusqu’à la dernière fibre et je vis pour le sentir. Le désespoir me saisit avec toute sa rage, et, dans le supplice d’enfer qui m’anéantit, l’insulte n’est plus qu’un faible cri de douleur. Je veux partir ! Et, si tu es loyal, montre-le-moi, et me laisse sur-le-champ m’éloigner d’ici.
ANTONIO.
Je ne te quitterai pas dans cette extrémité ; et, si tu manques tout à fait de constance, assurément la patience ne me manquera pas.
I&TASSE.
Il faut donc que je me rende à toi prisonnier ? Je me rends, et c’en est fait. Je ne résiste pas, et je m’en trouve bien…. Et maintenant laissemoi redire avec douleur combien était beau ce que je me suis moi-même ravi. Ils partent…. O Dieu ! je vois déjà la poussière qui s’élève des voitures…. Les cavaliers les devancent…. Ils vont à la ville ; ils y courent ! N’en suis-je pas aussi venu ? Ils partent ; ils sont irrités contre moi. Oh ! si du moins je baisais encore une fois la main du prince ! Oh ! si je pouvais du moins prendre congé de lui ; lui dire encore une fois : «Qhl pardonnez ! » L’entendre dire encore : « Va ; je te pardonne. » Mais je ne l’entendrai pas, je ne l’entendrai jamais…. Je veux aller !… Laissez-moi seulement leur dire adieu, oui, leur dire adieu ! Rendez-moi, rendez-moi, un seul instant, leur présence ! Peut-être je guérirai. Non, je suis repoussé, banni ; je me suis banni moi-même. Je n’entendrai plus cette voix ; je ne rencontrerai plus ce regard….
ANTONIO.
Sois docile aux avis d’un homme qui n’est pas sans émotion auprès de toi. Tu n’es pas aussi malheureux que tu crois l’être. Prends courage. Tu te laisses trop accabler.
ISU’ASSE.
Et suis-je donc aussi malheureux que je le semble ? Suis-je aussi faible que je me montre devant toi ? Tout est-il donc perdu ? Et, comme si la terre tremblait, la douleur a-t-elle changé l’édifice en un affreux amas de ruines ? Ne me reste-t-il aucun talent, qui dé mille manières m’amuse et me soutienne ? Toute la force qui s’agitait autrefois dans mon sein est-elle évanouie ? Suis-je anéanti, complêtement anéanti ? Non, tout est là…. et je ne suis rien !… Je me sens ravi à moi-même ; elle m’estravie !
ANTONIO.
Et, quand tu sembles te perdre tout entier, compare-toi à d’autres : reconnais ce que tu es !
MXJASSE.
Oui, tu me le rappelles à propos !… Aucun exemple de l’histoire ne viendra-t-il plus à mon secours ? Ne s’offre-t-il à mes yeux aucun noble caractère, qui ait plus souffert que je ne souffris jamais, afin que je prenne courage, en me comparant à lui ? Non, tout est perdu…. Une seule chose me reste. La nature nous a donné les larmes, le cri de la douleur, quand l’homme enfin ne la supporte plus…. Elle m’a laissé encore par-dessus tout…. elle m’a laissé, dans la douleur, la mélodie et l’éloquence, pour déplorer toute la profondeur de ma misère : et, tandis que l’homme reste muet dans sa souffrance, un Dieu m’a donné de pouvoir dire combien je souffre. (Antonio s’approche de lui et le prend par la main.) Noble Antonio, tu demeures ferme et tranquille ; je ne parais que le flot agité par la tempête : mais réfléchis, et ne triomphe pas de ta force. La puissante nature, qui fonda ce rocher, a donné aussi aux flots leur mobilité ; elle envoie sa tempête : la vague fuit et se balance et s’enfle etse brise par-dessus en écumant. Dans cette vague, le soleil se reflétait si beau ; les étoiles reposaient sur son sein doucement agité. L’éclat a disparu, le repos s’est enfui…. Je ne me reconnais plus dans le péril, et ne rougis plus de l’avouer. Le gouvernail est brisé, le navire craque de toutes parts ; le plancher éclate et s’ouvre sous mes pieds ! Je te saisis de mes deux bras ! Ainsi le matelot s’attache encore avec force au rocher contre lequel il devait échouer.
FIN DE TORQUATO TASSO.