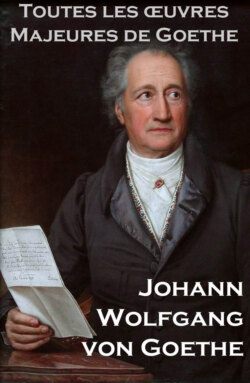Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Goethe - Johann Wolfgang von Goethe - Страница 15
STELLA
ОглавлениеMon bien-aimé !
FERNAND.
O délices ! délices !… Ici, où tu respires, tout nage dans une vie jeune et fortunée. Ici l’amour et la constante fidélité enchaîneraient le vagabond flétri.
STELLA.
Enthousiaste !
FERNAND.
Tu ne sens pas ce que la rosée du ciel est pour l’homme altéré, qui, d’un monde désert et stérile, revient sur ton sein.
STELLA.
Et la joie du pauvre ?… Fernand, de presser de nouveau sur son cœur son unique brebis, égarée, perdue ! Fernand, aiix pieds de Stella. Ma Stella !
STELLA..
Lève-toi, mon ami, lève-toi. Je ne puis te voir à genoux.
FERNAND.
Laissemoi. Je suis toujours à genoux devant toi ; mon cœur s’incline toujours devant toi, amour, bonté inépuisable !
STELLA.
Tu m’es rendu !… Je ne me connais pas ; je ne me comprends pas !… Au fond, qu’est-ce que cela fait ?
FERNAND.
Je me sens comme dans les premiers moments de nos joies. Je te tiens dans mes bras ; je recueille sur tes lèvres l’assurance de ton amour, et je suis dans l’ivresse, et je me demande, avec étonnement, si je veille ou si je songe.
STELLA.
Fernand, à ce qu’il me semble, tu n’es pas devenu plus sage.
FERNAND.
Dieu m’en préserve !… Mais ces moments d’ivresse dans tes bras me rendent de nouveau pieux et bon…. Je peux prier, Stella, car je suis heureux.
STELLA.
Que Dieu te pardonne d’être si mauvais sujet et si bon !… Que Dieu te pardonne, lui qui t’a fait…. si volage et si fidèle !… Lorsque j’entends le son de ta voix, aussitôt je crois encore que c’est ce Fernand qui n’aimait rien au monde que moi.
FERNAND.
Et moi, lorsque je pénètre dans cet œil bleu, si doux, et que je me perds à l’observer, je me figure que, dans tout le temps de mon absence, il n’a logé aucune autre image que la mienne.
STELLA.
Tu ne te trompes pas.
FERNAND.
Non ?…
STELLA. .
Je te l’avouerais !… Ne t’ai-je pas avoué, dans les premiers temps de mon amour, toutes les petites fantaisies qui avaient jamais effleuré mon cœur ? Et ne t’en étais-je pas plus chère ?.. ;
FERNAND.
Mon ange !
STELLA.
Pourquoi me regardes-tu ainsi ? N’est-il pas vrai que la douleur a terni l’éclat de mes joues ?
FERNAND.
Rose, ma douce fleur ! Stella !… Pourquoi secouer la tête ?
STELLA.
Qu’on puisse autant vous aimer !… Qu’on ne vous impute point le chagrin que vous nous avez causé !
Fernand, caressant les boucles de Stella.
Aurais-tu gagné à cela des cheveux gris ?… C’est un bonheur qu’ils soient.blonds : sans cela…. A la vérité, il ne semble pas qu’il en soit tombé. (// lui éte son peigne, et les cheveux se déroulent jusqu’aux pieds de Stella.)
STELLA.
Folâtre !
Fernand, enlaçant ses bras dans les cheveux. Renaud dans ses premières chaînes !…
UN DOMESTIQUE,
Madame !…
STELLA.
Que veux-tu ? Tu fais une triste et froide figure ! Tu sais que ces airs chagrins sont ma mort quand je suis contente.
LE DOMESTIQUE.
Mais, madame…. les deux étrangères veulent partir.
STELLA.
Partir !… Ah !…
LE DOMESTIQUE.
Comme je le dis. J’ai vu la fille aller à la poste, revenir parler à sa mère. Alors je me suis informé de tout vis-à-vis ; on m’a dit qu’elles ont commandé l’extra-poste, parce que la diligence est déjà partie. Je leur ai parlé. La mère, les larmes aux yeux, m’a prié de porter secrètement leurs effets vis-à-vis, et de souhaiter à madame mille bénédictions. Elles ne pourraient rester.
FERNAND.
C’est la dame qui est arrivée aujourd’hui avec sa fille ?
STELLA.
Je voulais m’attacher la jeune fille et retenir aussi la mère…. Ah ! faut-il à présent qu’elles me causent cette contrariété, Fernand !…
FERNAND.
Que leur peut-il être arrivé ?
STELLA.
Dieu sait ! Je ne puis, je ne veux rien savoir. Je serais fâchée de les perdre…. Mais je te possède, Fernand !… Je pourrais mourir à cette heure !… Parle-leur, Fernand…. A présent même, à présent !… Henri, fais que la mère revienne. (Le Domestique sort.) Parle-lui ; qu’elle soit libre !… Fernand, je vais dans le bosquet : viens me joindre ! viens !… 0 mes rossignols, vous le saluerez encore !
FERNAND.
Ame de ma vie !
Stella, à son cou. Et tu viendras bientôt ?
Fernand. A l’instant ! à l’instant ! (Stella sort. Fernand seul.) Ange du ciel ! comme en sa présence tout devient libre et serein !… Fernand, te reconnais-tu toi-même ? Tout ce qui oppressait mon cœur s’est dissipé ; tout souci, tout souvenir pénible, ce qui était…. et ce qui sera ! Déjà revenez-vous ?… Et pourtant, quand je te vois, Stella, quand je presse ta main, tout s’enfuit, toute autre image s’efface dans mon cœur. (Entre l’Intendant.) L’intendant, lui baisant la main. Vous voilà de retour !
Fernand, retirant sa main. C’est moi.
L’intendant. Permettez, permettez, ô monsieur !….
FERNAND.
Es-tu heureux ?
L’intendant. Ma femme vit, j’ai deux enfants…. et vous revenez !
FERNAND.
Comment avez-vous administré ?
L’intendant.
De telle sorte que je suis prêt à vous rendre compte sur-lechamp…. Vous serez surpris de voir comme nous avons amélioré le domaine…. Oserai-je vous demander quel a été votre succès ?
FERNAND.
Silence !… Dois-je te dire tout ? Tu le mérites, vieux complice de mes folies !
L’intendant.
Dieu soit loué, que vous ne fussiez pas chef de bohémiens ! Sur un mot de vous, j’aurais saccagé et brûlé.
FERNAND.
Écoute.
L’intendant. Votre femme ? votre fille ?
FERNAND. ’
Je ne les ai pas trouvées. Je n’ai pas osé pénétrer moi-même dans la ville, mais je sais, de source certaine, qu’elle s’est confiée à un marchand, un faux ami, qui, sous promesse de plus forts intérêts, lui a soutiré et dérobé les capitaux que je lui avais laissés. Sous prétexte de se retirer à la campagne, elle s’est éloignée du pays et a disparu ; il est vraisemblable qu’elle soutient péniblement sa vie par son travail et celui de sa fille. Tu sais qu’elle avait assez de courage et de caractère pour l’entreprendre.
L’intendant.
Et vous voilà revenu ! Il faut vous pardonner d’être resté si longtemps.
FERNAND.
J’ai couru beaucoup de pays.
L’intendant. Si je n’étais au mieux à la maison, avec ma femme et mes deux enfants, je vous envierais le nouveau voyage que vous avez tenté à travers le monde. Nous resterez-vous maintenant ?
FERNAND.
Si Dieu le veut. •.
L’intendant. Après tout, c’est le plus sûr et le meilleur.
FERNAND.
Oui, pour qui pourrait oublier le passé. L’intendant.
Qui, avec mainte joie, nous apporta mainte affliction. Je me souviens encore de tout parfaitement : comme nous trouvâmes Cécile aimable, comme nous fûmes pressants avec elle, et ne pouvions assez tôt nous délivrer de notre jeune liberté.
FERNAND.
Va, c’était un beau temps, un heureux temps !
L’intendant.. Comme elle nous donna une joyeuse et vive petite fille, mais perdit en même temps de sa gaieté et de ses charmes.
FERNAND.
Épargne-moi cette biographie.
L’intendant.
Comme nous jetâmes les yeux çà et là, d’un côté puis d’un autre ; comme enfin nous rencontrâmes cet ange ; comme il ne fut plus question d’aller et de venir, mais comme il fallut nous résoudre à rendre heureuse l’une ou l’autre ; comme enfin nous trouvâmes, à point nommé, une occasion de vendre nos biens ; comme nous nous sauvâmes avec mainte perte ; comme nous enlevâmes l’ange, et reléguâmes ici la belle enfant, qui ne connaissait ni elle-même ni le monde.
FERNAND.
A ce qu’il paraît, tu es toujours aussi sentencieux et aussi bavard qu’autrefois.
L’intendant.
N’ai-jepas eu l’occasion de m’instruire ? N’étais-je pas le confident de votre conscience ? Et, quand vous désirâtes encore vous éloigner d’ici, sans que je sache si ce fut purement par le désir de retrouver votre femme et votre fille, ou peut-être aussi par une inquiétude secrète, et, comme je pouvais vous être utile de plus d’une manière….
FERNAND. ’
Assez pour cette fois.
L’intendant. Restez seulement : tout ira bien. (// sort. Entre un Domestique.)
LE DOMESTIQUE.
Mme Sommer !
FERNAND. ’
Fais entrer. (Le Domestique sort.) Cette femme m’attriste. Rien de complet, rien de pur dans le monde ! Cette femme !… Le courage de la fille m’a troublé : que fera la douleur de la mère ? (Entre Mme Sommer. Fernand à part.) 0 Dieu ! et il faut que sa taille même me rappelle ma faute ! Notre cœur ! Notre cœur ! Oh ! si c’est dans ta nature de sentir et d’agir de la sorte,, pourquoi n’as-tu pas aussi la force de te pardonner ce qui est accompli ?… Une ombre de la tournure de ma femme !… Où donc ne la vois-je pas ? (Haut.) Madame !
MADAME SOMMER.
Que commandez-vous, monsieur ?
FERNAND.
Je souhaiterais qu’il vous convînt de tenir compagnie à ma Stella et à moi. Asseyez-vous.
MADAME SOMMER.
La présence des infortunés est un fardeau pour les heureux, hélas ! et celle des heureux plus encore pour les infortunés. .
FERNAND. ;
Je ne vous comprends pas. Pourriez-vous avoir méconnu Stella, elle qui est tout aimante, toute divine ?
MADAME SOMMER. *
Monsieur…. Je souhaitais partir secrètement…. Laissezmoi…. Il faut que je parte. Croyez que j’ai des raisons. Mais, je vous en prie, laissezmoi !
FERNAND, à part.
Quelle voix ! quelle taille !… Madame ! (Il se détourne.) Dieu ! c’est ma femme ! (Haut.) Pardonnez !… (// s’enfuit.)
MADAME SOMMER, Seule.
Il me reconnaît…. Je te remercie, mon Dieu, de ce qu’en ces moments tu as donné tant de force à mon cœurl… Est-ce bien moi, moi, abattue, déchirée, qui suis, à l’heure décisive, si tranquille, si courageuse ! Bonne, éternelle Providence, tu ne ravis donc rien à notre cœur que tu ne lui gardes en réserve, jusqu’à l’heure où il en a le plus besoin. (Fernand revient.) Fernand, à part.
Me reconnaîtrait-elle ? (Haut.) Je vous prie, madame, je vous conjure de m’ouvrir votre cœur !
MADAME SOMMER.
Il faudrait vous apprendre mon sort. Et comment seriez-vous disposé aux gémissements et au deuil, le jour où toutes les joies de la vie vous sont rendues ; où vous avez rendu toutes les joies de la vie à la femme la plus digne !… Non, souffrez, monsieur, que je parte !
FERNAND.
Je vous en prie.
MADAME SOMMER.
Que je l’épargnerais volontiers à vous et à moi ! Le souvenir des plus beaux, des plus heureux jours de ma vie me cause de mortelles douleurs.
FERNAND.
Vous n’avez pas été toujours malheureuse ?
. MADAME SOMMER.
Sans cela, je ne le serais pas maintenant à ce point. (Après une p«,use et d’une voix plus libre.) Les jours de ma jeunesse furent faciles et joyeux. Je ne sais ce qui m’attachait les hommes,’ mais un grand nombre souhaitèrent de me plaire. Quelques-uns m’inspirèrent de l’amitié, de l’affection. Toutefois il n’en était aucun avec lequel j’aurais cru pouvoir passer ma vie. Ainsi s’écoulèrent les heureux temps des distractions riantes, où un jour donne gracieusement la main à l’autre. Et cependant il me manquait quelque chose…. Quand je regardais plus avant dans la vie, et prévoyais les joies et les souffrances qui attendent l’homme, alors je souhaitais un époux dont la main m’accompagnât à travers le monde ; qui, en récompense de l’amour que mon jeune cœur lui pourrait consacrer, voulût devenir, dans l’âge avancé, mon ami, mon protecteur, et me tenir lieu de mes parents, que je quitterais pour l’amour de lui.
FERNAND.
Eh bien ?
MADAME SOMMER. .
Cet homme, je le vis ! Je vis celui sur lequel, dès les premiers jours de notre liaison, je plaçai toutes mes espérances. La vivacité de son esprit semblait être unie à une telle loyauté de cœur, que le mien s’ouvrit d’abord à lui ; que je lui donnai mon amitié, hélas ! et, bientôt après, mon amour. Dieu du ciel, quand sa tête reposa sur mon sein, comme il parut te remercier de la place que tu lui avais préparée dans mes bras ! Comme il se réfugiait vers moi, loin du tourbillon des affaires et des plaisirs, et, dans les heures de tristesse, comme je m’appuyais sur son cœur !
FERNAND.
Qui put troubler cette douce union ?
MADAME SOMMER.
Rien n’est durable…. Ah ! il m’aima aussi certainement que je l’aimai. 11 fut un temps où il ne connaissait rien, ne savait rien que me voir heureuse, me rendre heureuse. Ce fut, hélas ! le temps le plus doux de ma vie, les premières années d’une chaîne, où quelquefois un peu d’humeur, un peu d’ennui, nous affligent plus que si c’étaient de véritables maux. Hélas ! il m’accompagnait dans le chemin praticable, pour me laisser seule dans un vaste, un affreux désert.
Fernand, toujours plus troublé.
Eh quoi ?… Ses sentiments, son cœur ?
MADAME SOMMER.
Pouvons-nous savoir ce qui se passe dans le cœur des hommes ?… Je ne remarquai pas que peu à peu tout lui devenait… comment dois-jem’exprimer ?… non pas plus indifférent :.je ne puis me le dire. Il m’aimait toujours, toujours ! Mais il avait besoin d’autre chose que de mon amour. Je dus partager avec ses désirs, peut-être avec une rivale…. Je ne lui épargnai pas mes reproches, et enfin….
FEBNAND.
11 osa ?
CIT.THK. — TU, 1 30
MADAME SOMMER.
Il m’abandonna. Le sentiment de ma souffrance est inexprimable. Toutes mes espérances anéanties, anéanties, au moment où je croyais recueillir les fruits de mon printemps sacrifié.,.. Abandonnée !… abandonnée !… Tous les appuis du cœur humain, l’amour, la confiance, l’honneur, la position, une fortune chaque jour croissante, la perspective d’une postérité nombreuse, bien établie : tout croulait devant moi d’un seul coup, et moi…. le malheureux gage qui restait de notre amour…. Une morne tristesse suivit les furieuses douleurs, et mon cœur, noyé de larmes, profondément désespéré, tomba dans l’abattement. Les revers qui frappent la fortune d’une pauvre délaissée, je ne les remarquai point, je ne les sentis point, jusqu’à ce qu’enfin….
FERNAND.
Le coupable !
Madame Sommer, avec une tristesse contenue. Il ne l’est pas…. Je plains l’homme qui s’attache à une jeune fille. .
FERNAND.
Madame !
Madame Sommer, avec un léger badinage, pour couvrir son émotion.
Non, certainement ! Je le regarde comme un prisonnier. Et puis Fondit que c’est toujours comme cela. Il est amené de son monde dans le nôtre, avec lequel il n’a, dans le fond, rien de commun ; il s’abuse quelque temps, et malheur à nous quand ses yeux s’ouvrent !.. Pour moi, je ne pouvais plus à la fin être pour lui qu’une honnête mère de famille, qui lui était, il est vrai, attachée avec le plus ferme désir d’être pour lui agréable, vigilante ; qui vouait tous ses jours au bien de sa maison, de son enfant, et qui devait, j’en conviens, s’attacher à tant de bagatelles, que sa tête et son cœur étaient souvent arides ; qu’elle n’était point aimable ; qu’il devait nécessairement, avec la vivacité de son esprit, trouver ma société insipide. 11 n’est point coupable !…
Fernand, à ses pieds.
Je le suis !
Madame Sommer, à son cou, avec un torrent de larmes. Mon… !
FERNAND.
Cécile1…. Ma femme !…
Cécile, se détournant. •
Non ! tu n’es pas à moi. Tu m’abandonnes, mon cœur !…
(Elle se jette de nouveau à son cou.) Fernand !… qui que tu sois….
laisse couler sur ton sein ces larmes d’une infortunée !… Sou
.tiens-moi dans ce seul instant, et puis abandonne-moi pour
toujours1…. Ce n’est pas ta femme…. Ne me repousse pas !…
FERNAND.
Dieu !… Cécile, tes larmes sur mes joues…. ton cœur palpitant sur le mien !… Épargne-moi ! épargne-moi !…
CÉCILE.
Je ne veux rien, Pernand !… rien que ce moment !… Accorde à mon cœur cet épanchement : il sera soulagé, fortifié ! Tu seras délivré de moi….
\ FERNAND.
Que je meure avant que je t’abandonne !
CÉCILE.
Je te reverrai, mais non sur cette terre ! Tu appartiens à une autre, à qui je ne peux te ravir…. Ouvre, ouvre-moi le ciel ! Un regard dans cet heureux lointain, dans ce séjour éternel…. C’est la seule, oui, la seule consolation dans ce terrible moment.
Fernand. Il lui prend la main, la regarde et l’embrasse.
Rien, rien dans le monde ne doit me séparer de toi. Je t’ai retrouvée.
CÉCILE.
Tu as retrouvé ce que tu ne cherchais pas.
FERNAND.
Laisse ! laisse !… Oui, je t’ai cherchée ; toi, ma délaissée, ma bien-aimée ! Même dans les bras de cet ange, je ne trouvais aucun repos, aucune joie. Tout me faisait souvenir de toi, de 1a lille, de ma Lucie. Bon Dieu, que de joie ! Cette aimable personne serait-elle ma fille ?— Je t’ai cherchée partout. J’ai couru trois ans. Dans le lieu de notre séjour, je trouvai, hélas ! notre habitation changée, dans des mains étrangères, et la douloureuse histoire de la perte de ta fortune. Ta. disparition me déchira le cœur ; je ne pus trouver aucune trace de toi, et, las de moi-même et de la vie, je pris cet habit, j’entrai dans un service étranger ; j’aidai à opprimer la liberté mourante des braves Corses ; et maintenant, après de longues et surprenantes aventures, tu me revois ici sur ton sein, ma très-chère, mon excellente femme. (Lucie accourt.)
FERNAND.
’ 0 ma fille !
LUCIE.
Mon cher père, mon bon père, si vous êtes encore mon père !
FERNAND.
Encore et pour toujours.
CÉCILE.
Et Stella ?
FERNAND.
Ne perdons pas un moment. L’infortunée ! Pourquoi’, Lucie, pourquoi, ce matin, n’avonsnous pu nous reconnaître ?… Le cœur me battait ; tu sais avec quelle émotion je t’ai quittée. Pourquoi ? Pourquoi ? Nous nous serions épargné tout cela ! Stella ! Nous lui aurions épargné ces douleurs !… Mais partons. Je lui dirai que vous avez persisté à vous éloigner, que vous n’avez pas voulu l’importuner de vos adieux, Et toi, Lucie, retourne vite à la poste, et fais atteler une chaise pour trois. Le domestique joindra mes effets aux vôtres. Reste encore ici, chère femme. Et toi, ma fille, quand tout sera prêt, reviens ; et retirez-vous dans le salon du jardin. Attendez-moi. Je veux me dégager d’elle, lui dire que mon dessein est de vous accompagner jusqu’à la poste, de veiller à votre départ, et de payer pour vous les chevaux…. Pauvre âme, je te trompe avec ta bonté !… Partons !
CÉCILE.
Partir ?… Un seul mot de raison !
FERNAND.
Partons ! Il le faut…. Oui, mes chères amies, nous partons…. (Cécile et Lucie sortent.) Partir !… où fuir ? où fuir ?… Un coup de poignard mettrait fin à toutes ces douleurs, et me plongerait dans la froide insensibilité, pour laquelle je donnerais tout maintenant…. Es-tu là, malheureux ? Rappelle-toi ces jours de parfait bonheur où, dans ta sévère modération, tu blâmais l’infortuné qui voulait rejeter le fardeau de la vie ; ce que tu éprouvais dans ces jours heureux, et maintenant !… Oui, les heureux ! les heureux !… Un moment plus tôt cette découverte, et j’étais sauvé ! Je ne l’aurais jamais revue ; elle ne m’aurait pas revu. J’aurais pu me bercer et me dire : « Pendant ces quatre ans elle t’a oublié ; elle s’est consolée de ses-peines. » Mais à présent ? Comment dois-je paraître devant elle ? que lui dire ?… Oh ! ma faute, ma faute m’accable en ces instants…. Abandonner ces deux personnes chéries !… Et moi, dans le moment où je les retrouve, abandonné de moi-même…. désespéré !… 0 mon cœur !
[ocr errors]
ACTE QUATRIEME.
.Le jardin de Stella.
STELLA, seule. Elle.se promène dans un lieu solitaire.
Tu fleuris toujours belle, plus belle que jamais, place chérie, place du repos espéré, du repos éternel !… Mais tu ne m’attires plus…. je frissonne devant toi…. Terre froide et fragile, je frissonne devant toi !… Ah ! combien de fois, dans les heures de la rêverie, j’enveloppai déjà ma tête et mon sein du voile de la mort, et m’arrêtai tranquille devant ta profondeur, et descendis chez toi, et cachai mon cœur désolé sous ta voûte vivante ! Alors, ô pourriture, tu devais, comme un enfant chéri, épuiser ce sein trop rempli, oppressé, et résoudre tout mon être en un songe propice !… Et maintenant…. soleil des deux, tu luis dans cet asile !… Que de lumière, que d’espace autour de moi !… Et je m’en réjouis…. Il est de retour…. et, en un clin d’œil, autour de moi, la création sourit…. en moi tout est vie…. Et je veux puiser sur ses lèvres une vie nouvelle, plus chaude, plus brûlante. Pour lui…. près de lui…. avec lui, demeurer dans une ardeur constante…. Fernand !… Il vient !… Écoute !… Non, pas encore !… Je veux qu’il me trouve ici, ici, auprès de mon autel de roses.,. sous mes rosiers. Je cueillerai pour lui ces boutons…. Ici ! ici !… Et puis je le conduirai dans ce berceau. Ge fut bien à propos qu’en le faisant si étroit, je le disposai pour deux…. Là était auparavant mon livre, mon écritoire…. Livre, écritoire, adieu !… S’il venait seulement ! Sitôt abandonnée !… L’ai-je donc retrouvé ? Est-il bien là ?… (Arrive Fernand.)
STELLA.
Où t’arrêtes-tu, mon bien-aimé ? Où es-tu ? Je suis seule, seule depuis longtemps ! (Avec anxiété.) Qu’as-tu donc. ?
FERNAND.
Ces femmes m’ont troublé.».. La mère est une digne femme, mais elle ne veut pas rester ; elle ne veut donner aucune raison ; elle veut partir. Laisse-la faire, Stella.
STELLA.
Si l’on ne peut la persuader, je ne la veux pas contre sa volonté…. Et puis, Fernand, j’avais besoin de compagnie…. et à présent, (elle l’embrasse) à présent, je te possède !
: FERNAND.
Calme-toi.
STELLA.
Laissemoi pleurer. Je voudrais que le jour fût passé. Je tremble encore de tous mes membres…. La joie…. tout, soudainement, à la fois ! Toi, Fernand ! Et à peine, à peine !… A tout cela, je succomberai.
Fernand, à part.
Malheureux que je suis ! L’abandonner ! (Haut.) Epargne-moi, Stella.
STELLA.
C’est ta voix, ta voix caressante ! Stella ! Stella !… Tu sais comme j’aimais à t’entendre prononcer ce nom…. Stella ! Nul ne le prononce comme toi. Toute la chaleur de l’amour est dans cet accent…. Qu’il est encore vivant chez moi le souvenir du jour où je t’entendis le prononcer pour la première fois, où tout mon bonheur commença en toi !
FERNAND.
Ton bonheur !