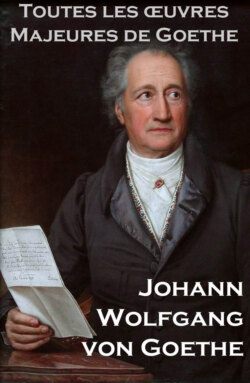Читать книгу Toutes les Oeuvres Majeures de Goethe - Johann Wolfgang von Goethe - Страница 14
TRAGEDIE
ОглавлениеACTE PREMIER.
Intérieur d’une maison de poste. — On entend un postillon sonner du cor.”
LA MAITRESSE DE POSTE. Charles ! Charles !
Charles, accourant. Qu’y a-t-il ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Où diable te tiens-tu ? Va donc ! La diligence arrive. Fais entrerles voyageurs ; porte leurs paquets ; remue-toi ! Fais-tu encore la mine ? (Charles sort it la Maîtresse de poste crie après lui.) Attends ! Je te ferai passer cette paresse. Un garçon d’auberge doit être toujours éveillé, toujours alerte. Lorsque ensuite un drôle comme cela devient maître, il se gâte. Si je pensais à me remarier, ce serait uniquement pour cela. Il est beaucoup trop difficile à une femme seule de bien gouverner son monde. (Entrent Mme Sommer et Lucie, en habits de voyage et suivies de Charles.)
1. Gœthe a écrit cette pièce en prose.
Lucie, à Charles. Elle porte elle-même une valise. Laissez cela, ce n’est pas lourd ; mais prenez la boîte de ma mère.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Votre servante, mesdames ! Vous arrivez de bonne heure. La diligence n’arrive jamais sitôt.
LUCIE.
Nous avons eu un jeune, joyeux et joli postillon, avec’lequel je voudrais, courir le monde ; et puis nous ne sommes que deux et peu chargées.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Si vous désirez vous mettre à table, soyez assez bonnes pour attendre : le dîner n’est pas encore prêt.
MADAME SOMMER.
Puis-je seulement vous demander un peu de soupe ?
LUCIE.
Je ne suis point pressée. Veuillez d’abord Tous occuper de ma mère.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Tout de suite.
LUCIE.
Mais de très-bon bouillon,
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Aussi bon que je pourrai. (Elle sort.) .
MADAME SOMMER.
Ne pourras-tu quitter ce ton de commandement ? Tu aurais déjà pu, il me semble, devenir sage en route. Nous avons toujours plus payé que consommé, et, dans notre situation….
LUCIE.
Nous n’avons jamais été dans le besoin.
MADAME SOMMER.
Mais nous en avons été bien près. (Entre le postillon.)
LUCIE.
Eh bien, brave postillon, qu’y a-t-il ?… N’est-ce pas, ton pourboire ?…
LE POSTILLON.
Ne suis-je pas allé comme l’extra-poste ?
LUCIE.
Cela veut dire, n’est-ce pas, que tu as aussi mérité quelque
chose d’extra ? Tu serais mon cocher, si seulement j’avais des chevaux.
LE POSTILLON.
Même sans chevaux, je suis à votre service.
Lucie, lui donnant un pourboire. Tiens !
LE POSTILLON.
Merci, mademoiselle ! Vous n’allez pas plus loin ?
LUCIE.
Nous restons ici pour cette fois.
LE POSTILLON.
Adieu, mesdames ! (Ilsort.)
MADAME SOMMER.
Je vois à son air que tu lui as trop donné.
LUCIE.
Fallait-il qu’il nous quittât en murmurant ? Il a été, tout le temps, si gentil ! Vous dites toujours, maman, que je suis capricieuse : du moins je ne suis pas avaricieuse.
MADAME SOMMER.
Je t’en prie, Lucie, ne comprends pas mal ce que je te dis. J’estime ta franchise, comme ton bon caractère et ta libéralité ; mais ce ne sont des vertus que lorsqu’elles sont à leur place.
LUCIE.
Maman, ce petit endroit me plaît véritablement. Et la maison de vis-k-vis est sans doute celle de la dame à qui je dois tenir désormais compagnie.
MADAME SOMMER.
Je suis charmée que le lieu de ta destination te soit agréable.
LUCIE.
Il doit être tranquille, je le vois déjà. Cependant c’est comme un dimanche sur la grande place. Mais la dame a un beau jardin, et doit être bonne. Il faudra voir comment nous nous arrangerons. Que regardez-vous de tous côtés, mamna.’
MADAME SOMMER.
Laissemoi, Lucie ! Heureuse enfant, à qui rien ne retrace des souvenirs !… Hélas ! en ce temps-là c’était autrement ! Rien ne m’est plus douloureux que d’entrer dans une maison de poste.
LUCIE.
Mais aussi, où ne trouveriez-vous pas matière à vous tourmenter ?
MADAME SOMMER.
Et où n’en trouvé-je pas sujet ? Ma chère-, comme c’était différent, lorsque ton père voyageait encore avec moi ; lorsque nous jouissions en liberté du plus beau temps de notre vie, les premières années de notre mariage ! Alors tout avait pour moi le charme de la nouveauté. Et, dans ses bras, passer devant mille et mille objets, quand chaque bagatelle me devenait intéressante, par son esprit, par son amour….
LUCIE.
J’aime aussi à voyager.
MADAME SOMMER.
Et lorsqu’après un jour brûlant, après les fatigues du voyage, les mauvais chemins en hiver, nous rencontrions quelque auberge, encore plus mauvaise que celle-ci, et que nous goûtions ensemble le plus simple bien-être ; que nous nous asseyions tous deux sur le banc de bois ; que nous mangions ensemble notre omelette et nos pommes de terre bouillies…. alors c’était autrement !
LUCIE,
Il est temps enfin de l’oublier.
MADAME SOMMER.
Sais-tu ce que cela veut dire, oublier ? Bonne fille, tu n’as encore, Dieu merci ! rien perdu qui ne se pût remplacer. Depuis le moment où je fus certaine qu’il m’avait abandonnée, toutes les joies de ma vie s’évanouirent. Un désespoir me saisit. Je ne me retrouvais plus moi-même ; je ne trouvais plus mon Dieu. Je puis à peine me souvenir de cette situation.
LUCIE.
Et moi je ne me rappelle rien de plus, sinon que j’étais assise sur votre lit, et que je pleurais parce que vous pleuriez. C’était dans la chambre verte, sur le petit lit. Cette chambre est ce que j’ai le plus regretté, quand nous dûmes vendre la maison.
MADAME SOMMER.
Tu n’avais que sept ans, et ne pouvais sentir ce que tu perdais. (Entrent la Maîtresse de poste et Charles ; Annetle apporte la soupe.)
ÀNNETTE. .
Voici le potage pour madame.
MADAME SOMMEH. ’
Merci, ma chère ! (A la.Maîtresse de poste.) Est-ce votre fille ?
LA MAÎTRESSE D’E POSTE.
C’est ma belle-fille, madame. Mais elle est si gentille, qu’elle me tient lieu d’enfant.,,
. - MADAME SOMMER.
Vous êtes en deuil ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
De mon mari, que j’ai perdu il y a trois mois. Nous avons à peine vécu trois années ensemble.
MADAME SOMMER.
Vous paraissez cependant assez consolée. ’
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Ah ! madame, nous autres, nous avons aussi peu le temps de pleurer, hélas ! que de prier. Cela va jours et dimanches. A moins qu’il n’arrive que le pasteur touche à ce texte ou qu’on n’entende un chant de. mort…. Charles, deux serviettes ! mets donc enfin■ le couvert ici.
LUCIE.
A qui appartient la maison vis-à-vis ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
A madame la baronne. La plus aimable femme !…
MADAME SOMMER.
Je suis charmée d’entendre confirmer par une voisine ce qu’on nous a certifié fort loin d’ici. Ma fille va demeurer chez elle et lui tenir compagnie.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.,
Je vous en félicite, mademoiselle.
LUCIE.
Je souhaite qu’elle puisse me plaire. ’..’
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Il faudrait que vous eussiez un goût singulier, si la société de cette dame ne vous plaisait pas.
LUCIE.
Tant mieux ! Puisque enfin je dois me plier aux volontés de quelqu’un, il faut que ce soit de bon cœur ; autrement, cela ne va pas.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Bon ! bon ! nous reviendrons bientôt là-dessus, et vous me direz si j’ai parlé vrai. C’est être heureux que de vivre auprès de notre baronne. Quand ma fille sera un peu plus grande, elle servira chez elle, au moins quelques années : cela profitera à la petite pour toute sa vie.
ANNETTE.
Quand vous la verrez seulement !… Elle est si aimable ! Vous ne croiriez pas avec quelle impatience elle vous attend. Elle m’aime aussi beaucoup. Ne voulez-vous pas aller auprès d’elle ? Je vous conduirai.
LUCIE.
Il faut d’abord m’ajuster, et je veux aussi prendre quelque chose.
ANNETTE.
Je puis du moins y courir, petite maman ? J’irai dire à madame que mademoiselle est arrivée.
LA MAÎTRESSE LE POSTE.
Va.
MADAME SOMMER.
Et dis-lui, ma petite, qu’en sortant de table, nous irons lui présenter nos devoirs. (Annette sort.)
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Ma fille lui est extraordinairement attachée. Aussi est-elle la meilleure âme du monde, et les enfants sont toute sa joie. Elle se fait servir par des filles de paysans, jusqu’à ce qu’elles soient formées : alors elle leur cherche une bonne condition ; et c’est ainsi qu’elle passe le temps, depuis que son mari est absent. C’est inconcevable qu’elle puisse être si malheureuse et en même temps si aimable, si bonne.
MADAME SOMMER.
N’est-elle pas veuve ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Dieu le sait ! Son mari est absent depuis trois ans, et l’on n’entend et ne voit rien de lui. Et elle l’a aimé par-dessus tout. Mon mari n’en finissait pas, quand il commençait à parler d’eux. Et puis, je le dis moi-même, il n’y a plus au monde de cœur pareil à celui-là. Tous les ans, le jour où elle le vit pour la dernière fois, elle ne reçoit âme qui vive ; elle s’enferme, et d’ailleurs, quand elle parle de lui, cela vous perce le cœur.
MADAME SOMMER.
L’infortunée !
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
On dit bien des choses là-dessus.
: MADAME SOMMER.
Expliquez-vous !
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
On ne le dit pas volontiers.
MADAME SOMMER.
Je vous en prie.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Si vous promettez de ne pas me trahir, je puis vous le confier. Il y a plus de huit ans aujourd’hui qu’ils vinrent ici. Ils achetèrent le fief. Personne ne les connaissait. On les appelait monsieur et madame, et on le tenait pour un officier, qui s’était enrichi au service étranger, et qui voulait se retirer. Elle était alors dans la fleur de la jeunesse, âgée au plus de seize ans, et belle comme un ange.
LUCIE.
Elle n’aurait donc aujourd’hui pas plus de vingt-quatre ans ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Elle a, pour son âge, éprouvé assez de chagrins. Elle eut un enfant, qui lui mourut bientôt. Son tombeau est dans le jardin, un simple tombeau de gazon, et, depuis que monsieur est parti, elle a établi auprès une retraite solitaire, et a fait préparer son propre tombeau. Feu mon mari était vieux et difficile à émouvoir, mais il ne contait rien avec plus de plaisir que la félicité des deux époux, aussi longtemps qu’ils vécurent ici ensemble. On se sentait tout autre, disait-il, rien qu’à voir comme ils s’aimaient.
MADAME SOMMER.
Mon cœur se porte vers elle.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Mais vous savez comme les choses vont. On disait que monsieur avait de singuliers principes : du moins il n’allait pas à l’église ; et les gens qui n’ont point de religion, n’ont point de Dieu et n’observent aucune règle. Tout à coup on apprend que monsieur est parti. Il était allé en voyage, et dès lors il n’est pas revenu. .
MADAME SOMMER, à part.
Toute l’image de mon sort !
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
On ne parlait que de cela. C’était justement quand je vins ici, nouvelle mariée. Il y aura trois ans à la Saint-Michel. Et chacun savait quelque chose de particulier ; on se disait même à l’oreille qu’ils n’avaient jamais été mariés.. ?. Mais ne me trahissez pas. Il doit être un homme de distinction ; il doit l’avoir séduite,, et tout ce qu’on dit. Oui, quand une jeune fille fait un pareil pas, elle a de quoi pleurer toute sa vie.
ANNETTE, aCCOUrant.
Madame vous fait prier instamment de vous rendre tout de suite chez elle ; elle ne veut-que vous parler un moment, que vous voir.
LUCIE.
Je ne puis me présenter ainsi vêtue.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Allez toujours ! Je vous donne ma parole qu’elle n’y prendra pas garde.
LUCIE.
Voulez-vous m’accompagner, ma petite ?
ANNETTE.
De bon cœur.
MADAME SOMMER.
Lucie, un mot ! (La Maîtresse de poste s’éloigne.) Ne va rien trahir, ni notre condition, ni notre sort ! Conduis-toi respectueusement.
Lucie, à voix basse.
Laissezmoi faire ! Mon père était un marchand ; il est allé en Amérique ; il est mort, et par là notre situation…. Laissezmoi faire : j’ai conté cette fable assez souvent. (Haut.) Ne voudriezvous pas vous reposer un peu ? Vous en avez besoin. Madame l’hôtesse voudra bien vous donner une petite chambre et un lit.
-LA MAÎTRESSE DE POSTE.
J’ai justement une jolie et tranquille chambrette sur le jardin. (A Lucie.) Je souhaite que Mme la baronne puisse vous plaire.
(Lucie et Annette sortent.)
MADAME SOMMER. ’
Ma fille est encore un tant soit peu vaine.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
C’est l’effet de la jeunesse. Ces bouffées d’orgueil s’apaiseront bientôt.
. MADAME SOMMER.
J’en serais fâchée. . «. ., !
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Venez, madame, s’il vous plaît. (Elles sortent. On entend un ’postillon. Entre Fernand, en habit d’officier, suivi d’un Domestique.)
. - LE DOMESTIQUE.
Dois-je faire atteler tout de suite et recharger vos effets ?
FERNAND.
Il faut les entrer ici, te dis-je, ici ! Nous n’allons pas plus loin, entends-tu ?
LE DOMESTIQUE.
Pas plus loin ? Vous disiez….
FERNAND.
Je te dis de retenir une chambre et d’apporter ici mes effets. (Le domestique sort. Fernand s’approche de la fenêtre.) Ainsi donc je te revois, céleste “séjour !… Je te revois, théâtre de ma félicité ! Comme toute la maison est tranquille ! Aucune fenêtre ouverte ! Comme elle est déserte, la galerie où nous venions si souvent nous asseoir ensemble ! Remarque, Fernand, l’aspect monastique de sa demeure ! Comme il flatte tes espérances ! Et, dans sa solitude, Fernand devait-il être sa pensée et son occupation ? L’a-t-il mérité ? Il me semble qu’après un long et lugubre sommeil de mort, je me réveille à la vie, tant chaque chose est pour moi.nouvelle et saisissante ! Les arbres, la fontaine, tout encore, tout ! L’eau s’élançait ainsi des mêmes canaux, lorsque, mille fois, hélas ! le cœur plein de pensées, je regardais avec elle de notre fenêtre, et que chacun, recueilli en soi-même, contemplait en silence le cours de l’eau ! Son murmure est pour moi une mélodie, une mélodie pleine de souvenirs. Et elle ? Elle sera comme elle était. Oui, Stella, tu n’as point changé : mon cœur me le dit. Comme il s’élance au-devant de toi ! Mais je ne veux pas, je n’ose pas ! Il faut d’abord me remettre, d’abord me persuader que je suis vraiment ici ; que je ne suis pas abusé par un de ces songes qui, si souvent, m’ont conduit ici, dormant ou éveillé, des pays les plus lointains. Stella ! Stella ! Je viens ! Ne sens-tu pas mon approche ? Je viens dans tes bras pour tout oublier.-… Et, si tu planes autour de moi, chère ombre de ma femme infortunée, pardonne-moi, laissemoi ! Tu n’es plus : laissemoi donc t’oublier, oublier tout dans les bras de cet ange, mes destinées, toutes mes pertes, mes douleurs et mon repentir…. Je suis si près et si loin d’elle ! Et, dans un moment…. Je ne puis ! Je ne puis !… Il faut me remettre, ou je suffoque à ses pieds.
LA MAÎTRESSE DE-POSTE.
Monsieur veut-il dîner ?
FERNAND.
Avez-vous un dîner prêt ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Oh ! oui. Nous attendons une demoiselle, qui est de l’autre côté, chez madame.
FERNAND.
Comment se porte votre dame ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
La connaissez-vous ?
FERNAND.
Autrefois j’allais de temps en temps chez elle. Que fait son mari ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Dieu le sait ! 11 court le monde.
FERNAND.
Loin ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Sans doute ! Il abandonne cette chère âme. Dieu veuille le lui pardonner !
FERNAND.
Elle saura bien se consoler.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Vous croyez ? Alors vous devez peu la connaître. Elle vit comme une religieuse, tout à fait retirée, depuis le temps que je la connais. Elle ne reçoit presque aucun étranger, aucune visite du voisinage. Elle vit avec ses gens, attire auprès d’elle tous les enfants du village, et, malgré sa douleur secrète, elle est toujours gracieuse, toujours agréable.
FERNAND.
Je veux pourtant aller la voir.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Faites-le. Elle nous invite quelquefois, la femme du bailli, la femme du ministre et moi. Elle s’entretient avec nous de mille choses. A la vérité, nous évitons de lui parler de monsieur. Cela n’est arrivé qu’une fois. Dieu sait ce que nous sentîmes, quand elle se mit à parler de lui, à le vanter, à pleurer. Monsieur, nous pleurâmes toutes comme des enfants, et nous ne pouvions presque nous remettre.
Fernand, à part.
Voilà ce que tu as mérité d’elle !.-.. (Haut.) A-t-on donné une chambre à mon domestique ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Au premier étage. Charles, fais voir la chambre à monsieur. (Fernand sort avec Charles. Entrent Lucie et /Innette.) Eh bien, comment la trouvez-vous ?
LUCIE.
Une aimable petite femme, dont je m’accommoderai fort bien. Vous n’en avez pas trop dit sur elle. Elle ne voulait pas me laisser partir. J’ai dû lui donner ma parole de revenir, aussitôt après dîner, avec ma mère et nos paquets.
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Je le pensais bien. Vous plaît-il maintenant de vous mettre à table ? Il est survenu un grand et bel officier…. Si vous n’en avez pas peur….
LUCIE.
Pas le moins du monde. J’aime mieux la société des soldats que celle des autres hommes. Du moins ils ne se déguisent pas, en sorte qu’on distingue, au premier abord, les bons des méchants. Ma mère dort-elle ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Je ne sais pas.
. LUCIE.
Il faut que je la voie. (Elle sort.)
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Charles, voilà encore la salière oubliée ! Cela s’appelle-t-il rincé ? Regarde un peu ces verres ! Je te les casserais sur la tête, si tu valais ce qu’ils coûtent. (Entre Fernancl.) La demoiselle est revenue. Elle va se mettre à table.
FERNAND.
Qui est-elle ?
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Je ne la connais pas. Elle paraît d’honnête condition, mais sans fortune. Elle sera dame de compagnie de la baronne.
FERNAND.
Est-elle jeune ? .
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Très-jeune et vive. Sa mère est aussi là-haut. (Entre Lucie.)
LUCIE.
Votre servante. …’..
FERNAND.
Je suis heureux de trouver à table une si charmante compagnie. (Lucie fait la révérence.)
LA MAÎTRESSE DE POSTE.
Ici, mademoiselle, et vous ici, monsieur, s’il vous plaît.
FERNAND.
Nous n’avons pas l’honneur de dîner avec vous, madame l’hôtesse ? -,
LA MAÎTRESSE. DE POSTE.
Si une fois je me repose, rien ne va. (Elle sort.)
FERNAND.
Ainsi un tête-à-tête !
LUCIE.
La table entre deux, comme je puis bien l’accepter.
FERNAND.
Vous avez résolu dé tenir compagnie à Mme la baronne ?
LUCIE. ’
Il le faut bien !
FERNAND.
Il me semble que vous ne pourriez manquer de trouver un compagnon, qui serait encore plus intéressant que Mme la baronne. .
LUCIE.
Je ne m’en soucie point.
’ FERNAND.
Parlez-vous sincèrement ?
LUCIE.
Monsieur, je vois que vous êtes comme tous les hommes.
FERNAND.
C’est-à-dire ?
LUCIE.
Très-présomptueux sur ce point. Vous autres messieurs, vous vous croyez indispensables ; et, je ne sais, je suis pourtant devenue grande sans votre secours.
FERNAND.
Vous n’avez plus de père ?
LUCIE.
Je me souviens à peine que j’en avais un. J’étais enfant, lorsqu’il nous quitta pour faire un voyage en Amérique ; et son vaisseau a péri, nous dit-on.
FERNAND.
Et vous y semblez bien indifférente ?
LUCIE.
Comment pourrais-je ne pas l’être ? Il m’a donné peu de marques d’affection, et, quoique je lui pardonne volontiers de nous avoir abandonnées (car est-il rien qui vaille mieux pour l’homme que sa liberté ?), cependant je ne voudrais pas être ma mère, qui se meurt de chagrin.
FERNAND.
Et vous êtes sans secours, sans protection ?
LUCIE.
Qu’importe ? Notre fortune :est devenue tous les jours plus petite, mais moi. je suis devenue tous les jours plus grande ; et je ne suis pas en peine pour nourrir ma mère.
FERNAND.
Votre courage m’étonne.
LUCIE. Oh ! monsieur, il vient de lui-même. Lorsqu’on craint si souvent de périr, et qu’on se voit toujours sauvé, cela donne une confiance !…
FERNAND.
Vous ne pouvez en donner une part à votre bonne mère ?
. LUCIE.
Malheureusement c’est elle qui perd, et non pas moi. Je rends grâce .à mon père de m’avoir mise au monde, car j’aime la vie et je suis contente : mais elle, qui avait fait reposer sur lui toute l’espérance de sa vie, qui lui avait sacrifié la fleur de son âge, et maintenant abandonnée, tout à coup abandonnée !… Ce doit être quelque chose d’horrible de se sentir abandonnée ! Je n’ai rien perdu encore : je ne puis en parler…. Vous semblez rêveur !
FERNAND.
Oui, ma chère demoiselle, à vivre on perd…. (//se lève.) mais on gagne aussi. Et Dieu soutienne votre courage ! (Il lui prend la main.) Vous m’avez étonné. O mon enfant, qu’il serait heureux !… Moi aussi, j’ai vu dans le monde, bien cruellement, bien souvent, mes espérances…. mes joies…. Mais c’est toujours…. Et….
LUCIE.
Que voulez-vous dire ?
FERNAND.
Toute sorte de biens !… les meilleurs, les plus ardents souhaits pour votre bonheur ! (Il sort.)
LUCIE.
Voilà un homme singulier ; mais il semble être bon.
[ocr errors]
ACTE DEUXIEME.
Maison de Stella. STELLA, UN DOMESTIQUE.
STELLA.
Va, va bien vite ! Dis-lui que je l’attends.
LE DOMESTIQUE.
Elle a promis de venir tout de suite.
STELLA.
Tu vois pourtant qu’elle ne vient pas. J’aime beaucoup cette jeune fille. Va !… Et que sa mère vienne avec elle ! (Le Domestique sort.) J’ai à peine la ! patience de l’attendre. Que de désirs, que d’espérances, en attendant un nouvel habit ! Stella ! Tu es un enfant. Et pourquoi ne devrais-je pas aimer ?… Il me faut beaucoup pour remplir mon cœur ! Deaucoup ? Pauvre Stella ! Beaucoup ?… Autrefois, lorsqu’il t’aimait encore, lorsqu’il reposait sur ton sein, son regard remplissait toute ton âme ; et…. O Dieu du ciel, ton décret est impénétrable ! Lorsque, de ses embrassements, je levais les yeux vers toi ; que mon cœur brûlait sur le sien, et que, de ma bouche tremblante, je respirais sa grande âme ; qu’ensuite, avec des larmes de joie, je regardais à toi, et te disais du fond de mon cœur : « Laisse-nous être heureux, mon Père, tu nous as rendus si heureux ! » ce n’était pas ta volonté. (Elle tombe un moment dans la rêverie, tressaille vivement et presse ses mains sur son cœur.) Non, Fernand, non : ce n’était pas un reproche ! (Entrent Mme Sommer et Lucie.)
STELLA.
Je les possède ! Aimable enfant, tu es à moi maintenant…. Madame, je vous remercie de la confiance avec laquelle vous remettez dans mes mains ce trésor. Petit esprit mutin, âme libre et bonne ! Oh ! je t’ai déjà comprise, Lucie.
GŒTHE. — TH. I . 29
MADAME SOMMER.
Vous sentez, madame, ce que je vous présente et vous abandonne.
STELLA, après vne pause, pendant laquelle elle a observé Mme Sommer. Pardonnez-moi ! On m’a conté votre histoire ; je sais que j’ai devant moi des personnes de bonne famille, mais votre présence m’étonne : je sens pour vous, au premier coup d’œil, confiance et respect.
MADAME SOMMER.
Madame….
STELLA.
N’en parlons pas. Ce que mon cœur avoue, ma bouche le déclare volontiers. J’apprends que vous n’êtes pas bien : qu’avez-vous donc ? Asseyez-vous,
MADAME SOMMER.
Laissez, madame ! Ce voyage, dans lés jouVs du printemps, ces objets changeants et cet air pur et vivifiant, qui déjà si souvent s’est pénétré pour moi d’une fraîcheur nouvelle, tout a si bien, si doucement agi sur moi, que lé souvenir même des joies évanouies devenait pour moi un sentiment agréable, et que je voyais poindre dans mon âme un reflet des beaux temps de la jeunesse et de l’amour.
STELLA.
Oui, le temps, le premier temps de l’amour !… Non, tu n’es pas retourné au ciel, âge d’or ! Tu environnes encore tous les cœurs, dans les moments où s’épanouit la fleur de l’amour. Madame Sommer, lui prenant les mains., .
Quelle noblesse ! quel charme !
STELLA.
Votre visage brille comme le visage d’un ange. Vos joues se colorent !
MADAME Sommer.
Et mon cœur !… Ah ! comme il s’élève, comme il se dilate devant vous !
STELLA.
Vous avez aimé ! Ah ! j’en rends grâce à Dieu ! Une âme qui me comprend, qui peut avoir pitié de moi, qui n’observera pas froidement mes douleurs !… Nous n’en pouvons davantage, si nQUs sommes, ainsi…. Que n’ai-je pas fait’ ? Que n’ai-je pas essayé ?… Et de quoi cela m’a-t-il servi ? C’était là ce que je voulais…. cela uniquement, et non pas un-monde, et rien d’autre au monde…. Ah ! le bien-aimé est partout, et tout est pour le bien-aimé !
MADAME SOMMER.
Vous portez le ciel dans le cœur. ’. .
STELLA.
Avant même que je fusse sur mes gardes, son image revenait…. Voilà comme il se levait dans telle ou telle société, et me cherchait des yeux…. Voilà comme il accourait à travers la campagne, et se jetait dans mes’bras, à la porte du jardin…. Je le voyais s’éloigner, s’éloigner…. hélas ! et il revenait…. Si je retourne, par la pensée, dans le tumulte du monde…. il est là ! Lorsque j’étais assise dans une loge, et que je savais, où qu’il fût caché, soit que je le visse ou ne le visse pas, qu’il observait et qu’il aimait chacun de mes mouvements, ma manière d’être debout, d’être assise…. je sentais quele balancement des plumes de ma coiffure l’attirait plus que tous les brillants regards d’alentour, et que toute musique n’était qu’un accompagnement pour l’éternelle mélodie de son cœur, «Stella ! Stella ! combien tu m’es chère ! »
LUCIE.
Peut-on s’aimer ainsi ?
STELLA. .
Tu le demandes, ma petite ?… Alors je ne puis te répondre…. Mais de quoi vais-je vous entretenir ?… Bagatelles !… importantes bagatelles !… En vérité, on est encore, un grand enfant, et l’on s’en trouve bien…. Précisément comme les enfants se cachent derrière leur petit tablier, et crient qu’on les cherche !… Comme tout notre cœur est rempli, lorsque étant offensés, nous prenons en nous-mêmes la ferme résolution de quitter l’objet de notre amour ! Avec quel déchirement des forces de l’âme nous reparaissons en sa présence ! Quels combats dans notre sein ! Et comme enfin tout s’évanouit, au premier regard, au premier serrement de main !
. MADAME SOMMER.
Que vous êtes heureuse ! Vous vivez encore tout entière dans le sentiment le plus tendre et le plus pur du cœur humain.
STELLA.
Un siècle de douleurs et de larmes ne saurait contrebalancer la félicité des premiers regards, du tremblement, du bégayeraient, de l’approche, de l’hésitation, de l’oubli de soi-même ; le premier baiser, rapide, enflammé, et le premier embrasseraient calme et paisible…. Madame !… Vous tombez dans la rêverie, ma chère ! Où êtesvous ?
MADAME SOMMER.
Les hommes ! les hommes ! .
STELLA.
Ils nous rendent heureuses et misérables. Ils versent dans notre cœur des pressentiments de félicité. Quelles sensations, quelles espérances nouvelles, inconnues, dilatent notre âme, quand leur passion impétueuse se communique à chacune de nos fibres ! Que j’ai senti souvent tout frissonner et retentir en moi, lorsqu’il versait dans mon sein, avec des torrents de larmes, les souffrances d’un monde ! Je le suppliais, au nom du ciel, de s’épargner, de m’épargner…. Vaine prière !… Il allumait en moi, jusqu’à la dernière moelle, les feux qui le dévoraient. Et c’est ainsi que, dans le fond de son être, la jeune fille devint tout cœur, tout sentiment. Et maintenant où est le climat qui puisse recueillir cette infortunée, pour y respirer, pour y trouver son aliment ?
MADAME SOMMER.
Nous croyons les hommes ! Dans les moments de la passion, ils se trompent eux-mêmes ; pourquoi ne serions-nous pas trompées ?
Stella ;
Madame ! Une idée me saisit…. Soyons l’une pour l’autre ce qu’ils auraient dû être pour nous. Restons ensemble…. Votre main !… Dès ce moment je ne vous quitte plus.
LUCIE.
Cela ne peut être.
STELLA.
Pourquoi, Lucie ?
MADAME SOMMER.
Ma fille sent….
STELLA.
Ce n’est pas un bienfait que je vous offre ! Sentez plutôt quel bienfait pour moi, si vous restez ! Oh ! je ne puis vivre seule. Ma chère, j’ai tout fait ; je me suis donné des oiseaux et des chevreuils et des chiens, j’apprends aux petites filles à tricoter et à faire de la dentelle, uniquement pour n’être pas seule, pour voir hors de moi quelque chose qui vive et qui croisse. Et pourtant, lorsque cela me réussit ; lorsque, par une belle matinée de printemps, une divinité bienfaisante semble avoir chassé la douleur de mon âme ; lorsque je m’éveille tranquille, que le doux soleil brille sur mes arbres fleuris, et que je me sens active, animée pour les affaires du jour : alors j’éprouve du bien-être ; alors je vais et je viens quelque temps, j’arrange et j’ordonne, et je dirige mes gens, et, dans la liberté de mon. cœur, je remercie à haute voix le ciel de ces heureux moments.
MADAME SOMMER.
Ah ! oui, madame, je le sens ! L’activité et la bienfaisance sont un don du ciel, une compensation pour les cœurs malheureux par l’amour.
STELLA.
Une compensation ? Dites un dédommagement, mais non une compensation. C’est quelque chose à la place de ce qu’on a perdu ; ce n’est pas la chose perdue elle-même…. L’amour perdu !… où donc en trouver la compensation ?… Oh ! si quelquefois je me plonge de pensée en pensée, si je me représente les doux songes du passé ; si je rêve un avenir plein d’espérance, et si je parcours ainsi mon jardin, à la clarté de la lune : alors je me sens tout à coup saisie, saisie par cette pensée, que je suis seule ; j’étends en vain les bras vers les quatre vents ; je prononce en vain l’enchantement de l’amour avec une force, une effusion telle qu’il me semble que je devrais attirer la lune en terre…” et je suis seule ; aucune voix ne me répond du bocage, et les étoiles versent de là-haut sur ma souffrance leur douce et froide clarté ! Et puis tout à coup le tombeau de mon enfant à mes pieds !…
MADAME SOMMER.
Vous aviez un enfant ?
STELLA.
Oui, ma chère ! O Dieu ! tu ne m’avais non plus donné à goûter ce bonheur qu’afin de me préparer un calice plus amer pour toute ma vie…. Si, ù la promenade, un enfant de paysan accourt au-devant de moi, les pieds nus, et, avec ses grands yeux innocents, me jette un baiser, cela me perce jusqu’à la moelle des os ! Je me dis : « Mina serait aussi grande !» Je le prends dans mes bras avec une douloureuse tendresse, je le baise cent fois, mon cœur est déchiré, les larmes jaillissent de mes yeux, et je m’enfuis !
LUCIE.
Cependant vous avez aussi beaucoup moins de peine. Stella. Elle sourit et lui frappe doucement sur l’épaule.
Comment puis-je seulement sentir encore ?… Comment ces horribles instants ne m’ont-ils pas tuée ?… Il était couché devant moi, séparé de sa tige, ce bouton de fleur !… et j’étais là, pétrifiée jusqu’au fond du cœur…. sans douleur…. sans me connaître…. j’étais là !… Alors la garde prit l’enfant, le pressa contre son cœur, et s’écria soudain : « Elle vit !… » Je me jette à son cou ; baignée de larmes, je me jette sur l’enfant…. aux pieds de la garde…. Hélas ! elle s’était trompée ! L’enfant était là sans vie, et moi à côté d’elle, dans un furieux, un horrible désespoir. (Elle se laisse tomber sur un siège.)
Madame Sommer. ’ Détournez vos pensées de ces tristes scènes.
STELLA.
Non ! Cela me fait du bien, beaucoup de bien, que mon cœur se puisse rouvrir, que ma bouche puisse exhaler tout ce qui m’oppresse !… Oui, quand je commence une fois à parler de lui, qui était tout pour moi !… qui…. 11 faut que vous voyiez son portrait ! son portrait !… Oh ! il me semble toujours que la figure de l’homme est le texte de tout ce qu’on peut sentir et dire sur lui.
LUCIE.
Je suis curieuse….
Stella. Elle ouvre son cabinet et les fait entrer. Ici, mes chères amies, ici !
MADAME SOMMER.
Dieu !
STELLA.
Le voilà…. le voilà ! Et pourtant ce n’est pas la millième partie de ce qu’il était. Ce front, ces yeux noirs, ces boucles brunes, ce sérieux…. Mais hélas ! il n’a pu exprimer cet amour, cette grâce, quand son âme s’épanchait !… O mon cœur, toi seul peux le sentir !
LUCIE.
Madame, je suis étonnée…. ’ .
STELLA… j ’ .
C’est là un homme !
LUCIE.,
Je dois vous dire que j’ai dîné aujourd’hui à la poste avec un oflicier qui ressemblait à ce monsieur…. Oh ! c’est lui-même ! Je gagerais ma vie….
STELLA.
Aujourd’hui ! Tu te trompes, tu me trompes !
… LUCIE.
Aujourd’hui. Seulement, il était plus âgé, plus brun, brûlé par le soleil. C’est lui ! c’est lui !
Stella. Elle sonne. . Lucie, mon cœur se brise ! J’y veux aller !
LUCIE.
Ce n’est pas convenable.
STELLA.
Convenable ? Oh mon cœur !,.. (Entre un Domestique.) Wilhelm, courez à la poste ! courez ! Un officier s’y trouve, qui doit…. qui est…. Lucie, dis-lui donc… Il faut qu’il vienne ici. Lucie, au Domestique.
Connaissez-vous monsieur ?
LE DOMESTIQUE.
Comme moi-même.
LUCIE.
Allez donc à la poste. Il s’y trouve un officier qui lui ressemble extraordinairement. Allez voir si je me trompe. Je jure que c’est lui.
STELLA.
Dis-lui de venir ! de venir vite, vite ! Que ne suis-je au bout !… L’aurais-je dans ce…. dans…. Tu te trompes ! c’est impossible…. Laissezmoi, mes chères amies, laissez moi seule….
(Elle ferme le cabinet sur elle.)
LUCIE.
Qu’ avez-vous, ma mère ? Comme vous êtes pâle !
MADAME SOMMER.
C’est le dernier jour de ma vie ! Mon cœur ne peut supporter cette épreuve ! Tout, tout à la fois !
LUCIE.
Grand Dieu !
MADAME SOMMER.
L’époux…. l’image…. celui qu’elle attend…. qu’elle aime…. c’est mon époux ! c’est ton père !
LUCIE.
Mère ! bonne mère !
MADAME SOMMER.
Et il est ici !… 11 se jettera dans ses bras, dans quelques instants !… Et nous ?… Lucie, il faut partir.
LUCIE.
J’irai où vous voudrez.
MADAME SOMMER.
Sur-le-champ.
LUCIE.
Venez dans le jardin. J’irai à la poste. Si seulement la voiture n’est pas encore partie, nous pouvons, sans congé, sans bruit…. pendant qu’enivrée de bonheur….
MADAME SOMMER.
Que, dans toute la joie du revoir, elle l’embrasse…. lui ! Et moi, dans le moment où je le retrouve…. pour jamais ! pour jamais ! (Entrent Fernand et le Domestique.)
LE DOMESTIQUE.
Ici ! Ne connaissez-vous plus son cabinet ? Elle est hors d’ellemême. Ah ! quel bonheur que vous soyez revenu !
(Fernand passe, en jetant les yeux sur Mme Sommer.)
MADAME SOMMER, à part.
C’est lui ! c’est lui ! je suis perdue !
[ocr errors]
ACTE TROISIEME.
STELLA, au comble de la joie, s’avance avec FERNAND.
Stella, s adressant aux murs. Il est de retour ! Le voyez-vous ? Il est de retour ! (S’approchant d’un tableau qui représente Vénus.) Le vois-tu, déesse ? Il est de retour ! Que de fois, hors de moi-même, j’ai promené ici mes pas égarés, et j’ai pleuré et gémi devant toi ! Il est de retour ! Je n’en crois pas mes sens. Déesse, je t’ai vue si souvent, et il n’était pas là !… Maintenant tu es là, et il est là !… Mon bien-aimé ! mon bien-aimé ! Tu fus absent longtemps !… Mais tu es là !… (Elle se jette à son cou.) Tu es là : je ne veux rien sentir, rien entendre, rien savoir, sinon que tu es là.
FERNAND.
Stella ! ma Stella ! (Il l’embrasse.) Dieu du ciel, tu me rends mes larmes !
STELLA.
O toi, l’unique….
FERNAND.
Stella ! Laissemoi encore boire ta douce haleine, ton haleine, auprès de laquelle tout l’air du ciel était pour moi vide et stérile.
STELLA.
Mon ami !
FERNAND.
Souffle dans monseindesséché, tourmenté, déchiré, un nouvel amour, une nouvelle ardeur de vie, de l’abondance de ton cœur…. (Il s’attache à ses lèvres.)