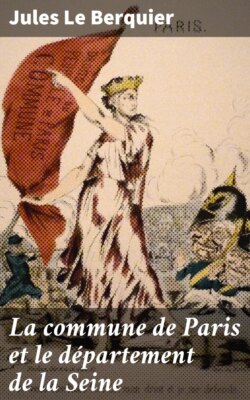Читать книгу La commune de Paris et le département de la Seine - Jules Le Berquier - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II.
ОглавлениеTable des matières
Examinons maintenant l’organisation de la commune de Paris:
On connaît le caractère distinctif de nos institutions municipales: elles reposent sur ce droit en vertu duquel les habitants d’une cité ou d’une bourgade délèguent à un petit nombre d’entre eux le soin des intérêts communs auxquels les devoirs de la famille les empêchent de s’appliquer eux-mêmes; droit primitif et naturel dont le germe, vigoureusement implanté dans les cités gauloises, dans les municipes romains, s’est perpétué jusqu’à nous à travers les temps d’oppression les plus déplorables de notre histoire; droit antérieur aux grandes constitutions sociales, que chaque commune a puisé dans son essence même et qui ne relève, par conséquent, d’aucune charte. Il est vrai qu’à une époque, des princes, des seigneurs ont eu la prétention d’octroyer ce droit; mais on est maintenant fixé sur le mérite de ces concessions: les puissantes institutions de la féodalité avaient comprimé sinon absorbé toutes les autres institutions vers le dixième siècle; le pouvoir municipal, subissant l’influence commune, avait sommeillé dans l’oppression ou était passé dans les mains qui renfermaient alors tous les autres pouvoirs. Quand vint la dernière heure du régime féodal, quand rappelées de leur sommeil léthargique, les cités voulurent secouer le joug sous lequel elles étaient courbées depuis des siècles, la plupart des seigneurs et des suzerains s’empressèrent de leur abandonner ce qu’ils ne pouvaient plus retenir; ils leur rendirent le droit de nommer leurs magistrats et de s’administrer. De leur côté, les rois allant au-devant d’une mesure qui devait plus promptement les débarrasser de la puissance féodale, en ce qu’elle tendait à ériger contre celle-ci la nouvelle force des cités rendues à la liberté, les rois accordèrent des chartes de communes aux villes et aux villages placés sous leur autorité exclusive et confirmèrent celles qui étaient passées avec les seigneurs dont les terres n’étaient pas encore réunies au domaine de la couronne. Mais, qu’on ne s’y trompe pas, ce ne fut point là un droit nouveau; ce droit était préexistant; on put le restituer ou le reconnaître à une époque où il avait été tant et si souvent méconnu; on ne pouvait le concéder, il ne l’a point été en dépit des termes de quelques chartes. Les communes qui, au douzième siècle, rentrèrent dans la plénitude de leurs droits descendaient, par une filiation incontestable, des municipalités romaines dont, à leur tour, elles nous ont transmis le principe, après bien des vicissitudes.
Les municipes étaient régis par un conseil ou sénat électif composé de décurions: c’était l’assemblée délibérante; par des magistrats choisis au sein de ce conseil et qui, sous le nom de duumvirs, de principaux, de curateurs, exerçaient l’autorité exécutive; enfin, par un défenseur de la cité, investi de la haute mission de protéger les intérêts de la communauté et ceux de tous ses membres. — Aujourd’hui dans nos communes, il existe un conseil municipal qui délibère; un maire et des adjoints qui exécutent. Il y a cinquante ans, un procureur de la commune remplissait encore, à peu de chose près, l’office de défenseur de la cité ; cette attribution spéciale a disparu dans l’institution actuelle.
La commune de Paris offre-t-elle le caractère général des autres communes? A-telle été organisée dès l’origine comme les cités gauloises, comme les municipes romains? Avait-elle ses magistrats électifs, ses biens, sa police, la liberté municipale, en un mot? La question n’a été sérieusement examinée qu’à l’époque où l’on a commencé à s’enquérir avec quelque sollicitude du droit municipal en France. Nos vieux auteurs n’en ont eu nul souci; tout ce qu’ils disent à cet égard atteste, d’ailleurs, la faible portée de leurs connaissances sur la nature de nos institutions municipales. Nicoles Gilles et Robert Gaguin, ayant pris les établissements communaux du douzième siècle pour des créations nouvelles dues à la munificence des princes et des seigneurs, attribuèrent naturellement à la générosité de Philippe-Auguste l’institution des magistrats municipaux de la commune de Paris: pour eux, il n’y avait rien au delà. Leur opinion fut bientôt accréditée; les auteurs qui vinrent après eux, tels que Gilles Corrozet, Jean du Tillet, François Belleforest, René Chopin et François du Chesne, l’acceptèrent sans défiance et la propagèrent en la fortifiant de leur propre assentiment. Cette opinion, déjà vieille de plusieurs siècles, fut combattue pour la première fois par Delamare; puis, vint Le Roi qui s’appliqua avec un soin tout particulier à rechercher l’origine de l’administration municipale de Paris et à définir son véritable caractère. Après avoir constaté qu’une célèbre corporation avait été considérée comme dépositaire de cette administration dans les édits de quelques-uns de nos rois et notamment de Philippe-Auguste, il remonta les âges et fut amené à conclure qu’elle avait dû en être investie dès les premiers temps qui suivirent la conquête de la Gaule; dès lors, qu’il fallait reconnaître dans les magistrats municipaux de Paris les anciens administrateurs des cités gallo-romaines.
Il est ici, en effet, une considération qui doit prédominer sur toutes les autres: nos institutions municipales présentent entre elles une homogénéité parfaite; elles procèdent du même principe; elles ont eu pour berceau la Gaule et les provinces romaines. A défaut de renseignements positifs sur sa première organisation, il semble donc qu’on soit forcé d’admettre que la cité de Paris n’a pas été autrement gouvernée, à l’origine, que le reste des cités gauloises. Il faudrait, pour donner quelque poids à l’assertion opposée, établir tout d’abord que la cité de Paris a dû être placée, à cet égard, dans une situation exceptionnelle, et jusqu’alors c’est ce qu’on n’a pu faire. Cette considération n’a pas échappé à Raynouard, qui a poussé si loin l’étude du droit municipal en France: «Quoiqu’il n’existe, a-t-il dit, ni monument ni titre qui prouve qu’un sénat municipal et les diverses magistratures accordées par les institutons romaines, existassent dans l’antique cité de Paris, on n’en doit pas moins regarder le fait comme certain, puisque rien ne permet de présumer le contraire. La cité de Paris pouvait-elle ne pas jouir des institutions romaines devenues le patrimoine politique de toutes les autres cités des Gaules?»
Par sa situation sur une rivière quia de nombreux affluents dans un rayon peu étendu, Paris offrait au commerce et à la navigation un riche entrepôt dont les avantages ne pouvaient manquer d’être mis à profit. Il faut croire que ces avantages fixèrent de bonne heure l’attention des Parisiens, car, sous le règne de Tibère, on voit une compagnie de négociants par eau qui, sous le titre de nautes parisiens, préside au commerce et semble déjà en possession des plus hautes prérogatives . Selon toute apparence, les membres de cette corporation étaient les habitants les plus considérables de la cité, ceux parmi lesquels pouvaient et devaient être choisis les magistrats municipaux. Dans une cité qui florissait surtout par la navigation, quels autres citoyens eussent mieux connu la gestion de ses plus chers intérêts! Aussi, faut-il croire que cette gestion n’a jamais été confiée qu’aux nautes parisiens, et ce qui doit le confirmer, c’est que plus tard on la retrouve entre les mains de la corporation qui a succédé à leurs traditions, à leurs droits et à leurs priviléges.
Dès les premiers temps de la monarchie, il y avait à Paris des magistrats qui réglaient l’administration de la ville et connaissaient, comme juges, des faits de commerce et principalement de commerce par eau. On ne les désigna d’abord que sous le nom de citoyens, de bourgeois; mais les titres que l’on donna, dans la suite, à la corporation de ces magistrats, à son chef, à l’édifice qui lui était destiné, démontrent clairement son origine, son double caractère, et ne laissent aucun doute sur l’intimité étroite qui la rattache à celle dont nous venons de parler.
Les membres de cette corporation étaient connus sous le nom de marchands de l’eau de Paris; ils avaient à leur tête un premier magistrat que l’on appelait le prévôt des marchands; auprès de lui étaient placés deséchevins et puis un procureur de la marchandise, qui devait être une image affaiblie de l’ancien défenseur de la cité. Le tribunal où siégeaient ces magistrats citoyens portait le nom de Parloir aux bourgeois, de Maison de la marchandise .
Sans doute, il serait assez difficile de donner une nomenclature exacte des attributions de ces marchands de l’eau, parce qu’elles n’ont été constatées doctrinalement à aucune époque; mais on peut dire qu’elles s’appliquaient, en définitive, à deux grands intérêts: aux intérêts du commerce de Paris et de la navigation fluviale; aux intérêts particuliers de la cité, à l’administration municipale proprement dite.
A l’égard du commerce et de la navigation, les marchands de l’eau présidaient à la confédération qui, sous le titre de Hanse parisienne, avait pour objet d’assurer la loyauté dans les opérations commerciales. On a peine à croire aujourd’hui de quelles précautions et de quelles difficultés le commerce était alors environné. Nul ne pouvait exercer le commerce sur la rivière, dans les limites de la ville, sans être hansé de la marchandise de l’eau, c’est-à-dire sans en avoir obtenu la permission formelle des officiers municipaux. Le haut de la rivière était libre jusqu’au premier pont de Paris exclusivement, mais, par le bas, il était défendu de passer le pont de Mantes sans être hansé. Une seule exception existait en faveur des bourgeois de Rouen, qui étaient autorisés à remonter la Seine jusqu’à Saint-Germain pour prendre chargement au rivage du port au Pecq. En cas d’infraction, les bateaux et la marchandise qui y était renfermée étaient confisqués au profit du Roi et de la ville, qui en partageaient la valeur par moitié.
Pour faire partie de la hanse, il fallait s’engager par serment à exercer loyalement le fait de la marchandise, suivant l’expression consacrée; à signaler au prévôt des marchands tout ce qu’on saurait avoir été fait au préjudice de la hanse, enfin à soumettre à ce magistrat toutes les affaires dont la connaissance lui était attribuée et de lui rendre obéissance. Ce serment, prêté dans le Parloir aux bourgeois, était suivi de la remise des lettres de hanse qui conféraient les priviléges attachés à l’association.
Outre ce serment, qui était imposé aux Parisiens eux-mêmes, le marchand forain avait une formalité particulière à remplir avant d’être admis aux franchises du commerce par eau. Il devait déclarer, sous la foi du serment, le juste prix auquel lui revenaient ses marchandises rendues à Paris, et cela avant de passer les ponts. Sur cette déclaration, le magistrat municipal lui donnait compagnie, française, c’est-à-dire désignait un bourgeois hansé de Paris qui devait examiner la cargaison. Cet examen fait, si les marchandises étaient à sa convenance, le bourgeois pouvait en prendre la moitié pour son compte et au prix coûtant; sinon, il se désistait de ses droits et laissait au marchand forain la liberté de vendre à ses profits et pertes la totalité du chargement. A une époque où Paris était exposé à de fréquentes attaques, il y avait au fond de cette mesure un très-bon moyen de police; de cette manière, tous les arrivages étaient surveillés avec soin, surtout du côté de la mer, d’où le danger était le plus à craindre.
Les marchands de l’eau devaient encore nommer à tous les emplois que nécessitait cette vaste association, connaître de tous les différents qui s’élevaient entre les marchands et autres à raison des actes de commerce, fixer les prix sur lesquels on n’était point d’accord et régler les mesures employées par les marchands, d’après les étalons déposés au Parloir.
Pour ce qui est de l’administration municipale proprement dite, la prévôté des marchands avait mission de stipuler au nom de la ville, de percevoir ses revenus, de pourvoir à l’entretien des rues et des places publiques, de régler la cote des tailles et impositions mises à la charge des citoyens, et de statuer sur les demandes en remise ou modération; de faire exécuter les travaux d’utilité communale; de prescrire des mesures de sûreté tant à l’intérieur de la ville qu’au dehors et notamment à l’égard des ponts, des quais, ports et chaussées, des chemins de halage établis le long des rivières; elle avait aussi la garde des tours, bastilles et fossés, des chaînes et des clefs de la ville; en un mot, tout ce qui concernait la gestion des intérêts particuliers de la cité, son embellissement, sa défense et sa police était spécialement dans ses attributions.
Il y avait aussi un prévôt de Paris; mais ce fonctionnaire était moins l’homme de la commune que celui du gouvernement. Ses fonctions étaient nombreuses: il exerçait un certain contrôle sur l’administration de la ville et intervenait dans tous les actes où le gouvernement avait un intérêt personnel à défendre. En 1304; on le voit nommer, concurremment avec le prévôt des marchands et les échevins, les sergents investis du soin de saisir les marchandises qui, contrairement aux règles prescrites, passeraient le pont de Mantes et celui de Paris; ces marchandises, on le sait, étaient confisquées par moitié au profit du Roi et de la ville.
Les fonctions les plus importantes du prévôt de Paris étaient celles qu’il exerçait comme chef du tribunal ordinaire, comme préposé à la juridiction du Châtelet, dont le sceau était entre ses mains et aux audiences duquel il remplaçait le Roi. Dans l’origine, le prévôt de Paris rendait la justice en personne; mais lorsqu’il fut passé en règle que les gens de justice devaient être docteurs ou licenciés, le prévôt de Paris devint purement titulaire de sa charge de judicature; un lieutenant civil le remplaça au Châtelet. Sous Louis XIV, l’office du lieutenant civil fut divisé en deux magistratures: l’une, pour la juridiction ordinaire; l’autre, pour la police, ce qui donna lieu à la création d’un lieutenant général de police.
Par suite de ces éminentes fonctions, le prévôt de Paris veillait à la bonne distribution de la justice et au maintien des coutumes du pays; lorsqu’il s’élevait quelque doute sur l’application d’une règle coutumière, il faisait appel aux souvenirs des magistrats municipaux de la ville, fidèles dépositaires des plus antiques traditions. C’est ainsi que le Parloir aux bourgeois a émis son opinion sur plusieurs dispositions que l’on retrouve dans la coutume écrite de Paris, mais qui alors ne subsistaient que dans la mémoire des hommes. Les sentences interprétatives du Parloir étaient confirmées par le prévôt de Paris et acquéraient pour ainsi dire force de loi.
Enfin, le prévôt de Paris avait le commandement de la noblesse, l’intendance des armes à Paris et dans la province, et la haute surveillance du guet de la ville, institution où l’on peut retrouver la première idée des deux corps qui la remplacent aujourd’hui, la garde nationale et la garde municipale: — le service était particulièrement à la charge des artisans et des gens de métier. Chaque métier devait faire le guet une fois en trois semaines. C’était là le guet bourgeois, qu’on surnommait guet assis ou dormant. Les rois en avaient établi une autre à leurs frais, composé de vingt sergents à cheval et de quarante sergents à pied, qui exécutaient des rondes de nuit. A la tête de l’institution était placé le chevalier du guet, ayant auprès de lui deux greffiers chargés de tenir le registre des inscriptions et d’avertir ceux dont le tour de garde était arrivé. Les artisans étaient exemptés du guet à soixante ans; ils étaient excusés, en cas d’absence pour leur commerce ou pour toute autre cause, lorsqu’ils s’étaient fait saigner le jour ou lorsque leur femme était en couches, selon les termes de l’ordonnance réglementaire. Les sergents du guet à cheval et à pied devaient partir du Châtelet au son de la cloche du couvre-feu et marcher toute la nuit. Ils visitaient le guet des métiers et, afin de prévenir les désertions, si quelqu’un s’était absenté, le reste de la bande était mis en prison. Le prévôt de Paris devait être informé de l’ordre du service et de toutes les mesures disciplinaires. Etienne Boileau, qui fut investi de la prévôté sous Saint-Louis, poussait le zèle de sa mission jusqu’à faire le guet en personne avec les artisans.
On le voit donc, le prévôt de Paris était en même temps de robe et d’épée et ses attributions n’avaient rien de commun avec celles du prévôt des marchands: «Il présidait en robe au tribunal, dit Delamare, et portait l’épée à la tête des troupes dont il avait le commandement. Ce double pouvoir était même exprimé par ses ornements dans les grandes cérémonies: il paraissait vêtu d’une robe de brocard d’or fourrée d’hermine, son cheval richement caparaçonné, et deux de ses pages, qui marchaient devant lui, portaient chacun au bout d’une lance son casque et ses gantelets.»
S’il fallait donner une dernière preuve du caractère véritablement démocratique de l’administration municipale de Paris, on la trouverait dans la mesure à laquelle donna lieu la sédition des maillotins. Le peuple s’était opposé par la violence à la perception de certains impôts; pour le punir de sa résistance et des excès auxquels il s’était laissé aller, Charles VI supprima la prévôté des marchands par un édit du 27 janvier 1382, et remit les droits et prérogatives qui y étaient attachés entre les mains du prévôt de Paris. On s’aperçut bientôt des calamités qui résultèrent de cet état de choses: déjà les édifices publics dépérissaient, les revenus de la ville étaient mal gérés; le désordre était partout; peut-être, une seconde sédition était-elle à craindre. On jugea à propos de mettre un terme à cet acte de rigueur, et, par un édit du 20 janvier 1411, l’administration municipale fut restituée au prévôt des marchands et aux échevins.
Ainsi, au moment où la plupart des communes venaient d’obtenir des chartes, Paris était dépouillé de son administration. Ici, les libertés municipales avaient été contestées, puis reconnues ou concédées comme par libéralité ; là, au contraire, elles étaient si vivaces qu’il fallait un édit du souverain pour les comprimer un seul instant. Paris n’avait pas et n’a jamais eu de charte de commune proprement dite; le grand mouvement des douzième et treizième siècles s’était accompli sans que personne songeât à lui contester ses antiques priviléges; au milieu de la conflagration universelle, les Parisiens s’étaient bornés à demander acte des coutumes qui leur étaient le plus chères avec l’administration de leur cité et qui formaient la base de leur grande association de commerce. Louis-le-Jeune avait fait droit à leur demande en reconnaissant qu’ils en jouissaient depuis les temps les plus reculés, ab antiquo; de sorte que, par la seule force de ses institutions, la commune de Paris avait paisiblement traversé la période où tant d’autres avaient dû soutenir leurs droits les armes à la main. On compte fort peu de cités en France où le régime municipal ait eu d’aussi profondes racines.
Mais que pouvait ce régime contre les désordres d’un gouvernement où la vénalité des charges devait pourvoir aux prodigalités de la cour et où toutes les fonctions allaient être vénales? Si la commune de Paris ne perdit pas absolument tous ses priviléges, comme les autres communes du royaume, il lui en resta bien peu; les élections des magistrats ne furent plus qu’un vain simulacre de représentation populaire; les citoyens n’y figuraient que pour la forme; leur vote, tout restreint qu’il était, ne devenait définitif qu’après une révision qui en altérait presque entièrement le caractère. Voici, en effet, la physionomie que présentait le corps municipal de Paris au dix-huitième siècle:
L’ancien Parloir aux bourgeois avait fait place à l’Hôtel-de-Ville; c’est là que continuaient de siéger les officiers municipaux.
Un prévôt des marchands, quatre échevins, un procureur du roi, un greffier et un receveur composaient ce qu’on appelait le bureau de la ville. A côté de ce bureau étaient ipstitués vingt-six conseillers et dix sergents. Enfin, des officiers subalternes, sous le nom de quarteniers, de cinquanteniers, de dizainiers, étaient répartis dans les différents quartiers de la ville pour y maintenir le bon ordre. Trois compagnies d’archers complétaient le corps de ville.
Les charges des magistrats municipaux, à part celles du prévôt des marchands et des échevins, étaient vénales. L’élection du prévôt des marchands avait lieu pour deux années; les échevins étaient. renouvelés tous les ans par moitié. A l’approche des élections, chaque quartenier rassembliat les électeurs de son quartier et les invitait à désigner quatre citoyens parmi lesquels deux seraient choisis pour procéder à la nomination du prévôt et des échevins. Le choix de ces deux citoyens était fait en assemblée générale, sur la liste des quatre candidats, par les électeurs du second degré qui appartenaient, pour la plupart, au gouvernement. Le corps électoral se composait alors du prévôt des marchands et des échevins, des conseillers de ville, des quarteniers et des deux citoyens délégués par chaque quartier. Le roi confirmait l’élection des nouveaux magistrats et recevait leur serment.
Telle était encore l’organisation de la commune de Paris, lorsqu’éclata la révolution du dernier siècle. Au moment de la convocation des états généraux, Paris avait été divisé en soixante districts. Ce sont ces districts qui avaient désigné les électeurs chargés de nommer les vingt députés ou représentants dé la commune à l’Assemblée nationale. Après la nomination des députés, et bien que leur mission fût remplie, les électeurs avaient cependant continué de s’assémbler dans les différents districts. Aux premières alarmes jetées dans la capitale, ils siégèrent sans interruption. Le 12 juillet 1789, l’Hôtel-de-Ville était envahi par la foule; ils s’y rendirent, confirmèrent les magistrats municipaux dans leurs pouvoirs, et, de leur propre autorité, instituèrent un comité permanent, composé de la plupart des magistrats municipaux et d’un grand nombre d’électeurs. De leur côté, les districts continuèrent d’agir. Le 14 juillet, le jour même de la prise de la Bastille, le dernier prévôt des marchands, Jacques Flesselles, tomba sous les coups de la multitude qui l’accusait de trahison. Bailly fut nommé par acclamation maire de la commune. Le trouble était à son comble. Les districts étaient devenus de petites républiques où les ordres du comité permanent et de la commune n’avaient plus d’accès. Le 23 juillet, comme on venait informer l’Assemblée nationale des désordres qui éclataient de toutes parts, Mirabeau s’écria que l’établissement d’une municipalité pouvait seul ramener la subordination et la paix: «Les municipalités, ajouta-t-il, sont d’autant plus importantes qu’elles sont la base du bonheur public, le plus utile élément d’une bonne constitution, le salut de tous les jours, la sécurité de tous les foyers, en un mot, le seul moyen possible d’intéresser le peuple entier au gouvernement, et de réserver les droits autour des individus. Quelle heureuse circonstance que celle où l’on peut faire un si grand bien sans composer avec cette foule de prétentions, de titres achetés, d’intérêts contraires, que l’on aurait à concilier, à sauver, à ménager dans des temps calmes! Quelle heureuse circonstance que celle où la capitale, en élevant sa municipalité sur les vrais principes d’une élection libre, faite par la fusion des trois ordres dans la commune, avec la fréquente amovibilité des conseils et des emplois, peut offrir à toutes les villes du royaume un modèle à imiter!» Aussitôt, en effet, l’on s’occupa d’un plan de municipalité ; en attendant son achèvement, une municipalité provisoire fut organisée; chaque district nomma des représentants et consentit à faire abdication de ses pouvoirs entre leurs mains. Dès le 30 juillet, le comité de l’Hôtel-de-Ville demeura seul chargé de l’administration communale; ses membres, s’élevant au nombre de cent vingt, furent désignés sous le nom de représentants de la commune.
Après avoir supprimé jusqu’à la dénomination des anciens magistrats, le décret du 14 décembre 1789 reconstitua les municipalités du royaume sur un plan uniforme. Il fut bientôt suivi par la loi du 21 mai 1790, qui posa les bases spéciales de la municipalité de Paris.
D’après cette loi, la ville de Paris fut divisée en quarante-huit parties sous le nom de sections, au sein desquelles devaient être choisis les divers officiers municipaux et les commissaires de police, alors soumis à l’élection des citoyens. La municipalité fut composée d’un maire, de seize administrateurs, de trente-deux conseillers, de quatre-vingt-seize notables, d’un procureur de la commune et de deux substituts. Tous ces magistrats étaient élus par les citoyens actifs, et ne pouvaient être destitués que pour forfaiture jugée.
Le corps municipal se divisait en conseil et en bureau. Le maire et les seize administrateurs composaient le bureau. Les trente-deux conseillers réunis au bureau formaient le conseil municipal. Enfin la réunion du conseil municipal et des quatre-vingt-seize notables constituait le conseil général de la commune, qui n’était appelé à se prononcer que dans les affaires importantes.
La municipalité avait deux espèces de fonctions à remplir, les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l’administration générale de l’Etat, par qui elles lui étaient déléguées.
Les fonctions propres au pouvoir municipal étaient: 1° de régir les biens communs et revenus de la ville; 2° de régler et d’acquitter les dépenses locales qui devaient être payées des deniers communs; 3° de diriger et faire exécuter les travaux publics qui étaient à la charge de la ville; 4° d’administrer les établissements appartenant à la commune, ou entretenus de ses deniers; 5° d’ordonner tout ce qui avait rapport à la voirie; 6° de faire jouir les habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté, de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Parmi les fonctions propres à l’administration générale de l’Etat, la municipalité pouvait avoir par délégation, 1° la direction de tous les travaux publics, dans le ressort de la municipalité, qui n’étaient pas à la charge de la ville; 2° la direction des établissements publics qui n’appartenaient pas à la commune, ou qui n’étaient pas entretenus de ses deniers; 3° la surveillance et l’agence nécessaires à la conservation des propriétés nationales; 4° l’inspection directe des travaux de réparations ou reconstructions des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte.
La municipalité exerçait la première espèce de fonctions sous la simple surveillance de l’administration du département de Paris; elle ne lui était subordonnée qu’à l’égard des fonctions qu’elle remplissait par délégation.
A cette époque le département de Paris avait peu d’éclat; il était pour ainsi dire effacé par la commune qui était l’objet de toutes les préoccupations et avait pris date avant lui dans les grands travaux d’organisation qui venaient de s’exécuter. Plus tard nous verrons la commune céder la place au département et à son tour disparaître dans la vaste administration de celui-ci, où elle est encore ensevelie.
Le territoire du royaume avait été divisé en départements et en districts par la loi du 22 décembre 1789. En désignant ces diverses circonscriptions et leurs chefs-lieux, la loi du 26 février 1790 statuait de cette manière à l’égard de Paris: «L’assemblée de ce département se tiendra dans la ville de Paris. Il est divisé en trois districts, dont les chefs-lieux sont: Paris, Saint-Denis, le Bourg-la-Reine.»
Et comme la loi du 22 décembre avait établi dans les chefs-lieux de département et de district une assemblée administrative divisée en conseil et en directoire, ce système d’organisation devint celui du département de Paris, des districts de Saint-Denis et du Bourg-la-Reine. Quant à la commune de Paris, qui formait à elle seule un des districts du département, la loi des 3-5 novembre 1790 déclara qu’elle n’aurait point d’administration de district et que cinq commissaires seraient chargés d’y suppléer dans certains cas.
Telle était la situation respective du département et de la commune.
Ainsi, la commune de Paris avait la libre administration de ses biens et se trouvait placée sous la surveillance tutélaire du département, qui n’intervenait d’une manière active qu’autant qu’il s’agissait de mesures touchant à l’ordre public. Si les circonstances avaient été plus calmes, cette institution, basée sur les vrais-principes du droit municipal, eût été pour Paris la source des plus grands bienfaits; on peut s’en convaincre par les actes qui ont signalé le court espace de temps où elle a fonctionné librement; ce qui ne permet pas d’en douter, c’est le spectacle de nos communes où ce système d’administration est aujourd’hui en vigueur. Mais, dans ces temps d’orage, quelle est l’institution dont le mécanisme n’aurait pas été ébranlé ! Celle-là fut bientôt faussée, détruite par les mains violentes qui s’emparèrent de l’administration municipale lors des événements du 10 août. Ce jour-là même on vit se former à l’Hôtel-de-Ville une Commune insurrectionnelle; les magistrats municipaux en furent expulsés, et à l’ancienne municipalité succéda une dictature toute politique La royauté venait de tomber; la nouvelle commune reçut quelques-unes des attributions du pouvoir exécutif: le II août 1792, l’Assemblée législative lui départit la police générale, dite de sûreté , ce terrible instrument dont Marat devait faire un si cruel usage. On organisa, en effet, un comité de surveillance; c’est Marat qui en fut le chef et délivra les mandats contre les suspects. Le reste est connu de tous; chacun sait le nom et l’histoire de ces fameux représentants de la commune; ces mêmes hommes, qui se rendaient au conseil en sabots pour épargner le cuir alors que l’armée manquait de chaussures, étaient la terreur du pays. Le 9 thermidor fut le dernier jour de leur règne. Devenue maîtresse absolue, la Convention remit le soin de l’administration municipale à deux commissions provisoires nommées par elle et agissant sous la surveillance du département: l’une était chargée de la partie administrative et de la police municipale, l’autre de l’assiette et de la répartition des impôts. Ces commissions, instituées le 14 fructidor an 11, subsistèrent jusqu’à la constitution de l’an III.
D’après cette constitution, la France devait être divisée en départements, en cantons et en communes. En conséquence, la loi du 11 octobre 1795 circonscrivit le territoire de la commune de Paris dans un canton qu’elle partagea en douze municipalités. Un bureau central, composé de trois membres, désignés par l’administration du département, fut spécialement chargé de la police et des subsistances dans le ressort du canton, ces objets n’ayant pas paru susceptibles d’être divisés entre les douze maires de la capitale. C’était un acheminement à la création d’un préfet de police.
Arriva enfin la constitution de l’an VIII avec un nouveau mode de circonscription administrative, avec un nouveau système d’organisation. Il y eut alors des départements et des arrondissements communaux. La loi du 28 pluviôse an VIII institua dans le département de la Seine, comme dans tous les autres départements, un préfet, un conseil de préfecture, un conseil général et leur attribua les fonctions exercées jusque-là par les administrations de département. Le préfet de la Seine, les conseillers de préfecture et les membres du conseil général étaient à la nomination du premier consul.
L’arrêté du 17 ventôse de la même année divisa le département de la Seine en trois arrondissements. Paris fut désigné comme le siège de la préfecture; Sceaux et Saint-Denis devinrent les chefs-lieux des deux sous-préfectures.
Quant à la commune de Paris, un maire et deux adjoints furent chargés, dans chacun des arrondissements municipaux, de la partie administrative et des fonctions relatives à l’état civil. Un préfet fut préposé à la police de la commune, sous le nom de préfet de police; des commissaires, répartis dans les douze municipalités furent placés sous ses ordres.
La loi du 28 pluviôse déclara en même temps que le conseil général du département remplirait à Paris les fonctions du conseil municipal. Par là, la commune se trouvait privée de son administration et de sa police; le droit d’élire ses représentants lui était également enlevé : le premier consul choisissait les maires et les adjoints; les conseillers municipaux étaient nommés par le préfet de la Seine, qui pouvait les suspendre. Le département absorbait ainsi la commune; c’était là toute l’économie de la constitution, non-seulement à l’égard de Paris, mais à l’égard des autres communes du royaume; de sorte qu’à vrai dire, il n’y avait en France qu’une seule municipalité dont le maire était le chef de l’Etat; les fonctions d’adjoints étaient remplies par les préfets et les sous-préfets. Ce système de centralisation administrative n’aurait pas dû survivre à l’empire; il a cependant traversé la restauration: les institutions de 1830 l’ont aboli.
La charte avait promis qu’il serait pourvu à des institutions départementales et municipales fondées sur un système électif. La promesse a été remplie envers les départements par les lois des 22 juin 1833 et 10 mai 1838; et envers les communes par les lois des 21 mars 1831 et 18 juillet 1837 Toutefois, la ville de Paris et le département de la Seine ayant paru devoir être l’objet de dispositions spéciales, la loi du 20 avril 1834 a réglé en partie leur situation exceptionnelle: nous disons en partie, car cette loi est purement organisatrice; il lui manque un complément indispensable; il faut qu’une autre loi vienne définir les attributions des magistrats et fonctionnaires institués. On a fait espérer dans la disposition finale de la loi du 18 juillet 1837 que ces attributions seraient bientôt déterminées. Il serait temps que les chambres fussent appelées à s’en occuper, car la loi du 20 avril est restée boiteuse et n’a pour seul appui que la constitution de l’an VIII.
La loi du 20 avril a rendu à la commune de Paris le droit de choisir les membres du conseil municipal, les maires et les adjoints des douze arrondissements; mais elle n’est pas allée au delà ; le système de la constitution de l’an VIII a été suivi presque entièrement pour le reste: d’après cette loi, le corps municipal de Paris se compose du préfet du département de la Seine, du préfet de police, des maires, des adjoints et des conseillers élus par les citoyens. Il y a un maire et deux adjoints par chacun des douze arrondissements. C’est toujours le conseil général qui remplit les fonctions du conseil municipal de la ville. Seulement, lorsqu’il s’agit des intérêts purement départementaux, huit membres sont adjoints à l’assemblée pour y représenter les arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis.
Dans l’état des choses, le pouvoir municipal se trouve partagé entre le préfet de la Seine et le préfet de police. Les douze maires de Paris n’ont qu’une fonction importante à remplir, et cette fonction n’a rien de commun avec le pouvoir municipal proprement dit: c’est la tenue des registres de l’état civil. Il est vrai qu’une loi doit bientôt régler les attributions de ces magistrats, mais l’organisation actuelle ne permet guère d’étendre la sphère de ces attributions. Il semble que les souvenirs de la révolution du dernier siècle pèsent à tout jamais sur la commune de Paris et la condamnent à l’impuissance et à l’inertie. Ce sont du moins ces souvenirs que l’on évoque toutes les fois qu’il s’agit de régler les droits de ses magistrats municipaux. Il est à craindre qu’il y ait ici confusion. Est-ce le pouvoir municipal, qu’on revendique en faveur de la ville de Paris, et dont jouissent toutes les autres villes, tous les bourgs et villages du royaume, est-ce ce pouvoir qui a rendu la commune si redoutable à l’époque que l’on s’efforce de rappeler aujourd’hui? Evidemment non; les faits sont là , qu’on les interroge. On ajoute, il est vrai, que c’est de l’Hôtel-de-Ville qu’est tombée la première proclamation contre l’empire et qu’une commission municipale a porté le dernier coup à la restauration. Mais si, en 1793, la commune de Paris avait le droit absolu d’administrer ses propres affaires, oublie-t-on, qu’en 1814 et en 1830, elle était sous le régime de l’an VIII, qui avait effacé jusqu’aux dernières traces du pouvoir municipal? — Qu’on y songe bien, ce n’est point à l’œuvre du pouvoir munipal qu’il faut attribuer les événements de ces trois époques, et quand on en tire exemple pour refuser à la première cité du monde la libre administration de ses biens, on abuse des mots ou l’on se trompe sur les choses.