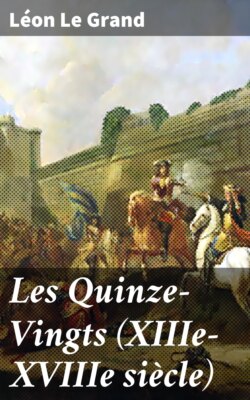Читать книгу Les Quinze-Vingts (XIIIe-XVIIIe siècle) - Léon Le Grand - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FORTUNE IMMOBILIÈRE (suite). DESCRIPTION DE L’ENCLOS.
ОглавлениеL’histoire du quartier où fut construit le manoir des aveugles a été étudiée avec le plus grand détail par Berty, qui avait soigneusement exploré les archives de l’hôpital. Notre tâche est donc ici fort simplifiée, et nous n’avons qu’à résumer rapidement le travail du savant historien en ajoutant un certain nombre de renseignements sur l’intérieur de l’hôtel.
La place achetée par saint Louis pour y bâtir la maison des Quinze-Vingts s’étendait près de la porte Saint-Honoré, en dehors de l’enceinte de Philippe-Auguste, le long du chemin qui allait au Roule à travers les faubourgs, en prolongeant la rue Saint-Honoré.
Au nord, l’église, la porte, l’hôtel du portier et les habitations de quelques autres frères donnaient sur le chemin même, puis la limite était formée par les maisons particulières construites le long de cette voie.
A l’est, du côté de Paris, l’enclos était bordé par les maisons de la rue Saint-Thomas-du-Louvre, parmi lesquelles on devait un jour compter le fameux hôtel de Rambouillet, et l’hôtel de Chevreuse, passé plus tard aux d’Épernon, puis aux Longueville.
Au midi, l’évêque avait conservé un arpent de terre que les Quinze-Vingts lui achetèrent avant 1281, et ils n’eurent plus dès lors pour voisin de ce côté que le propriétaire de l’hôtel de Bretagne.
A l’ouest enfin se trouvait la Couture-l’Évêque, dont nous avons déjà parlé.
La disposition de l’enclos au moyen âge nous est mal connue; à la fin du XIIIe siècle ou au commencement du XIVe, on y constate l’existence de l’église, de la porterie, de la «garde-robe» et de quelques maisonnettes habitées par des frères. Quant à l’ensemble des bâtiments affectés au logement des aveugles, nous n’avons à ce sujet aucun renseignement.
Les sceaux de la congrégation présentent bien, derrière la figure de saint Louis, la façade d’un vaste édifice, mais on ne peut guère se fier à des documents de cette nature, d’autant plus que ces deux sceaux, gravés à des époques peu éloignées l’une de l’autre, donnent chacun à cette maison un aspect tout différent.
Dans un compte de 1384, cité par Berty, les habitations des frères sont classées sous les rubriques suivantes: «la grand-cour, la Bretaigne (du nom de l’hôtel voisin), la petite cour, les chambres en haut et les chambres en bas;» ces dernières divisions semblent indiquer un grand corps de logis à deux étages. C’est certainement ce qui existait au XVIe siècle, quand le Parlement dispensa de tout loyer les frères qui habitaient les maisons distinctes du grand hôtel de l’hôpital.
A cette époque, on peut se rendre un compte assez exact de l’aspect qu’offrait cette sorte de petite cité, avec son église, son beffroi, son cimetière, son refuge pour les malades, son moulin, son four, sa prison, ses maisons et ses tavernes.
Ces divers édifices donnaient sur trois cours principales. La première, la cour pavée, s’ouvrait devant la porte de la rue Saint-Honoré et bordait l’église et la grand’maison.
On désignait sous ce titre la maison commune de la congrégation; elle était louée à un frère, mais à la condition d’y réserver une salle pour les séances du chapitre et un appartement pour l’aumônier du roi.
Le chapitre, la garde-robe, suivant l’expression reçue alors, était l’assemblée de tous les membres de l’hôpital. Il se réunissait probablement autrefois dans une salle qui portait le nom de garde-robe et était située, en 1290, à l’extrémité du pourpris, «du côté des champs. «C’est sans doute dans cette grande pièce que la confrérie Saint-Jacques, au début de son institution, obtint la permission de tenir ses séances.
En 1513, le chapitre s’assemblait déjà dans la grand’maison; un petit beffroi, surmonté d’une bannière, d’une girouette de laiton, renfermait la cloche destinée à convoquer les frères. En 1529, on fit de neuf une garde-robe au premier étage du même bâtiment.
Le grand aumônier avait souvent affaire chez les Quinze-Vingts, dont il était le supérieur. Jean de Grand-Pré, en 1321, y fit construire une maison à plusieurs étages qui lui coûta 500 l. et dont les aveugles lui abandonnèrent la jouissance; mais il la leur revendit quelques années plus tard. Au XVIe siècle, quand le grand aumônier venait à l’hôpital, il avait le droit d’y occuper un logis aux réparations duquel il contribuait, et c’était une partie de la grand’maison qu’on disposait à cet effet. Les détails relatifs à sa réception peuvent donner une idée de l’aménagement d’un appartement à cette époque.
Les murs de sa chambre à coucher étaient tendus de tapisseries, et le plancher couvert de nattes; un lit de bois, dont la paillasse renfermait huit bottes de «feurre,» se dressait sous un ciel de tapisserie et était entouré de chaises et d’escabeaux. A côté se voyait une petite table à quatre pieds sur laquelle on étendait un drap vert.
Quand on était prévenu de l’arrivée du grand aumônier ou de son vicaire, on allumait un bon feu de bourrées et de cotterets dans la cheminée munie de chenets, pelles, «tenailles, fourchette,» et on disposait à côté les éléments d’une collation, tels que pain, vin, pruneaux et fruits.
L’éclairage était ce qu’il y avait de moins confortable dans cette pièce; le papier huilé qu’on collait sur les châssis des fenêtres ne devait en effet laisser passer que peu de lumière.
Auprès de la chambre à coucher s’ouvrait le cabinet de travail, l’«étude» du grand aumônier; c’était également une salle nattée et tendue de tapis. Une table, montée sur des tréteaux, servait de bureau et était recouverte d’un «banquier» de trois aunes de drap vert; la cheminée renfermait toujours sa garniture de pelles, pincettes et fourchette, avec deux chenets à pommes de cuivre.
L’aumônier pouvait réclamer une place pour son vin dans la cave du commun, qui était habituellement destinée à serrer le vieux bois; il avait aussi la jouissance d’un jardin garni de belles treilles que le jardinier venait lier chaque printemps avec de l’osier. On y semait des graines de différentes sortes et une couche de fumier s’y couvrait en été de «pompons, de courges et de concombres.»
Ce jardin communiquait avec le cimetière par un huis de bois ferré.
La grand’maison séparait la cour pavée de la grand’cour ou la cour verte et était bordée de ce côté par une galerie. La cour verte était plantée d’ormes, qu’on protégeait, tant qu’ils étaient petits, avec des barrières de bois et d’épine.
Au milieu de chacune de ces cours était creusé un puits, garni de deux seaux de cuir suspendus à une corde longue de quatre toises; à la margelle de ces puits venaient s’appuyer tantôt le boulanger, tantôt l’infirmière ou quelque autre des frères ou des sœurs qui «allaient à l’eau,» mais il était interdit de s’en servir pour les lessives.
La troisième cour était la petite cour pavée, située près de l’infirmerie. Nous parlerons plus tard en détail de l’«enfermerie;» qu’il nous suffise de dire ici qu’elle longeait le chemin des remparts, à l’extrémité occidentale de l’enclos.
A côté de l’infirmerie, et pour permettre aux malades d’assister plus facilement aux offices, on avait élevé la chapelle Saint-Nicaise. Cet édifice, surmonté d’un petit clocher, avait son entrée sur les murs de la ville; le chemin qui le bordait finit par lui emprunter son nom et devint la rue Saint-Nicaise. Auprès de la chapelle, le long des fortifications, se trouvaient les maisons des prêtres.
Dans le reste du pourpris, on rencontrait une prison avec des fenêtres défendues par de gros barreaux de fer, une place où s’élevait un moulin qu’un cheval mettait en mouvement, un four pour cuire le pain des pauvres, une étable pour loger les chevaux des fermiers, une «cuisine» pour mettre le vin, un grenier pour déposer le blé.
Ce grenier devait avoir de grandes dimensions, car il servait de magasin pour l’aumône du roi; nous voyons qu’en 1390, on y fit transporter 78 milliers de harengs saurs destinés à «plusieurs maladreries, hôpitaux, maisons-Dieu et pouvres mesnagiers.»
Nous n’avons pu reconnaître la place exacte qu’occupaient, au XVIe siècle, ces différents bâtiments; il en est de même pour le bureau, où se faisaient les écritures de l’hôpital; nous savons seulement qu’en l’année 1500, on y ajouta une annexe, un second petit bureau, où l’on déposa les reliques et joyaux, avec les lettres et les titres de l’église. A côté de la maison du bureau se dressait un siège en pierre «à monter à cheval.»
A l’angle sud-est de l’enclos s’étendait le cimetière qui était réservé à l’inhumation des aveugles et comprenait un arpent. Dès 1297, Guillaume Langlois et son frère avaient donné 12 l. p. de rente à la congrégation pour en acquérir l’emplacement. L’achat fut conclu avant 1282, époque à laquelle l’évêque amortit ce terrain.
Au XVIe siècle, le cimetière formait un véritable verger où, en l’espace de deux ans (1531-1532), nous voyons planter 25 marcottes de vigne, 39 noyers, 16 amandiers et 100 noisetiers. Les fruits étaient consacrés à la nourriture des enfants de l’infirmerie ou affermés à un frère. L’herbe qu’on semait sous les arbres était louée également, et les voisins du cimetière ne pouvaient y circuler et y faire sécher leurs lessives avant que ces diverses récoltes ne fussent enlevées.
En 1530, les gouverneurs conçurent le projet de faire construire une petite chapelle au milieu du cimetière, et en commandèrent le «portraict et divis» à un maître maçon; les comptes ne nous donnent pas de renseignements sur la construction de cet édifice, mais il est indiqué par le plan de Quesnel (1609).
Un plan très détaillé, levé en 1747 et reproduit par Berty, nous permet de parcourir, sans crainte de nous égarer, l’intérieur de l’hôpital. Après avoir franchi la porte de la rue Saint-Honoré, après avoir contourné l’église et traversé la cour pavée, la cour du commencement des Epousailles, où s’accomplissait sans doute, conformément à l’ancienne liturgie, la cérémonie essentielle du mariage, c’est-à-dire l’affirmation solennelle du consentement des époux, on trouve à sa gauche l’habitation du maître et la maison du chapitre; devant soi, on voit s’ouvrir la grande cour, ornée au milieu d’une fontaine, et l’on a à sa droite un vaste bâtiment divisé dans sa longueur en deux parties par une allée, probablement couverte, qu’on appelle la tranche, et qui commence dans la cour pavée, devant l’église. Ce bâtiment est côtoyé sur la face opposée par une rue qui longe toute la partie occidentale de l’enclos, parallèlement à la rue Saint-Nicaise, et est bordée de maisons donnant sur l’ancien chemin des Remparts. On remarque parmi ces édifices l’infirmerie et la chapelle Saint-Nicaise, qui depuis longtemps n’est plus consacrée au service du culte.
La grande tranche, qui se prolonge autant que la grand’cour, aboutit aux bâtiments entourant le carré des commodités; en suivant de là les maisons qui bordent le fond de la cour de l’ouest à l’est, on arrive à la maison des prêtres et à la grande aumônerie; puis, si l’on continue à s’enfoncer dans l’enclos, on trouve le jardin des prêtres et le cimetière, avec la cour qui le longe et sert de promenoir aux aveugles. A l’entour se dressent diverses constructions, entre autres celles qui renferment les fours des boulangers.
Les maisons de l’enclos sont pour la plupart assez élevées et comptent généralement quatre ou cinq étages; à elles toutes, elles renferment environ 411 chambres, 200 cabinets, 100 greniers, 76 salles, 36 boutiques, 29 bûchers, 18 cuisines, 2 magasins; on trouve dans leurs dépendances 51 caves, une remise et 5 jardins. Avec leurs deux pompes à incendie faites «à l’instar de celles de la ville,» les Quinze-Vingts pouvaient défendre leurs bâtiments contre les atteintes du feu; mais ils ne surent pas lutter contre l’action du temps, et, dès le commencement du XVIIIe siècle, une partie des constructions menaçait ruine; en 1714, une personne qui ne se nomme point «s’offre d’obtenir pour l’hospital de céans une permission nécessaire du Roy pour l’establissement, publication et réception d’une loterie de un million de livres, dont le profit servira à refaire tous les vieux bâtimens de céans, que l’on voit estre dans une extrême caducité;» ce projet ne reçut pas d’exécution immédiate, mais il n’était pas abandonné, et, une trentaine d’années plus tard, en 1746, les Quinze-Vingts firent rendre un arrêt du conseil qui leur attribuait la moitié des produits de la loterie de Saint-Sulpice pour la reconstruction de leur église et de leurs maisons.
Un des administrateurs, Labbé, architecte du roi, fit dresser des projets et un plan en relief, qui, du consentement de Gaston de Rohan, grand aumônier furent soumis au roi et obtinrent son approbation.
Des sommes importantes ayant été remises par le curé de Saint-Sulpice (486,002 l. 3 s. 6 d. de 1746 à 1759), les travaux commencèrent aussitôt; on éleva d’abord le bâtiment des frères, au fond de l’enclos, sur l’emplacement de l’ancien cimetière, qui fut transféré en une place de 17 toises 1 pied de long et 6 toises 1 pied de large bordant ce bâtiment. Une petite chapelle, fermée par une porte en bois sculpté, et décorée de peintures à l’intérieur, fut construite en même temps et dédiée à saint Louis.
On travailla ensuite aux maisons de rapport, qui devaient entourer une grande cour carrée ménagée au centre de l’enclos; l’aile gauche de cet édifice, derrière laquelle on plaça le logement de la communauté des prêtres ainsi que l’école des garçons et l’école des filles, le bâtiment du milieu et celui de la grande aumônerie, l’aile droite et enfin le bâtiment du chapitre furent successivement élevés de 1750 à 1767.
A cette époque, la suppression de la loterie de Saint-Sulpice
«mit l’hôpital dans l’impossibilité de pouvoir continuer les bâtimens suivant le plan approuvé par Sa Majesté.» Le roi, comme nous le verrons en parlant de l’église, consentit à remplacer les produits de la loterie de Saint-Sulpice par une allocation annuelle de 40,000 l. sur la loterie de Piété, mais en déclarant qu’il ne mettrait l’argent à la disposition des Quinze-Vingts que quand ils seraient prêts à entreprendre les travaux de l’église. Ceux-ci voulaient auparavant terminer la restauration des maisons qu’ils louaient aux étrangers. Après une certaine interruption, ils reprirent les travaux en 1772 et bâtirent une partie de la façade de la rue Saint-Honoré, ainsi que celle de la rue Saint-Nicaise.
En 1779, il ne restait plus de l’ancien hôpital qu’un vieux bâtiment sur le devant et l’église avec les boutiques qui s’y adossaient; le reste de l’enclos, suivant le dire de l’abbé Georgel,
«formoit au milieu de Paris un monument remarquable par la multiplicité et la beauté de ses édifices.»
Ces constructions, en effet, revêtaient une certaine élégance. Claude Vassé fut chargé d’y exécuter différentes sculptures, entre autres une Renommée que cite d’Argenville, ainsi que des frontons recouverts de guirlandes de feuilles de laurier et de feuilles de chêne au-dessus de la porte du chapitre et des portes qui accompagnaient la fontaine; celle-ci, œuvre du même artiste, était formée d’une niche «sculptée en glaçons,» surmontée d’une figure représentant «une nymphe couchée sur le rivage.»
Des ouvrages aussi importants ne pouvaient s’effectuer sans entraîner des frais considérables; les sommes payées aux ouvriers jusqu’en 1779 s’élevèrent à près de 2 millions et demi, sans compter les honoraires de l’architecte, de l’inspecteur, du dessinateur, du garde-magasin et les gratifications données aux officiers de la maison à l’occasion des travaux. Labbé, qui avait entrepris la direction de l’œuvre, recevait 6,000 l. par an; après sa mort, arrivée le 24 novembre 1750, il eut pour successeur de Saint-Martin, époux de Marie-Françoise Vassé, sœur du sculpteur. De Saint-Martin touchait chaque année 8,000 l.; en 1779, il fut lui-même remplacé par son beau-frère Baccarit.
Après avoir parcouru les longues colonnes de chiffres où s’alignent les capitaux absorbés par la restauration de l’hôpital, on ne peut se défendre d’un certain étonnement en voyant le résultat auquel devaient aboutir toutes ces dépenses.
Le 31 décembre 1779, en effet, Louis-René-Édouard, cardinal de Rohan, grand aumônier, ayant à ce titre la haute direction des Quinze-Vingts, obtint du roi des lettres patentes qui l’autorisaient à aliéner l’emplacement occupé par les aveugles et à transporter leur demeure dans l’ancien hôtel des Mousquetaires noirs au faubourg Saint-Antoine. Le prix, fixé à 6 millions de livres, devait être employé de la manière suivante: 5 millions versés dans la caisse du domaine, et le surplus remis au cardinal, qui le consacrerait à l’achat de l’hôtel des Mousquetaires et à l’augmentation des revenus de la maison. Les privilèges attachés à l’enclos devaient lui être conservés jusqu’en 1781.
A peine en possession de ce titre, le cardinal conclut le contrat de vente avec une société formée, le 14 octobre précédent, pour percer des rues sur l’emplacement des Quinze-Vingts et y établir des maisons de rapport; l’aliénation était faite aux conditions fixées par le roi, mais on stipulait, en outre du prix de 6 millions, un versement de 312,000 l. destiné à empêcher l’hôpital de souffrir de la brusque diminution de son revenu, tandis qu’il ne toucherait plus les loyers des habitants de l’enclos et que le domaine ne lui servirait pas encore les intérêts des 5 millions dont le trésor ne devait être entièrement payé qu’en 1784.
La vente portait sur tous les terrains, bâtiments et matériaux étant dessus, et on n’en avait excepté que le mobilier de l’église; la date du 1er janvier 1780 fut fixée pour l’entrée en jouissance des acquéreurs, sauf en ce qui concernait les logements des frères et les locaux de l’administration, livrables seulement au 1er juillet.
L’hôtel où allait être transférée l’habitation des Quinze-Vingts, construit en 1699 pour servirde caserne aux Mousquetaires noirs, était vide depuis le 15 décembre 1775, époque de la suppression des Mousquetaires de la garde. Mis en vente le 19 avril 1777, il n’avait pas encore trouvé acheteur, mais venait d’être loué moyennant 15,600 l. par an à Alexis Moreau du Chillon, inspecteur des fermes du roi.
Le cardinal s’en rendit acquéreur le 18 janvier 1780 pour une somme de 450,000 l.. D’après les prescriptions de Louis XVI, ce prix devait être prélevé sur le million payable à l’hôpital par la compagnie Séguin; cependant, comme l’État se trouvait redevable à cette époque de 450,000 l. destinées primitivement à la reconstruction de l’église, cet argent, n’ayant plus désormais d’emploi fixe, servit à éteindre, par voie de compensation, la dette des Quinze-Vingts.
Le déménagement s’effectua au milieu de l’été 1780; à la même époque, l’archevêque permit de transférer dans la nouvelle église les ossements qui reposaient dans l’ancienne, ainsi que les plaques commémoratives. La place étant insuffisante dans la chapelle des Mousquetaires, on obtint de l’Hôtel-Dieu l’autorisation de creuser au cimetière de Clamart une fosse de 5 toises sur 3 d’ouverture, et de 2 toises de profondeur, pour déposer les cendres recueillies dans le cimetière des Quinze-Vingts et dans une partie de l’église. Afin de pourvoir aux ensevelissements futurs, un terrain fut acheté à la Tour-de-Billy, près des Mousquetaires, pour la somme de 7,920 l..
L’archevêque de Paris ne pouvait autoriser les Quinze-Vingts à faire célébrer le service divin dans leur nouvel enclos sans indemniser le curé de la paroisse Sainte-Marguerite; il lui assigna 300 l. de rente, plus les offrandes qui se feraient aux quatre grandes fêtes dans la chapelle, et, le 21 septembre 1780, le grand aumônier envoya un de ses représentants prendre possession en son nom de la «juridiction spirituelle et quasi épiscopale» qu’il avait le droit d’exercer dans l’hôpital.
Les motifs que mit en avant le cardinal de Rohan, pour expliquer la grave résolution qu’il avait prise, n’ont rien que de très plausible; dans l’ancien enclos, le logement des frères était rendu insalubre par la proximité du cimetière, et le quartier présentait trop d’agitation pour leur permettre une circulation commode; les immeubles considérables qu’ils possédaient exigeaient un entretien coûteux et immobilisaient un capital énorme qu’il paraissait bien préférable de remplacer par une forte rente assurant aux aveugles un plus grand bien-être; on pouvait, de cette façon, supprimer les quêtes, comme cela se fit dès le mois de juillet 1780, et augmenter le nombre des aveugles secourus. Remarquez d’ailleurs qu’à cette époque, un placement sur l’État semblait assez avantageux pour faire perdre de vue la diminution de valeur qui atteint inévitablement une rente perpétuelle.
En admettant que tous les mobiles de sa décision fussent aussi désintéressés, il faut avouer que le prince Louis agit dans cette circonstance avec la présomption et la légèreté qui lui furent si fatales dans l’affaire du collier.
Ne se rendant pas compte du caractère indépendant que les Quinze-Vingts avaient toujours conservé, il crut que sa qualité de grand aumônier lui donnait toute autorité. On dirait qu’il ne soupçonnait pas l’existence de ces administrateurs qui prêtaient gratuitement à l’hôpital le concours de leur travail et de leur expérience.
Ces ecclésiastiques, ces magistrats chargés de veiller au maintien des règlements et des traditions dans un établissement dont les membres déclaraient avec orgueil, en 1605, que «jusques icy ils ont souffert de grandes nécessitez et n’ont pourtant jamais rien vendu ny alliéné de ce qui est propre à la maison,» c’est à peine si le cardinal songea à les prévenir individuellement.
D’après les registres du chapitre, ce fut seulement au mois de janvier 1780 qu’il présenta officiellement à leur approbation l’opération qu’il avait déjà décidée en août 1779.
De tels procédés devaient blesser la susceptibilité des administrateurs; le 25 juillet 1780, ils donnèrent leur démission, se plaignant de ce que le cardinal ne les avait pas consultés pour procéder à la vente, de ce qu’il avait tenu dans son propre hôtel plusieurs assemblées du chapitre irrégulières par ce fait même, et de ce qu’il avait compris dans l’aliénation des maisons que ne visaient pas les lettres du roi.
Le grand aumônier passa outre, mais il rencontra chez le maître et chez le ministre une résistance à laquelle il ne s’attendait pas. Aidé de l’abbé Georgel, qu’il avait nommé administrateur, il chercha à briser cette opposition; la nomination d’un administrateur onéraire lui permit de remplacer indirectement le maître, et Maynier, titulaire de la maîtrise, ayant réclamé, son opposition fut purement et simplement annulée.
Pour justifier la marche qu’il avait imprimée à l’affaire des Quinze-Vingts, le cardinal de Rohan résolut de s’adresser au roi et obtint du conseil, le 14 mars 1783, un arrêt «du propre mouvement » qui approuvait ce qui s’était passé et félicitait le grand aumônier des améliorations apportées dans l’institution, savoir: la suppression des quêtes, avec la création de vingt-cinq places pour des gentilshommes et de huit places pour des ecclésiastiques pauvres et aveugles; la distribution de pensions alimentaires à des aveugles de province et de pain à 150 aveugles aspirants; enfin le projet de l’installation d’un hospice de vingt-cinq lits pour les aveugles qui viendraient se faire soigner.
Le lendemain, un second arrêt du conseil interdisait au Parlement de faire une enquête, comme il l’avait résolu, et prescrivait au cardinal de rendre ses comptes.
Les mécontents ne se tinrent pas pour battus, les murmures continuèrent, et un de ceux qui les excitaient, l’abbé Hespelle, ecclésiastique du clergé des Quinze-Vingts, fut renvoyé. Il réclama énergiquement et porta devant le Parlement un appel comme d’abus.
En même temps, trois des administrateurs qui avaient été nommés récemment refusèrent d’entrer en charge, pour ne pas engager leur responsabilité dans une opération qui leur paraissait suspecte. Le Parlement, saisi une seconde fois de l’affaire des Quinze-Vingts, prit fait et cause pour les anciens administrateurs et présenta au roi, en décembre 1783, des remontrances où il prétendait que la bonne foi du souverain avait été surprise au moment de l’approbation donnée au cardinal de Rohan.
N’ayant pas été écoutée, la Cour fit procéder à une enquête qui provoqua de secondes remontrances au mois de mai 1784.
Nous allons résumer les griefs relevés par cette enquête et tâcher de découvrir la vérité au milieu de ces accusations et des réponses qui leur furent faites.
Avant de commencer cette critique, il est bon d’observer que presque toutes les assertions des déposants, quand il est possible de les contrôler d’autre part, nous apparaissent entachées de fausseté ou d’exagération; on ne peut donc accepter leurs dires que quand ils sont entourés de preuves.
Le maître des Quinze-Vingts, interrogé le premier, se plaint naturellement tout d’abord d’avoir été supplanté, puis il signale l’irrégularité des séances du chapitre et se fait l’écho des bruits peu favorables qui se sont répandus sur les mœurs de Prieur, nommé gouverneur onéraire, bruits que vient confirmer le témoignage de l’abbé Rat de Mondon, ancien administrateur; il prétend enfin que le cardinal lui a offert un pot-de-vin considérable, s’il ne faisait pas d’opposition.
Nous avons déjà parlé du sans-gêne avec lequel le prince de Rohan traita l’administration des Quinze-Vingts; le mauvais état de sa santé et les troubles qui agitaient l’hôpital n’étaient pas des motifs suffisants pour ne pas tenir régulièrement les assemblées du chapitre.
La conduite de Prieur semble en effet avoir été fort légère puisqu’elle lui attira un procès criminel; en tous cas, elle n’est pas ici de bien grande importance; quant à la somme proposée au maître, elle est niée énergiquement par le cardinal.
Mais des reproches plus graves sont articulés dans l’enquête. D’après un récit de l’architecte Poyet à son confrère Baccarit, le cardinal aurait touché, dès le mois de juillet 1779, 50,000 écus sur la vente des terrains; le fait serait important, mais il ne repose pas sur une preuve certaine, et, comme l’avoue Baccarit lui-même, il ne suffit pas de savoir que le cardinal a placé à cette époque, par un intermédiaire, une somme de 341,667 l. sur la caisse de Poissy pour en conclure que cet argent provenait de la vente des Quinze-Vingts.
Il est vrai que le bruit d’un pot-de-vin payé par les acquéreurs s’était répandu avec insistance, mais il est démenti par une déclaration sous forme authentique de ces mêmes acquéreurs, qui protestent n’avoir versé d’autre pot-de-vin qu’une somme de 20,000 l. demandée par le cardinal «pour des emplois connus, dignes de sa bonté.» Il s’agit là sans doute d’un avantage que d’après la déposition de Laugier, ministre de l’hôpital, le prince de Rohan avait promis de réclamer pour les aveugles. Maynier avait aussi déclaré qu’on accusait le grand aumônier d’avoir touché 300,000 l.; il semble assez probable que cette allégation, dont la preuve n’est fournie nulle part, avait son origine dans la clause de la vente qui prescrivait d’ajouter aux six millions une indemnité de 312,000 l., représentative des loyers de l’enclos.
Si le cardinal avait parlé tout d’abord d’un prix de 6,600,000 l., il ne s’agissait là, d’après lui, que d’un projet, et ses déclarations officielles n’ont jamais annoncé qu’une soumission de 6 millions.
On rencontre ensuite une objection spécieuse qui pourrait, à première vue, faire croire à une fraude. Quand il fallut approprier l’hôtel des Mousquetaires à sa nouvelle destination, Baccarit proposa un devis de 160,000 l., qui, jugé trop élevé par le grand aumônier, fut remplacé par un projet d’un autre architecte ne montant qu’à 110,000 l.; puis, peu de temps après, l’abbé Georgel ordonna à Baccarit, de la part du cardinal, de composer un devis s’élevant à environ un million.
En réalité, cette exagération si flagrante s’explique facilement par le besoin qu’avait à cette époque le cardinal de justifier de dépenses très importantes pour obtenir la délivrance des 450,000 l. dues par l’État sur les produits de la loterie de Piété.
Reste une dernière question plus difficile à élucider. Les lettres patentes n’autorisaient à vendre que les bâtiments dépendant de l’hôpital; cependant on y comprit deux maisons de la rue Saint-Honoré qui ne touchaient pas à l’enclos. Cette opération irrégulière paraîtrait d’autant plus suspecte s’il était exact que le grand aumônier fût intéressé dans la société Séguin, comme le prétendaient ses adversaires, mais rien ne saurait le prouver; il est bien vrai qu’il avait primitivement réservé quatre actions à Prieur, une de ses créatures, mais celui-ci les refusa, et les associés reconnurent que, si Prieur était admis à leurs réunions, ce n’était pas à titre de sociétaire, mais simplement pour surveiller une affaire qui touchait indirectement aux intérêts de l’hôpital.
De toutes ces accusations, on ne peut donc retenir avec certitude que le mépris manifesté par le prince pour les administrateurs et une irrégularité commise dans l’interprétation du contrat. C’est en vain qu’on tenta d’amener un rapprochement entre les parties; le roi ayant répondu au Parlement, au mois de septembre 1784, que tout ce qui s’était passé avait été exécuté par ses ordres, de troisièmes et itératives remontrances furent publiées en 1785, mais sans plus de résultat. La disgrâce du cardinal, au moment du procès du collier, provoqua un nouvel examen de sa gestion par le conseil, qui vérifia les comptes des deniers employés à la translation.
Ces comptes étaient assez compliqués, car il semblerait que tout concourût à plaisir à obscurcir l’affaire. Les acquéreurs du terrain, n’ayant pas à leur disposition les capitaux nécessaires pour effectuer leurs premiers paiements, contractèrent à Gênes un emprunt de 4 millions garanti par l’État français; les Génois ne se contentèrent pas d’une hypothèque sur les terrains; ils exigèrent des acquéreurs la présentation d’une quittance justifiant du paiement d’un million au domaine et d’un million aux Quinze-Vingts; la difficulté fut tournée au moyen de quittances fictives; l’État fut payé en papier, le cardinal signa, le 15 juillet 1780, un reçu d’un million, mais, par une contre-lettre de 1784, les parties reconnurent qu’en réalité, le versement en espèces n’était que de 430,000 l.; la société n’était donc pas encore libérée envers les Quinze-Vingts; seulement, le million n’étant exigible qu’en 1784, l’hôpital en redevait les intérêts pendant quatre ans, et 166,000 l. furent passées à cet effet en compensation par les acquéreurs.
Un examen des pièces justificatives du compte fut fait par le conseil, qui les approuva par arrêt du 22 avril 1786. Si l’on observe la défaveur où était tombé le cardinal et l’animosité que lui portait le baron de Breteuil, qui présidait à la vérification, on est tenté d’accepter sans réserve cette décision; mais une autre considération vient jeter des doutes sur l’impartialité du jugement: le conseiller rapporteur n’était autre en effet que de Tolozan, un des nouveaux administrateurs de l’hôpital, qui avait intérêt à justifier les opérations.
Quoi qu’il en soit, les chiffres apportés semblent exacts. Voici le résumé de ce qui touche à l’emploi du sixième million dû par la société Séguin à l’hôpital:
«Ce million était payable par les acquéreurs des Quinze-Vingts, aux termes de leur contrat, le 1er juillet 1784.
Emploi.
Il est juste de remarquer que, si ce compte est sincère, il ne concorde pas avec celui que l’abbé Georgel avait soumis au comte de Vergennes après l’arrêt de 1783, et où les frais de «transports, réparations, constructions» étaient portés à 415,000 l.; on est donc en droit de reprocher au cardinal au moins une grande irrégularité dans sa comptabilité pendant les premiers temps de son administration.
On voit que le grand aumônier n’a pas fait intervenir l’hôpital dans la convention conclue avec les acquéreurs au sujet du paiement anticipé de 1780; les 430,000 l. furent versées à la caisse de Rohan, qui les prêta à intérêts aux Quinze-Vingts; cette opération, qui pourrait à première vue faire croire à une spéculation, n’a pas en somme ce caractère, puisque le cardinal représenta en 1784 le million tout entier et qu’il dut, de son côté, payer les intérêts aux sociétaires.
On ne pouvait donc se plaindre que du peu de rigueur avec lequel il avait poursuivi l’acquittement des 312,000 l., mais il invoqua comme excuse un motif d’humanité. Il est à croire d’ailleurs que les sociétaires avaient de bonnes raisons pour ne pas payer, car la spéculation ne semble pas avoir réussi, et c’est ce qui explique pourquoi on fut obligé de leur laisser en prêt une partie du million. Une fois en possession des terrains, les acheteurs y pratiquèrent le percement des rues indiquées par le plan joint à l’exemplaire des lettres patentes et aujourd’hui perdu; c’étaient les rues de Chartres, de Montpensier, de Beaujolais, des Quinze-Vingts et enfin de Rohan, la seule qui subsiste aujourd’hui pour rappeler le souvenir des aveugles dans ce quartier qu’ils avaient habité durant cinq siècles.
Les acquéreurs conservèrent sans doute le plus grand nombre possible des maisons qui venaient d’être bâties par les Quinze-Vingts , mais le nouvel aménagement des lieux exigea de grands travaux; le 25 novembre 1781, les sociétaires avaient déjà payé aux ouvriers 1,022,891 l. et en devaient encore 618,190; les dépenses continuèrent pendant plusieurs années, comme le prouvent les règlements d’experts conservés aux Archives nationales.
De plus, des difficultés s’élevèrent avec l’archevêque de Paris, qui, prétendant que la majeure partie des bâtiments dépendaient de sa directe, réclama les droits de lods et ventes, dont le contrat avait été affranchi, parce qu’on considérait ce terrain comme situé dans la censive du roi.
Le Parlement fit droit à cette réclamation (5 juillet 1785), et l’archevêque fit saisir les loyers; le domaine ayant attaqué l’arrêt, les loyers furent mis sous séquestre jusqu’à une décision définitive. Émus de ces événements, les Génois, qui n’étaient pas payés de leurs intérêts, se plaignirent au gouvernement français de les avoir engagés dans cette affaire. Pour faire honneur à sa parole, le roi, par arrêt du Conseil du 8 février 1787, prit à sa charge l’emprunt contracté à Gênes et déclara que les loyers resteraient sous séquestre jusqu’à complet désintéressement des privilégiés. Le 18 juin 1792, un compromis intervint entre le trésor et les acquéreurs des terrains, mais nous ne savons pas quelle en était la teneur.
Les sociétaires tentèrent de sortir de ces difficultés pécuniaires en faisant intervenir leurs vendeurs. Ils réclamèrent aux Quinze-Vingts une partie de leurs déboursés, parce que le rendement des loyers, sur lesquels avait été calculée l’indemnité de 312,000 l., n’avait pas tenu ce qui avait été promis.
Ces complications furent exploitées par les ennemis du cardinal de Rohan, qui s’adressèrent en 1790 à l’assemblée nationale pour faire réformer les arrêts rendus contre eux; la requête qu’ils présentèrent, et qui jusqu’ici a servi de base aux jugements portés sur cette affaire, reproduit toutes les accusations que nous avons déjà exposées; elle demande compte en outre au cardinal du million que les acquéreurs, répudiant la contre-lettre de 1784, prétendaient avoir versé intégralement; elle suppose que, si l’État a pris à sa charge l’emprunt fait aux Génois, c’est que la société ne lui avait rien payé et que, par conséquent, la rente de 250,000 l. ne repose sur aucun fondement et n’est qu’une libéralité du trésor; elle en demande compte au cardinal, qu’elle accuse d’être intéressé dans la société. Ces allégations, tirées du compte de Necker, sont présentées d’une façon injuste, puisque la requête oublie de reconnaître que l’État a pris pour gage des terrains dont la valeur, déjà considérable, ne fera qu’augmenter et comblera la perte que la reprise de l’emprunt impose momentanément au domaine.
Telles sont les pièces qui nous restent de ce long et obscur procès. On n’y trouve rien qui autorise d’une façon certaine à mettre en doute l’honnêteté du cardinal, et on doit reconnaître qu’il introduisit dans l’hôpital d’utiles innovations; mais on peut lui reprocher sévèrement l’imprudence qui le fit s’engager seul dans cette opération compliquée et le peu de soin avec lequel il surveilla l’emploi des deniers, qu’il avait été bien aise d’avoir quelque temps à sa disposition.
Les lettres qui nous restent de lui reflètent avec exactitude cet esprit léger; en 1779, à peine a-t-il conçu l’idée de la vente qu’il en parle comme d’un fait accompli à un ministre qui ne sait même pas ce dont il s’agit.
Après que sa hauteur envers les administrateurs et son défaut d’ordre l’ont amené dans une difficile impasse, on l’entend tour à tour exprimer son dépit contre «l’affaire des Quinze-Vingts, cette insupportable affaire, de misère et de bettise qu’elle étoit, devenue une affaire majeure;» puis témoigner son indignation, quand il écrit au comte de Vergennes: «Je vous prie de vous souvenir que celui qui se plaint aujourd’hui et qui est forcé de demander justice a gardé le silence pendant quatre ans, et, parce qu’il est modéré, on a cru que l’on pouvoit l’attaquer impunément.»
Ce n’est qu’après que la disgrâce l’a atteint qu’il consent à reconnaître son inexpérience et à demander des conseils:
«Comme souvent, avoue-t-il au directeur des Quinze-Vingts, des manques de formes ou des clauses insidieusement mises dans les actes peuvent servir à la fraude qui sait préparer de pareilles ressources, je voudrois que vous me fissiez le plaisir de me marquer ce qui peut vous faire naître quelques doutes.»
En somme, nous croyons que la satire suivante, malgré les accusations injustes qu’elle renferme, dépeint, sous des couleurs assez vraies, une partie du rôle que le cardinal Rohan joua vis-à-vis des Quinze-Vingts. Voici le «petit conte oriental» que l’auteur inconnu de ce pamphlet prête à la comtesse. de Marsan:
«Haron-Chek de la Mecque, et de père en fils desservant une célèbre mosquée, obtint un regard favorable du sultan, qui lui valut la charge de distributeur de ses aumônes; à ce titre, il régis-soit une maison d’Aveugles que jadis un prince Ginguisien avoit dotée de 80 bourses pour leur entretien. Haron, noble, beau, capricieux, sans science ni jugement, mais ambitieux et prodigue, se livra sans mesure à toutes ses passions. Là, il exerçoit les concussions d’un Pacha, les vexations d’un Boyard; ici, sans respect pour le Coran, il avoit des Harems de tous les ordres; sa vie publique étoit d’un tel faste qu’elle insultoit à la modestie de celle du Sultan, sans qu’il en redoutât la sévérité ; il avoit dans ses intérêts le Mufti, premier comédien de l’Empire, ne se plaisant qu’à jouer le Sultan, les peuples et les rois. Les grandes richesses d’Haron ne furent bientôt plus proportionnées à ses énormes dépenses; il usa de ressources, il imagina de vendre les fonds des pauvres, sous prétexte d’en doubler le revenu en déposant les capitaux dans le Hasné du souverain, mais en réalité pour en détourner le plus possible. Le Mufti agréa tout et jura d’en soutenir l’exécution, à quelque prix que ce fût. On méprisa toutes les formes, on vendit pour 4,000 bourses, à charge d’en remettre les trois quarts au Hasné et d’employer le reste; mais, le marché une fois conclu, il n’y eut que la moitié des conditions exécutées; le surplus de l’argent fut consumé en fêtes. Le corps des Ulmats représenta le désordre au sultan; le Mufti intercepta leurs représentations et les traita de rebelles; ils recommencèrent et dévoilèrent des horreurs; le Mufti, écumant de colère, leur répondit avec menaces que cela n’avoit été fait que par les ordres du Grand Seigneur..... Haron conçut le projet de réduire tout au silence et de maîtriser jusqu’à la fortune: son imagination exaltée l’avoit entraîné dans les chimères de l’alchymie, il avoit à ses côtés le Muned-gin-bachi, juif d’origine, qui le mystifioit nuit et jour; il ne rêvoit plus qu’or et pierreries, il venoit d’établir chez ses Aveugles une fabrique de diamans par des Juifs, et le Muned-gin, grand décompositeur, promettoit l’or à plein creuset...» Le conte expose alors l’affaire du collier et se termine par le récit du renvoi de Haron, «qu’on a jugé encore plus fol que fripon.»
Quels qu’eussent été les torts immédiats du grand aumônier en cette occasion, les conséquences de l’opération qu’il accomplit furent déplorables pour les Quinze-Vingts.
Non seulement les terrains vendus en 1779 ont acquis depuis une valeur, qu’on ne pouvait pas prévoir à cette époque, et qui n’a plus aucune relation avec le montant invariable de la rente de 250,000 l. promise par l’État, mais cette rente elle-même n’existe plus à proprement parler. Les événements que nous avons retracés en retardèrent la constitution régulière, bien qu’elle fût officiellement reconnue, comme le constate le compte de Necker en 1789.
La Révolution refusa de la ratifier comme rente et se contenta de servir à titre de subvention cette somme de 250,000 francs.
L’établissement a donc aujourd’hui perdu l’indépendance que lui assurait sa richesse et qui est si utile aux institutions charitables. Au lieu d’être considéré comme créancier de l’État, il n’en reçoit plus qu’une simple allocation, dont le caractère est toujours un peu précaire, comme le prouve la diminution de 40,000 francs par an qu’elle a subie depuis 1831 jusqu’à 1849.