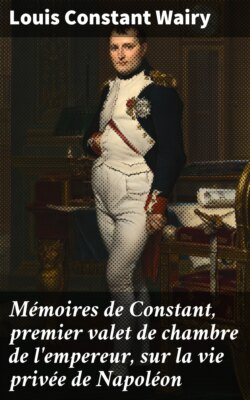Читать книгу Mémoires de Constant, premier valet de chambre de l'empereur, sur la vie privée de Napoléon - Louis Constant Wairy - Страница 25
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE X.
ОглавлениеTable des matières
Influence du voyage en Normandie sur l'esprit du premier consul.—La génération de l'empire.—Les mémoires et l'histoire.—Premières dames et premiers officiers de Madame Bonaparte.—Mesdames de Rémusat, de Tallouet, de Luçay, de Lauriston.—Mademoiselle d'Alberg, et Mademoiselle de Luçay.—Sagesse à la cour.—MM. de Rémusat, de Cramayel, de Luçay, Didelot.—Le palais refusé, puis accepté.—Les colifichets.—Les serviteurs de Marie-Antoinette, mieux traités sous le consulat que depuis la restauration.—Incendie au château de Saint-Cloud.—La chambre de veille.—Le lit bourgeois.—Comment le premier consul descendait la nuit chez sa femme.—Devoir et triomphe conjugal.—Le galant pris sur le fait.—Sévérité excessive envers une demoiselle.—Les armes d'honneur et les troupiers.—Le baptême de sang.—Le premier consul conduisant la charrue.—Les laboureurs et les conseillers d'état.—Le grenadier de la république devenu laboureur.—Audience du premier consul.—L'auteur l'introduit dans le cabinet du général.—Bonne réception et conversation curieuse.
Le voyage du premier consul dans les départemens les plus riches et les plus éclairés de France, avait dû aplanir dans son esprit bien des difficultés qu'il avait peut-être craint de rencontrer d'abord dans l'exécution de ses projets. Partout il avait été reçu comme un monarque; et non-seulement lui, mais madame Bonaparte elle-même avait été accueillie avec tous les honneurs ordinairement réservés aux têtes couronnées. Il n'y a eu aucune différence entre les hommages qui leur furent rendus alors, et ceux dont ils ont été entourés depuis et même sous l'empire, lors des voyages que leurs Majestés firent dans leurs états à diverses époques. Voilà pourquoi je suis entré dans quelques détails sur celui-ci; s'ils paraissent trop longs ou trop dépourvus de nouveauté à quelques lecteurs, je les prie de se souvenir que je n'écris pas seulement pour ceux qui ont vu l'empire. La génération qui fut témoin de tant de grandes choses et qui a pu envisager de près, et dès ses commencemens, le plus grand homme de ce siècle, fait déjà place à d'autres générations qui ne peuvent et ne pourront juger que sur le dire de celle qui les a précédées. Ce qui est familier pour celle-ci, qui a jugé par ses yeux, ne l'est pas pour les autres, qui ont besoin qu'on leur raconte ce qu'elles n'ont pu voir. De plus, les détails négligés comme futiles et communs par l'histoire, qui fait profession de gravité, conviennent parfaitement à de simples souvenirs, et font parfois bien connaître et juger cette époque. Il me semble, par exemple, que l'empressement de toute la population et des autorités locales auprès du premier consul et de madame Bonaparte, pendant leur voyage en Normandie, montre assez que le chef de l'état n'aura point à craindre une bien grande opposition, du moins de la part de la nation, lorsqu'il lui plaira de changer de titre et de se proclamer empereur.
Peu de temps après notre retour, une décision des consuls accorda à madame Bonaparte quatre dames pour lui aider à faire les honneurs du palais. C'étaient mesdames: de Rémusat, de Tallouet, de Luçay et de Lauriston. Sous l'empire, elles devinrent dames du palais; madame de Luçay faisait souvent rire les personnes de la maison par de petits traits de parcimonie; mais elle était bonne et obligeante. Madame de Rémusat était une femme du plus grand mérite et d'excellent conseil. Elle paraissait un peu haute, et cela se remarquait d'autant plus que M. de Rémusat était plein de bonhomie.
Dans la suite, il y eut une dame d'honneur, madame de La Rochefoucault, dont j'aurai occasion de parler plus tard;
Une dame d'atours, madame de Luçay, qui fut remplacée par madame de La Vallette, si glorieusement connue depuis par son dévouement à son époux;
Vingt-quatre dames du palais, françaises, parmi lesquelles: mesdames de Rémusat, de Tallouet, de Lauriston, Ney, d'Arberg, Louise d'Arberg, depuis madame la comtesse de Lobau, de Walsh-Sérent, de Colbert, Lannes, Savary, de Turenne, Octave de Ségur, de Montalivet, de Marescot, de Bouille, Solar, Lascaris, de Brignolé, de Canisy, de Chevreuse, Victor de Mortemart, de Montmorency, Matignon et Maret;
Douze dames du palais, italiennes;
Ces dames prenaient le service tous les mois, de manière qu'il y eût toujours ensemble une Italienne et deux Françaises. L'empereur ne voulait pas d'abord de demoiselles parmi les dames du palais, mais il se relâcha de cette règle pour mademoiselle Louise d'Arberg, depuis madame la comtesse de Lobau, et mademoiselle de Luçay, qui a épousé M. le comte Philippe de Ségur, auteur de la belle histoire de la campagne de Russie. Ces deux demoiselles, par leur conduite prudente et réservée, ont prouvé que l'on peut être très-sage, même à la cour;
Quatre dames d'annonce, mesdames Soustras, Ducrest-Villeneuve, Félicité Longroy et Eglé Marchery;
Deux premières femmes de chambre, mesdames Roy et Marco de Saint-Hilaire, qui avaient sous leur direction la grande garde-robe et le coffre aux bijoux;
Quatre femmes de chambre ordinaires;
Une lectrice;
En hommes, le personnel de la maison de Sa Majesté l'impératrice se composa dans la suite de:
Un premier écuyer, M. le sénateur Harville, remplissant les fonctions de chevalier d'honneur;
Un premier chambellan, M. le général de division Nansouty;
Un second chambellan, introducteur des ambassadeurs, M. de Beaumont;
Quatre chambellans ordinaires, M. de Courtomer, Degrave, Galard de Béarn, Hector d'Aubusson de La Feuillade;
Quatre écuyers cavalcadours, MM. Corbineau, Berckheim, d'Audenarde et Fouler;
Un intendant général de la maison de Sa Majesté, M. Hinguerlot;
Un secrétaire des commandemens, M. Deschamps;
Deux premiers valets de chambre, MM. Frère et Douville;
Quatre valets de chambre ordinaires;
Quatre huissiers de la chambre;
Deux premiers valets de pied, MM. Lespérance et d'Argens;
Six valets de pied ordinaires;
Les officiers de bouche et de santé étaient ceux de la maison de l'empereur. En outre, six pages de l'empereur étaient toujours de service auprès de l'impératrice.
Le premier aumônier était M. Ferdinand de Rohan, ancien archevêque de Cambray.
Une autre décision de la même époque fixa les attributions des préfets du palais. Les quatre premier préfets du palais consulaire furent MM. de Rémusat, de Cramayel, plus tard nommé introducteur des ambassadeurs et maître des cérémonies; de Luçay, et Didelot, depuis préfet du Cher.
La Malmaison ne suffisait plus au premier consul, dont la maison, comme celle de madame Bonaparte, devenait de jour en jour plus nombreuse. Une demeure beaucoup plus étendue était devenue nécessaire, et le choix du premier consul s'était fixé sur Saint-Cloud.
Les habitans de Saint-Cloud avaient adressé une pétition au corps législatif, pour que le premier consul voulût bien faire de leur château sa résidence d'été, et l'assemblée s'était empressée de la transmettre au premier consul, en l'appuyant même de ses prières, et de comparaisons qu'elle croyait flatteuses. Le général s'y refusa formellement, en disant que quand il se serait acquitté des fonctions dont le peuple l'avait chargé, il s'honorerait d'une récompense décernée par le peuple; mais que tant qu'il serait chef du gouvernement, il n'accepterait jamais rien. Malgré le ton de détermination de cette réponse, les habitans de Saint-Cloud, qui avaient le plus grand intérêt à ce que leur demande fût accueillie, la renouvelèrent lorsque le premier consul fut nommé consul à vie, et il consentit cette fois à l'accepter. Les dépenses pour les réparations et l'ameublement furent immenses, et surpassèrent de beaucoup les calculs qu'on lui avait faits, encore fut-il mécontent des meubles et des ornemens. Il se plaignit à M. Charvet, concierge de la Malmaison, qu'il avait nommé concierge de ce nouveau palais, et qu'il avait chargé de présider à la distribution des pièces et de surveiller l'ameublement, qu'on lui avait fait des appartemens comme pour une fille entretenue; qu'il n'y avait que des colifichets, des papillottes, et rien de sérieux. Il donna encore en cette occasion une preuve de son empressement à faire le bien, sans s'inquiéter de préjugés qui avaient encore beaucoup de force. Sachant qu'il y avait à Saint-Cloud un grand nombre d'anciens serviteurs de la reine Marie-Antoinette, il chargea M. Charvet de leur proposer, soit leurs anciennes places, soit des pensions; la plupart reprirent leurs places. En 1814, on fut bien loin d'agir aussi généreusement. Tous les employés furent renvoyés, ceux même qui avaient servi Marie-Antoinette.
Il n'y avait pas long-temps que le premier consul s'était installé à Saint-Cloud, lorsque ce château, redevenu résidence souveraine à frais énormes, faillit être la proie des flammes. Il y avait un corps-de-garde sous le vestibule du centre du palais. Une nuit que les soldats avaient fait du feu outre mesure, le poêle devint si brûlant qu'un fauteuil qui se trouvait adossé à une des bouches qui chauffaient le salon prit feu, et la flamme se communiqua promptement à tous les meubles. L'officier du poste s'en étant aperçu, prévint aussitôt le concierge, et ils coururent à la chambre du général Duroc, qu'ils réveillèrent. Le général se leva en toute hâte, et recommandant aussitôt le plus grand silence, on organisa une chaîne. Il se mit lui-même dans le bassin, ainsi que le concierge, passant des seaux d'eau aux soldats, et en deux ou trois heures le feu, qui avait déjà dévoré tous les meubles, fut éteint. Ce ne fut que le lendemain matin que le premier consul, Joséphine, Hortense, tous les habitans enfin du château, apprirent cet accident, et témoignèrent tous, le premier consul surtout, leur satisfaction de l'attention qu'on avait mise à ne pas les réveiller. Pour prévenir, ou au moins rendre moins dangereux à l'avenir de pareils accidens, le premier consul fit organiser une garde de nuit à Saint-Cloud, et, dans la suite, dans toutes ses résidences. On appelait cette garde chambre de veille.
Dans les premiers temps que le premier consul habitait le palais de Saint-Cloud, il couchait dans le même lit que sa femme. Plus tard, l'étiquette survint, et, sous ce rapport, refroidit un peu la tendresse conjugale. En effet, le premier consul finit par habiter un appartement assez éloigné de celui de madame Bonaparte. Pour se rendre chez elle, il fallait qu'il traversât un grand corridor de service. À droite et à gauche habitaient les dames du palais, les dames de service, etc. Lorsque le premier consul voulait passer la nuit avec sa femme, il se déshabillait chez lui, d'où il sortait en robe de chambre et coiffé d'un madras. Je marchais devant lui, un flambeau à la main. Au bout de ce corridor était un escalier de quinze à seize marches, qui conduisait à l'appartement de madame Bonaparte. C'était une grande joie pour elle quand elle recevait la visite de son mari; toute la maison en était instruite le lendemain. Je la vois encore dire à tout venant, en frottant ses petites mains: «Je me suis levée tard aujourd'hui, mais, voyez-vous, c'est que Bonaparte est venu passer la nuit avec moi.» Ce jour-là elle était plus aimable encore que de coutume; elle ne rebutait personne, et on en obtenait tout ce qu'on voulait. J'en ai fait pour ma part bien des fois l'épreuve.
Un soir que je conduisais le premier consul à une de ces visites conjugales, nous aperçûmes dans le corridor un jeune homme bien mis qui sortait de l'appartement d'une des femmes de madame Bonaparte. Il cherchait à s'esquiver, mais le premier consul lui cria d'une voix forte: Qui est là? où allez-vous? que faites-vous? quel est votre nom? C'était tout simplement un valet de chambre de madame Bonaparte. Stupéfait de ces interrogations précipitées, il répondit d'une voix effrayée qu'il venait de faire une commission pour madame Bonaparte. «C'est bien, reprit le premier consul, mais que je ne vous y reprenne pas.» Persuadé que le galant profiterait de la leçon, le général ne chercha point à savoir son nom ni celui de sa belle.
Cela me rappelle qu'il fut beaucoup plus sévère à l'égard d'une autre femme de chambre de madame Bonaparte. Elle était jeune et très-jolie, et inspira des sentimens fort tendres à deux aides-de-camp, MM. R... et E.... Ils soupiraient sans cesse à sa porte, lui envoyaient des fleurs et des billets doux. La jeune fille, du moins telle fut l'opinion générale de la maison, ne les payait d'aucun retour. Joséphine l'aimait beaucoup, et pourtant le premier consul s'étant aperçu des galanteries de ces messieurs, se montra fort en colère, et fit chasser la pauvre demoiselle, malgré ses pleurs et malgré les prières de madame Bonaparte et celles du brave et bon colonel R..., qui jurait naïvement que la faute était toute de son côté, que la pauvre petite ne méritait que des éloges, et ne l'avait point écouté. Tout fut inutile contre la résolution du premier consul, qui répondit à tout en disant: «Je ne veux point de désordre chez moi, point de scandale.»
Lorsque le premier consul faisait quelque distribution d'armes d'honneur, il y avait aux Tuileries un banquet auquel étaient admis indistinctement, quels que fussent leurs grades, tous ceux qui avaient eu part à ces récompenses. À ces dîners, qui se donnaient dans la grande galerie du château, il y avait quelquefois deux cents convives. C'était le général Duroc qui était le maître des cérémonies, et le premier consul avait soin de lui recommander d'entremêler les simples soldats, les colonels, les généraux, etc. C'était surtout les premiers qu'il ordonnait aux domestiques de bien soigner, de bien faire boire et manger. Ce sont les repas les plus longs que j'aie vu faire à l'empereur; il y était d'une amabilité, d'un laissez-aller parfaits; il faisait tous ses efforts pour mettre ses convives à leur aise; mais pour un grand nombre d'entre eux, il avait bien de la peine à y parvenir. Rien n'était plus drôle que de voir ces bons troupiers, se tenant à deux pieds de la table, n'osant approcher ni de leur serviette ni de leur pain; rouges jusqu'aux oreilles, et le cou tendu du côté de leur général, comme pour recevoir le mot d'ordre. Le premier consul leur faisait raconter le haut fait qui leur valait la récompense nationale, et riait quelquefois aux éclats de leurs singulières narrations. Il les engageait à bien manger, buvant quelquefois à leur santé; mais pour quelques-uns, ses encouragemens échouaient contre leur timidité, et les valets de pied leur enlevaient successivement leurs assiettes sans qu'ils y eussent touché. Cette contrainte ne les empêchait pas d'être pleins de joie et d'enthousiasme en quittant la table. «Au revoir, mes braves, leur disait le premier consul, baptisez-moi bien vite ces nouveau-nés-là» (montrant du doigt leurs sabres d'honneur). Dieu sait s'ils s'y épargnaient.
Cette bienveillance du premier consul pour de simples soldats me rappelle une anecdote arrivée à la Malmaison, et qui répond encore à ces reproches de hauteur et de dureté qu'on lui a faits.
Le premier consul sortit un jour de grand matin, vêtu de sa redingote grise et accompagné du général Duroc, pour se promener du côté de la machine de Marly. Comme ils marchaient en causant, ils virent un laboureur qui traçait un sillon en venant de leur côté.—Dites donc, mon brave homme (dit le premier consul en s'arrêtant), votre sillon n'est pas droit, vous ne savez donc pas votre métier?—Ce n'est toujours pas vous, mes beaux messieurs, qui me l'apprendrez; vous seriez encore assez embarrassés pour en faire autant.—Parbleu non!—Vous croyez: eh bien! essayez, reprit le brave homme en cédant sa place au premier consul. Celui-ci prit le manche de la charrue, et, poussant les chevaux, voulut commencer la leçon; mais il ne fit pas un seul pas en droite ligne, tant il s'y prenait mal.—Allons, allons, dit le paysan en mettant sa main sur celle du général, pour reprendre sa charrue, votre besogne ne vaut rien: chacun son métier; promenez-vous, c'est votre affaire. Mais le premier consul ne continua pas sa promenade sans payer la leçon de morale qu'il venait de recevoir du laboureur: le général Duroc lui remit deux ou trois louis pour le dédommager de la perte de temps qu'on lui avait causée. Le paysan, étonné de cette générosité, quitte sa charrue pour aller conter son aventure, et rencontre en chemin une femme à laquelle il conte qu'il croit bien avoir rencontré deux gros messieurs, à en juger parce qu'il avait encore dans sa main. La fermière, mieux avisée, lui demanda quel était le costume des promeneurs, et d'après la description qu'il lui en fit, elle devina que c'était le premier consul et quelqu'un des siens. Le bon homme fut quelque temps interdit; mais le lendemain, il se prit d'une belle résolution, et s'étant paré de ses plus beaux habits, il se présenta à la Malmaison, demandant à parler au premier consul, pour le remercier, disait-il, du beau cadeau qu'il lui avait fait la veille[8].
J'allai avertir le premier consul de cette visite, et il me donna l'ordre d'introduire le laboureur. Celui-ci, pendant que j'étais sorti pour l'annoncer, avait, suivant sa propre expression, pris son courage à deux mains, pour se préparer à cette grande entrevue. Je le retrouvai debout au milieu de l'antichambre (car il n'avait osé s'asseoir sur les banquettes, qui, bien que des plus simples, lui paraissaient magnifiques); et songeant à ce qu'il allait dire au premier consul pour lui témoigner sa reconnaissance. Je marchai devant lui, il me suivait en posant avec précaution le pied sur le tapis, et lorsque je lui ouvris la porte du cabinet, il me fit des civilités pour me faire entrer le premier. Lorsque le premier consul n'avait rien de secret à dire ou à dicter, il laissait assez volontiers la porte de son cabinet ouverte. Il me fit signe cette fois de ne point la fermer, de sorte que je pus voir et entendre tout ce qui se passait.
L'honnête laboureur commença, en entrant dans le cabinet, par saluer le dos de M. de Bourrienne, qui ne pouvait le voir, occupé qu'il était à écrire sur une petite table de travail placée dans l'embrasure de la fenêtre. Le premier consul le regardait faire ses saluts, renversé en arrière dans son fauteuil, dont, suivant une vieille habitude, il travaillait un des bras avec la pointe de son canif. À la fin pourtant il prit ainsi la parole:
—Eh bien, mon brave (le paysan se retourna, le reconnut et salua de nouveau). Eh bien, poursuivit le premier consul, la moisson a été belle cette année?
—Mais, sauf votre respect, citoyen mon général, pas trop mauvaise comme çà.
—Pour que la terre rapporte, reprit le premier consul, il faut qu'on la remue, n'est-il pas vrai? Les beaux messieurs ne valent rien pour cette besogne-là.
—Sans vous offenser, mon général, les bourgeois ont la main trop douce pour manier une charrue. Il faut une poigne solide pour remuer ces outils-là.
—C'est vrai, répondit en souriant le premier consul. Mais grand et fort comme vous êtes, vous avez dû manier autre chose qu'une charrue. Un bon fusil de munition, par exemple, ou bien la poignée d'un bon sabre.
Le laboureur se redressa avec un air de fierté: «—Général, dans le temps j'ai fait comme les autres. J'étais marié depuis cinq ou six ans, lorsque ces b..... de Prussiens (pardon, mon général) entrèrent à Landrecies. Vint la réquisition; ou me donna un fusil et une giberne à la maison commune, et marche! Ah dame, nous n'étions pas équipés comme ces grands gaillards que je viens de voir en entrant dans la cour.»
Il voulait parler des grenadiers de la garde consulaire.
—Pourquoi avez-vous quitté le service? reprit le premier consul, qui paraissait prendre beaucoup d'intérêt à cette conversation.
—Ma foi, mon général, à chacun son tour. Il y avait des coups de sabre pour tout le monde. Il m'en tomba un là (le digne laboureur se baissa montrant sa tête, et écartant ses cheveux), et après quelques semaines d'ambulance, on me donna mon congé pour revenir à ma femme et à ma charrue.
—Avez-vous des enfans?
—J'en ai trois, mon général; deux garçons et une fille.
—Il faut faire un militaire de l'aîné de vos garçons. S'il se conduit bien, je me chargerai de lui. Adieu, mon brave; quand vous aurez besoin de moi, revenez me voir. Là-dessus, le premier consul se leva, se fit donner, par M. de Bourrienne, quelques louis qu'il ajouta à ceux que le laboureur avait déjà reçus de lui, et me chargea de le reconduire. Nous étions déjà dans l'antichambre, lorsque le premier consul rappela le paysan pour lui dire:
—Vous étiez à Fleurus?
- Oui, mon général.
—Pourriez-vous me dire le nom de votre général en chef?
—Je le crois bien, parbleu! c'était le général Jourdan.
—C'est bien; au revoir. Et j'emmenai le vieux soldat de la république, enchanté de sa réception.