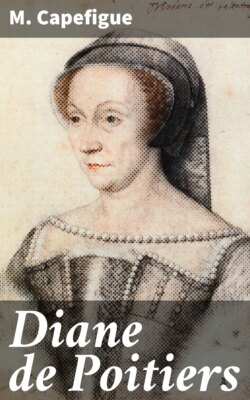Читать книгу Diane de Poitiers - M. Capefigue - Страница 6
IV
LA CHRONIQUE DE L'ARCHEVÊQUE TURPIN.—LE MONDE ENCHANTÉ.
1200-1510.
ОглавлениеCette impulsion vers les actions héroïques, toute la génération la recevait d'un livre populaire, d'une légende, la chronique de l'archevêque[26] Turpin, épopée traditionnelle sur Charlemagne. Ce ne sont, en général, qu'avec les glorieux mensonges, que les peuples sont conduits à l'héroïsme; les réalités n'ont jamais enfanté que la vie matérielle: les Grecs et les Romains eurent leurs fables des dieux et des demi-dieux, d'Hercule et de Mars, leurs temps qu'on appela héroïques; et les époques modernes, malgré leur prétention au réalisme, ont été conduites aux grandes actions par les épopées de leurs chroniques sur la Révolution et l'Empire. L'archevêque Turpin, il buon Turpino, tant invoqué par l'Arioste, avait écrit une légende sur Charlemagne, ses douze pairs, ses barons, ses paladins: on ne voyait partout que géants, nains, enchanteurs, nécromanciens et des exploits à faire croire qu'il existait alors une génération d'une nature particulière, invulnérable aux coups, qui ne mourait que d'une façon fabuleuse, qui ne tombait qu'en fendant les rochers à coups d'épée comme Roland à Roncevaux.
Ce n'étaient pas les paladins seuls qui avaient le privilége de l'épopée mais encore leurs chevaux de bataille, leurs armes enchantées; chaque chevalier d'une certaine renommée avait son coursier bien-aimé, d'une intelligence égale à celle de l'homme, doué de sens et de passions comme lui; la généalogie des chevaux, leur histoire était aussi connue que celle des héros. Chaque chevalier avait son coursier doté d'intelligence, d'une double vue; il s'arrêtait tout d'un coup, quand un danger menaçait son maître, il dressait les oreilles, soulevait la poussière, quand il approchait d'une embûche dressée par un enchanteur malfaisant, et les nobles chevaux de Roland, d'Otger le Danois, de Renaud de Montauban couraient à toute bride à travers les sentiers, les taillis sombres des forêts, pour les conduire à leurs maîtresses, Angélique, Bradamante, Marphise, qu'ils saluaient en s'agenouillant devant elles comme de doux agneaux[27].
Chaque pièce de l'armure d'un chevalier avait aussi sa tradition, son histoire: le cor enchanté qui retentissait à travers la campagne, la lance merveilleuse dont le simple contact renversait un cavalier; les paladins faisaient tant de prodiges qu'on pouvait croire qu'il y avait une âme dans chaque épée; toutes avaient leur nom, la Bonne Joyeuse, Durandal[28], Flamberge, qui pourfendaient des géants invulnérables, ou qui faisaient brèche dans la montagne, comme dans une molle argile. L'armure d'un paladin était sa gloire et son orgueil; son casque, sa cuirasse, son brassart le couvraient tout entier. On ne savait son nom, son origine, que par le blason qu'il portait: aux fleurs de lis, aux merlettes, aux ailerons, aux tourteaux, on savait sa famille; par les émaux et les barres, on savait aussi s'il était aîné, cadet, et même bâtard, à quelle maison il s'était allié. Chaque pièce de son écu était un souvenir de bataille ou d'action héroïque, et s'il était permis d'employer une expression moderne, le blason était comme le certificat de civisme au moyen-âge pour les grandes actions, ou bien une flétrissure pour la félonie; il était la garantie de la société féodale pour la défendre et la protéger[29].
Ce monde d'enchantement embrassait tout de ses créations merveilleuses: on était entouré de féeries, ces illusions charmantes qui trompent et amusent encore nos sociétés blasées. Les blessures même des chevaliers se guérissaient par des baumes enchantés; l'art de guérir les plaies profondes, les coups d'épées et de lances, entrait dans l'éducation des châtelaines, toutes si empressées auprès des chevaliers blessés[30]. On doit croire qu'il existait alors des secrets inconnus de nos jours, car tout se guérissait par des simples cueillis dans la campagne, ou par des baumes préparés dans chaque château, quand on ne recourait pas à l'art de quelque nécromancien ou enchanteur, tel que Maugis, le cousin des quatre fils Aymond, avec les bons tours qu'il joue à Charlemagne, ou Merlin, des légendes bretonnes. Quel que soit le jugement que l'on porte sur ce monde merveilleux, il est impossible de nier qu'il avait créé ce peuple de héros, cette belle lignée de chevaliers qui précéda le règne de François Ier. La chanson de Roland, entonnée par le hérault d'armes avant la bataille, depuis Guillaume-le-Conquérant[31] n'était-elle pas le résumé de l'épopée chevaleresque? et si les paladins faisaient de si grandes prouesses, c'est qu'ils avaient la pensée que leurs aïeux en avaient fait de plus grandes encore. Chaque génération, qui se propose de glorieux exploits, a sa légende, ses chansons de Roland; la démocratie a les siennes, aussi fières, aussi hardies que celle que récitait la chevalerie au moyen-âge.
Aussi, faut-il en vouloir à tous ces mauvais esprits qui raillent les nobles illusions, ou si l'on veut, les mensonges illustres des peuples: à travers ces belles banderolles de tournois, ces faisceaux d'épées et de lances, ces palais enchantés, on aperçoit la méchante figure de Rabelais, aux joues saillantes, aux yeux ronds, à l'expression ignoble; rien de bas, de commun, comme cette figure de Rabelais[32], telle que la peinture nous l'a conservée[33]; sa vie bouffonne et crapuleuse, il la consacre à détruire les croyances dorées, à se moquer des chevaliers loyaux: les illusions glorieuses pour le devoir, pour la patrie, il les place dans son île des lanternes; érudit, farci de grec et de latin, à la grosse panse, aux lèvres épaisses, aux yeux égrillards, avec ses doigts sales et crochus, il gratte les blasons, souille les étendards; les soldats ne sont plus que les moutons de Panurge, et dans sa langue inintelligible, il détruit les grandes causes d'orgueil pour les nations. Les époques modernes ne sont pas exemptes de leur Rabelais, natures mauvaises et égoïstes, qui tuent les poëmes épiques des peuples.