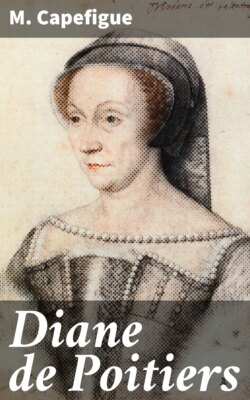Читать книгу Diane de Poitiers - M. Capefigue - Страница 9
VII
LÉONARD DE VINCI.—LA BELLE FERRONNIÈRE.
1515-1518.
ОглавлениеParmi les splendides conquêtes de François Ier en Italie, on doit compter la passion des arts qu'il y puisa comme à une source abondante, et le souvenir des merveilles de la Renaissance qu'il réunit autour de lui: à Rome, à Florence, à Milan, tout se réveillait alors au bruit des écoles de sculpture, de peinture, et François Ier s'enthousiasma pour les artistes surtout, qui souvent en Italie réunissaient les plus nobles instincts au génie.
Dans le rayonnement de la renaissance, apparaît une grande figure, celle de maître Léonard de Vinci, vieillard déjà; il était né dans une de ces villa qui entourent Florence[63], et Dieu l'avait doué d'une belle figure, d'une taille élevée et d'une force de corps si prodigieuse, qu'il ployait de ses doigts le fer d'un cheval aussi facilement qu'une lanière de cuir. A ces dons naturels, il joignait les soins de l'éducation la plus haute, la plus variée: la physique, les mathématiques, l'éloquence[64]. Il fut placé dans l'atelier du peintre André Verocchio, qu'il étonna et surpassa bientôt par ses progrès. A l'art du peintre, Léonard de Vinci joignait une pratique étonnante dans la fonte des métaux, la sculpture colossale[65] et même l'art de l'ingénieur qui construit les ponts, trace et creuse les canaux. Ludovic Sforza avait appelé à Milan pour décorer ses fêtes, ses spectacles, maître Léonard de Vinci, qui se révéla tout d'un coup comme un habile mécanicien: des planètes roulaient dans un ciel d'or, des lyres d'argent rendaient un son harmonieux par le seul effet de son art créateur, et le bruit s'en était répandu dans toute l'Italie.
A l'entrée de Louis XII à Milan, Léonard de Vinci avait construit un lion automate qui marchait seul, et, s'arrêtant devant le Roi, se dressa sur ses pattes pour lui offrir l'écusson fleurdelisé de France; et, quand le pape Léon X voyageait, maître Léonard avait façonné en bois, des petits oiseaux qui volaient et chantaient merveilleusement pour amuser et distraire le pontife. Mais l'œuvre admirable de Léonard de Vinci fut le tableau de la Cène qu'il entreprit pour le réfectoire des Dominicains, à la prière du grand duc Ludovic Sforza, suite de portraits de ses amis et de ses ennemis; la tête de Judas fut même une vengeance[66]. La tradition veut que maître Léonard ait laissé la tête du Christ inachevée, parce qu'il s'était épuisé dans le dessin de celles des apôtres, et qu'il n'avait pu atteindre un assez haut degré de perfection pour peindre le divin maître[67].
Cet artiste extraordinaire, François Ier se le fit présenter après la victoire de Marignan; il le prit en grande amitié, car maître Léonard était un charmant esprit, d'une éducation particulière, gracieux poëte dans la langue italienne. Quand Milan et Florence étaient si agités, la peinture devait s'exiler, et le roi de France avait alors de grands projets pour la construction de ses châteaux, l'embellissement de ses jardins, l'achèvement des canaux autour de la Loire. Il faut donc placer à la fin de cette année 1515 le départ de maître Léonard de Vinci pour Fontainebleau[68], où le Roi lui fit un grand accueil; il lui donna un appartement splendide au château d'Amboise. Léonard de Vinci s'occupa, comme ingénieur, à tracer le canal de Romorentin[69], à jeter ses idées sur les embellissements des demeures royales. C'est durant un de ses voyages à Paris, que Léonard composa le portrait un peu mystérieux, de la Joconde (Lisa del Giocondo), chef-d'œuvre tracé par l'ordre de François Ier. On dit que, pour distraire l'ennui que les longues séances pouvaient donner au modèle, Léonard de Vinci l'avait entourée de chanteurs, de joueurs d'instruments, d'improvisateurs et de poëtes, et c'est ainsi qu'il parvint à la perfection ravissante du portrait, à ce regard d'une joyeuse enfant qui se reflète dans le regard de la Lisa del Giocondo.
Nul n'a pu dire quelle a été la femme aimée de François Ier, qui a servi de modèle au portrait de la Joconde[70], et à ce sujet quelques conjectures me seront permises. Si l'on compare ce portrait à celui qui nous est resté de la belle Ferronnière, du même Léonard, on y trouve une certaine ressemblance dans les traits, malgré la différence des manières et des ornements de la chevelure. Il ne serait donc pas étonnant que le même type eût servi à deux portraits, et que Lisa del Giocondo ne fut que l'idéalisme de la belle Ferronnière. Je ne nie pas que, pour admettre cette hypothèse, il faudrait bouleverser toutes les histoires racontées sur les amours du roi François Ier et de la belle Ferronnière. Ces histoires d'abord portent avec elles un grand anachronisme: Léonard de Vinci était mort le 2 mai 1519[71], et elles reportent l'amour du Roi pour la belle Ferronnière à la fin de la vie de François Ier, c'est-à-dire à plus de vingt ans plus tard! Ils la font femme d'un bourgeois drapier, une sorte de baladine qui dansait et chantait dans les rues de Paris, puis avait épousé un marchand de la rue de la Ferronnerie. Or, la date des amours du Roi pour la belle Ferronnière est fixée par le portrait même, une des belles œuvres de Léonard de Vinci, mort en 1519: la Lisa del Jocondo était donc la femme aimée du roi à cette époque de jeunesse et de victoire. Maintenant le doute est de savoir si c'était la belle Ferronnière.
Elle était un chef-d'œuvre de grâce, de douceur et de joie expansive; cette figure de jeune fille désespère l'art par la perfection de ses traits: nul ornement, un front pur, un nez divin, des yeux admirables d'expression, et la bouche animée par un léger sourire. Je crois donc que la belle Ferronnière, comme semble d'ailleurs l'indiquer son nom Ferronari, Ferrieri, était une de ces belles milanaises ou génoises éprises du roi de France ou de ses chevaliers, après la victoire de Marignan, et qui le suivirent à Paris, doux trophée d'un retour glorieux. Quand il s'agit de peindre Lisa, le Roi s'adressa directement à Léonard de Vinci, et, comme la Joconde, fille rieuse, aurait pu s'ennuyer, comme un moment de fatigue sur ce beau front aurait pu le ternir, Léonard de Vinci, plaçant la Joconde sur une espèce de trône, l'avait entourée, comme nous l'avons déjà dit, de musiciens et de baladins pour la distraire[72]. François Ier assistait lui-même à ces longues séances, et quand le portrait fut achevé, il le paya 4,000 écus d'or (ce qui fait aujourd'hui 200,000 francs).
Le beau côté de François Ier fut de n'avoir jamais marchandé avec le talent, qui a sa couronne au front. Avec Léonard de Vinci, il agissait plutôt en ami qu'en roi; on voyait partout ce beau vieillard à la barbe blanche, dans les royales pompes d'Amboise, de Fontainebleau et de Saint-Germain, les trois résidences du Roi; nulle tête plus belle, nulle humeur plus enjouée, nulle philosophie plus douce[73], avec cette universalité de talent qui le rendait partout précieux et nécessaire; mécanicien pour le théâtre et les fêtes, ingénieur pour le tracé des canaux, architecte pour les bâtiments, peintre admirable de la nature et de l'art. Léonard de Vinci était néanmoins susceptible, inquiet, fier de lui-même, comme tout génie supérieur qui craint de ne pas être suffisamment apprécié, mais toujours d'une grave et douce philosophie. L'universalité était le caractère de son génie, et la même main qui peignait la Cène, traçait les remparts et les glacis des places-fortes. Tantôt on le trouvait dans un atelier disséquant le corps humain, comme l'anatomiste le plus exact, tantôt écrivant le Traité de la Peinture, objet de tant d'éloges de Poussin, et dont Annibal Carrachio disait: «Quel dommage que je ne l'aie pas connu plutôt; il m'aurait évité vingt ans d'études.» François Ier fit de Léonard de Vinci presqu'un peintre français, car il mourut à Amboise dans le sentiment d'une extrême piété, et fut enterré dans l'Église de Saint-Florentin; le Roi assista debout à ses funérailles, disant à tous: «qu'il pouvait faire un noble, que Dieu seul faisait les grands artistes!»