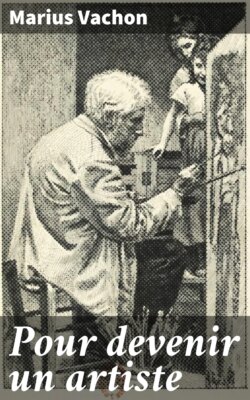Читать книгу Pour devenir un artiste - Marius 1850-1928 Vachon - Страница 10
ОглавлениеL’énergie.
— L’énergie est le plus haut degré de la volonté.
— L’énergie est la force physique et la force morale en action.
— Les difficultés et les obstacles font la force morale et la force physique.
— Il faudrait inventer les difficultés et les obstacles, s’ils n’existaient pas.
— La souffrance est un lest qui empêche l’artiste de se perdre, comme un ballon délesté, dans les hauteurs du ciel où l’on ne respire plus.
— La lutte dirige du côté de la réalité l’imagination de l’artiste, qui a constamment des tendances à s’en écarter.
— Ne jamais renoncer à lutter, alors même que la lutte semble impossible.
— Ne jamais désespérer, alors même qu’on n’espère plus.
— Manger de la vache enragée est la preuve d’un organisme humain supérieur.
— Ne pas se laisser décourager par la misère des débuts dans la carrière artistique. Presque tous les grands artistes ont commencé par être très malheureux; mais ils ont lutté avec énergie, leur situation s’est peu à peu améliorée, et la fortune leur est venue, souvent avec la gloire.
Si parfois l’étude est aride, si la traduction n’est pas à la hauteur de votre conception, ne vous laissez pas aller au découragement, n’ayez pas pour vous-mêmes de lâches complaisances. Rappelez-vous le mot de Napoléon écrivant à son frère: «Ne redoute pas la fatigue: il n’y a que ceux qui la méprisent qui deviennent quelque chose.»
BONNAT.
L’homme vraiment appelé ne redoute pas les obstacles, parce qu’il sait pouvoir les surmonter; ils sont même souvent pour lui un véhicule de plus; la fièvre qu’ils peuvent exciter dans son âme n’est point perdue; elle devient même souvent la cause des plus étonnantes productions. Je dis bien plus: si les obstacles et les difficultés rebutent un homme médiocre, ils sont, au contraire, nécessaires au génie et comme son aliment; ils le mûrissent et l’exaltent; il serait resté froid dans une route facile. Tout ce qui s’oppose à la marche dominante du génie l’irrite et lui procure cette fièvre d’exaltation qui renverse et domine tout, et produit les chefs-d’œuvre.
GÉRICAULT.
Souvenez-vous que le courage dans la lutte est la première affirmation de la personnalité.
J.-P. LAURENS.
Je ne suis pas un philosophe, je ne veux pas supprimer la douleur ni trouver une formule qui me rende stoïque et indifférent. La douleur est, peut-être, ce qui fait le plus fortement exprimer les artistes.
J.-F. MILLET.
Il n’est pas mauvais d’avoir commencé par balayer l’atelier.
J’ai eu une enfance et une adolescence assez rudes, comparables à celles des fils d’ouvriers qui sont obligés de se suffire et d’envisager les charges et les devoirs de la vie. Ce qu’il y a en moi de sérieux et de grave vient de ces premières épreuves. Elles m’ont appris à mesurer mes forces.
RODIN.
Il faut s’attendre à tout dans ce métier-là ; quand on a bu le calice d’amertume, il faut se dire: «Eh bien, demain on crachera dedans; après-demain on m’en salira la face.» Faire de l’art pour l’art, c’est rouler le rocher de Sisyphe. Quant à moi, je m’attends à tout, rien ne me surprendra. Je ne forme qu’un souhait, c’est de conserver ma main et de pouvoir rêver les yeux ouverts.
TH. ROUSSEAU.
La plupart des grands artistes, afin de pouvoir se préparer à suivre leur vocation, et pour vivre, ont dû, faisant ainsi acte constant d’énergie, se livrer à des travaux précaires, pénibles ou bizarres, sinon commencer par la pratique la plus vulgaire et la plus dure de la profession.
En sortant de l’école primaire, Raffet entra en apprentissage chez un tourneur en bois du faubourg Saint-Antoine. Il devint rapidement un excellent ouvrier; et, à dix-huit ans, il pouvait prélever sur son salaire de quoi payer les cours d’une petite école de dessin de quartier.
A Paris, de retour de Rome, après des travaux d’art assez importants, Prud’hon en fut réduit, pour nourrir sa femme, à faire pour un papetier des en-têtes de lettres, des cartes commerciales, des vignettes de bonbonnières, etc.
En 1818, Charlet dut se mettre au service d’un peintre d’enseignes, du nom de Jubel. Son patron l’employa immédiatement à décorer l’auberge des Trois-Couronnes, à Meudon; et le futur peintre des grognards de Napoléon brossa, sur les volets des fenêtres, des brioches, des lièvres, des lapins, des canards, etc.
MONUMENT DE RAFFET
PEINTRE ET DES DESSINATEUR
1804-1860
(Jardin du Louvre).
PRINCIPALES ŒUVRES
Souvenirs d’Italie: — Siège de Rome; — Épisodes du siège d’Anvers;
Voyage dans la Russie méridionale et le Caucase;
Les deux Sièges de Constantine; — L’Expédition des Portes de fer.
A ses débuts d’artiste, à Cherbourg, J.-F. Millet peignit des enseignes; il fit notamment une Petite Laitière pour un magasin de nouveautés, un cheval pour un vétérinaire, une scène de la conquête de l’Algérie pour un saltimbanque, qui la lui paya trente francs en monnaie de gros sous. Les personnages de la ville qui s’étaient intéressés à lui, en considération de ses aptitudes artistiques, l’abandonnèrent, déclarant hautement qu’ils ne voulaient pas encourager un vulgaire peintre d’enseignes.
Dans sa première jeunesse, Daubigny brossa des tableaux pendules pour un horloger de la rue Portefoin, à Paris, des vignettes de prospectus pour des commerçants, et fut employé à l’ornementation des panneaux et des portes de plusieurs salles du musée de Versailles.
Robert Fleury, le peintre du Colloque de Poissy, se trouva, dès son enfance, dans le dénuement le plus profond, par suite de la pauvreté de sa famille. Il dut, pour vivre, entrer comme apprenti chez un peintre en voitures. Celui-ci, lui trouvant de l’intelligence et du goût, le spécialisa dans les armoiries. Le jeune ouvrier ne tarda pas à constater que son patron ne connaissait pas le premier mot de l’art héraldique, et se contentait de faire reproduire les documents que lui apportaient ses clients; il résolut d’apprendre cet art, pour être en mesure de gagner de l’argent à la fois comme dessinateur et comme peintre. Il acheta chez un bouquiniste des quais, pour cinq sous, le Traité du blason, s’exerça à composer des armoiries pittoresques, des écussons originaux, accostés d’animaux fantastiques, pouvant jouer les armoiries les plus historiques.
Le succès le plus complet couronna ses efforts et justifia son initiative audacieuse. Il se rendit bien vite assez indépendant, dans son travail d’atelier, pour pouvoir suivre les cours de l’École des beaux-arts.
L. de Fourcaud conte, dans une biographie de Théodule Ribot, que ce peintre fut très heureux, dans sa jeunesse, d’entrer comme teneur de livres chez un fabricant de draps d’Elbeuf; cette place le tirait d’une misère noire. Marié, et père d’un enfant, son destin le conduisit à Paris. Il se fit artisan pour nourrir sa famille. Il peignait du matin au soir, dans un atelier de marchand de glaces, des cadres à marges violettes, semées d’oiseaux; et, plus tard, un marchand de stores l’occupa à décorer des toiles de déjeuners sur l’herbe, de parties de pêche, etc.
Bracquemond a débuté dans la vie comme apprenti écuyer; il avait à nourrir lui-même sa famille: son père venait de mourir en laissant cinq enfants en bas âge; puis il fut engagé dans un atelier de lithographe. A dix-neuf ans, ayant pu suivre les cours d’une école de dessin, après sa journée de travail, il envoyait au Salon de 1852 un portrait de femme qui attira l’attention de Théophile Gautier.
En arrivant de sa province lyonnaise à Paris, où il n’avait ni protecteur, ni maître, ni amis, Ch. Roybet dut, pour vivre, faire un peu de tout: des cartons de vitraux, des dessins de perruques pour coiffeurs, des tableautins qu’il vendait au prix moyen de dix francs; quand on lui en donnait quinze, c’était du délire. Il contait, un jour, à Firmin Javel que son premier client sérieux et notable fut Ribot, que Vollon, son camarade de l’École des beaux-arts de Lyon, lui avait fait connaître. Le peintre des marmitons lui acheta un tableau représentant une bonne dans une cuisine, et le paya vingt francs. «Je n’ai jamais été si fier que ce jour-là,» ajoutait-il.
Félix Charpentier, qui a obtenu, en 1898, la médaille d’honneur de la sculpture du Salon des artistes français, a travaillé, de treize à seize ans, dans une fabrique de briques réfractaires de Vaucluse comme manœuvre. Les dimanches et le soir, après son travail, il s’amusait à modeler d’instinct des petites figurines en terre, qu’il distribuait à ses camarades et aux gens du village. Un compatriote, élève de l’École des beaux-arts d’Avignon, ayant vu ces essais, en informa ses maîtres, qui firent venir le jeune briquetier et lui donnèrent le conseil d’entrer à l’école. Trois ans après, le Conseil général du département l’envoyait à Paris comme boursier, avec une pension de trois cent cinquante francs par an. Charpentier s’engagea dans un atelier de praticien, et put ainsi suffire aux frais de ses études à l’École des beaux-arts.
J.-J. HENNER
PEINTRE
Né en 1829.
PRINCIPALES ŒUVRES
La Chaste Suzanne; — Idylle; — Naïade; — La Créole;
Saint Sébastien; — Fabiola; — Dormeuse
(Musée du Luxembourg);
Décoration de l’hôtel Sédille, à Paris;
Portraits de Feyen Perrin, du général Chanzy,
de Ravaisson, Ch. Hayem, Mme Karakehia.
Falguière fut employé, comme apprenti et comme ouvrier, chez un peintre plâtrier, avant d’entrer à l’École des beaux-arts de Toulouse.
Roty, le grand médailleur, a commencé sa carrière artistique en dessinant des coins de mouchoirs pour un magasin de blanc du quartier du Sentier, à Paris.
Dans les Souvenirs et Entretiens de Meissonier, je lis le récit de cette conversation du grand peintre avec sa femme: «Puisqu’on vient de m’envoyer une nouvelle édition des Misérables, relis-m’en un peu. Ces passages de la misère de Marius me rappellent la mienne,... mes dîners à vingt centimes, un mauvais bol de bouillon, et un peu de pommes de terre frites achetées en sortant... Mais le tout était assaisonné de conversations en plein idéal, avec mes amis... Nous ne nous occupions que d’art et de sentiment.»
Pendant les premières années qu’il habita Paris, après son retour de Rome, Chapu fut obligé de faire de l’art industriel pour vivre; il modelait pour des bronziers du Marais des pendules, des ornements de meubles. O. Fidière rapporte une anecdote plaisante de cette époque de la vie du célèbre sculpteur. Un charcutier du boulevard Saint-Germain fit demander, un jour, au jeune artiste s’il voulait lui modeler en saindoux un sanglier qu’il avait l’intention d’exposer à la devanture de sa boutique aux approches du jour de l’an. Le prix demandé parut trop élevé au charcutier, qui finit par proposer à Chapu, pour toute rémunération, l’œuvre elle-même, qu’il pourrait reprendre après le 1er janvier. La mère de l’artiste, bonne ménagère, goûta fort cet arrangement, qui l’approvisionnait de saindoux pour tout l’hiver; elle décida son fils à accepter, ce qui fut fait.
Petit paysan, J.-J. Henner faisait tous les jours, par tous les temps, le voyage de son village, Bernwiller, à Altkirch; soit quatre bonnes lieues, pour aller étudier chez un professeur de dessin. Venu à Paris, pendant l’hiver de 1856, il passait la plus grande partie de son temps au Musée du Louvre, afin de pouvoir travailler sans mourir de froid. Il était si pauvre, — ne recevant qu’une pension de quatre cent cinquante francs de sa famille et du département, — qu’il avait dû renoncer à fréquenter l’atelier de Drolling, qui coûtait vingt francs par mois. Un camarade le sauva de la misère en le faisant entrer chez un peintre, du nom de Viennot, qui avait monté une fabrique de portraits d’après photographies pour l’exportation dans l’Amérique du Sud et aux États-Unis. Cet entrepreneur occupait un certain nombre de jeunes rapins pour l’aider dans ses travaux; il payait un habit noir, une robe de bal, douze francs; un châle des Indes, quinze francs; une décoration, une bague en brillants, cinq francs. «Avec le travail de cette fabrique, contait humoristiquement Henner à Thiébaut-Sisson, on pouvait vivre pendant un mois sans quitter l’École des beaux-arts; grâce à Viennot, pendant deux ans, j’ai fait mes trois repas par jour.»