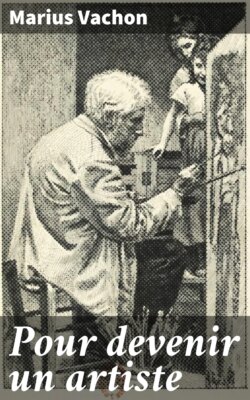Читать книгу Pour devenir un artiste - Marius 1850-1928 Vachon - Страница 7
La volonté.
Оглавление— La volonté est la faculté première de l’artiste, la faculté la plus nécessaire au développement de sa vocation, et à l’exercice de sa profession.
— Qui ne veut pas est destiné à la mort physique et intellectuelle.
— Le plus fort dans la vie est celui qui veut le plus et le mieux, c’est-à-dire résolument et irréductiblement.
— Qui veut une chose, qui la veut bien, qui la veut toujours, finit par l’obtenir envers et contre tout et tous.
— L’homme qui veut s’impose irrésistiblement.
— Le monde a le respect de l’artiste qui a de la volonté et de l’énergie, c’est-à-dire de la race.
— Celui-là seul, parmi les artistes, est grand et fort, qui s’impose aux autres au lieu de les subir, qui s’impose à lui-même au lieu de se subir, et qui, du même effort de volonté, étouffe à la fois ses propres découragements et les résistances extérieures.
— La volonté prépare la conception de l’œuvre d’art, en excitant l’esprit sur l’idée qu’elle lui insuffle; et, dans l’exécution, la volonté fait l’œuvre suggestive d’émotion, par le spectacle de l’effort réalisé.
— La volonté est l’expression de la vocation, indispensable pour aborder la carrière artistique, en apparence facile, agréable et fructueuse, en réalité très pénible, très dure, et féconde en souffrances et en déceptions.
Avec de la volonté, de l’énergie et de la conscience, un artiste peut résoudre, dans une certaine mesure, les difficultés d’exécution que crée l’insuffisance d’un métier appris trop tard.
E. BARRIAS.
Je me rappellerai éternellement la nuit de mon départ, cette nuit froide et pluvieuse qui m’a emporté dans sa tristesse et dans son obscurité ; en passant devant la statue du général Travot (à la Roche-sur-Yon), je me suis juré, la main sur la poitrine, avec exaltation, de revenir homme et avec du talent... Au lieu de me dégoûter, les obstacles m’excitent et me font cabrer; je les saute d’un seul bond.
PAUL BAUDRY.
Vouloir toujours, vouloir quand même.
CARPEAUX.
Vouloir, c’est pouvoir: c’est l’axiome de toute ma vie; j’ai toujours voulu.
MEISSONIER.
On croit qu’on me fera courber, qu’on m’imposera l’art des salons: eh bien, non; paysan je suis né, paysan je mourrai. Je veux dire ce que je sens. J’ai des choses à raconter comme je les ai vues, et je resterai sur mon terroir sans reculer d’un sabot, et, s’il le faut, je combattrai encore pour l’honneur.
J.-F. MILLET.
Le vrai artiste, se détachant de toute idée de lucre, se crée une vie aussi simple et aussi modeste que possible pour pouvoir, au prix souvent de grandes souffrances et de grandes privations, poursuivre avec acharnement la recherche de l’idéal artistique qui est pour lui le seul but de la vie.
ROTY.
Un dimanche d’été, à Dijon, en sortant de la boutique de son père, poêlier, le petit Rude voit une foule endimanchée s’engouffrer dans le Palais des États. Avec la curiosité innée de l’enfance, il y entre lui aussi. On distribue les prix aux élèves de l’école de dessin de Devosge. Le jeune garçon entend prononcer plusieurs discours, qui tous expriment les avantages d’une instruction artistique pour les ouvriers. L’éloquence des orateurs le convainc. Il se dit: «Si j’allais prier M. Devosge de me recevoir à son école?» De retour à la maison, il conte à son père ce qu’il vient de voir et d’entendre, et lui fait part de son désir d’entrer à cette école. «Tu perds la raison, répondit le poêlier; nos affaires ne vont pas déjà si bien, je n’ai pas besoin chez moi d’un artiste pour qu’elles aillent plus mal encore. — Mais, père, répliqua le petit Rude, tu ne sais donc pas que le dessin est utile à tout le monde; on nous l’a très bien expliqué tout à l’heure à l’académie...; et rien que pour l’ornementation de nos cheminées à la prussienne... » Le père se contenta de hausser les épaules, et l’on parla d’autre chose ce soir-là. Mais le petit Rude tenait à son idée; il ne manqua pas une occasion de revenir sur son désir d’entrer à l’école de Devosge. Enfin, un jour, las des réclamations incessantes de son fils, le père lui dit: «Allons, fais à ta guise; mais souviens-toi bien que je te défends d’être un artiste; et ne vas à l’académie qu’à tes moments perdus. Je ne peux faire de toi qu’un ouvrier poêlier.» Le lendemain, le futur auteur du Départ de l’Arc de triomphe de l’Étoile se faisait inscrire sur les registres de l’école, d’où Prud’hon était déjà sorti.
A vingt ans seulement, David d’Angers put vaincre les résistances de son père à le laisser aller à Paris pour tenter la fortune artistique, suivant sa vocation. Le vieux maître sculpteur qui l’occupait comme apprenti lui prêta quarante francs. David gagna Chartres par la voiture publique, et, de là, Paris à pied. En franchissant la barrière de la Conférence, il avait neuf francs dans sa poche. A ce moment, l’Arc de triomphe de l’Étoile était un vaste chantier d’ornemanistes et de sculpteurs; le jeune homme s’y fit embaucher à vingt sous par jour comme ravaleur. Bien souvent, il eut à souffrir de la faim, par suite de la modicité de ce salaire; mais peu lui importait: il était à Paris, et il voulait, de plus en plus, devenir un grand artiste. S’instruisant, le soir, et apprenant tout seul le dessin, David pouvait se faire recevoir peu de temps après comme élève dans l’atelier d’un sculpteur.
Simart, l’auteur de la fameuse restitution de la Minerve du Parthénon et du fronton du pavillon Denon, au Louvre, travaillait comme apprenti dans l’atelier de menuiserie de son père, à Troyes; mais il occupait ses loisirs et ses veillées à sculpter sur bois des figurines, à dessiner d’après les images qui lui tombaient sous la main; et il manifestait l’ambition de devenir un jour statuaire. Son père n’était point hostile à ces occupations; mais sa mère, qui gouvernait la maison, n’entendait point de cette oreille et tenait à ce que le garçon, en tant qu’aîné de la famille, suivît le métier paternel, afin de garder l’atelier de menuiserie. Pour arriver à ses fins et décourager le sculpteur en herbe, elle décida de frapper un grand coup. Le jour de l’Ascension, elle convoqua toutes les commères du voisinage dans sa maison, autour d’une table sur laquelle elle avait entassé les dessins de son fils, et leur dit: «Charles a perdu la raison; il veut devenir un artiste; mais c’est un métier de misère; je le sauverai malgré lui.» Les commères opinèrent du bonnet. Alors, elle jeta dans la cheminée tous les dessins. Puis, se précipitant dans l’atelier de menuiserie, elle ramassa les morceaux de sculpture, les empila dans la cour, et mit le feu au tas. Lorsque, en rentrant, le jeune Simart constata l’autodafé, il fut pris d’une crise de larmes et courut s’enfermer dans sa chambre. Là, il écrivit à sa mère une lettre, dans laquelle il lui disait qu’ayant la conscience de n’avoir jamais manqué à ses devoirs d’apprenti, d’avoir toujours obéi à son père, il ne comprenait pas que ses parents aient pu trouver mauvais qu’il se fût occupé, en dehors de son travail, à dessiner et à sculpter; il déclarait qu’il était décidé à suivre une vocation qu’il sentait irrésistible, tout en ajoutant que dans sa décision irrévocable il n’entrait aucun sentiment de mépris pour la profession paternelle. Et, pour donner plus de poids à sa déclaration, il signait en trempant la plume dans son sang. Cette lettre émut à un tel point la mère qu’elle laissa son fils libre de faire ce qui lui plairait. Peu de temps après, le jeune Simart entrait à l’école de dessin de la ville, et il y obtint un succès si complet que le conseil municipal lui vota une subvention de trois cents francs pour qu’il pût se rendre à Paris, afin d’y compléter ses études, et y apprendre le métier de sculpteur chez un maître en renom.
RUDE
SCULPTEUR
1784-1855.