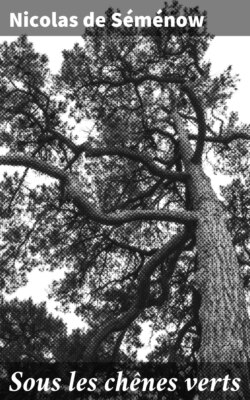Читать книгу Sous les chênes verts - Nicolas de Séménow - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
I
ОглавлениеLe château où est né notre héros est certainement le plus plaisant qui se puisse rencontrer en ce pays aimé du soleil qui s’appelle la Provence. Il est situé sur les bords d’un fleuve majestueux, tranquille et rapide, mais capricieux à ses heures et terrible dans ses emportements. Les pluies qui tombent dans le Nord le font déborder tous les trois ou quatre ans, et, quand il déborde, il porte la désolation à quelques lieues de ses rives. Ses eaux se répandent dans les terres basses, et alors les collines qui les enclavent ou qui y surgissent semblent des côtes escarpées ou des îlots dans une mer nouvelle. Aussi ce fleuve a-t-il été, malgré son inclémence, chanté par les poètes;–aussi les habitants des plaines, où il fait le plus de ravages, ont-ils pour lui une vénération superstitieuse. C’est presque de l’adoration. On n’adore que ce qu’on craint, ce qui est malfaisant dans sa puissance et irrésistible dans ses colères, auxquelles on trouve toujours, malgré leurs brutalités inintelligentes, un caractère de grandeur.
Ce fleuve s’appelle le Rhône; le château riant qu’il domine s’appelle la Renède. Bâti à l’italienne, flanqué de larges terrasses, avec une belle galerie à arceaux sur la façade, il regarde gaiement le midi.
Il n’affecte pas des airs fiers comme les vieux châteaux féodaux; il aime mieux plaire que de paraître vénérable; aussi vous attire-t-il par ses airs de coquetterie modeste dont le charme est souverain. Sa façade est peinte à fresque à l’italienne, mais plus finement qu’en Italie. Les tons en sont plus doux et se marient sans se heurter; d’ailleurs toute cette décoration est élégante et légère. C’est un mélange de styles moresque et égyptien, et les arabesques bizarres qui courent sous les corniches sont d’une délicatesse merveilleuse.
La décoration de l’intérieur de la maison correspond à son aspect extérieur. Point de tapisseries banales. Les murs sont peints dans le style de l’ameublement de chaque pièce. Le vestibule, de proportions grandioses, est décoré du blason du châtelain et de ceux de sa femme, de sa mère et de son aïeule. La salle à manger, dont les meubles François Ier sont recouverts en cuir de Cordoue, est du style de cette époque, et dans les panneaux de vieux chêne sont incrustés des médaillons de fleurs et de fruits d’une grande vérité de tons. Le salon, la seule pièce du château qui soit meublée dans le goût moderne, est très vaste, très coquet et très confortable. Pas trop de dorures, mais assez pour que l’œil ne s’effarouche point des effets criards du d’amas bouton-d’or qui couvre les meubles et, drapant les porte-fenêtres, retombe sur le carreau en plis droits et .raides, comme si l’étoffe était tissue de métal.
Mais de vraies merveilles dans cette habitation sont une chambre à coucher Louis XV et un boudoir Louis XVI qui restent toujours fermés. Le petit salon est surtout ravissant. Ce sont des feuillages fantastiques sur fond couleur planche encadré de gris clair. Le rose, le vert tendre et le jaune y dominent. Des colombes, embellissement obligatoire de toute décoration ou de tout meuble du dernier siècle, se becquètent avec une grâce toute mignarde ou tiennent gravement dans leurs becs de longs rubans, sur lesquels s’enroulent des sujets capricieux que le décorateur artiste a variés à l’infini. Le plafond en voûtins est aussi frais, aussi fin que le reste; les meubles et les glaces, tous de l’époque, ’n’ont de doré que leurs arêtes; les fleurs et les feuillages en sont peints et paraissent en porcelaine.
Un piano en bois de thuya, une pendule, des candélabres de cuivre travaillés à jour et sortant d’un des châteaux royaux, quelques portraits dans des cadres ovales sculptés à Florence complètent l’ameublement de ce charmant boudoir de jeune fille.
C’est, en effet, pour une jeune fille qu’on l’avait arrangé avec tant de soin et d’amour. C’est pour elle qu’on avait rajeuni le château, en lui donnant un aspect si riant,–qu’on avait dessiné dans des massifs d’arbres séculaires un parc anglais merveilleux, tout vert, tout coquet, malgré ses allures solennelles, ses allées mystérieuses et ses réduits ombreux, où les premiers rires d’une enfant, dont le cœur s’éveille, flottent à l’aise, insaisissables et mystérieux comme la sève qui, aux premiers jours du printemps, monte timidement aux hautes branches. C’est pour elle qu’on a incrusté dans les pelouses, sous les grands arbres, des corbeilles de rosiers, de lauriers-roses, de géraniums;–c’est pour elle enfin qu’on vivait, car ses parents l’aimaient tant et si exclusivement, qu’ils se souvenaient à peiné qu’ils avaient un fils: Norbert, le héros de ce récit, son aîné de deux ans.
Rien n’était trop beau pour elle, et certes aucune jeune fille ne méritait davantage une heureuse destinée. Mais la mort, qui, jalouse ou inconsciente, guette les heureux et fauche les plus belles destinées, ne voulut pas lui faire grâce.
Le désespoir que cette perte cruelle causa à ses parents fut immense. Ils ne comprenaient pas pourquoi la Providence les avait si implacablement frappés. N’avaient-ils pas toujours mené la vie de bons châtelains, soulageant les misères qui se montrent, découvrant celles qui, honteuses, se cachent, faisant le bien comme par instinct et non parce que leur position sociale les obligeait à donner le bon exemple? Et, tout à coup, le destin, un destin mauvais, mais tout-puissànt dans sa cruauté, leur enlevait leur seule consolation et les frappait comme s’ils avaient été de grands coupables. Aussi, dans leur douleur, ne trouvèrent-ils d’abord que des imprécations et des blasphèmes. Puis, le temps aidant, ils revinrent, petit à petit, comme à une habitude, à leurs pratiques religieuses et charitables. Seulement, tout en continuant à faire le bien, ils étaient devenus profondément égoïstes, et, chose étrange! au lieu de reporter sur Norbert toute la tendresse dont ils avaient entouré la défunte, ils devinrent encore plus froids pour ce fils, qui restait vivant, lui, comme pour usurper la place de celle qui était au tombeau et narguer ainsi leur douleur.
Cependant lui les aimait. Il les respectait surtout de ce respect absolu, qui ne raisonne pas, qui ne met pas en doute l’autorité paternelle, qui ne cherche même pas à se rendre compte si les parents remplissent bien ou mal leurs devoirs de parents et méritent qu’on se montre envers eux reconnaissant et soumis. Chez Norbert, c’était comme une religion, car il était de haute lignée, et, dans sa race, le respect filial était de tradition comme l’honneur et le courage.
D’ailleurs, tous les beaux sentiments de chevalerie étaient, pour ainsi dire, incarnés dans cette noble maison. Les comtes de Vabran, issus du célèbre baron de Vence, ministre du comte de Provence Raymond-Bérenger III, pouvaient comme noblesse rivaliser avec les Barras, et l’on disait d’eux, dans le pays:
Noble coume li Barras
Autant viei que li roucas.
«Nobles comme les Barras, aussi vieux que les rochers.» Ils étaient alliés aux Porcelets, aux Blacas, aux d’Adhémar, aux Arlatun et aux Forbin dont, sauf les couleurs et les métaux, ils portaient les armes: de sinople à trois têtes de léopard d’or, languées de gueules2et1, avec Libertas pour devise. La devise était bien un peu guelfe et indiquait certainement que les Vabran s’étaient alliés à des maisons de Bologne, de Florence et de Sienne; cependant la fleur de lys florentine, octroyée à la Toscane par le pape Clément IV, ne figurait pas dans leurs armoiries. Enfin, cette noble famille, tout en se montrant, en plein dix-neuvième siècle, très fière de son origine, ne se vantait jamais de ses alliances-illustres avec les seigneurs d’Uzès et de Forcalquier, ni des dignités dont les Bourbons l’avaient comblée depuis la conquête de la Provence. Ils ne s’enorgueillissaient que d’avoir pour aïeux de bons gentilshommes du royaume d’Arles, et parlaient encore avec dépit des barbares du Nord qui avaient envahi et ruiné leur pays, qui y avaient détruit toute culture littéraire, et cette élégance de mœurs, unique en Europe, que les Provençaux tenaient peut-être des Mores d’Espagne encore plus que des Italiens. Ils étaient, malgré tout, restés Provençaux, savaient leur histoire oubliée et continuaient de reprocher aux Français de les avoir rendus aussi grossiers que l’étaient jadis les croisés du comte Simon de Montfort,
Norbert fut naturellement élevé dans ces principes plus que surannés; mais, une fois à Paris, où ses parents l’avaient envoyé faire son droit, il se dépêcha de devenir Parisien, tout en gardant, comme une relique, le culte de son nom.-Il le gardait en secret, craignant la raillerie; mais, tout en fraternisant avec des amis de rencontre, tout en menant avec eux la vie un peu folle des étudiants riches, il n’osait pas trop se livrer, et, dès qu’il voyait ses compagnons de plaisir glisser, même légèrement, sur cette pente, très douce d’ailleurs, où l’on se brouille un peu avec la délicatesset" il s’arrêtait net et se disait avec un orgueil qui, certes, aurait fait rire de lui: «Je ne puis, moi, un Vabran, me laisser aller ainsi.»
Quand il venait au château,–à l’époque des vacances,–il y était bien accueilli, les premiers jours surtout. On lui faisait manger les plus fins morceaux et boire du meilleur vin de la cave, on convoquait quelques voisins qui l’examinaient attentivement, avec cette curiosité malveillante que tout bon provincial sait à peine dissimuler, quand il rencontre dans son pays un étranger qu’il se sent supérieur. Il le soupçonne naturellement de le trouver ridicule, et s’il n’en laisse rien paraître ce n’est que par dédain; car le Parisien est malin, car il ne se livre qu’à bon escient, et la politesse qu’il affecte n’est qu’une raillerie constante et dissimulée.
D’ailleurs, peut-être n’est-il pas inutile d’apprendre au lecteur ce qu’étaient les intimes du comte de Vabran. Tous, sans exception, ils étaient dignes de figurer dans le Cabinet des antiques, de Balzac.
Les journaux conservateurs étaient convaincus par ce petit groupe de tendances jacobines, tendances déplorables et déplorées par Monseigneur le comte de Chambord, qui s’en était, assurait-on, ouvert à leur chef. Il lui avait aussi indiqué la ligne de conduite que devaient suivre lui et les siens. Norbert essayait de comprendre, mais n’interrompait jamais. Il gardait parfaitement son sérieux pendant qu’on débitait autour de lui les énormités les plus folles, les gasconnades les plus échevelées. Un jour cependant, mis en gaieté par tant de mensonges, il eut l’imprudence d’adresser un sourire d’intelligence à l’un des convives qui était Parisien comme lui.. Mal lui en prit, car celui-ci, craignant que ce sourire ne le compromît aux yeux de son parti, garda son sérieux et dénonça notre héros au comte de Vabran comme libre penseur.
Le comte, qui ne cherchait qu’un prétexte à tancer son fils, pour accentuer son autorité paternelle, en profita comme de juste. Il reprocha à Norbert ses manières trop libres, le peu de déférence qu’il témoignait aux anciens amis de la maison, qu’il s’avisait de traiter presque en égaux, au lieu de leur marquer le respect qu’un jeune homme doit toujours aux personnes plus âgées que lui. Il lui reprocha de se permettre parfois des plaisanteries boulevardières d’un goût douteux, car le sens n’en était jamais bien clair, et que dans une société d’hommes graves et posés elles n’étaient guère de mise. «C’est à Paris, ajoutait sa mère, qu’un vous apprend toutes ces balivernes. De notre temps la jeunesse était toute différente de ce qu’on la voit aujourd’hui. Elle était respectueuse, etc., etc.»
Norbert, sans mot dire, subissait ces averses de lieux communs, baisait la main à sa mère en la remerciant de ses bons conseils, et finalement lui demandait la permission de s’absenter pendant quelques jours, pour aller chasser avec des amis. Ses absences étaient fort longues, de sorte que, sur deux mois et demi que durent les vacances, il ne passait guère plus de trois semaines dans sa famille.
Cependant l’année de la mort de sa sœur il n’avait pas osé quitter ses parents, et, pour les consoler, il leur avait fait voir qu’il partageait leur peine. On lui répondait un peu durement, et les éloges qu’on faisait de la morte étaient autant d’épigrammes à son adresse. «Notre ange est parti, lui disait-on. Personne ne nous la remplacera. En la perdant nous avons tout perdu.»
Alors il penchait la tête et devenait profondément triste. Ces accès de tristesse ne le prenaient, du reste, que rarement et seulement pendant les vacances. Rentré à Paris, il se replongeait dans une vie intelligente et se retrouvait dans son milieu, où la parole est donnée à l’homme pour exprimer une pensée,–faculté qu’en province on nie, ou qu’on traite d’incongruité et d’impertinence.
C’était d’ailleurs un garçon fort aimable, très simple dans sa manière d’être, aux allures franches, mais sans brusquerie, et d’une distinction native qui ne s’apprend pas. Il était bon, affable, généreux. Ayant, tout jeune, hérité d’un oncle une trentaine de mille livres de rente, il s’était tout d’abord trouvé embarrassé de tant d’argent. Il ne voulait pas afficher un luxe dont pouvaient se blesser les étudiants avec lesquels il s’était lié. Aussi n’avait-il au quartier Latin qu’un petit appartement, modestement meublé, et pas de valet de chambre, luxe scandaleux pour un si jeune homme. Enfin, il s’était promis que, tant qu’il ne serait pas reçu licencié, il vivrait en étudiant et non en grand seigneur.
De sa personne il était fort bien: d’une taille un peu au-dessus de la moyenne, admirablement proportionné et très joli garçon. Ses cheveux étaient bruns, ses yeux châtains, avaient une douceur caressante qui charmait même ceux-là qui voulaient s’en défendre. Le sourire de sa bouche petite, mais à la lèvre inférieure un peu épaisse, marquait la bienveillance et comme un sentiment d’amitié, enfin sa voix était si douce qu’on aimait à l’entendre.
Il était sage à ses heures, sans qu’il lui en coûtât; mais, une fois lancé dans les plaisirs, il manquait de philosophie, ou, pour mieux dire, s’en créait une fort commode. «La vraie sagesse, se disait-il, consiste à s’amuser le plus qu’on peut.» Qu’on n’aille pas en conclure qu’il ne savait s’amuser qu’en mauvaise compagnie. Ce serait là une erreur. Il ne négligeait pas ses relations dans le faubourg Saint-Germain et y allait volontiers, plutôt pour changer de société que pour se retremper dans un milieu qui était le sien.
Il y était le bienvenu comme partout où il allait. On l’y accueillait en enfant de la maison que chacun ne demandait qu’à gâter. Même les hommes qui y occupaient des positions sérieuses, étant classés dans les salons: élégants «hors concours», s’oubliaient jusqu’à le traiter avec gentillesse, et, par le plus grand des miracles, perdaient avec lui leurs façons dédaigneuses dont ils n’osaient jamais se départir de crainte d’être confondus avec ces apprentis en élégance qui manquent encore de style et de tenue.
lis y manquaient, eux aussi, quand Norbert était là, car ils n’avaient pas le cœur de se montrer poliment cassants avec ce jeune homme si modeste dont la nature toute charmante, l’aménité communicative étaient irrésistibles dans leur simplicité et mettaient tout le monde à l’aise. Il y avait autour de lui comme un rayonnement de jeunesse, de cette jeunesse aimable, que l’ambition ne ronge pas, à laquelle les chagrins et les soucis de la vie n’ont pas encore touché, qui ne se nourrit pas de rêves creux, mais jouit de la réalité follement, riche de sève, plus riche encore d’espérances, et vous séduit comme toute gaieté de bon aloi.
Ce n’était pas seulement aux jeunes qu’il plaisait; Norbert était surtout le favori des douairières. Elles le tançaient, le morigénaient amicalement sur sa tenue un peu sans façon, sans que jamais il s’avisât de répondre à leurs doctes sermons autrement que par des chatteries mêlées de sourires enfantins, qui charmaient ces bonnes vieilles. A’leur tour elles lui souriaient avec une bonté et une indulgence, qu’à cause de leur âge, elles n’avaient pas à déguiser.
Mais ce qui, plus que les gâteries des douairières et des charmantes personnes qui charitablement s’étaient chargées de compléter son éducation, lui faisait un bien sérieux, c’était la fréquentation des étudiants ses camarades, qui, n’ayant pas comme lui trente mille livres de rentes, se montraient fort préoccupés de la carrière qu’ils allaient embrasser. Ils en causaient souvent entre eux, comme si Norbert, qui écoutait, n’était pas des leurs, et se laissaient aller à leurs rêves ambitieux. De grands noms, comme celui de Berryer, étaient prononcés, et ces jeunes gens, qui avaient du talent, croyaient sans peine qu’ils arriveraient un jour à l’égaler, illustrant ainsi leurs noms obscurs qui passeraient à la postérité. Norbert, en les entendant discourir de la sorte, devenait pensif.
«C’est l’aristocratie de l’avenir, se disait-il, et ils ont bien raison de vouloir prendre notre place. Nous ne voulons plus être bons à quelque chose, nous trouvons que nous avons grand air à briller par notre nullité, laissant aux gens de peu le souci de se montrer de vrais hommes. Quelle gloire cependant, pour quiconque porte un nom historique, de relever ce nom de l’oubli –car on oublie tout aujourd’hui,–de l’imposer à cette société démocratique par une supériorité réelle, de passer dans la mêlée le front haut et tout fier d’être l’enfant de ses œuvres. Non seulement on se montrerait ainsi, digne de ses aïeux, mais on pourrait encore se dire avec raison qu’ils sont honorés d’avoir un tel descendant.»
Quand Norbert se mettait à raisonner ainsi, il se retirait du monde, s’enfermait chez lui, se plongeait dans l’étude à corps perdu, se montrait plus assidu aux cours que les plus studieux de ses camarades, renonçait absolument aux parties de plaisir et même aux soirées intimes. C’était alors une vie de vrai dominicain. Il résistait à toutes les tentations, se répétant sans cesse:
«Je veux être un grand homme.»–Et il avait la foi.
Hâtons-nous cependant, pour n’être pas taxé d’exagération, d’avouer que cette foi robuste en lui-même, cette fièvre de travail ne duraient chez lui jamais plus de deux ou trois mois. Pour son malheur, Norbert était modeste, et la modestie, chacun le sait, est l’ennemie jurée de tout ambitieux.
«A quoi bon, se disait-il–quand à la fin il était ennuyé de son existence de reclus–à quoi bon me tant fatiguer et me priver de toute joie? Si j’étais, en effet, supérieurement doué, ce serait fort bien de sacrifier ainsi ma jeunesse; mais je ne suis probablement qu’un homme ordinaire, et, en persévérant à vouloir me grandir outre mesure, j’imiterais peut-être la grenouille de la fable.»
D’ailleurs, cher lecteur, nous ne voulons pas affirmer que cet aimable garçon soit un modèle de fermeté et de persévérance. C’est, au contraire, une nature flottante comme le sont aujourd’hui la plupart des hommes, qui, pour la bataille de la vie, ne sont pas cuirassés d’égoïsme,–la plus sûre, la plus impénétrable des armures. Norbert ne pouvait, lui, arriver au but qu’il ne voyait même pas clairement, que poussé par le Destin. Or, le Destin prend rarement pour favoris les gens trop scrupuleux, qui n’ont d’ambition que par boutades, et encore moins ceux-là qui ne sont pas guidés par la meilleure des ambilions: la «Nécessité,» dans des sentiers scabreux qu’on suit alors sans découragement et sans dégoût.
Mais, lui, suivait la grande route ou faisait l’école buissonnière. Ce qui le désolait infiniment, car, tout en vivant très heureux, il se désolait quelquefois à propos d’un rien, aussi sérieusement que s’il se fût agi d’une chose sérieuse; ce qui le désolait donc, c’était, par exemple, de ne jamais avoir ressenti, dans ses liaisons passagères, un mouvement de passion qui lui eût donné le change sur la banalité de ses aventures galantes. Le seul sentiment venant du cœur, qu’il eût encore éprouvé auprès d’une femme, c’était de la compassion. Il s’apitoyait toujours sur les larmes de la maîtresse qu’il quittait; il faisait son possible pour la consoler, soit en lui donnant beaucoup d’argent, quand c’était une femme à en accepter, soit en pleurnichant avec elle, mais, en bon méridional, jamais ne la gardait quand il en avait assez.
«Peut-être, se disait-il, ne suis-je pas créé comme les autres hommes. Les poètes parlent d’amour, la musique en parle aussi, et sa voix est encore plus éloquente; donc l’amour existe, et, si je suis le seul à ne pas pouvoir le ressentir, c’est que probablement la Providence me réserve à de plus hautes destinées. Les hommes vraiment grands n’ont jamais aimé. Aussi y a-t-il peut-être en moi l’étoffe d’un vrai diplomate ou d’un homme d’État. Quelques folies que je fasse, je reste au fond un homme sérieux, un homme d’analyse. Jamais je n’ai senti monter de mon cœur à mon cerveau ces prétendues fumées d’ivresse qui l’obscurcissent; mes idées restent toujours claires et précises. Je ne saurais donc être heureux comme les autres; car, pour cela, il faut, paraît-il, sentir si vivement qu’on en oublie le monde entier. Nos meilleurs poètes–et je ne puis les croire des menteurs–ne nous disent-ils pas, sur tous les tous, que, pour un seul baiser, ils donneraient leur gloire et leur génie?… Hélas! je ne les comprends même pas!»