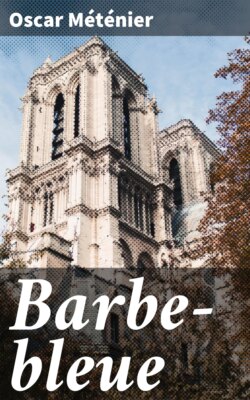Читать книгу Barbe-bleue - Oscar Méténier - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
III
ОглавлениеTable des matières
A égale distance entre Moulins et Souvigny se trouve un canton boisé que l'on prendrait volontiers pour un coin de l'ancienne Gaule.
C'est un continent de verdure haute et profonde où les champs labourés ne forment que des golfes épars.
Il y a là une propriété moins agricole que forestière, connue sous le nom de Coupes de Guermanton, où, sur les rares débris d'un château qui fut brûlé à l'époque de la Révolution, s'élève un cottage pimpant, confortable, faisant face au levant et au couchant et dont on n'aperçoit rien de la grande route, que les girouettes.
Derrière une grille flanquée de deux pavillons de garde, le passant voit fuir une large et sinueuse allée, qui disparaît derrière un massif de grands pins.
Cette aimable retraite était l'habitation d'une famille composée de quatre personnes et d'une domesticité plus fidèle que nombreuse.
M. de Guermanton, ancien officier, avait épousé par raison sa cousine Jeanne dont il avait deux enfants, un garçon et une fille.
La solitude qui n'est saine pour personne n'est tolérable que pour la nullité ou le génie.
Ces quatre personnes auraient eu le droit de s'ennuyer prodigieusement, dans un tête-à-tête de dix mois par an, qu'interrompaient à peine quelques visites, sans une particularité assez rare aujourd'hui.
M. de Guermanton s'était fait un plan d'existence laborieuse auquel il se soumettait avec la ponctualité d'un soldat.
L'ayant été, il avait gardé de ce genre de vie le culte de l'heure sonnante et de l'ordre.
Fort actif, il avait pris par contre en horreur la vie de garnison.
Indifférent au turf, au jeu, à l'opéra, il n'avait que deux passions: la philanthropie et l'agriculture.
Il menait au besoin la charrue, maniait la cognée et plus qu'aux trois quarts médecin, il visitait les malades et les pauvres. Mais l'amour de l'agriculture et la philanthropie n'étaient pas les qualités exclusives de l'homme. Père attentif et tendre, il avait pour Jeanne l'estime que mérite une femme correcte et irréprochable.
Mais l'indifférence de Mme de Guermanton pour tout ce qui n'était pas le ménage, ainsi qu'une certaine étroitesse d'esprit qui l'empêchait de s'associer aux vues très hautes de celui qu'elle appelait, avec une nuance d'ironie, son philosophe, faisait de cette femme la matrone romaine plutôt que la compagne d'un penseur qui, tout en comptant des pieds d'arbres ou des mesures d'avoine, brassait des idées.
Mme de Guermanton, femme de taille moyenne et replète, était jolie, blonde, plutôt gaie que triste, mais tranquille et unie comme l'eau de son étang, où de nombreuses carpes rappelaient encore, par leur immobilité béate, l'humeur sans variété de leur châtelaine.
Elle avait un compartiment pour tout; le plus spacieux pour les questions culinaires.
En dehors de ce luxe, elle était parcimonieuse, et si le latin eût fait partie de ses études restreintes, elle eût pu prendre cette devise: Pro domo meâ.
Elle surveillait tout de la même attention, le poli de ses marbres, le brillant de ses parquets, le mouvement de la basse-cour et de la cave, les faits et gestes de ses valets et de son époux.
Douce et têtue, elle attachait à tous les détails la même importance.
Avec Jeanne, il n'y avait pas de péchés véniels. Cette tournure d'esprit et la résolution de trouver excessif tout ce qui n'était pas à sa mesure la rendaient ennuyeuse, absolue et sereine comme le chapelain d'une douairière.
Quand elle éprouvait la moindre résistance, elle avait une voix de tête qui faisait songer au caquetage d'une poule chassée par un passant de dessus ses œufs.
Cela ne durait point, mais on en gardait le souvenir et l'on évitait tout ce qui aurait pu en provoquer le retour.
Son mari n'était pas le dernier à se soumettre.
Jamais il ne cherchait à briser l'obstacle.
Tout au plus se donnait-il la peine de le tourner.
Il avait si nettement défini les deux sphères différentes de la double activité conjugale que les compétitions étaient rares.
Toutefois, ce tête-à-tête perpétuel avec Jeanne eût été réellement insupportable pour un esprit aussi élevé que le châtelain, mais il y avait heureusement dans la maison quelqu'un pour sentir, sans en parler, l'admiration méritée par Jacques de Guermanton.
C'était Pauline Marzet, l'institutrice.
Elle n'avait qu'une façon de le lui témoigner: c'était de se prodiguer aux enfants.
Aussi la recherchaient-ils et l'aimaient-ils comme une grande sœur.
Le grand art de la jeune fille consistait à remplir les longues soirées d'hiver.
Elle avait sur le piano un talent de réminiscence ou d'improvisation qui équivalait, pour Jacques, à tout un orchestre.
Cet art, qui ne s'apprend point, tenait à une organisation supérieure.
Au demeurant, Pauline Marzet était presque de la famille.
M. de Guermanton avait servi sous les ordres de son père, ancien officier supérieur.
Le commandant Marzet était d'un caractère aventureux. La monotonie de la vie de garnison ne pouvant convenir à son tempérament, il avait donné sa démission et sollicité du gouvernement une mission à l'étranger. Successivement, il s'était trouvé en des pays lointains à la tête d'entreprises qui n'avaient pas eu des résultats heureux et il était mort, laissant sa famille dans une situation fort précaire.
C'est alors que le hasard fit retrouver à M. de Guermanton la petite fille qu'il avait fait bien souvent sauter sur ses genoux alors qu'il était sous-lieutenant.
La pauvre enfant, orpheline à dix-sept ans, avait remis son sort entre les mains de l'ancien officier, et celui-ci lui avait ouvert toutes grandes les portes de sa maison.
Jeanne avait approuvé la décision de son mari et c'est ainsi que Pauline Marzet avait trouvé une nouvelle famille.
Dans son besoin de reconnaissance pour le bienfaiteur que le ciel avait mis sur son chemin, Pauline s'était consacrée entièrement à l'éducation de Georges et de Berthe, dont on pouvait dire qu'elle était la véritable mère.
On s'était habitué à elle et, dans cet intérieur uni et calme, elle était la vie et la gaieté.
Sa conversation était variée et intarissable.
Elle lisait beaucoup et surtout elle avait gardé un souvenir très vif des longs voyages qu'elle avait faits au temps de ses années heureuses.
Car elle avait, en compagnie de ses parents, parcouru l'Asie tout entière.
Tout l'avait frappée dans ces pérégrinations lointaines.
Aussi, lorsque la théière fumait, le soir, sur le guéridon du salon, M. de Guermanton n'était-il pas le dernier à dire:
—Pauline, dans quel coin de l'Orient allez-vous nous promener aujourd'hui?
Mme de Guermanton n'interrompait guère ces récits que pour s'écrier:
—Mais, c'est vraiment par trop extraordinaire!
Même certains points de détail lui étaient fort suspects.
Ainsi, jamais Pauline ne put faire accepter par Jeanne l'histoire de ces fleurettes, que les filles hindoues font pousser et s'épanouir à vue d'œil, autour de leurs pieds nus, après en avoir répandu les graines sur le sol.
Jacques, qui connaissait ce prodige et qui souffrait pour Pauline de l'incrédulité de sa femme, s'efforça en vain de la convaincre à son tour, il n'en obtint jamais que l'unique réponse:
—C'est vraiment trop extraordinaire!
Au demeurant, Pauline étonnait et inquiétait Mme de Guermanton sans la charmer.
La châtelaine avait souvent sur le bord des lèvres le mot des sceptiques:
—A beau mentir qui vient de loin.
De plus, l'institutrice avait dépassé la vingtième année et elle était devenue une superbe jeune fille. Jacques lui paraissait animé à son égard d'une sympathie bien vive...
M. de Guermanton ne fut pas long à trouver le fin mot des réticences et des résistances de sa femme.
Il comprit que la jalousie s'était emparée de l'âme de Jeanne et y était à l'état latent.
N'étant pas homme à souffrir dans sa maison les péripéties d'un roman vulgaire, il ne ménagea rien pour l'empêcher d'éclore.
On avait l'habitude, à Guermanton, de faire chaque jour une promenade à cheval.
Trois poneys procuraient aux trois habitants du cottage ce salutaire plaisir.
Un beau jour, Mme de Guermanton se plaignit brusquement de la fatigue que lui causait l'équitation.
Jacques aurait voulu et aurait pu continuer ses promenades avec Pauline, intrépide cavalière.
Il n'en fit pas une seule dans ce tête-à-tête.
Lorsqu'il fut avéré positivement que Jeanne se récusait, les trois poneys furent vendus et Jacques, monté sur un grand cheval de sang, continua seul à arpenter le pays au lever du soleil, franchissant haies et barrières.
De la même brusque façon, il élimina tout ce qui, entre Pauline et lui, pouvait être taxé d'intimité.
Mais il restait l'échange des pensées et il eût été bizarre que l'on ne causât de rien, parce que Jeanne ne prenait aucune part aux causeries d'une certaine portée.
Jacques tenait à parler de tout et même de ce qui n'intéressait nullement sa femme, alors justement qu'elle était présente.
Il n'aurait pas voulu que même les domestiques pussent dire que monsieur et mademoiselle s'entretenaient à part.
Malheureusement, ces sages précautions ne servirent à rien.
Jeanne châtiait doucement son mari et la jeune fille en s'endormant après dîner dans son fauteuil.
C'était signifier assez nettement que toute conversation l'ennuyait.
Or, un soir d'automne, et comme une pluie réglée avait un peu détendu la fibre de tout le monde, les enfants dégoûtés de leur damier, et pour conjurer l'heure du sommeil, toujours trop prompte à sonner, s'étaient logés sur les genoux paternels, demandant à cor et à cri une histoire.
Jacques transmit la supplique à Pauline; et Pauline, les yeux attachés à un dernier bouquet de roses, répéta d'un air distrait et rêveur:
—Une histoire?
—Une belle histoire de l'Inde! dirent les enfants.
—En fait d'histoire, reprit Pauline, je préférerais à toutes les miennes celle que pourraient nous raconter ces fleurs; on croirait, en cette saison surtout, que les dernières fleurs épanouies ont quelque chose à nous dire. Elles semblent regarder, attendre et chercher une voix pour nous jeter un adieu!
—Est-ce qu'il y a des fleurs qui parlent? demanda l'espiègle de huit ans qui était parvenu à enfourcher un des genoux de son père.
—Tu sais bien, répliqua sa petite sœur, qu'il y a des plantes à qui l'on fait mal en les touchant: ainsi les sensitives...
—Il y a aussi, dit le petit garçon, le baguenaudier qui craque comme un pistolet, quand on le presse dans la main.
—Il faut, dit la mère assoupie, demander à Mlle Pauline s'il n'y a pas aussi des fleurs qui parlent dans l'île de Ceylan.
—Il y a, sans aller si loin, dit Jacques en riant, les Mandragores qui chantent. Il est vrai que paroles et musique sont de Charles Nodier.
—Je ne connais à Ceylan, répondit Pauline, que les plantes qui tuent quand on dort à leur ombre.
—Mais, dit la petite fille, il ne pousse pas de ces fleurs-là à Guermanton.
—Et pourtant, dit le petit Georges, maman a défendu de laisser jamais des fleurs dans notre chambre à coucher, parce que cela nous ferait mourir. C'est égal, je voudrais bien trouver une fleur qui parle!
—Allez dormir, mes enfants, dit alors M. de Guermanton, il est huit heures. Vous rencontrerez peut-être de ces fleurs-là dans vos rêves.
—Nous n'avons pas eu notre histoire, fit Georges en appuyant lourdement sa tête contre le gilet de son père. On ne peut pas dormir sans histoire.
—Tu vas voir que tu dormiras parfaitement sans cela, répliqua le père en se levant doucement et emportant son fils dans ses bras.
La petite Berthe, un peu désappointée aussi, recueillit les baisers du soir et suivit son frère, en tenant l'habit de M. de Guermanton comme un refuge contre l'obscurité du corridor.
Quand les dames furent seules:
—Voilà maintenant mon fils entêté des fleurs qui parlent, dit Mme de Guermanton, avec une nuance d'aigreur. Si l'on continue à farcir la tête de ces enfants de toutes ces fadaises, on court grand risque d'en faire des rêveurs comme leur père.
Pauline tressaillit imperceptiblement:
—Je suis la coupable, murmura-t-elle, un peu émue; mais il me semblait que l'avantage de l'éducation de famille consiste justement à laisser aux enfants tremper leurs lèvres à la coupe d'intelligence et de sentiments où l'on boit soi-même, et, si les fleurs ont un langage pour nous, il n'est point déplacé de le leur faire entendre.
—Passe encore pour les fleurs, dit Mme de Guermanton, mais je suis épouvantée pour eux de ces veuves du Malabar qui se font rôtir, de ces sournois cuivrés qui vous étranglent avec un mouchoir, sans vous crier gare, de toute cette vie de fièvre, d'embuscades, de poisons, à laquelle vous avez eu le malheur d'assister toute jeune et qui, Dieu merci, est étrangère à nos climats pluvieux et tempérés. Tout cela a déteint sur vous d'une façon incurable. Je commence à croire que vous ne vous corrigerez jamais de la passion du drame asiatique, bien que vous en soyez la première victime. Vous marchez à la journée sur des chausses et des serpents. Ici, dans nos taillis, c'est tout au plus si en avril on rencontre au soleil une couleuvre inoffensive. Les besaciers qui viennent réclamer à la grille leur morceau de pain ne combinent point en secret de nous assassiner. Notre vie est unie. Nos enfants la continueront, j'espère; et puissent-ils ne point trouver dans sa paix monotone une raison de changer.
Cette sortie inattendue de la mère, articulée sur un ton d'impatience, stupéfia positivement Pauline; la broderie qu'elle tenait lui échappa des mains; elle les joignit en pâlissant, comme à l'ouïe d'un coup de tonnerre lointain dans un ciel sans nuages.
Elle regardait Mme de Guermanton sans rien trouver à lui répondre et quand, sur ces entrefaites, M. de Guermanton rentra le sourire aux lèvres, après avoir assisté à la prière du soir de ses enfants, il se demanda, voyant ces deux figures immobiles, s'il interrompait une conversation dans laquelle il était de trop. La physionomie de Pauline lui parut altérée, celle de sa femme à la fois animée et contrainte.
—Puis-je savoir, demanda-t-il avec un enjouement feint, de quelle espèce de fleurs il est à présent question?
—D'une terreur folle que j'ai pour mes enfants, de certaines fleurs des tropiques, répondit Mme de Guermanton, avec un sourire qui voulait tempérer l'amertume de son premier discours. Je disais à Pauline que Georges et sa sœur prennent insensiblement un tour d'esprit si... tropical que bientôt ils penseront en zend ou en cingali.
—Plût à Dieu qu'ils parlassent le persan comme le français! dit gaiement M. de Guermanton; mais ils n'en sont pas encore là.
—Quant à moi, dit Pauline, je ne saurais me charger de leur apprendre; mais Mme de Guermanton faisait tout à l'heure une réflexion qui m'a frappée...
—Et laquelle? demanda le mari.
—Elle n'avait pourtant rien de bien extraordinaire, dit Mme de Guermanton.
—Enfin la connaîtrai-je? répéta-t-il en remarquant le silence gardé par Mlle Marzet.
—Que ne parlez-vous à ma place? dit à Pauline Mme de Guermanton, qui ne se souciait apparemment point de se répéter.
—C'est bien simple, dit la jeune fille avec un pénible effort: j'ai quitté la patrie à l'âge de Georges, avec mon père et ma mère, qui, attirés par les souvenirs d'une ancienne fortune, allaient demander à un sol plus fécond une fortune nouvelle pour leur pauvre petite fille. Ballottés de l'Inde française, qui n'existe plus, à l'Inde anglaise, qui envahit tout, ils crurent vingt fois toucher au succès et perdirent vingt fois l'espérance. A Ceylan, sous les grands bois de teck de l'île Centrale, dont il suffirait d'abattre et de transporter quelques centaines de pieds d'arbres pour être riche, mon père contracta au milieu des miasmes la maladie qui l'emporta et qui m'a faite orpheline. Des débris de ce naufrage, ma mère recueillit en pleurant quelques poignées d'or avec lesquelles elle voulut ramener son enfant dans cette Europe, que nous pensions ne revoir jamais! Se défiant de toutes les spéculations et de tous les placements après la dure expérience qu'elle en avait faite, elle dépensa, pièce à pièce, le trésor de la veuve, pour achever mon instruction, aimant mieux me laisser, en mourant, institutrice d'une école primaire, que femme incomprise et cherchant aventure! Vous m'avez rencontrée ayant pour tout bien un diplôme d'institutrice et ce deuil qu'après trois ans je porte encore... Vous m'avez accueillie, vous m'avez tenu lieu du père et de la mère que j'avais perdus. En me confiant vos enfants, vous m'avez laissé croire que je leur étais utile; mais si les souvenirs de mon enfance remplissent malgré moi mes discours, si je parle trop devant ces chers petits de choses qui peuvent tourmenter leur esprit et les agiter, si, en un mot, et bien malgré moi, je ne suis plus pour eux bienfaisante et bien disante, pourquoi ne songerais-je point à la retraite? Ah! si j'ai gardé si chers les souvenirs d'une enfance orageuse, de quelle tendresse n'entourerai-je point le souvenir des jours que j'ai passés ici? Monsieur de Guermanton, vous ne me dites rien? Mais, madame a parlé; j'ai compris... et j'abdique.
Pauline, dont la voix avait souvent tremblé en parlant ainsi, mais qui avait fait taire toute faiblesse, essuya deux larmes furtives, en femme qui ne veut pas les montrer. Un coup d'œil qu'elle jeta sur M. de Guermanton, à la dérobée, le lui montra sérieux, pensif, interrogeant sa femme du regard, mais voulant paraître impassible.
—Une semblable détermination me semble un peu soudaine, dit Mme de Guermanton que la figure de son mari inquiétait et dont le ton avait fléchi.
—Vous m'atterrez, dit enfin le père de famille à l'institutrice. Mais vous êtes libre. Si vous nous quittez, vous emporterez des regrets que vous n'imaginez pas.
—Je les jugerai d'après les miens, répondit Pauline attendrie.
Elle se leva, salua et sortit à pas lents, sans bruit, comme une ombre.
Dès que Pauline Marzet eut refermé la porte, Jacques de Guermanton entra dans une de ces franches colères qui se déchaînent parfois chez les hommes les plus maîtres d'eux-mêmes, quand on les frappe au plus sensible de leur cœur.
Les préoccupations domestiques et les confitures de Mme de Guermanton ne l'avaient jamais amusé.
En faisant le plus raisonnable des mariages, comme on l'entend, il avait épousé l'uniformité et l'ennui; et, comme avant d'accepter le joug conjugal, il avait connu les plaisirs d'une vie aventureuse, celle des camps et des voyages, il n'avait pas tardé à s'apercevoir que le pot-au-feu n'était point son fait.
Or, la vie, si courte quand elle est remplie, est d'une longueur désespérante quand elle est vide.
On peut bien se jeter à la nage pour traverser un détroit; mais on est bien aise de rencontrer, chemin faisant, une barque où se reposer, quand le courage du nageur est trahi par ses forces.
C'est ainsi que Pauline, avec le tour original de son caractère, sa beauté expressive, son passé voyageur, sa saveur méridionale, avait semblé à Jacques une distraction nécessaire dans une vie monotone. En vivant en frère avec elle, il s'était épris d'elle, sans le vouloir, au point de considérer le riant exil des bois, comme le temple de Pauline dont Jeanne n'ornait qu'une niche, tandis que l'autre divinité trônait sur le maître autel.
On comprend dès lors la colère de Jacques en voyant, d'un coup sec et imprévu, Jeanne renverser avec sa main mignonne et perfide la divinité du temple et se figurer que dans la vie solitaire de Guermanton, Pauline ôtée, il n'y aurait qu'une institutrice de moins.
—Ma chère, dit l'ancien officier de dragons, vous venez, en congédiant Mlle Marzet sans mon avis, de me causer un désappointement que vous n'imaginez guère. Ah! ça, dites-moi, je vous prie, ce que vont devenir nos enfants, quand elle n'y sera plus! Vous figurez-vous que le spectacle de vos occupations, que l'examen des légumes apportés chaque matin par votre jardinier, que le rangement des fruits dans le fruitier, que les supputations arithmétiques avec votre cuisinière tiendront lieu à vos enfants de l'étude de la nature, des sciences élémentaires et des langues vivantes? Êtes-vous polyglotte comme Mlle Marzet? Êtes-vous musicienne comme Mlle Marzet? Êtes-vous... amusante comme Mlle Marzet?
—Il y a longtemps, murmura Mme de Guermanton, que je trouve Mlle Marzet beaucoup trop amusante! Je crois que les enfants y perdront sous un rapport; mais le mal est réparable, il y a d'autres institutrices. Seulement, tout en vous voyant fort occupé de Pauline, je n'imaginais pas que vous en fussiez arrivé à trouver le vide irréparable à compter du jour où il n'y aurait plus que votre femme pour le combler.
—Ainsi, c'est à une risible jalousie que vous sacrifiez les intérêts les plus sérieux?
—Oui, je suis jalouse de cette demoiselle: j'ai ce vice, de toutes les femmes: tenir au cœur de mon mari!
—Si vous aviez quelque motif sérieux de jalousie, croiriez-vous donc, dans votre myopie, remédier à tout cela en éloignant votre rivale? Croyez-vous tout conjurer en cachant, comme l'autruche à l'heure du danger, votre tête dans le sable? Mais en vérité, ma chère, je n'aurais point attendu jusqu'ici et je n'aurais point adopté la vie que je mène si j'avais voulu vous tromper! Paris est grand et, si je l'avais exigé, vous auriez consenti à y vivre! Or, vous savez sans doute que les distractions n'y manquent ni pour l'esprit ni pour le cœur. Cette Babylone a toutes sortes de petits jardins suspendus près des toits où l'on peut aller s'asseoir sans la permission de sa femme et tout à fait à son insu. La polygamie orientale y est poussée aux derniers raffinements. Ici, dans une maison de verre, sous la surveillance implacable de mes gens, je mène austèrement une vie austère. Une femme aimable, dont la présence est justifiée par une mission évidente, celle d'enseigner à nos enfants ce que—franchement—nous ne savons plus guère, cette femme, cette jeune fille, se trouve être de plus, pour nous, une compagnie agréable; et, par un coup de tête, vous la supprimez!
—Vous êtes le maître, monsieur, dit Jeanne entêtée dans sa résolution, mais en revenant sur ce qui a été dit ce soir, vous outrageriez la mère de famille. Faites maintenant ce qu'il vous plaira.
—Un retour aimable, un repentir ne peuvent émaner que de vous. Ainsi le veulent les convenances.
—Ne comptez pas sur moi pour me dégager, mon ami. Je ne saurais que me taire et vous obéir.
—Un tiers imposé par ma volonté, dans le ménage, deviendrait un perpétuel sujet de discorde. Or, je veux la paix!
Jeanne sourit imperceptiblement. Elle avait bien songé à cela et elle connaissait le respect classique de son mari pour la dignité conjugale.
—Après tout, dit-elle, ce n'est pas un sort si digne d'envie que celui de Mlle Marzet. Que voulez-vous que devienne à la longue une fille de vingt ans pleine d'idées romanesques, de passions inassouvies, de diables bleus, en face de deux enfants faisant des gammes et traçant des bâtons sur du papier réglé? Si vous êtes l'ami de Mlle Marzet, vous devez avoir pitié d'elle et désirer pour elle autre chose. Si vous n'êtes que son ami désintéressé, vous devez désirer qu'elle se marie. Cherchons ensemble, aidons-la à trouver un époux. Nous aurons travaillé tous deux à une bonne action et votre attachement pour elle y trouvera son compte.
—Ah! vous croyez, dit Jacques d'un ton de persifflage, avoir tout fait pour le prochain en lui mettant la corde au cou? Epousez donc n'importe qui, et tout sera dit sur votre destin! C'est ainsi que finissent les romans et les pièces de théâtre, il est vrai, mais le moment où la toile tombe est celui où commence, bien souvent, le vrai drame, le drame sans témoins, le drame sans littérature où l'on conjugue en tournant les pouces: Je m'ennuie, tu t'ennuies, il s'ennuie, nous nous ennuyons...
—Vous devenez tout à fait galant! s'écria Jeanne, de sa voix de tête. Vous me feriez aussi à la longue conjuguer ce verbe-là!
Jacques revint-il à de meilleurs sentiments, ou persévéra-t-il dans sa colère?
Patiente et froide, Jeanne triompha-t-elle de son emportement de femme dont on brise une habitude chère? Les caractères les plus entiers font à la paix des sacrifices proportionnés à leur force même.
Peut-être aussi Jacques comprit-il qu'il aimait Pauline Marzet beaucoup plus qu'il ne l'avait pensé.
Or, il n'est pas de supplice comparable à une observation perpétuelle de soi dans ces relations où tout sollicite à la fois la raison de s'abstenir et un cœur tendre et chaleureux de passer outre.
Jacques avait sacrifié ses inclinations à ses intérêts et à une foi prématurée dans sa maturité, en épousant sa cousine moins pour ses beaux yeux que par esprit de famille et par convenance.
Il avait partagé l'erreur exprimée dans la maxime vulgaire: «Il faut faire une fin», comme si le cœur de certaines gens en avait jamais fini!
Il rongea son frein et chercha peut-être désormais d'autres distractions que ses platoniques entretiens avec Pauline...
De son côté Mlle Marzet, retirée chez elle, s'y était enfermée vivement. Puis, avec l'instinct de ceux dont la circulation s'arrête dans le paroxysme d'une émotion soudaine, elle dénoua tous les liens de ses vêtements, se mouilla les tempes avec de l'eau froide et se jeta sur son lit en sanglotant.
—Que leur ai-je fait? fut sa première exclamation.
Par quelque revers que l'on ait passé, les revers nouveaux confondent les calculs de la pensée au point de nous faire croire que nous rêvons.
L'idée du mutisme de M. de Guermanton, dans un moment où il avait semblé à Pauline que l'estime et la sympathie de cet homme dussent être son égide, l'avait frappée plus que tout le reste et elle le diminuait dans son estime au point d'effacer presque le souvenir de ses bienfaits.
Il s'écoula un temps long, sans qu'il lui fût possible de coordonner les faits ni de les rattacher à une logique quelconque. Alors elle remonta le cours des trois années écoulées, cherchant dans les souvenirs plus anciens et dans les moindres, un indice, une origine, une cause à ce désastre impossible à prévoir.
Jamais Mme de Guermanton ne lui avait fait une observation pénible, jamais elle ne l'avait blâmée que dans cette forme délicate qui consiste à dire:
—Ne pensez-vous pas que... Ne trouvez-vous pas qu'il serait préférable...?
Questions auxquelles Pauline avait toujours répondu par:
—Il se pourrait... Vous avez certainement raison...
Le sujet des Contes orientaux était assurément ce dont Pauline se préoccupait le moins.
Elle sentait que ce n'était là qu'un prétexte; mais alors... elle avait péché d'une manière plus grave! Et laquelle?
Chemin faisant dans ce dédale, elle considéra tout à coup son propre portrait, une petite carte photographique suspendue dans un cadre de cinquante centimes, à côté d'un portrait de Mme de Guermanton, suspendu dans un cadre pareil.
C'était l'œuvre d'un artiste de passage, de ceux qui, dans les fêtes de village, vous bâclent une épreuve, avec ressemblance garantie, pour vingt sous.
Il y avait trois ans que ces photographies étaient faites. Pauline avait alors dix-huit ans.
Elle était maigre, toutes ses forces vives s'étant, jusque-là, concentrées dans son cerveau. Cet organe avait fait tort aux autres.
La jeune fille n'était encore faite pour inspirer, presque enfant, de jalousie à personne.
Il n'y avait point jusqu'à ses cheveux en bandeaux plats qui ne lui donnassent un peu l'air d'une pensionnaire.
Par contre Mme de Guermanton, déjà mère, était dans la plénitude de sa beauté; ses cheveux blonds formaient, autour de son visage aquilin, une auréole de boucles et de nattes, qui en corrigeaient la placide sécheresse en donnant un cadre gracieux à ses yeux arrondis.
Nulle comparaison à établir entre la jeune femme à son apogée et Pauline à l'aube des floraisons premières, et dans cette comparaison, si elle venait à l'esprit de quelqu'un, tout marquait que l'une était le centre et l'autre la satellite.
Mais il y avait trois ans de cela!
Soudain Pauline se releva; elle prit la bougie et vint s'accouder devant le miroir ovale de sa petite toilette en noyer.
Non! Elle n'était plus le petit magister en jupons chargé d'enseigner l'écriture à Berthe et à Georges!
En trois ans, la fleur s'était épanouie au soleil d'une vie large, au grand air et dans cette liberté relative que procurent l'aisance et les soins prévenants.
Le deuil perpétuel de Pauline s'était tempéré; les caprices de la mode en avaient fait une parure et, tandis que ses cheveux d'un noir d'encre avaient pris le tour onduleux des statues de Coustou, ses lèvres framboisées accompagnaient d'une touche vive l'éclat de ses prunelles ardentes.
L'étoffe légère de ses manches laissait deviner, à travers leur réseau noir, un bras d'albâtre qui n'avait plus rien des sécheresses étiolées de la première adolescence.
Elle avait enfin, ce je ne sais quoi qui commande la sympathie, qui occupe, qui fascine la pensée et qui confond tous les jours les calculs de la raison pour laisser libre cours aux surprises du cœur.
Il n'était que faire d'aller chercher ailleurs que dans ce changement, l'amertume trahie par les paroles de Mme de Guermanton; et bien que Pauline fût à cent lieues de se trouver décidément plus belle et plus aimable que l'épouse de son hôte, un éclair lui révéla que peut-être elle avait perdu dans l'esprit de Mme de Guermanton, ce qu'elle-même avait gagné à tous les yeux.
Jacques aimait Pauline et Jeanne puisait dans cette certitude tous les motifs de son aversion contre la jeune fille.
Et Pauline aussi n'avait-elle point cent fois pensé avec émotion au bonheur que Jeanne devait trouver dans la tendresse d'un époux comme le sien?
Un rien lui avait révélé l'âme de feu de cet homme encore jeune, si ce n'était plus un jeune homme.
Il avait l'habitude de noter sur de petites bandes de papier qu'il laissait ensuite, comme des marques dans les livres eux-mêmes, les pensées saillantes ou les mots frappants recueillis dans ses lectures.
C'est ainsi qu'une fois, lisant après lui un livre charmant, la Bêtise humaine de Noriac, elle y avait trouvé et elle avait gardé avec prédilection un petit papier de cette espèce, sur lequel Jacques avait, de sa main, écrit ce mot de l'héroïne du roman reprochant au héros des préoccupations philosophiques: