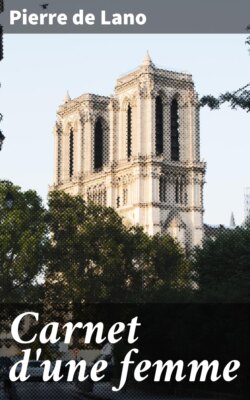Читать книгу Carnet d'une femme - Pierre de Lano - Страница 3
ОглавлениеCARNET D'UNE FEMME
CE QU'APPREND LE MARIAGE
Hier, pour la première fois depuis mon mariage, je suis retournée dans le monde.
Lorsque j'étais jeune fille, j'éprouvais un émoi, chaque fois que ma mère me conduisait en soirée. J'allais au bal, le cœur battant très fort, comme si j'eusse dû y rencontrer des êtres extraordinaires, comme si j'eusse dû y voir des choses très défendues.
Je croyais que le mariage m'eût guérie de cette inquiétude. Eh bien, pas du tout. Je me suis retrouvée, hier, en allant à cette fête, chez les de Sorget, exactement comme j'étais au temps—tout récent encore—où l'on m'appelait «mademoiselle.»
En vérité, oui, j'ai ressenti cette même anxiété qui me faisait interrogative, naguère, devant les gens et devant les choses que j'allais frôler, cette même nervosité qui m'agitait au point de m'empêcher de manger.
Cependant—le mariage est un grand initiateur—je dois avouer que mon émotion actuelle, que mon trouble de femme, ne ressemblent en aucune façon à mon trouble et à mon émotion de jeune fille; que mes sentiments et mes sensations d'aujourd'hui n'ont, avec ceux d'hier, de commun que l'apparence.
Jeune fille, je me rendais au bal, d'abord pour les jouissances intimes et inconscientes que le bal me procurait; ensuite, pour me rapprocher, tout en m'en éloignant au plus vite, avec quelque effroi même, des groupes d'hommes ou de femmes auxquels il ne m'était pas permis de me mêler; pour y chercher, peut-être aussi, la fine moustache du Prince Charmant que quelque rêve m'avait montrée.
Ce n'est point cette innocente curiosité qui m'a tourmentée, hier.
Je suis entrée chez les de Sorget avec l'espérance d'entendre et de voir ce que je n'avais, jusqu'alors, ni vu ni entendu—d'entendre des paroles que l'on ne dit qu'aux femmes mariées, de voir des visages qui ne sourient qu'à elles. S'il faut être franche, il y avait même plus que de l'espérance en moi; il y avait du désir et une forte dose de complaisance préméditée, à l'appui de ce désir.
Eh bien, j'ai été satisfaite.
On nous a mariés, Jean et moi, vers la fin de la saison mondaine. Il y a sept mois environ que nous vivons en tête à tête, ayant voyagé, et mon mari semblait tout heureux de revenir à ses amis, à ses habitudes. Sa hâte à marquer ce plaisir a même manqué de galanterie. Dès notre arrivée chez les de Sorget, il m'a «plaquée,» comme il dit, avec les femmes, et il s'en est allé serrer un tas de mains au fumoir, dans la serre, je ne sais où.
Cette fuite précipitée m'a un peu chagrinée. J'aime beaucoup Jean, malgré ses brusqueries fréquentes, ses façons de penser sans cesse, depuis quelque temps, à toute autre qu'à moi, l'ennui profond qu'il semble traîner après lui, mais qui n'est qu'un «chic,» qu'une attitude d'homme du monde, paraît-il. En le voyant me quitter aussi vite, j'ai eu comme un serrement de cœur, et je n'affirmerais point qu'une pauvre petite larme n'aurait pas noyé ma paupière si l'on m'avait laissé le loisir de ruminer ma peine.
Mais à peine Jean se fut-il éloigné, que je me vis prise d'assaut par une dizaine d'habits noirs, parmi lesquels je reconnus plusieurs de mes anciens danseurs—de mes assidus valseurs d'autrefois.
Je remarquai que tous, en dansant, m'enlaçaient beaucoup plus étroitement que jadis. Il y en eut, même, qui se livrèrent autour de ma taille et, à la dérobée, sur ma personne, à une sorte de «massage» qui m'agaça fort.
Les compliments qu'on m'adressait n'étaient plus les mêmes. Naguère, c'était après mille et une contorsions de phrases très comiques, souvent, que l'on osait me faire entendre que j'étais charmante. Hier, on n'a point pris tant de précautions, et l'on ne m'a plus dit que j'étais charmante. On a remplacé cet adjectif banal par d'autres plus accentués. Hier, selon mes danseurs, j'ai été tour à tour divine, prenante, sorcière, attirante; il y en eut un qui voulut absolument voir en moi une beauté perverse. Je l'assurai, en riant, car dans le monde il faut rire de tout et de tous, que je ne possède certainement aucune des qualités ou aucun des défauts qu'il me prêtait, et comme je lui donnais à supposer que je le croyais poète, il se récria:
—Moi, poète, non, madame, non. A peine musicien.
Je l'interrogeai:
—Instrumentiste?... compositeur?
Il parut réfléchir.
—Mon Dieu, ni l'un, ni l'autre... ou plutôt, instrumentiste.
—Pianiste?... violoniste?
—Non... tout ça... trop commun... Je joue du tambour.
—Du tambour?
—Oui; et comme, à Paris, jouer du tambour est défendu, j'ai fait capitonner, sur toutes ses faces, une chambre dans mon appartement où, sans gêner personne, je passe mes journées à «battre.»
Je ne pus tenir mon sérieux. Cet homme qui joue du tambour, durant toutes ses journées, qui est le duc de Blérac et qui trouve en moi tant de choses perverses, m'apparut comme le type le plus réjouissant qu'il fût offert de rencontrer. J'éclatai de rire, et, comme il ne comprit pas la cause de ma gaîté, il se mit à rire avec moi.
En me reconduisant à ma place, il m'a invitée à venir voir son installation musicale. Je l'ai remercié.
Comme la soirée s'achevait, je pensai: des mains se sont promenées sur tout ce que mon corps laissait à leur portée; des bouches ont prononcé, à mes oreilles, des mots que la correction mondaine empêchait tout juste d'être inconvenants; des regards ont fixé mon regard, dans une convoitise à peine dissimulée.
C'étaient donc là, les choses que j'ignorais, jeune fille, et au-devant desquelles j'allais, tout à l'heure, presque émue?
J'eusse dû m'indigner. Je ne m'indignai pas, je le confesse, et, quoique je reconnusse la sottise de ceux qui m'avaient ainsi ennuyée, je trouvai quelque attrait que je ne saurais expliquer au danger que cachaient leurs paroles ou leurs gestes et que, dans un instinct, je devinai.
Je me faisais un plaisir de conter tout cela à Jean, lorsque nous sortirions.
Mais, aux premiers mots que je lui adressai, dans la voiture, à ce sujet, il m'arrêta:
—On vous a fait la cour, tant que cela?... Eh bien, vous ne devriez pas me le dire. Une femme, dans notre monde, ne dit jamais à son mari qu'on lui fait la cour.
Etonnée, je répliquai:
—Je ne vous comprends pas.
Alors, un peu brusque, Jean conclut:
—C'est simple, pourtant.—Une femme ne peut empêcher qu'on lui fasse la cour. Cela ne l'engage en rien et ne regarde qu'elle.
En mettant son mari au courant de tous ces détails de salon, elle le rend ridicule. Songez-y.
Je restai muette et, comme le désirait Jean, je songeai... je songeai que le mariage apprend, aux femmes, de singulières choses... dans notre monde.