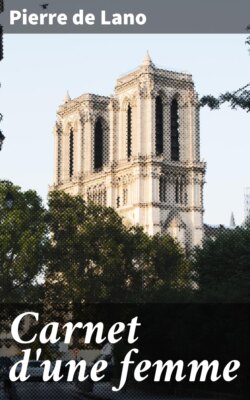Читать книгу Carnet d'une femme - Pierre de Lano - Страница 4
L'INCONSTANCE DU MARI
ОглавлениеJ'ai appris, aujourd'hui, une chose abominable... une chose qui m'a fait un mal affreux.
J'ai appris que mon mari, que Jean a une maîtresse, c'est-à-dire ne m'aime plus, sans doute.
Cette révélation explique bien des faits que je ne comprenais pas depuis le retour de notre voyage de noces.
Jean, dès le lendemain de ce retour, presque, s'était montré nerveux, ennuyé et, comme une sotte que j'étais, je pensais que cet état d'esprit correspondait, chez lui, à un simple «chic» de mondain. C'était une femme qui le changeait ainsi, et cette femme a été plus forte que moi, puisque je n'ai pas su la deviner et lui retirer mon mari, même, et surtout, sans connaître qu'elle était ma rivale.
Je n'oserais affirmer que Jean n'avait pas un peu lassé ma patience par ses singularités de caractère et d'attitude, en ces derniers temps; je n'oserais affirmer que je l'aime autant que jadis. Cependant, en apprenant qu'il a une maîtresse, j'ai éprouvé un gros chagrin et, l'avouerai-je, un froissement d'orgueil très profond.
On assure que lorsque l'orgueil se mêle à un sentiment de tendresse, cette tendresse est à son déclin. Je ne sais si cette observation est juste; mais il me semble très naturel qu'une femme, jeune, jolie—parfaitement, jolie!—à peine mariée, comme je suis, se sente humiliée à la pensée qu'une autre femme lui prend celui qu'elle a aimé ou qu'elle aime.
Je ne suis pas une niaise et j'eusse pardonné, à Jean, un caprice—une passade—selon l'expression de cette folle d'Yvonne, après laquelle passade l'infidèle me fût revenu tout entier, au moins moralement. Mais non; il a une maîtresse, une maîtresse qu'il adore, sans doute, et auprès de laquelle il vit le plus grand nombre de ses heures.
Comment ai-je su l'inconstance de Jean? Très simplement et, probablement, comme on sait ordinairement ces choses-là. Une imprudence de mon mari m'a mise au courant des faits.
Etant entrée, cette après-midi, dans sa chambre, je ne l'y trouvai pas, mais j'y vis, en revanche, traînant sur un meuble, une lettre dont il m'a semblé reconnaître l'écriture. La tentation fut plus puissante que mon désir de ne pas lire, que l'avis de ma conscience qui me conseillait de ne pas être curieuse; j'ouvris la lettre et je la parcourus. Je ne me trompais pas. L'épître était de cette petite peste de Rolande qui, mariée au duc de Blérac—le monsieur qui passe ses journées à jouer du tambour et qui m'a fait la cour récemment—s'ennuie et se distrait, je le vois, en volant, à ses amies, leurs maris.
Il y avait, là, quatre pages d'extraordinaire passion exprimée dans un langage, par des mots que je n'ai pas très bien compris, toujours. Je ne croyais pas Jean, dans ses grands airs froids, guindés et cérémonieux, que jamais le rire n'éclaire, capable de parler un tel patois amoureux, capable, surtout, d'inspirer à une femme l'enthousiasme que témoigne Rolande.
Ce fait présente, à mes yeux encore mal ouverts de petite mariée, comme on me nomme depuis mon retour à Paris, une énigme qui m'intrigue et que je ne devinerai jamais, si je reste ce que je suis, une pauvre bête d'épousée que tout étonne.
J'ai pleuré en lisant la prose de Rolande—cette prose où il y a des phrases d'amour si précises, que je n'ai pu douter une seconde de l'intimité de ses relations avec Jean—des phrases aussi qui me feraient supposer que cette intimité date de plus loin que notre retour à Paris, existait avant notre mariage.
J'ai pleuré. Mais Jean ne saura pas ma peine. Je ne suis pas si naïve que je ne sache qu'un plaisir se double par la douleur ou, simplement, par l'ennui qu'il procure à autrui, dans un contre-coup logique. En apprenant que j'ai pleuré, Jean qui considère sa trahison, peut-être, ainsi qu'une incidence insignifiante dans sa vie, l'envisagerait comme une chose sinon méritoire, du moins fort appréciable, et en goûterait le charme d'autant plus délicieusement qu'il se saurait deviné, qu'il se croirait surveillé.
Je ne l'ai pas vu, d'ailleurs, aujourd'hui, et j'ai des «chances» pour ne le point voir jusqu'à demain.
Yvonne seule—ma meilleure amie du Sacré-Cœur—cette tête folle d'Yvonne de Mercy, est venue me troubler dans mes méditations et me tirer, un peu aussi, de mon chagrin.
Elle a dîné avec moi et sa présence m'a certainement consolée.
C'est un cœur excellent, mais quelle cervelle détraquée!
Mariée depuis deux ans, elle parle de tous et de tout sur un ton qui n'admet pas de réplique. Elle professe une grande expérience des choses d'amour, surtout, et comme je ne suis pas assez savante, en cette matière, pour la contredire, je suis bien forcée de m'incliner devant ses raisonnements.
On lui fait une cour terrible, dans le monde, et elle a, sans cesse, un troupeau d'amoureux sur ses pas. On l'a baptisée, pour cette cause, la Bergère.—Gare au loup, madame; les moutons attirent le loup qui croque même les bergères.
On ne peut rien lui cacher, et elle s'est aperçue que j'avais les yeux rouges... que j'avais pleuré. Elle m'a questionnée et quoique j'eusse voulu ne pas révéler le secret humiliant qui me faisait souffrir, elle m'a obligée, par ses instances, par ses caresses, à le lui avouer.
Je m'attendais à ce qu'elle s'indignât avec moi contre la conduite de Jean. Mais elle s'est mise à rire, à rire, à tellement rire, que sa gaîté m'a choquée. Voyant qu'elle me contrariait, elle est redevenue sérieuse et m'a dit:
—Ton mari te trompe, et tu te lamentes, et tu pleures, au risque d'abîmer tes jolis yeux. C'est insensé.
—Tu ne voudrais pas, pourtant, que je me réjouisse, répliquai-je.
—Non. Mais je tiens à ce que tu ne perdes pas ton temps et ta beauté en des gémissements inutiles. La surprise que tu éprouves, actuellement, tu l'aurais éprouvée demain. Un peu plus tôt, un peu plus tard, va, c'est ainsi dans le mariage, pour nous autres, femmes, et le mieux, souvent, est quand c'est un peu plus tôt.
—Que signifie cela?
—Cela signifie qu'on a, ainsi, plus de temps devant soi, pour se consoler.
—C'est affreux ce que tu dis là.
—Mais non, ce n'est pas affreux. C'est simplement conforme à la morale mondaine.
Comme je ne trouvais rien à répondre à cette étrange théorie, Yvonne se rapprocha de moi et, s'emparant de mes mains, me parla affectueusement.
—Ecoute-moi bien. Jean t'a aimée pendant sept mois d'une façon à peu près exclusive. Eh bien, résigne-toi s'il ne t'aime plus ainsi, et songe que tu es parmi les heureuses. Combien de femmes, dans le monde, pourraient avoir le souvenir d'amour que tu possèdes et y puiser une compensation à leur abandon? Nous donnons beaucoup, en entrant dans le mariage, ma pauvre chérie, tandis que l'homme ne nous offre qu'un cœur fatigué d'avoir battu la charge, un peu sur tous les champs de bataille, qu'un désir superficiel, émoussé, qui ressemble à un feu prêt à s'éteindre, sans cesse, et en lequel il est nécessaire de jeter, à toute minute, de nouveaux fagots. Nous sommes des fagots, aux yeux de ces messieurs; lorsque nous sommes consumés, ils vont au bois en chercher d'autres. Pourquoi nous plaindre et pourquoi leur demander plus qu'ils ne peuvent donner? La vie—la vie mondaine—est ainsi et rien ne la changera. Dans ton cas particulier, tu dois te féliciter. Après huit mois de mariage, ton mari ne t'a pas rendue mère et tu restes libre, par conséquent.—Un enfant est un élément consolateur, pour la femme délaissée, dans le monde bourgeois. Mais, chez nous, il n'apporte, souvent, qu'une amertume de plus. On ne saurait prévoir ce que l'avenir réserve à une mondaine dédaignée par son mari. Or, quoi qu'elle fasse, quelqu'aventure dont elle soit l'héroïne, si elle n'a pas d'enfant, elle sera excusée. Un bambin, au contraire, lui vaudrait la sévérité, le contrôle des gens qu'elle fréquente, et ces gens la condamneraient, la mettraient à l'index si le plus léger incident venait rompre la monotonie de son existence. Je ne te souhaite ni te conseille cet incident, ma chérie, mais, enfin, s'il survenait, tu es indépendante et ton mari lui-même se réjouirait de te savoir dégagée de tout devoir envers un enfant—fille ou garçon—qui porterait son nom. Je n'ai pas eu d'enfant, et lorsque M. de Mercy m'a oubliée, je me suis bien trouvée de n'être pas mère; m'as-tu comprise?
J'ai compris, certes, le discours d'Yvonne, ou plutôt—car elle n'a pas voulu m'en dire davantage, aujourd'hui, et s'en est allée en coup de vent—je sens que ma vie d'innocence, si je puis ainsi m'exprimer, est finie; je sens que j'ai l'âme et tout l'être troublés, et il me semble que je quitte une demeure familière et paisible, pour entrer dans une maison inconnue et en laquelle, au bruit de chacun de mes pas, répond un écho mystérieux.