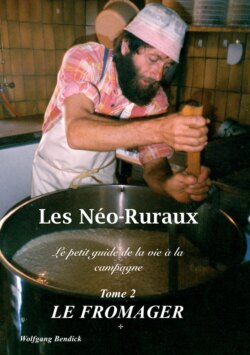Читать книгу Les Néo-Ruraux Tome 2: Le Fromager - Wolfgang Bendick - Страница 14
MADAME BERNAGOU
ОглавлениеL’été, nous allons toutes les deux semaines à Sentein pour faire le marché. En fait, ce lieu a un vrai caractère de village, car il n’est pas, comme la plupart des autres localités, construit des deux côtés de la rue principale. Le centre est sans aucun doute l’ancienne église fortifiée, avec ses trois tours différentes. De là, une route sinueuse mène à Antras, une autre se poursuit dans la vallée du Lez jusqu’aux anciennes mines au Bocart, endroit où l’on traitait le minerai des mines du Bentaillou puis, comme piste dans les montagnes jusqu’à l’étang d’Araing. Sur les pentes se dressent encore de nombreux pylônes en fer, la plupart privés de leurs câbles sur lesquels le minerai était transporté jusque dans la vallée. Cet endroit, autrefois accessible même par un tramway, nous fascine et nous venons souvent ici pour faire de la randonnée et de ‘l’exploration’.
Après la fermeture des usines, certains paysans ont enlevé les câbles des mâts pour construire de petits téléphériques pour le transport de fumier et de foin, comme Daniel, un vieux paysan, qui avait encore quelques chèvres avec lesquelles, accompagné de sa femme, il participait à « Autrefois le Couserans ». C’est une manifestation d’anciennes machines et coutumes qui a lieux chaque mois d’aout à St. Girons. Il avait, plus jeune, travaillé dans les mines et racontait drôlement bien la vie d’autrefois. Dans sa famille ils ont tous dépassés l’âge de cent ans. D’autres ont défait les gros câbles porteurs et construit des clôtures avec les torons, les tresses plus minces qui ressemblent à un tire-bouchon sans fin. Les bâtiments situés en bas de la vallée contiennent encore les machines de broyage et de tri des minerais qui étaient transportés par camion ou par tramway vers St. Girons, puis par train jusqu’aux usines de transformation. Sous les toits en tôle rouillée, nous trouvons des machines, arrêtées au milieu de l’exploitation, dont nous ne pouvons que deviner l’utilisation. Des tonneaux de produits chimiques utilisés pour extraire les métaux sont entreposés. Certains ont été renversés, soit par des vandales soit par le temps, et autour de ceux-ci s’est répandu leur contenu certainement toxique. Deux VW tout-terrain tout neufs sont encore dans la cour. Des appareils électriques, jamais mis en service et encore emballés dans leurs caisses de transport se trouvent dans les galeries, et les baraques en bois ont été en partie démolies pour servir ailleurs comme matériaux de construction. Fascinant, mais dangereux ! Surtout pour l’environnement, l’eau. Parce que tôt ou tard, tout finira là-dedans !
En 1975, peu avant notre arrivée, les mines ont été fermées après plus d’un siècle d’exploitation. Au 19ème et 20ème siècle, l’exploitation avait atteint son apogée. On m’a dit que vers la fin, une société allemande projetait de reprendre les mines et de continuer le travail, ou qu’EDF reprendrait tout et fermerait le site. En tant que bons patriotes, les responsables ont choisi la deuxième solution et le chômage et la pollution qui allaient avec.
Les galeries se trouvent en partie à plus de 2000 mètres d’altitude, et traversent parfois la montagne jusqu’au côté espagnol. Nous n’y sommes jamais rentrés très loin, car il y a parfois des puits perpendiculaires, bien sûr non sécurisés ! Le minerai était acheminé dans la vallée dans des wagonnets par les téléphériques pour une première transformation. La mine la plus connue est celle du Mail de Bulard, appelée la ‘mangeuse d’hommes’ parce que sa construction et son exploitation ont causé la mort de nombreuses personnes. Mais à part ‘des hommes et du fer’, le pays avait besoin de plomb, de zinc, de tungstène, de cuivre, soit d’abord pour la guerre, soit plus tard pour la reconstruction.
Le site est devenu un énorme self-service. Les machines, les voitures, les générateurs disparaissent. Des amis à nous ont rempli un camion entier avec, plus des tôles ondulées et des poutres de bois. Ils sont rentrés la nuit pour ne pas être vus. Mais à Carérat, qui se trouvait là ? Les flics ! Puisqu’il était tard, ils les ont laissé partir après une brève inspection, avec l’obligation de passer au poste avec le véhicule le lendemain ! C’est ce qu’ils ont fait, mais seulement après avoir déchargé tout ce qui était précieux chez eux. Quand les gendarmes ont examiné ce qu’il restait de la cargaison, ils ont constaté qu’il n’y avait rien d’utile et ont laissé tomber la plainte pour vol. Mais ils les ont raccompagnés aux mines où ils ont dû tout décharger, heureux que ça se termine comme ça ! Les 4x4 étant difficiles à embarquer, ils ont par la suite enlevé les moteurs.
Après des années, le site devait être ‘sécurisé’. « Enfin ! » Pensaient les riverains. Donc une entreprise a posé une clôture en grillage tout autour et érigé des panneaux. Les décennies ont passé, la clôture a été découpée pour récupérer les métaux précieux des câbles électriques encore sur le site ou pour célébrer des fêtes à l’intérieur. La végétation et l’oubli ont lentement caché cette catastrophe écologique.
*
Un dimanche, une voiture s’arrête dans notre cour. En descend la vieille boulangère de Sentein, immédiatement reconnaissable par sa taille, puis une autre dame âgée et deux personnes un peu plus jeunes. J’ai tout de suite une idée de qui il s’agit ! Heureux, nous descendons les accueillir. Comme on pouvait s’y attendre, l’autre femme âgée est la petite-fille du dernier fermier de chez nous. Elle est accompagnée de son fils avec sa femme. Ces deux-là ne connaissent la propriété que par les récits de leur mère.
La mère de la dame, Joséphine, était partie en Amérique en 1908 quand sa fille n’avait même pas un an. Elle avait laissé l’enfant chez des proches à Arey, qui eux-mêmes n’avaient pas d’enfants. Plus tard, ils l’emmenèrent à Paris, où elle alla à l’école et travailla ensuite à la Poste. C’est là qu’elle a rencontré son mari, avec qui elle a déménagé à Girons où elle avait encore de la famille, juste avant de prendre leur retraite.
Pendant son enfance, ses parents adoptifs l’envoyaient chaque année chez les grands-parents pendant les vacances d’été et parfois même pendant les autres vacances. Avec le chemin de fer, une véritable aventure ! Plus tard aussi, elle venait souvent les voir, y compris sa tante et les oncles qui vivaient tous à la ferme. Elle n’avait que de beaux souvenirs de cette époque, parce qu’elle était le seul enfant à la ferme et avait été gâtée par tout le monde. Nous l’amenons à travers la maison, un peu fiers quand elle nous raconte comment tout était avant et à quel point elle s’étonne des changements ! À l’époque, ils allaient chercher l’eau à un peu plus de 200 mètres plus loin, là où j’ai capté la source et conduit l’eau jusqu’à la maison. Je lui dis qu’elle peut boire l’eau de la fontaine, c’est cette même source ! C’est ce qu’elle fait, se mouillant aussi le visage et elle nous raconte : « A l’époque, il y avait toujours un verre à la source, où chaque personne qui passait buvait. Par contre, le ruisseau à côté de la maison, servait à abreuver les animaux, ainsi qu’à se laver et à laver le linge. Ça arrivait deux fois par an.
Au cours de l’année, les cendres du feu de la cheminée étaient recueillies à cette fin. En fait, tout était gardé et rien n’était jeté parce que tout pouvait être utile à un moment donné ! Par exemple ses grands-parents conservaient les saucisses et les jambons au grenier, dans des cendres dans des caisses en bois. Les mouches et autres parasites ne pouvaient ainsi pas les abîmer. Pour laver le linge, les cendres étaient d’abord tamisées. La grand-mère mettait une couche de linge dans le chaudron, la lessiveuse, puis elle répandait une fine couche de cendres, puis une autre couche de linge, puis des cendres et ainsi de suite jusqu’à ce que le récipient soit plein. Puis elle y versait lentement de l’eau bouillante, qui s’infiltrait dans le linge. La lessiveuse était équipée en bas d’un robinet par lequel, après un certain temps, l’eau sortait, puis, souvent, après avoir été réchauffée, était de nouveau versée par le haut. L’eau devenait ainsi une solution alcaline puissante. La nuit, on fermait le robinet pour que le linge trempe. Ça durait parfois deux ou trois jours. Le linge était ensuite rincé avec l’eau du ruisseau à l’arrière de la maison et puis posé bien étiré dans les prés pour sécher et blanchir. Les tissus qui devaient être les plus blancs étaient aspergés plusieurs fois par jour avec un peu d’eau, afin qu’ils soient bien blanchis.
Sinon, on évitait de gaspiller de l’eau pour le lavage. Les vêtements étaient parfois lavés dans le ruisseau, la vaisselle essuyée avec un morceau de pain. Quand il y avait de la soupe, tout le monde y versait un peu de vin rouge vers la fin et faisait ‘chabrol’ (ou ‘chabrot’), comme on disait, et remuait l’assiette avec le vin avant de le boire.
Étant une enfant de la ville, ma famille me considérait comme fragile, peut-être à cause de ma couleur pâle au début des vacances. Alors on me donnait le ‘repas des hommes’ ! Ils devaient penser qu’on n’avait pas assez à manger en ville, c’était l’opinion dominante à la campagne. Les hommes, probablement à cause du travail pénible qu’ils faisaient, mangeaient mieux et plus que les femmes qui travaillaient le plus souvent à la maison. Quand on travaillait dans les champs, on ne retournait pas à la maison à midi et on mangeait ce que les femmes avaient emballé. C’était des pommes de terre cuites, du fromage ou du fromage blanc et un oignon, parfois un œuf. Le tout accompagné d’un vin rouge âpre, souvent bien dilué avec de l’eau, parce que ce n’était pas tout le monde qui avait quelques ceps, comme le voisin du Graviaret, qui les avait fait monter sur un poirier. Ce qui rendait la récolte, qui était faite par les enfants, un peu difficile, mais les raisins étaient bien sucrés, car ils avaient eu beaucoup de soleil !
La viande était rare, sauf quand un animal devait être abattu. La viande était plutôt pour les hommes, les femmes en mangeaient peu. En hiver, on tuait un cochon, le deuxième était vendu pour avoir un peu d’argent, pour payer les impôts ou les baux à la fin de l’année. Bien sûr, c’était toujours une grande fête, où tous les voisins se réunissaient ! Parce que déjà pour tenir le cochon quand il était saigné, il fallait beaucoup de bras forts ! Comme il couinait, je me bouchais toujours les oreilles avec les mains ! Quand il était pendu et vidé, les femmes se rendaient à Graviaret avec les boyaux, car il y avait une autre source propre, stockée dans un grand bassin muré, mais ouvert en haut. Le bassin avait une sortie en bas, où simplement avec le jet de l’eau les femmes retournaient les boyaux pour les nettoyer avant de les remplir avec du sang ou de la chair à saucisse. Que ça sentait bon quand le boudin flottait dans l’eau chaude ! Si l’eau était trop chaude, le boyau éclatait parfois et le sang solide flottait dans l’eau, donnant à la soupe, qui était ensuite cuite, une couleur rouge et un meilleur goût. C’était toujours des jours de fête quand le cochon était tué ! Le soir, on chantait, on dansait, on racontait des histoires. Et chaque voisin recevait un bout de boudin ! Les autres enfants du quartier étaient là aussi.
Tout était utilisé. ‘Dans le cochon tout est bon !’, disait grand-père. La rate et le poumon, une fois cuits, étaient passés par le hachoir à viande et ajoutés au boudin, le foie était transformé en pâté, les pieds et les oreilles cuits pour obtenir de la gélatine. Qu’est-ce qu’on était avides de mâcher les cartilages jusqu’à ce qu’il ne reste que les os, qui ensuite étaient aussi cassés et cuits afin d’améliorer les soupes avec leur moelle ! Les meilleurs morceaux, tels que les jambons ou les jambonneaux étaient assaisonnés et bien salés, déposés sur une croix en bois, puis suspendus enveloppés dans un torchon pendant trois à quatre semaines, afin que le sel puisse y pénétrer et les sécher un peu. Puis on les lavait et les frottait avec du poivre. Surtout à côté des os, il fallait faire rentrer beaucoup de poivre jusqu’à l’articulation, pour que rien ne pourrisse. Qu’est-ce qu’on riait, parce que tout le monde éternuait sans arrêt !
Ce qui ne pouvait pas être conservé par dessiccation était placé dans un fût en bois dans du sel, ou dans des pots en grès sous forme de confit, couvert de saindoux chaud, quasiment scellé à l’intérieur. Bientôt, les saucisses et saucissons s’alignaient accrochés sur des perches en bois sous le plafond de la cuisine, plus tard les plaques de lard s’y ajoutaient, et en dernier les jambons cousus dans de vieux draps. Certaines parties étaient pasteurisées dans des bocaux, comme les jambonneaux, avec un morceau de couenne autour. Mais les bocaux étaient chers et il y en avait peu. On me donnait à chaque fois un bocal, bien emballé, et un saucisson sec quand je rentrais à Paris.
Tante Alexine était la seule à savoir lire. Les grands-parents n’avaient envoyé que leurs filles à l’école du village, les garçons avaient été nécessaires pour travailler à la ferme. Pour le grand-père, Jean-Marie, aller à l’école était une perte de temps. C’est juste bien pour les filles, afin qu’on puisse mieux les marier ! ». Ainsi, Madame Bernagou termine son récit. Je rentre vite dans la maison pour aller chercher les documents que j’ai trouvés sous un lit quand nous avons acheté la maison. Dans le tas, je trouve l’acte de naissance de sa tante Alexine, en 1878, et son certificat de fin d’études en 1892, ainsi qu’un grand nombre de lettres envoyées par sa mère aux parents et aux frères et sœurs. Elle est proche des larmes quand elle les survole des yeux.
« Parfois, quand j’étais là, une lettre de ma mère arrivait. Ça a toujours été un événement ! On donnait un verre de gnôle au facteur et tout le monde attendait avec impatience que Tante Alexine ouvre la lettre et nous la lise ! Puis le facteur repartait et racontait les nouvelles partout ! Tout le monde dictait une lettre de réponse à tatie Alexine, et moi aussi je pouvais écrire quelque chose qui me rendait fière et les grands-parents aussi ! Au début, je ne le savais pas, mais le fait que ma mère m’ait eu en tant que femme célibataire a fait courir beaucoup de bruits ! Et maintenant, ils pouvaient être fiers de leur fille qui avait réussi en Amérique et pouvait même leur envoyer de temps en temps un peu d’argent, et de son enfant qui était même capable de lire et d’écrire, ce qui n’était pas le cas des enfants voisins !
J’ai appris que grand-mère et grand-père avaient été mariés par leurs parents. Il y a eu pas mal de disputes, et le grand-père a fait jurer à ses fils, mes oncles, qu’ils ne se marieraient jamais ! Était-ce qu’ils ont été obéissants ? En tout cas, personne ne s’est jamais marié ! Après la mort des grands-parents, l’oncle Joseph a pris la ferme. » Je fouille dans les papiers. « Voici un certificat du médecin militaire, daté du 4 juillet 1904, disant que Jean-Marie Joseph est exempt du service militaire pour incapacité ». Je demande : « C’est lui qui a pris la ferme ? » « Ça doit être lui. Il avait des problèmes de vue. Ma mère est venue une fois en visite, vers 1925. À l’époque, grand-mère était malade. Je crois qu’elle est morte en 1927. Ma mère avait envoyé de l’argent pour qu’ils aménagent un peu la maison et qu’ils construisent une chambre pour elle aussi, parce qu’elle avait toujours eu l’intention de revenir ici plus tard. Le maçon de Banos avait pris de l’argent à titre d’acompte, mais n’était jamais venu faire les travaux ! Puis grand-père n’a pas survécu longtemps ».
En posant les dernières lettres, je dis : « J’ai trouvé du courrier jusqu’en 1940, puis il n’y a plus rien ». La dame continue : « Ma mère était souffrante depuis longtemps. Les médecins avaient détecté la tuberculose. Elle a été placée dans un sanatorium où elle a succombé peu après de la maladie. Malheureusement elle n’a pas pu revenir ici, comme elle l’avait toujours souhaité. À cette époque, l’oncle Joseph est devenu complètement aveugle. Tatie Alexia et les deux autres oncles étaient déjà morts. Pendant la guerre, ce n’était pas facile pour moi de venir ici. Quand j’ai enfin pu lui rendre visite, il vivait chez un maquignon près de Castillon, sur sa propriété. Il allait plutôt bien, sauf qu’il se plaignait qu’il n’était plus utile à rien à cause de sa cécité. La plupart du temps, j’apprenais des nouvelles par des proches, mais ils étaient déjà très vieux et avaient du mal à se déplacer. Car à l’époque, ici il y avait très peu de voitures.
Lorsque je suis venue la fois suivante, je n’ai plus trouvé oncle Joseph à la ferme du marchand de bétail. Celui-ci m’a expliqué que mon oncle avait absolument voulu aller à l’hospice de St. Girons. Je suis allé le voir là-bas. Quelle misère ! Les vieux étaient largement laissés à eux-mêmes, ils n’avaient pas grand-chose à manger. Il m’a raconté qu’un jour, le maquignon lui avait demandé de signer un papier. « Comment faire, je vois rien et je sais pas écrire ! », lui avait-il répondu. « C’est pas grave ! Il y a un voisin comme témoin ici, il suffit que tu fasses un gribouillis en dessous, une croix ou quelque chose comme ça ». Ce qu’il a fait. Le lendemain, le marchand de bétail l’a emmené à l’asile des sans-abri. L’oncle avait signé un acte qui disait qu’il avait laissé ses terres au maquignon ! À partir de là, son état s’est mis à empirer. Quand je lui ai rendu visite l’année suivante, c’était jour de marché. Avant de partir il m’a demandé de lui acheter un poulet rôti et de rester avec lui jusqu’à ce qu’il l’ait mangé. « Mais pourquoi, tu pourras le manger plus tard ? », lui ai-je dit. « Non, reste encore ! Sinon, comme d’habitude, les autres me prendront tout, car je ne peux pas les voir, et ils me laissent que les restes ! » Alors je suis restée avec lui. Je suis revenue pour son enterrement, il aurait bientôt eu 70 ans ! »
Nous restons silencieux pendant un moment, ébahis. Dans la pile de photos, elle en reconnaît une de sa tante Alexine quand elle était jeune, une des premières photos, sur du carton épais. Une autre montre son oncle Eugène, qui était ambulancier pendant la première guerre, et d’autres photos de parents. Est-ce que c’était à cause du serment que Joseph était resté célibataire et que personne n’avait eu de descendants ? Ou était-ce déjà difficile à l’époque pour les paysans de trouver une femme avec qui partager le travail et la vie ? C’est l’heure des bêtes. Je commence à enfermer les animaux.
Madame Bernagou nous rendra encore visite plusieurs fois. Nous aussi lui rendons visite en ville quelques fois. Au marché, la boulangère de Sentein me rapportait souvent de ses nouvelles. Mais un jour, celle-ci n’est pas venue me voir. Elle s’était endormie pour toujours cette nuit-là.
Par sa fille, j’apprends que Madame Bernagou, âgée de plus de 80 ans, commence à perdre la tête et qu’on l’a emmenée dans une maison de retraite. Je connais cette maison, c’est plutôt un établissement chic, en rien comparable à l’asile de son oncle ! Avec sa fille, qui a pris sa retraite il y a un moment et qui vit aussi à St. Girons, je me mets d’accord pour nous rencontrer chez sa mère à 15h. Mais apparemment, elle a un contretemps, et je me retrouve seul avec sa mère. J’ai apporté du miel, un morceau de fromage et une carte postale de notre ferme. Mais Madame Bernagou ne me reconnaît pas, ni la ferme sur la carte. Elle n’arrête pas de répéter qu’elle ne veut rien acheter. Je laisse alors tout sur son chevet et je rentre chez moi. Le soir, je reçois un appel de sa fille, qui a entre-temps rendu visite à sa mère. Au bout d’un moment de conversation, celle-ci s’était souvenu de qui j’étais, et elle voulait me revoir un autre jour ! Mais la faucheuse a été plus rapide…