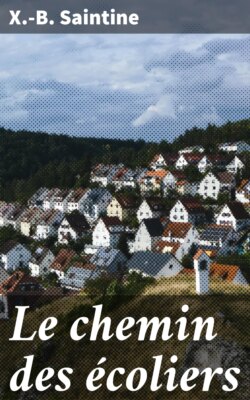Читать книгу Le chemin des écoliers - X.-B. Saintine - Страница 11
V
ОглавлениеKehl. — Le petit homme jaune. — L’île des Épis. — Le pont volant. — Passage du Rhin. — Café de la Cigogne. — Le chevalier de Chamilly. — Un gendarme badois. — Départ de Kehl.
«S’il en faut croire une tradition strasbourgeoise, le roi Louis XIV était quelque peu magicien, et, malgré sa grande dévotion, en rapport avec le diable. Dans un coffret d’ébène, cerclé de fer, fixé par une chaîne au pied de son prie-Dieu, il détenait un petit homme jaune, démon de la plus minime espèce, haut à peine de six pouces. Quand le roi avait besoin de correspondre rapidement avec un de ses généraux ou de ses ambassadeurs, à défaut de la télégraphie électrique, qui n’était pas encore inventée, il décerclait sa boîte d’ébène, en tirait Chamillo (c’était le nom du petit homme jaune), le plaçait dans le creux de sa main, soufflait dessus, et celui-ci, chargé des instructions de son maître, fendant l’air avec la rapidité de la foudre, arrivait en quelques minutes au but qui lui était assigné.
«A Chamillo (on ne s’en doute guère en France cependant) Louis XIV dut la plus grande partie de ses prospérités. Malgré sa nature diabolique, jamais serviteur ne se montra d’abord plus sobre et plus désintéressé. Pour chacun de ses repas, il n’exige que trois grains de chènevis, et la plus grande récompense à laquelle il aspirât était de les recevoir de la main du roi. Certes, pas un courtisan, pas même un perroquet, ne se serait contenté de si peu.
«Quelques années se passèrent ainsi, puis, insensiblement, le petit homme jaune en vint à la friandise, ensuite à l’ambition. Au lieu de ses trois grains de chènevis, il lui fallut pour son dîner trois perles fines. Le monarque souffrit même qu’il se permît parfois de grignoter l’écrin de la reine. Ce ne fut pas tout; bientôt, à chaque service rendu, il exigea un titre ou une décoration nouvelle; tour à tour le roi le nomma gentilhomme de la Chambre, comte, marquis, duc, et le décora de tous ses ordres.
«Un jour, le petit diable-duc Chamillo s’abattit sur la ville, encore libre et impériale, de Strasbourg. Par les fenêtres entr’ouvertes, quelques-uns disent par le trou même des serrures, il s’introduisit chez les principaux magistrats de la cité, et quelque temps après, l’imprenable capitale de l’Alsace ouvrait ses portes devant un semblant d’armée française.
«Pour cette importante besogne, le roi pensa que Chamillo allait réclamer de lui un brevet de prince, peut-être aussi le grand cordon du Saint-Esprit. Il n’en fut rien. Chamillo en avait assez des honneurs séculiers. Il avait vu l’évêque de Strasbourg officier en robe rouge; il voulait être cardinal.
«Louis XIV ne pouvait faire un cardinal à lui seul; il comprit que le pape se refuserait à introduire un diable dans le haut clergé. Il refusa net. Chamillo s’enfuit, et alla offrir ses services au roi de Prusse, le grand Frédéric. (Ne faites point attention à l’anachronisme.) A compter de cette époque, la fortune du roi de France et de Navarre commença à décroître, et la paix de Rysvick faillit lui enlever Strasbourg, que le petit homme jaune voulait restituer à l’Allemagne.»
Nous étions sortis de Strasbourg par la porte d’Austerlitz, et tandis que du coin de l’œil, tout en prêtant l’oreille, j’examinais les abords de la forteresse, les divers accidents du chemin de Kehl, et cette île des Épis, véritable Élysée, où sous la verdure, sous l’ombre des grands arbres, sous un fouillis de hautes herbes, se cache le tombeau de Desaix, tel est le récit populaire dont me fit part mon ingénieur. Il était originaire d’Alsace et connaissait les traditions du pays.
«Voyons, lui dis-je, derrière ce conte il doit y avoir un fait, une anecdote historique; le peuple n’invente pas, il dénature.
—C’est possible, me répondit-il; mais voilà tout ce que j’en sais; à vous de trouver le reste, c’est votre métier.»
Comme il parlait, nous arrivions en vue du fleuve. Déjà le pont volant était presque achevé. En moins de quarante-cinq minutes, cent soixante soldats du génie, commandés par quelques officiers de la même arme, avaient suffi pour l’établir d’une rive à l’autre du Rhin, sur une traversée de deux cent cinquante mètres de longueur. C’était superbe! M. le général de division Larchey paraissait enchanté. Je ne l’étais pas moins que lui.
Devant moi, au delà du Rhin, s’élevait la petite ville de Kehl, ville allemande, où Beaumarchais avait dû se réfugier pour y faire imprimer la première édition complète des œuvres de Voltaire. Un vif désir me prit de visiter Kehl, et dans ce désir Voltaire et Beaumarchais n’entraient que pour une bien faible part.
«On ne voyage pas pour voyager, mais pour dire qu’on a voyagé.» Vraie ou fausse, l’observation est de Pascal, je crois. Mon ambition vaniteuse allait plus loin. Non-seulement je voulais pouvoir dire que j’avais visité Kehl, mais à cette question du premier venu: «Avez-vous jamais été en Allemagne? — Connaissez-vous l’Allemagne, monsieur?» il me plaisait d’être en droit de répondre, d’un air modeste toutefois: «Oh! fort peu.... Je connais l’Allemagne à peine.... C’est un beau pays! J’ai le regret de n’y avoir pas séjourné suffisamment pour en parler ex professo;» et autres phrases à réticences, qui m’aideraient à dissimuler ma honteuse immobilité parisienne.
Un vif désir m’avait donc pris de poser, ne fût-ce que pour cinq minutes, le pied sur la terre allemande. J’avais encore deux heures à ma disposition. Comme passage, un double chemin s’ouvrait ou plutôt se fermait devant moi. En tête de l’ancien pont de bateaux, la douane française était là, visitant les bagages, s’enquérant des passe-ports. Vous le comprenez, pour aller de Paris à Marly-le-Roi, vu que, généralement, on ne traverse pas la frontière, j’avais cru inutile de me munir d’une feuille de route et de lettres de recommandation. Le nouveau pont appartenait à l’armée; pour s’y frayer une voie, il fallait porter le shako ou le casque. Je n’avais qu’une casquette. Mon ingénieur vit mon embarras, devina mon désir; il me glissa sous le bras un rouleau de cartes et de plans; il m’arma d’un mètre et d’une équerre; ma boîte de fer-blanc elle-même aida à me donner une apparence de quelque chose appartenant aux ponts et chaussées. La musique du génie débouchait, se dirigeant vers l’autre rive; je marchai à sa suite. C’est ainsi que je fis mon apparition sur le territoire germanique.
J’étais à Kehl, dans les États badois! Qui me l’eût prédit le matin, quand je pensais me réveiller à Noisy-le-Sec?
Kehl est une ville formée d’une seule rue.... Je n’entrerai pas dans plus de détails topographiques. Cette rue, ou cette ville, à peine l’avais-je parcourue à moitié qu’apercevant un bureau de poste, l’idée me vint d’écrire à Minorel trois mots (je n’avais pas de temps à perdre en correspondance), trois mots datés de Kehl (grand-duché de Bade, Allemagne). Certes, je comptais bien arriver à Marly avant la lettre; mais, si Antoine refusait de croire à mes récits de voyageur, du moins cette lettre, par son timbre, viendrait lui prouver pertinemment que, plus heureux que le grand roi, j’avais franchi le Rhin avec une partie de l’armée française, et musique en tête!
Afin de me procurer promptement papier, plume et encre, j’entrai dans un café, à l’enseigne de la Cigogne. Là, déjà nos soldats, mêlés aux bourgeois de la ville, fumaient à pleine pipe du tabac de contrebande, en buvant de la bière badoise. Je prenais la plume, lorsqu’un individu placé près de moi, à la table voisine, dit à un sien compagnon qui lui faisait face:
«Ne dirait-on pas que les Français arrivent ici en vainqueurs, savez-vous? et s’emparent de Kehl par surprise, comme jadis ils se sont emparés de Strasbourg?
—Ce ne sont pas les Français qui ont pris Strasbourg, lui répliqua son vis-à-vis, c’est le petit homme jaune.»
Je redressai l’oreille; mon voisin, Belge de naissance, ouvrit de grands yeux. Le vis-à-vis, s’apercevant sans doute alors qu’au lieu d’un seul auditeur il en avait deux, raconta dans tous ses détails non plus le conte des paysans alsaciens, que m’avait débité mon ingénieur, mais bel et bien, et à ma grande satisfaction, cette anecdote historique que j’avais soupçonnée devoir être logée sous le conte. Et tandis qu’il parlait, moi j’écrivais; je n’écrivais pas à Minorel, je prenais des notes sur Chamillo, ou plutôt sur M. de Chamilly, et la diablerie devenait simplement un chapitre de l’histoire intime du grand roi, oublié par Saint-Simon.
«M. de Louvois, le puissant ministre, avait fait la promesse au marquis de Chamilly, depuis maréchal de France, d’employer prochainement son neveu dans quelque affaire diplomatique de haute importance, qui ne pouvait manquer de le lancer. Chaque jour, le jeune Chamilly se présentait devant le ministre et n’en recevait que cette réponse: «Attendez; je ne vois pas poindre encore un emploi digne de vous.» Las d’attendre toujours, le jeune homme se désespérait. Vers le milieu de septembre 1681, Louvois lui dit: «Monsieur, le roi vous charge d’une mission de la plus haute importance, qui demande à la fois célérité et discrétion. Vous allez prendre la poste et vous rendre à Bâle, où vous devrez être arrivé le mardi 17 du présent mois; les relais sont préparés; le lendemain, mercredi, 18, de midi à 4 heures, en costume qui ne puisse attirer l’attention, vous vous tiendrez sur le pont de ladite ville; vous prendrez rigoureusement note de tout ce qui s’y passera, de tout, entendez-vous bien, monsieur, et, aussitôt, sans désemparer, vous reviendrez m’instruire du résultat de vos observations. Allez! la façon dont vous vous acquitterez de ce rôle, tout de confiance, décidera de votre avenir.»
«Le chevalier de Chamilly était sur le pont de Bâle au jour et à l’heure indiqués. Il s’attendait à y rencontrer une députation des cantons suisses, le grand landamann en tête. Il vit passer des charrettes, des villageois, des citadins, qui allaient à leurs affaires; des troupeaux de bœufs et de moutons; des gamins qui couraient les uns après les autres; des mendiants, qui, tour à tour, lui demandèrent l’aumône; il la leur fit à tous, pensant que quelques-uns, agents mystérieux des cantons, pourraient bien être porteurs d’un message secret. Une vieille femme traversa le pont sur un âne rétif, qui la jeta par terre; il releva la vieille femme, ne sachant trop si cette chute n’était pas une manœuvre diplomatique, et s’il n’allait point trouver en elle le grand landamann travesti; il eut même la pensée de courir après l’âne; mais l’âne galopait déjà hors des limites assignées au diplomate.
«Le chevalier de Chamilly se damnait pour savoir ce qu’il était venu faire sur le pont de Bâle en Suisse. Il patienta encore; de nouveau passèrent devant lui des ânes, des bœufs, des moutons, des flâneurs, des paysans et des charrettes; mais de députation et de grand landamann, pas l’ombre! Il se dépitait. Comme pour l’achever, vers la fin de sa longue et fastidieuse faction, un petit laquais, grotesquement vêtu d’une casaque jaune, vint au-dessus du parapet secouer et battre des couvertures de laine, et Chamilly en reçut la poussière dans les yeux. Déjà hors de lui, il s’apprêtait à rosser le maroufle, lorsque la quatrième heure sonnant, il reprit la poste.
«Au milieu de la troisième nuit, harassé du voyage, profondément humilié de son insuccès, il reparut devant le ministre, auquel il raconta piteusement sa triste odyssée, sans lui faire grâce du moindre détail, car il avait pris note exacte du tout. Quand il en fut au petit homme à la casaque jaune, M. de Louvois jeta un cri et lui sauta au cou. Sans lui laisser le temps de respirer, il l’entraîna chez le roi. Le roi dormait. On le réveilla par ordre du ministre. Louis XIV se frotta les yeux et passa sa perruque; après quoi, les rideaux de son lit étant tirés, il écouta à son tour le récit détaillé du chevalier de Chamilly. A l’apparition du petit homme jaune, comme son ministre, il poussa un cri, et dans son transport de joie, s’élançant hors du lit, il exécuta une sarabande au milieu de sa chambre à coucher. De tous les gentilshommes de France, l’heureux M. de Chamilly fut le premier peut-être à qui il ait été donné de voir Louis le Grand danser en chemise et en perruque à trois marteaux.
«Ce ne fut pas là sa seule récompense. Le roi le nomma chevalier de ses ordres, comte et conseiller d’État, au grand ébahissement du digne garçon, qui ne comprenait encore rien à l’affaire.
«Le petit laquais du pont de Bâle, en secouant ses couvertures, annonçait à l’envoyé du roi, de la part des magistrats de Strasbourg, que la ville se mettait à sa disposition.
«Voilà comment le petit homme jaune a pris Strasbourg; comment aussi du nom de Chamilly il fut baptisé Chamillo; et comment notre roi Louis XIV passa pour un magicien.»
Je tenais donc une légende! et, avec la légende, sa version explicative. Il m’avait fallu passer le Rhin pour la trouver. Je ne regrettais pas ma course. Combien j’étais loin de prévoir le mauvais tour que Chamillo ou Chamilly allait me jouer!
Tandis que mon voisin de la Cigogne parlait, tandis que j’essayais de sténographier son récit, les soldats avaient cessé de fumer leur pipe et de boire leur bière; le rappel avait battu dans les rues de Kehl; ils étaient partis, et je n’avais rien vu, rien entendu. Je regardai à ma montre, un vrai chronomètre de Poitevin; j’avais encore trois quarts d’heure devant moi pour me rendre à l’embarcadère, plus que le temps nécessaire, mon ingénieur ayant mis sa voiture à ma disposition. Néanmoins je crus prudent de renoncer à écrire à Minorel. Je fis mes adieux à Kehl, et me dirigeai vers le pont nouvellement construit.
Il était déjà en voie de démolition.
Forcément, je gagnai en toute hâte l’ancien pont. Là, ce ne fut plus la douane française qui me barra le passage, ce fut la douane badoise. Le préposé aux passe-ports me demanda mes papiers. Je lui racontai mon histoire, en regardant à ma montre vingt fois par minute.... si le chemin de fer allait partir sans moi! Cette idée me causait une telle irritation que, pour la première fois de ma vie peut-être, il m’arriva d’être inconvenant vis-à-vis de l’autorité.
Le préposé me lança un regard de Sicambre et me tourna le dos, après m’avoir d’un geste recommandé à l’attention de ses subordonnés. Évidemment, j’étais en suspicion. Connaissant ma qualité de Français, on me prenait sans doute pour un réfugié, pour un interné qui cherchait à rompre son ban, à rentrer en France avec les plus coupables intentions. Je le crois fermement, ma chemise de couleur me donnait seule de ces allures équivoques.
Un de mes voisins de la Cigogne, l’historiographe même du chevalier de Chamilly, honnête commerçant de Kehl, avait quitté le café en même temps que moi. Je l’apercevais alors sur le seuil de sa boutique, d’où il semblait m’observer d’un air plein de commisération. Demeurant près de la douane, au courant des mécomptes dont elle est cause, il me fit signe de venir à lui, et me demanda si je ne connaissais pas à Strasbourg deux notables qui pussent me réclamer: «Hélas! monsieur, je n’y connais que le garçon d’hôtel, qui ce matin m’a servi à déjeuner à la Ville de Paris, et le sacristain qui, à Saint-Thomas, m’a fait voir le tombeau du maréchal de Saxe et je ne sais quelles momies dans leurs boîtes.
—Ce ne sont point là des notables, me répondit-il.
—Mais un notable de Kehl, un homme établi, lui répliquai-je en le regardant d’une façon toute particulière, ne pourrait-il, aussi bien que ceux de Strasbourg, me servir de caution?»
Ma question sembla l’embarrasser; il se gratta l’oreille, puis, rompant les chiens: «Mais comment êtes-vous parti de Paris pour Kehl sans vous mettre en règle?» me dit-il.
De nouveau j’entrepris la narration succincte de mon étrange voyage. Il ne parut guère y donner plus de créance que le préposé aux passe-ports, et, après m’avoir mesuré d’un regard empreint moitié de pitié moitié de défiance, je le vis se troubler tout à coup: «Voici un gendarme!» me dit-il brièvement et à voix basse.
Et il rentra dans sa boutique.
Je puis me rendre à moi-même ce bon témoignage: jusqu’alors la vue d’un gendarme ne m’avait inspiré d’autre sentiment que celui de la confiance et de la sécurité. Pour celui-ci ce fut tout autre chose. Quoique bien convaincu de mon innocence, un froid nerveux me prit entre les deux épaules, et comme le gendarme et moi nous avoisinions le chemin de fer badois, j’eus soin de mettre entre nous l’épaisseur des wagons.
Là, pour me donner une contenance, je lisais l’affiche des principales stations échelonnées de Kehl à Francfort. Semblable au Sésame, ouvre-toi, de la lampe merveilleuse, le mot Carlsruhe m’apparaît. Grâce à lui, tous les obstacles vont disparaître!
Je me rappelle avoir un ami dans la capitale du grand-duché de Bade, M. Junius Minorel, cousin germain de mon ami Antoine Minorel, et attaché de la Légation de France à Carlsruhe. On me demande une autorité, en voilà une! Je vais lui faire parvenir une dépêche télégraphique, un télégramme, comme on dit aujourd’hui. Dans dix minutes j’aurai sa réponse, et mon attestation de bonne vie et mœurs.
Misère!... Le guignon s’attache après moi! La correspondance électrique est interrompue par la rupture d’un fil. Je ne puis cependant rester ainsi confisqué par la douane badoise! Je prends un grand parti. La locomotive du chemin de fer de Kehl à Carlsruhe s’apprête à se mettre en route; je monte résolûment dans un des wagons.
Trois heures après, j’étais à Carlsruhe.
Pour un homme ennemi juré des chemins de fer, c’était peut-être en abuser. J’ai déjà pris celui de Noisy-le-Sec à Épernay, celui d’Épernay à Strasbourg. Je me vois forcé de prendre celui de Kehl à Carlsruhe, ayant en expectative celui de Carlsruhe à Kehl, puis celui de Strasbourg à Paris; cela pour n’avoir point voulu prendre le chemin de fer de Paris à Saint-Germain, par lequel il me faudra passer cependant!