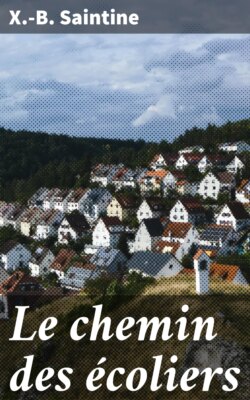Читать книгу Le chemin des écoliers - X.-B. Saintine - Страница 13
VII
ОглавлениеNotes de voyage. — Observations de mœurs. — Des serrures, du poêle et des miroirs obliques. — Perrette, la laitière. — Le vaudeville et la romance. — Un maçon badois. — Bain à domicile. — Table d’hôte académique. — Ma jolie hôtesse. — Suppositions insensées. — La chambre aux sonnettes.
Aujourd’hui, 2 mai, je me suis éveillé au chant des fauvettes et des pinsons, ce qui, en partie, a dissipé les brumes de mon cerveau. Mon premier soin a été d’écrire aux deux Minorel, à l’un à Marly-le-Roi, à l’autre à Heidelberg. A Minorel Ier, j’ai raconté, et, ma foi! fort gaiement, comment, depuis Épernay, j’avais joué le rôle du voyageur malgré lui. Pauvre humanité! nos désastres de la veille deviennent facilement pour nous, le lendemain, un sujet de plaisanterie. Je l’engageais à planter son pavillon chez moi, à m’y attendre, et je le confiais aux bons soins de Madeleine et de mon vieux Jean. A Minorel II, j’ai annoncé mon arrivée à Carlsruhe et reproduit exactement, pour les détails plaisants, ce que je venais d’écrire à son cousin. Dans le cas où il devrait rester à Heidelberg plus de deux jours encore, je l’ai prié de correspondre en ma faveur avec la Légation, pour la délivrance de mon passe-port.
Voici mes deux lettres en route pour la poste. Je me sens tout à fait soulagé; je respire plus librement; je reprends possession de moi-même! Chantez joyeusement petits oiseaux; un ami est là qui vous écoute!
Avec deux jours de loisirs devant soi, peut-être trois, il est permis de songer à tirer parti de certaine dose d’observation dont, en pays étranger, le voyageur, volontaire ou involontaire, se croit toujours suffisamment pourvu.
Le voyageur à poste fixe, celui qui durant des mois entiers séjourne dans un pays, peut juger sainement de ses institutions, de ce qui fait sa force et son essence, étudier à fond son organisation morale ou politique; mais pour juger des surfaces, des oppositions de mœurs et d’habitudes avec les autres pays, le voyageur au pied levé a l’avantage. Il n’a pas eu le temps de participer aux coutumes de la localité, de s’y faire; tout ce qui est étrangeté (j’emploie ici le mot dans sa bonne acception) le saisit brusquement et au vif.
Sans sortir de ma chambre, allons à la découverte! Je regarde ma porte, et déjà je m’étonne. A la partie supérieure de ma serrure s’élève horizontalement une branche de fer, qui joue là le rôle du pêne chez nous. Vous laissez tomber votre main dessus, la porte s’ouvre. Vous n’avez pas à tirer un bouton, souvent rétif, ou à tourner une poignée qui vous laisse aux doigts une odeur de cuivre. Le poids de la main suffit; au besoin on ouvrirait avec le coude.
Je trouve ce mécanisme bien supérieur aux nôtres dans les instruments du même genre. Autre perfectionnement! Ma serrure est compliquée d’un verrou, placé en dessous, à la place du pêne, et qui glisse facilement dans la gâche. Par ce moyen si simple on évite ces verrous massifs qui encrassent et fatiguent les chambranles de nos portes.
Immédiatement je pris note de ma serrure.
Ma chambre est à la fois décorée d’un poêle et d’une cheminée. La cheminée ressemble à toutes les cheminées et ne mérite aucune remarque particulière. Il n’en est pas ainsi du poêle. Étroit et grêle, montant du parquet au plafond, comme un pilastre de faïence, que fait-il là, engagé dans la muraille? Je ne lui découvre d’autres ouvertures, de mon côté, que des bouches de chaleur. On l’allume (et c’est là ce que je glorifie en lui!), on l’allume en dehors, par la galerie qui règne le long des chambres. Si vous mettez à profit cette excellente invention, mes chers compatriotes, je ne regretterai pas ma station forcée à Carlsruhe; vous ne risquerez plus de voir votre domestique venir, le matin, troubler et enfumer votre sommeil. Après une nuit froide ou humide, vous vous réveillerez, comme par enchantement, au milieu d’une douce atmosphère, et si vous jugez à propos de faire flamber votre cheminée, ce sera seulement par sybaritisme et pour vous réjouir la vue.
Quoique né curieux, très-curieux (c’est mon vice radical; mais je lui ai dû tant de jouissances que l’heure du repentir n’a pas encore sonné pour moi), je signalerai moins honorablement cette petite glace oblique placée en dehors de la vitre, et commune à toutes les maisons de Carlsruhe, meuble commode, distrayant, mais immoral, qui vous met à même de voir sans être vu, et livre à votre merci les mystères de la voie publique. Il présente toutefois cet avantage réel. Un visiteur vous arrive; prévenu par votre espion, vous avez tout le temps nécessaire pour vous préparer à le recevoir convenablement, et mieux encore, si c’est un fâcheux ou un créancier, pour lui faire défendre votre porte.
Après ce mûr examen de mon mobilier, n’y trouvant plus rien à relever, la main sur la conscience, à mon poêle en pilastre je donne le premier prix, le second à la serrure à verrou et au pêne horizontal; quant à la glace oblique, je la mets hors de concours.
A mon retour à Paris, cependant, il se pourrait bien que j’en fisse orner les deux côtés de la fenêtre de mon cabinet, qui donne sur la rue Vendôme.
Pour m’essayer au jeu du miroir, tout en faisant ma barbe devant la croisée, je jette de droite et de gauche un regard dans ma double glace; de droite et de gauche le joli boulevard d’Ettlingen se développe à mes yeux dans une partie de sa longueur.
Comme M. de Chamilly sur le pont de Bâle, je ne vois d’abord que des paysans et des moutons, des vieilles femmes et des ânes qui passent. Attendez!... Sur les bas côtés de la route quelles sont ces filles blondes, traînant après elles de petits chariots semblables à des chariots d’enfants? Ce sont les laitières du pays. Ici, Perrette ne porte plus son pot au lait sur sa tête; elle peut rêver à son aise, si rêver lui est doux, sans crainte de voir, sous une cabriole, s’écrouler ses châteaux en Espagne.
Parmi ces blondes filles, j’en remarque une; avec plus de nonchalance, mais aussi avec plus de grâce que les autres, elle tire à elle son petit chariot, laissant volontiers ses compagnes la devancer. Demeurée en arrière de la bande, elle s’arrête. Un grand garçon sort alors d’une futaie qui longe le boulevard, et, lui venant charitablement en aide, il remplace Perrette au timon du chariot, poussant l’attention jusqu’à lui enlacer la taille de son bras resté libre, sans doute pour la soutenir dans sa marche. La route se fait déserte un instant. Il penche sa tête vers celle de la jolie laitière, qui lui sourit, et je vois.... je ne vois rien! Par l’effet des distractions que me causait ma glace moucharde, mon rasoir venait de tourner entre mes doigts, et je m’étais fait une entaille au menton; juste punition d’une curiosité que je déplore, mais dont je ne suis pas près de guérir.
Mon voyage autour de ma chambre terminé, mes observations notées sur mon carnet de touriste, j’ouvris ma fenêtre, et, machinalement, mon regard se dirigea vers la place où j’avais laissé les deux amoureux. Douce surprise! j’y pus embrasser dans toute son étendue la futaie, ou plutôt le charmant petit bois, déjà verdoyant et rempli de clartés joyeuses, d’où le grand garçon était sorti pour aller à la rencontre de Perrette. Quel voisinage pour un botaniste! Je rêvais déjà d’y rencontrer toute la flore printanière de l’Allemagne. J’arrêtai mes yeux, remplis d’espoir, sur ma boîte de fer-blanc piteusement rencognée contre la cheminée.
«Sois tranquille, ma vieille compagne! ton rôle humiliant de valise va cesser!»
Mais avant de me livrer à mes recherches botaniques, j’allais avoir à signaler de nouvelles observations, non moins importantes, et d’un ordre plus élevé peut-être que les premières.
Sorti de la maison, je gagnais le petit bois, quand la vue de trois grandes banderoles tricolores, qui flottaient près d’une usine avoisinante, m’arrêta court. L’usine appartient à la maison Ch. Christofle et Cie. M. Charles Christofle, qui, en France, confectionne depuis les simples couverts d’argent jusqu’aux pièces de canon en bronze d’aluminium, était en train de conquérir l’Allemagne à la dorure et à l’orfévrerie artistique. Il y avait eu je ne sais quelle inauguration la veille, et la maison française, comme un vaisseau dans une rade étrangère, s’était pavoisée aux couleurs nationales. Mon cœur battit; je crus être en France, dans une France où l’on peut voyager sans passe-port; j’entrai, et là je fus à même de comparer entre elles l’activité allemande et l’activité française. Cette fois, la comparaison était tout à l’honneur de la France.
Dans les ateliers occupés par nos compatriotes le travail marchait au pas accéléré; les maillets, les marteaux, en tombant sur le métal, marquaient une mesure leste et rapide, qui semblait servir d’accompagnement à quelque gai vaudeville; dans les autres, peuplés d’ouvriers allemands que M. Christofle avait initiés à son œuvre d’alchimiste, la mesure lente, presque mélancolique, martelait le Roi des Aulnes ou le Chasseur noir.
Dans le même espace de temps, le vaudeville français fera deux fois la besogne de la romance allemande.
Autre tableau pris sur les mêmes lieux.
Des maçons badois s’occupent d’une construction annexée à l’usine. Un jeune manœuvre va à cinquante pas de là chercher des briques, dont le besoin se fait sentir parmi les travailleurs. Après s’être arrêté quelque temps en route à une petite fontaine, dont il fait jouer la pompe pour se désaltérer à un mince filet d’eau, si mince qu’il est forcé de s’y reprendre à diverses reprises pour étancher sa soif, il arrive enfin au tas de briques, le but de sa promenade. Il en prend six, pas davantage! et, d’un véritable pas de flâneur, les porte aux ouvriers. Alors, se croisant les bras, témoin impassible, il assiste au scellement des six briques. Quand il se décide à reprendre son tranquille mouvement de va-et-vient, c’est le tour des ouvriers de se croiser les bras, en attendant que leur approvisionneur de briques ait fait retour vers eux. Il est rare que le jeune manœuvre passe devant la petite fontaine sans s’y désaltérer de nouveau, et pas un reproche ne lui est adressé, pas une parole excitante, pas un geste d’impatience ne le troublent dans son indolence, tant les allures engourdies sont dans les habitudes de tous.
Troisième tableau! Parfois, à la lenteur de l’individu vient s’ajouter la complication des moyens. J’ai déjà parlé du garçon baigneur servant dans son baden, voyons-le portant à domicile.
Une grande voiture s’arrête devant votre logis; vous y voyez figurer douze petits tonneaux, bien bondés. Étranger, français, vous croyez à l’arrivée du brasseur, avec ses quartauts de bière; mais près des tonneaux est une baignoire: ceci vous éclaire. Le garçon de bain prend d’abord soin de son cheval; il l’examine; si la course l’a mis en sueur, il le caparaçonne d’une couverture et l’empanache de quelques branches de feuillage, pour le garantir de l’importunité des mouches. Ces préliminaires indispensables achevés, après une petite causerie avec la servante, votre homme apporte la baignoire. Il retourne ensuite à sa voiture, donne à son cheval quelques poignées d’herbes, et, si la maison est hospitalière, il le dételle et le conduit à l’écurie; car, pour se dispenser d’une course nouvelle, il compte bien attendre que le client ait pris son bain pour rentrer en possession de sa baignoire.
Ceci fait, il se décide enfin à enlever un des petits tonneaux, le porte dans votre chambre, le débonde, ce qui parfois exige du temps si la bonde résiste; puis il verse le liquide, qui aussi en prend à son aise pour passer de la douve dans la baignoire. Cette opération, interrompue par une nouvelle causerie avec la servante, ou une nouvelle visite au cheval, doit se reproduire douze fois.
Généralement, il en résulte ce petit inconvénient qu’au lieu d’un bain chaud c’est un bain froid que vous prenez. Voilà ce qui m’est arrivé à moi-même ce deuxième jour du mois de mai. Je n’ai pas de bonheur avec messieurs les garçons de bains.
Je ne donne point ici des tableaux de fantaisie, mais des tableaux photographiés sur nature. Patience! tel est le mot d’ordre que doit adopter tout Parisien voyageant dans cette partie de l’Allemagne.
J’en ai fini de mes observations ethnologiques. J’emploie ce mot grec avec intention; il est fort à la mode.
Comme je sortais de mon bain, l’heure du dîner sonnait à ma pension bourgeoise.
A la table d’hôte, je me trouvai avec huit ou dix individus, tous parlant français ou s’évertuant à le parler. La maison ayant pour spécialité d’être le rendez-vous de la langue française, les Français et les Belges y viennent naturellement; quelques Badois se joignent à eux pour y faire des exercices de linguistique; les domestiques et même la cuisinière jargonnent à l’unisson, ce qui ne laisse pas que d’étonner beaucoup les servantes du voisinage, lesquelles s’imaginent qu’aux maîtres seuls est réservé le droit de se servir de ce noble idiome et que, même en France, tous les domestiques ne parlent que l’allemand.
Pendant quelque temps je me mêlai, et avec plaisir, à la conversation générale. Je me sentais heureux de faire ma partie dans un concert de langue française; je n’y réussis pas trop mal, si j’en juge d’après les coups d’œil approbatifs qu’échangeaient entre eux mes nouveaux compagnons, surtout les badois, qui se délectaient à ma prononciation parisienne. Mais bientôt je devins plus attentif et moins disert.
Placée en face de moi, jeune, jolie, charmante, notre hôtesse, que j’avais entrevue à peine jusqu’alors, me regardait d’un air singulier, presque inquisitorial. Je songeai à mon passe-port. Avait-elle reçu quelque avis officiel de la police? Mon postillon de la veille avait-il abusé de ma confiance en lui pour me dénoncer? Je ne m’alarmai pas trop cependant. La réponse de Junius Minorel ne pouvait tarder; elle me servirait de sauvegarde. Je m’imaginai ensuite que, ne m’étant présenté chez elle que sous la caution de mon cocher, qui ne me connaissait pas, l’hôtesse concevait quelques doutes sur ma solvabilité, surtout m’ayant vu arriver sans autres bagages que ma boîte de fer-blanc, mon caoutchouc et mon parapluie. Pour mettre fin à ses appréhensions, assez naturelles du reste, je tirai négligemment de mon gousset mon superbe chronomètre-Poitevin et semblai vérifier s’il était d’accord avec le cartel de la salle à manger. Cette adroite manœuvre me parut avoir réussi complétement.
Tout à coup, à mes idées de crainte et de défiance, en succédèrent d’autres d’un caractère tout opposé. La physionomie de la jeune femme non-seulement s’était adoucie à mon égard, mais elle se montrait, peu à peu, empreinte d’une bienveillance telle qu’il m’était impossible d’admettre que la vue d’une montre, cette montre fût-elle de Bréguet, à sonnerie, à musique, avec un entourage de diamants, eût opéré une métamorphose semblable.
Évidemment, son regard m’épiait, me parcourait, m’enveloppait, me demandant une explication dont je ne pouvais deviner le premier mot. De mon côté, je me mis à l’examiner avec plus d’attention. De l’examen, il résulta clairement pour moi que mon gracieux vis-à-vis ne m’était pas inconnu. Mais où l’avais-je déjà rencontré?... dans quelles circonstances?... Quoique physionomiste, je brouille assez volontiers les visages, et souvent il m’est arrivé de changer une tête de place. Celle-ci, sur les épaules de qui m’était-elle d’abord apparue? Grave question! et pour la résoudre, croyant consulter ma mémoire, c’est mon cœur que j’interrogeai sottement; je me mis à le fouiller jusque dans ses plus lointains souvenirs.
Fou! vieux fou que j’étais! Mon hôtesse a de vingt-deux à vingt-quatre ans, le front lisse, les cheveux immaculés, complétement bruns, et si, aujourd’hui, mes anciennes amours ne sont pas toutes grisonnantes c’est que le cosmétique y a passé.
J’étais hors de voie. Décidément, je ne connaissais la jolie brune que pour l’avoir entrevue, sans doute, la veille, en arrivant.
Mais, alors, que me voulait-elle?
Seul, entre tous les convives, j’étais de nouveau l’objet de son inspection souriante et obstinée. A plusieurs reprises nos yeux se rencontrèrent; elle baissa lentement les siens, mais pour les relever presque aussitôt.
Y avait-il encore à s’y tromper? n’était-ce pas là une provocation flagrante? ma vanité redressa l’oreille. Légèrement animé par la bonne chère, et par un délicieux petit vin de Muskateller, il me passa par la tête des rêves d’autrefois; j’oubliai ma retenue habituelle, la date de mon acte de naissance; j’oubliai même la balafre faite par mon rasoir, et qui, recouverte alors d’une bande de taffetas d’Angleterre, devait, pour un galant, me donner une figure passablement grotesque. Je redevins jeune, je redevins poëte; mon regard flamboya; ma tête se remplit de vapeurs à reflets roses ou dorés; il ne me répugnait plus trop de prolonger mon séjour à Carlsruhe. J’étais décidé à y attendre patiemment le retour de Junius Minorel.... Qui me pressait?...
Mes fatuités allaient encore recevoir un nouvel encouragement.
Tandis qu’on prenait le café, ma jolie hôtesse, passant rapidement près de moi, moins de la voix que du geste, m’invita à la suivre. Mon bonheur prenait des allures tellement vives que j’en restai interdit. Mes compagnons de table me regardaient, et se regardaient entre eux en clignant de l’œil. Mon visage s’empourpra comme celui d’un écolier à sa première bonne fortune.
L’hôtesse et moi nous entrâmes dans un petit salon attenant à la salle à manger. C’est là qu’elle se tenait d’ordinaire. L’ameublement en était des plus simples; le cadre des plaques à timbre correspondant aux cordons des sonnettes; celui des clefs, rangées par échelons numérotés; quelques registres, alignés sur une planche, en formaient la principale décoration. Elle tira un registre, l’ouvrit, et me le présenta, en m’indiquant du doigt le bas de la page:
«Monsieur, me dit-elle, voulez-vous bien inscrire ici votre nom, le lieu de votre départ et celui où vous vous rendez.»
Et, après avoir elle-même trempé une plume dans l’encrier, elle me la présenta. Je pris la plume et restai immobile, sans avoir l’air de comprendre. Ce que je comprenais, c’est que, d’un mot, elle venait de faire crever toutes les bulles de savon dont ma tête s’était gonflée.
Cette femme n’était plus à mes yeux que la personnification de la police, de l’affreuse police!
Cependant, elle paraissait émue:
«Oh! signez, je vous en prie,» reprit-elle d’un ton presque suppliant, qui m’étonna.
Ne voyant pas ce que je pouvais gagner à déguiser mon nom, je signai: «Augustin Canaple, propriétaire — venant de Paris — se rendant à Marly-le-Roi.»
Je n’avais pas achevé, qu’abaissant sa jolie tête sur le registre, car elle est un peu myope:
«M. Canaple!... c’est donc bien lui!... Je ne m’étais pas trompée! s’écria-t-elle avec un éclat de joie.
—Vous me connaissez? lui demandai-je tout ahuri.
—Si je vous connais?... Et les deux poules!»
Juste l’exclamation du père Ferrière lors de notre dernière rencontre.
C’est que mon hôtesse n’était autre que Thérèse Ferrière, la fille de mon brave bohémien, cette gentille Thérèse à qui je portais des gâteaux lorsqu’elle n’était encore qu’une enfant; cette belle fillette que, douze ans auparavant, j’avais vue débiter ses fleurs devant la maisonnette du Trou-Vassou. Je ne pouvais revenir de ma surprise; c’était Thérèse! Voilà pourquoi il m’avait semblé la reconnaître; mais douze ans, à cet âge, amènent tant de changements, et de si heureux!
La connaissance renouée, je me souvins alors des dernières questions adressées par moi au père Ferrière à son sujet, et des réponses pleines de réticences de celui-ci. Me posant le plus adroitement, le plus courtoisement possible en juge d’instruction, donnant à ma curiosité une honnête apparence d’intérêt:
«Comment vous trouvez-vous ici? dis-je à Thérèse; êtes-vous mariée?
—Non.
—Êtes-vous veuve?
—Non. Et elle rougit.
—On vous appelle madame, cependant!
—Envers toute maîtresse d’hôtel, cela est d’habitude.
—Cette marraine qui vous avait recueillie.... vous voyez que je suis au courant de votre histoire.... est-elle donc morte?
—Non; Dieu merci, elle se porte bien.
—C’est donc à Carlsruhe qu’elle demeure?
—Non; à Bruxelles.