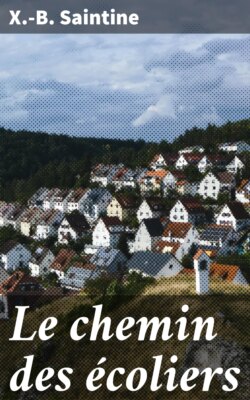Читать книгу Le chemin des écoliers - X.-B. Saintine - Страница 7
II
ОглавлениеMisères et splendeurs d’un bohémien français. — L’orphelin. — Une dame charitable. — Petits métiers. — Un cheval au lieu d’une soupe. — Choléra de 1832. — Les deux mendiants. — Un ménage sur la grande route. — Fin de la vie nomade. — Une maison pour dix francs. — La jolie bouquetière.
Avez-vous jamais élevé des poules?... C’est une attrayante occupation. Il fut un temps où, dans ma basse-cour de Belleville, j’avais quarante poules de premier choix: brahma-pootra, cochinchinoises, andalouses; poules de Crèvecœur, de Bréda, de la Flèche; poules cauchoises et poules russes, toutes bien cravatées, huppées, colleretées; des perfections du genre.
Je ressentais pour elles une grande affection qu’aucune idée gastronomique ne venait dégrader; elles le savaient bien, croyez-le. Il m’arrivait parfois d’en céder, d’en échanger, et même d’en vendre; mais me nourrir de mes élèves, grand Dieu! était-ce possible? Il m’aurait semblé entendre un de mes sujets bien-aimés pépier sous ma dent, ou caqueter dans mon estomac. Horreur!
Toutefois, je faisais là un singulier commerce, il en faut convenir. Il m’arrivait de vendre un poulet, mal coiffé il est vrai, un franc, et d’acheter un œuf trois francs.... Oui, trois francs pièce, trente-six francs la douzaine. A ce prix, une omelette eût été un plat de luxe.
J’étais donc marchand de poules, lorsqu’un matin, Jean, mon vieux Jean, m’annonça qu’un individu, conduisant une charrette, demandait à me parler.
A ma porte, je trouvai un homme à la figure intelligente sans être rusée, chose rare parmi les pauvres diables de son espèce; quoique jeune encore, il grisonnait; sa blouse, rapiécée sur toutes les coutures, mais propre et sans déchirure aucune, témoignait que si la misère l’avait éprouvé, il n’en était point au découragement.
«Monsieur, me dit-il, vous aimez les poules; j’en ai une couple à vous vendre; de bien jolies bêtes tout de même.»
Il alla à sa charrette, ouvrit une espèce de grande cage en lattis, qui en occupait la partie postérieure; puis j’entendis de gros soupirs sortir de dessous la bâche qui recouvrait le pauvre véhicule. Je m’approchai; j’aperçus à l’avant de la charrette une jeune femme assez belle, mais d’une grande pâleur. Elle tenait les deux poules sur ses genoux, et les caressait, les baisait, comme pour leur faire ses adieux. L’une était une poule nankin de Crèvecœur, d’une forme élégante et svelte; l’autre, une belle cauchoise ardoisée, à la robe irréprochable, mais dont la huppe laissait échapper quelques petites plumes blanches. Sans cette macule, c’eût été une merveille.
«Combien en voulez-vous? lui demandai-je.
—Faites le prix vous-même, me répondit-il, puisque vous êtes connaisseur.»
Après les avoir examinées, non-seulement au plumage, aux pattes et au bec, mais à la langue et sous l’aile, les reconnaissant jeunes, saines et de race, peut-être aussi tenant compte de l’apparence misérable du vendeur: «Elles valent trente francs pièce,» lui dis-je.
Mon homme fit un soubresaut; un éclair de joie jaillit de ses yeux, où une larme apparut, et j’entendis un sanglot étouffé sortir de la voiture.
«Pourquoi les vendre si vous y tenez tant? Cette somme vous est-elle indispensable? je puis vous en faire l’avance.
—Ah! vous êtes un vrai chrétien, vous! me répondit le brave Ferrière, en s’essuyant l’œil du bout de sa manche; la femme y tient, c’est vrai; dame! c’est elle qui les a élevées et presque couvées, monsieur. Les œufs qu’elles nous pondaient faisaient notre régal dans les jours difficiles; mais, nuit et jour, nous n’avons d’autre logement que notre berlingot; la femme s’apprête à me donner un poupon, et, avant longtemps, il aurait toujours fallu que la jaune et la grise cèdent leur place au berceau de l’enfant. Nous ne pouvons pas tenir tant de monde là dedans.»
Je dus me rendre à cette raison.
Mais, pourquoi ne compléterais-je pas ici l’histoire de mon ami Ferrière? Elle vaut bien une légende.
Né avec le siècle, dans une famille honorable du département de Seine-et-Marne, Ferrière perdit sa mère de bonne heure. Il avait dix ans à peine lorsque son père, ruiné par des spéculations malheureuses, après avoir fait argent de tout, alla chercher fortune à l’étranger. Son fils n’entendit plus parler de lui.
Une dame charitable prit en pitié l’enfant abandonné; mais elle le nourrissait mal et le battait parfois. Le jugeant indocile et ingrat, elle le fit entrer, en qualité de petit clerc, chez un avoué de Fontenay-Trésigny. Celui-ci, ne lui trouvant pas assez d’orthographe pour l’occuper dans son étude, lui faisait faire ses courses, balayer sa maison et cirer ses bottes.
L’enfant ne manquait ni de bon sens, ni de fierté; il échappa à ses bienfaiteurs, résolu d’embrasser un état qui pût le faire vivre honorablement. Par malheur, tout état demande un apprentissage, et cet apprentissage, il faut le payer. Il dut donc se résigner à ces petits métiers qui s’apprennent du jour au lendemain. Si je devais le suivre à travers toutes ses pérégrinations et ses métamorphoses, je le montrerais tour à tour passeur de bac, par intérim, piéton de la poste, comparse et machiniste dans un théâtre de quatrième ordre; casseur de pierres, et se dégoûtant vite de cet ingrat labeur de grande route, plus tard, bedeau, maître d’école, batteur de grosse caisse dans une fête de village, et abandonnant tout à coup son instrument pour se mêler aux danseurs, car il a vingt ans, et comme un autre il aime le plaisir.
Après avoir ainsi sauté de branche en branche, semblable au pauvre oiseau qui ne peut prendre son vol, découragé de ses vaines tentatives de vie sédentaire, n’espérant plus rien que du hasard, il alla droit devant lui, couchant dans les étables, dans les greniers, le plus souvent à la belle étoile; tantôt charitablement hébergé dans une honnête ferme, où il trouvait un emploi de quelques jours; tantôt rudement repoussé comme vaurien et vagabond. Vagabond, il l’était. Il ne savait plus se fixer; il lui fallait la vie errante, le grand air, et son indépendance complète. Il riait à sa misère, pourvu qu’elle changeât de place.
Un jour que le hasard, sa Providence, semblait l’avoir oublié, longeant, l’estomac vide, les murs d’un château, il y vit une affiche placardée. On réclamait des bras inoccupés pour un travail de terrassement. Tout travailleur, avant de se mettre à l’œuvre, avait droit à une soupe. Ce dernier article le tenta.
A la grille dudit château un domestique, en riant aux éclats, lui apprit que l’affiche était apposée là depuis six mois; on n’avait plus besoin de personne. Toutefois, il lui dit de l’attendre, et, un instant après, au lieu d’une soupe il lui donna un cheval. Oui, un cheval, un vrai cheval, en chair et en os; en os surtout.
C’était un pauvre animal, encore jeune, mais quasi étique, véhémentement soupçonné de quelque maladie contagieuse. Ayant reçu l’ordre de le mener à l’abattoir, le domestique, qui, ce jour-là, sans doute, avait autre chose à faire, chargea Ferrière de la commission, lui en abandonnant les bénéfices.
Ferrière ne fit point abattre son cheval; il le soigna, il le guérit. Par quel moyen? Je l’ignore.
On apprend bien des choses en courant les routes, pour peu qu’on ait d’intelligence et de mémoire. Tel bohémien, à force de toucher à tous les pays, à tous les métiers, de frayer avec des gens de toutes sortes, devient, à la longue, une encyclopédie vivante; encyclopédie superficielle, d’accord. Selon moi, les vagabonds de cette espèce se rapprochent assez des philosophes anciens, coureurs de routes aussi, et qui allaient deçà delà recueillir la science éparpillée alors dans le monde.
Aristote, presque seul, fut un philosophe sédentaire; mais il avait pour aide-naturaliste, pour commis voyageur, son élève, Alexandre de Macédoine. Ferrière, lui, voyait tout, apprenait tout par lui-même, comme Démocrite et Platon. Il était observateur, et, dans nos entretiens au Trou-Vassou, je m’étonnai parfois de l’étendue de ses connaissances et de la finesse de ses aperçus. Il possédait les généralités, les points de relation. De notre temps, par malheur, à force de s’accroître, les sciences sont devenues complexes, rayonnantes, obèses. Pour chacune d’elles, l’existence d’un homme suffit à peine. Il n’y a donc plus de généralisateurs, par conséquent de grandes idées relatives, que parmi ceux-là qu’on nomme les ignorants et les désœuvrés: les poëtes et les bohémiens.
Mais j’aborde les considérations, et je veux être bref.
Donc Ferrière a un cheval, et il en tire parti. Il est messager; il exécute des transports de paille, de foin, de paquets, d’un village à un autre. Le fardeau est-il trop lourd au pauvre bidet, l’homme en prend sa part, et tous deux font la route en s’entr’aidant. Grâce à son cheval, à défaut du métier qui lui manque, il a un labeur quotidien et régulier; il a mieux encore, une affection. Il aime son cheval, et son cheval l’aime.
Tous deux étaient en voie de prospérité; vint une époque désastreuse, le choléra de 1832. Dans la contrée que fréquentait le plus volontiers Ferrière, le fléau sévissait avec violence, et chacun barricadait sa porte, espérant l’empêcher d’entrer. Le pauvre messager surtout devint l’objet de la défiance générale; il semblait qu’il n’eût plus que la contagion à transporter d’un village à l’autre. On le fuyait, et en le fuyant on le condamnait à une misère sans issue. S’il avait été seul, il aurait pu se résigner peut-être, et reprendre sa vie d’autrefois en attendant des temps meilleurs; mais il fallait pourvoir aux besoins de son ami, de son cheval. Il prit une grande résolution.
Chose incroyable, au milieu de ses plus rudes épreuves, jamais notre bohémien n’était descendu jusqu’à la mendicité. Quand je m’en étonnais devant lui: «Monsieur, me répondait-il d’un ton passablement burlesque, empreint d’une fierté sincère cependant, je n’aurais pas tant souffert de la faim si j’avais pu me faire domestique ou mendiant. Mais le pouvais-je? je suis gentilhomme.»
Son père, en effet, à tort ou à raison, se faisait nommer M. de Ferrière, et le fils, à raison ou à tort, pensait que d’avoir été saltimbanque, casseur de pierres, vagabond, ne le dégradait point de noblesse comme aurait pu faire la mendicité.
Se préparant à franchir ce Rubicon de la prud’homie, il ne voulait pas mendier là où son nom était connu.
Déjà ces groupes de villages où l’homme et le cheval avaient leurs habitudes étaient loin derrière eux, lorsque, à la nuit tombante, Ferrière vit venir à lui une femme, qui, dans la demi-obscurité, lui sembla une élégante fermière, ou une honnête bourgeoise. Pour un début, l’occasion était favorable. De son côté, la soi-disant bourgeoise, apercevant dans l’ombre un homme traînant un cheval en laisse, crut tout au moins à un valet de bonne maison, et tous deux s’abordèrent en tendant la main l’un vers l’autre.
Ferrière, que j’ai eu tort peut-être de comparer à Démocrite, mais qui, après tout, était philosophe, partit d’un grand éclat de rire, et saisissant la main avancée vers lui, il la secoua cordialement.
La mendiante ne rit pas, elle. Depuis longtemps le sourire s’était effacé de ses lèvres pâles et amincies. Ouvrière en linge, son travail la faisait vivre; tout à coup la paralysie s’était jetée sur sa main laborieuse. Aujourd’hui, pour combler la mesure de ses misères, les premiers symptômes du choléra venaient de l’atteindre.
Ferrière la fit monter sur son cheval, et la conduisit, à une lieue de là, chez un bon curé de village qui lui avait fait faire sa première communion, et dont il était devenu plus tard le bedeau. Le bon curé accueillit tout à la fois l’homme, le cheval et la malade. Pour celle-ci, notre docteur bohémien mit en œuvre toutes les ressources de sa science de rencontre. Au bout d’un mois, elle était guérie et se nommait Mme Ferrière.
Deux misères réunies se portent parfois assistance, tant le principe de l’association est bon dans son essence même. Le mariage de notre ami avait reflété sur sa personne un certain éclat de moralité. Maintenant, les jeunes filles le saluaient quand il traversait le village.
Une chose, cependant, mettait le nouvel époux en grande perplexité. A peine marié, et pas mal amoureux, allait-il installer sa femme, seule, dans quelque pauvre chaumière, et courir les chemins sans elle, ou renoncerait-il à cette vie du grand air qu’il aimait tant?
Un matin qu’il se posait cette embarrassante question, deux vieilles roues, placées à la porte d’un charron, semblèrent d’elles-mêmes y répondre et résoudre la difficulté. Il les acheta et les paya au charron par des journées de travail. Pendant toute une semaine, il tira le soufflet de la forge. Son compte soldé, Ferrière, avec quelques poutrelles qu’il équarrit, quelques planches, quelques cerceaux, qu’il ajusta lui-même, se construisit une voiture.
Ainsi prit naissance ce fameux berlingot dans lequel, durant plusieurs années, vécurent les deux époux, roulant à travers les chemins, à la manière des anciens Scythes, et emportant avec eux, non-seulement leurs pénates, mais leur mobilier, leur poulailler, et leurs ustensiles de cuisine, un fourneau de terre, un poêlon et deux assiettes.
A la traversée des villages, on recueillait ou l’on distribuait les objets de messagerie. A l’heure des repas, le berlingot s’arrêtait sous un arbre. S’il faisait beau, on mettait pied à terre; la dame du logis allumait le fourneau dans un fossé ou derrière une haie; on dînait en plein air; la cage des poules était ouverte, et pas de crainte qu’une d’elles cherchât à fausser compagnie au pauvre ménage. Elles allaient chercher leur picorée en grattant les terrains environnants; mais au premier appel, d’elles-mêmes elles rentraient dans leur cage, non toutefois sans avoir été becqueter les miettes à la table des maîtres.
A ce même appel accourait un autre personnage, le chien de l’habitation, un piteux griffon, borgne et un peu écloppé, mais docile, intelligent, dévoué. Comme son cheval, comme sa femme, comme tous ses autres bonheurs enfin, Ferrière l’avait ramassé sur la route.
Ah! le bon temps! Ah! la rude existence, où les incidents, l’inattendu, le peut-être, remplissent le cœur du nomade d’émotions et de surprises incessantes; où, chaque jour, il laisse derrière lui plus de souvenirs que nous autres sédentaires n’en pouvons récolter dans un mois; où par conséquent il jouit de fait de ces quelques siècles de durée promis par un grand physiologiste à l’espèce humaine, quand elle saura se bien conduire. Sur ma parole, Minorel a raison, et si un sort contraire ne m’avait encotonné dans ce milieu bourgeois, où le mouvement semble être une convulsion, si j’avais été assez heureux pour connaître la misère (passagèrement toutefois!), moi, poëte, moi, artiste, voilà la vie qui m’aurait convenu! Chaque matin s’éveiller avec un nouvel horizon devant soi! avoir le ciel pour baldaquin, la grande route pour salon!... Je sais bien qu’à ce métier on gagne des rhumatismes.... D’ailleurs, pourquoi vais-je entreprendre l’apologie de cette existence de bohémien, juste au moment où Ferrière songe à s’en affranchir?
Ce fut vers ce temps que la vente de la jaune et de la grise vint doter le ménage d’un capital inespéré.
Devenu père, Ferrière avait senti se modifier en lui ses idées d’indépendance absolue; au nom de l’enfant, sa femme le poussait doucement vers le calme et la stabilité. Il s’y laissa prendre. Un beau jour, les joies du propriétaire passèrent devant ses yeux comme un rêve éblouissant.
Avec ses épargnes et la vente de ses poules, il possédait un avoir de cent et quelques francs. Il résolut d’acheter un terrain, de s’y bâtir une maison, et il en vint à bout.
Ferrière fit l’acquisition de quelques ares de terre du côté du Trou-Vassou, et les paya comptant. Une dizaine de francs lui restaient seuls pour entreprendre la construction de sa maison. Ils y suffirent.
Le terrain était inculte et pierreux, quelques arbres rabougris l’ombrageaient. Les arbres fournirent la charpente; la terre les matériaux.
Trois ou quatre ans plus tard, dans mes herborisations, me dirigeant de ce côté, je voyais, au milieu d’un champ de luzerne, une petite chaumière faite de meulière et de torchis; malgré sa maigre toiture de roseaux et de genêts, elle riait à l’œil par son air agreste. Après tout, on ne se bâtit pas un palais de marbre pour dix francs.
Parfois Ferrière et le cheval étaient en course, mais je trouvais là sa femme et sa fille; celle-ci trottait déjà menu, ou se roulant à terre avec le chien grillon; celle-là occupée d’ouvrages de couture. Quoique toujours impotente de sa main droite, elle était parvenue à coudre très-habilement de sa main gauche. Le chien, battant de la queue, venait à ma rencontre; l’enfant poussait des cris de joie en me voyant, et ses petites mains essayaient d’entr’ouvrir ma boîte de fer-blanc, où elle savait trouver pour elle un gâteau et un petit pot de confitures de Bar.
Puis, je quittai Belleville, et les années passèrent. Une dernière fois, me trouvant à Charonne pour certaine affaire contentieuse, je poussai jusqu’à la demeure de mes anciens amis. La chaumière s’était métamorphosée en une maisonnette couverte de tuiles, avec volets verts; elle embaumait. Au champ de luzerne avait succédé un champ de roses. Les roses sont d’un bon produit dans la banlieue parisienne, et le ci-devant bohémien, à ses états de voiturier, de messager, d’architecte et de constructeur, avait ajouté celui de jardinier-fleuriste. Sur le seuil de la porte extérieure, la gentille Thérèse, déjà grandelette, offrait aux passants des bouquets de roses, ce qui lui attirait quotidiennement vingt madrigaux, tous brodés sur un thème invariable.
Tels étaient les souvenirs que j’avais laissés au Trou-Vassou, lorsque, douze ans après, au début de mon voyage de Paris à Marly-le-Roi, sous l’ombre du fort de Noisy-le-Sec, je retrouvai mon ancien Ferrière.
Mais qu’était devenue ma petite marchande de roses?
Tout en déjeunant avec lui, lorsque je parlai d’elle à son père, la figure de celui-ci, un instant auparavant joviale et rayonnante, se crispa tout à coup.
«Thérèse? me dit-il brusquement, comme s’il eût cherché qui je voulais désigner par ce nom. Est-ce de ma femme que vous parlez? Elle se nommait Thérèse, en effet.... Eh! bien, elle est morte; tant mieux pour elle!
—Je vous parle de votre fille, père Ferrière.
— Ah! ah! ma fille?... ma fille Thérèse?... Depuis beau jour elle nous a quittés, pour aller vivre bien loin d’ici, auprès de sa marraine, qui est riche, et qui, n’ayant pas d’enfants, l’avait adoptée pour lui donner une belle éducation.
—Et vous n’avez pas revu votre fille depuis?
—Oh! que si!... Il y a deux ans, elle est revenue.... Son éducation était faite.
—Ne la verrai-je point?
—Elle est repartie.
—Pour rejoindre sa marraine?
—Non! sa marraine ne la recevrait plus.... N’allez pas croire que ce soit une méchante enfant, reprit-il tout à coup; elle, si douce, si bonne, le vrai portrait de la défunte! Vous l’avez connue cette autre Thérèse-là? mais assez causé là-dessus; vous ne voudriez pas me faire de la peine?»
C’est ainsi que mon ancienne connaissance du Trou-Vassou excita ma curiosité sans la satisfaire. Enfin, je dus prendre congé de lui, et, après une double et affectueuse poignée de main, je poursuivis ma promenade en me dirigeant vers Noisy.