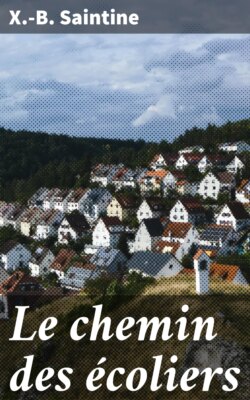Читать книгу Le chemin des écoliers - X.-B. Saintine - Страница 6
I
ОглавлениеBelleville. — Une maison qui a changé de propriétaire. — Chassé du Paradis terrestre. — L’huile de sureau. — Le Trou-Vassou. — La maison disparue. — Un ancien ami.
Autrefois, Belleville, joyeux village de quelques mille âmes, perché sur sa hauteur, en regardant autour de lui, voyait d’un côté Paris se dérouler comme un immense panorama; de l’autre, les Prés-Saint-Gervais et les bois de Romainville l’encadraient dans la verdure. J’ai passé à Belleville mon enfance et une partie de ma jeunesse, et c’est à l’intention d’y récolter de précieux souvenirs que je l’avais inscrit en tête de mon itinéraire. Je me rappelais ses beaux jardins, ses élégantes maisons de campagne, ses rues bordées de lilas, sa petite église modeste, placée presque en face de l’Ile d’Amour, guinguette célèbre, où le soir, au bruit des orchestres de danse, les arbres s’illuminaient de verres de couleur.
Aujourd’hui le village, à la tête de ses soixante-cinq mille habitants, vient de faire son entrée dans la grande enceinte parisienne; les populations ouvrières des faubourgs, qui, aux jours de fête, comme une marée montante, l’envahissaient naguère, s’y sont fixées; les lilas ont fait place à des murs, les maisons de campagne à des usines; l’Ile d’Amour est une mairie, et la petite église une cathédrale.
Non sans peine je parvins à retrouver la maison construite par mon père, et que j’avais possédée après lui, tant de nombreuses voisines étaient venues s’entasser autour d’elle. Combien l’aspect en était changé! La grande grille, surmontée du chiffre de l’ancien propriétaire, avait disparu. Une horrible et maigre bâtisse, presque neuve, déjà décrépite, s’élevait insolemment aux dépens de la cour, masquant tout ce que j’étais venu chercher.
Je pris mon parti. Au risque d’être indiscret, je sonnai à la petite porte, maintenant l’unique entrée extérieure de l’habitation. Les aboiements d’un chien répondant seuls à mon appel, je tournai le bouton, j’entrai.
Rien ne bougeait dans la maison; le chien, après m’avoir salué d’un nouveau jappement, ayant regagné sa niche, je pus, tristement, à mon aise, prendre note des changements subis par elle depuis tantôt vingt-cinq ans que je ne l’avais revue.
Noircie et lézardée, elle me fit l’effet d’un catafalque. Ce catafalque, il recouvrait la première moitié de ma vie et les dernières années de mon père. Sur sa toiture, où la tuile avait remplacé l’ardoise, s’élevait encore la girouette que j’y avais fait planter. Les persiennes, reconnaissables pour moi à un reste de couleur verte, à moitié désarticulées, en signe de deuil s’inclinaient de haut en bas contre le mur; à la double fenêtre de la chambre qu’avait occupée mon père, et où, plus tard, j’avais installé ma bibliothèque, pendaient de vieux linges et des bas rapiécés.... Cette maison, grande, spacieuse, aérée, mon père en avait disposé les appartements pour ma mère, et ma mère était morte avant que les portes s’en fussent ouvertes devant elle.
Comme je m’abandonnais à ces tristes impressions, le cri d’un oiseau funèbre sembla déchirer l’air et me fit tressaillir. C’était la girouette qui tournait sous le vent.
Le cœur serré, je détournai mon regard et le reportai sur le jardin. Ce beau jardin, le paradis de mon enfance, qu’en restait-il? Qu’étaient devenues ses larges pelouses et ses allées couvertes? Divisé, morcelé par des spéculateurs, la portion minime se reliant encore à la maison ne représentait guère qu’un chantier. J’y voyais plus d’arbres couchés sur terre, ébranchés, que d’arbres debout. Quand le temps ne peut détruire assez vite, les hommes lui viennent en aide. Au milieu de cet abatis, de ce désordre, mon œil plongeait en vain; rien n’y parlait à ma mémoire, rien n’y réveillait pour moi les temps passés. Cependant, ces deux marronniers qui s’élèvent en pyramide, leur force, leur hauteur, le disent assez clairement, ils sont de vieille date implantés dans le terrain.... Je m’orientai, et de leur âge, de la position qu’ils occupaient, je pus conclure avec certitude que c’étaient bien ceux-là qu’un jour, en revenant de l’école, j’avais déposés en terre, simples marrons. Je les avais vus sortir de terre, croître d’année en année, et pour la première fois fleurir sous mes yeux, simples arbrisseaux! Qu’ils étaient grands! qu’ils étaient beaux aujourd’hui! Ne sont-ils donc plus à moi, mes élèves, mes enfants? Ah! devrait-on jamais vendre la maison de son père! Pourquoi me suis-je laissé effrayer par l’invasion des faubourgs?...
Parés de leurs innombrables fleurs en girandoles, murmurant au vent du matin, mes chers marronniers semblaient m’appeler à eux. Je me dirigeai vivement vers le jardin.
A peine avais-je fait quelques pas, le chien, resté muet tant que j’étais demeuré immobile, s’élança de sa niche, en aboyant de nouveau et avec fureur contre moi. C’était une espèce de dogue, à la mine retroussée et hargneuse. Je ne m’intimidai pas d’abord. Le voyant solidement attaché à sa cabane par une chaîne de fer, et l’espace restant libre entre nous, je continuai d’avancer. Mais sous l’élan qu’il prit alors, sa cabane, construite trop légèrement (j’ai tout lieu de le supposer), se déplaça; il la traînait après lui, il me barrait le passage. J’essayai de le calmer du geste; par un second élan, il arriva jusqu’à moi et faillit me mordre. Je reculai prudemment; il me suivit, toujours traînant sa cabane, écumant de rage, prêt à me dévorer. Tout à fait intimidé, je me hâtai de regagner la porte de sortie, et la refermai sur moi au plus vite.
C’est ainsi que je fus chassé de mon ancien paradis terrestre. Et par qui?
Moi, à qui mes amis accordent un heureux caractère, plus enclin à la bonne humeur qu’à l’humeur noire, je me sentais profondément attristé. Pour un voyage d’agrément c’était mal débuter. J’espérai me distraire à la vue des fraîches vallées de Saint-Gervais et du joli bois de Romainville. Pour y atteindre, il me fallut, une demi-heure durant, longer une double file de murs et de maisons. A Saint-Gervais, des murs et des maisons encore; à Romainville, rien que des maisons et des murs. Dans ce dernier village, ce qui me surprit presque autant que la destruction complète de son bois, ce fut d’y rencontrer une boutique d’horloger. Autrefois, on y eût trouvé à peine trois montres disséminées entre tous les habitants. Chez notre horloger de Romainville, il est vrai, s’étalaient le long de la vitrine plus de paires de sabots et de pots de moutarde que de chronomètres.
Devant l’église, je vis un vieux sureau, noueux et rabougri, le seul arbre du pays auquel la hache n’eût osé toucher. Voici l’histoire merveilleuse qui s’y rattache et dont j’avais été bercé dans mon enfance. C’est encore un souvenir que j’évoque.
Il y a un siècle à peu près, le saint homme alors en possession de la cure de Romainville s’était complétement dépouillé de tout en faveur de ses pauvres. L’épicier du village, homme avide et défiant, refusa de lui livrer à crédit la provision d’huile destinée à l’entretien de la lampe du sanctuaire. Bientôt, privée de son alimentation indispensable, la lampe, charbonnant, crépitant, agonisant, jeta ses dernières clartés au milieu d’un nuage de fumée noire.
Pour le bon curé, son extinction était un sacrilége dont il se croyait responsable envers Dieu. Perdant la tête, il quitta l’autel en poussant des cris d’angoisse. Arrivé dans son jardin, les deux genoux en terre, il se frappa la poitrine en répétant des meâ culpâ. Dieu prit pitié de lui.
Le jardin du presbytère, décoré seulement de plantes médicinales, en l’honneur des pauvres, ne recevait d’ombre que d’un tilleul et d’un sureau. Tout éploré, le malheureux tenait ses yeux fixés sur ce dernier arbre, quand il vit l’écorce du tronc s’entr’ouvrir et donner passage à un jet de séve abondante, bien différente de la séve ordinaire. C’était de l’huile. Le ciel venait de faire un miracle en sa faveur.
Le bruit ne tarda pas à s’en répandre dans le village, où jusqu’alors on n’avait jamais entendu parler d’huile de sureau. La sensation y fut grande. L’épicier récalcitrant vint trouver le curé et lui proposa un coup de commerce qui devait les enrichir tous deux. Le bonhomme lui tourna le dos. Sous prétexte d’horticulture et d’expériences à faire, les marguilliers lui demandèrent à mains jointes une bouture de la plante, lui offrant en échange des oies grasses et des pâtés de lièvre; il fit la sourde oreille; l’huile était sainte, destinée seulement à de saints usages.
Chaque jour il visitait son précieux sureau, en pressait l’écorce, et l’huile coulait à flots, comme d’un palmier le vin de palme. Toutefois, même durant le long temps du carême, il se serait bien gardé d’en distraire le superflu pour assaisonner ses maigres repas.
Moins scrupuleuse que lui, sa servante en usa en secret, d’abord pour la salade, puis pour la confection de ses ragoûts. La séve providentielle commença à décroître. Un jour, l’imprévoyante fille en graissa les souliers de son maître. Dès ce moment, le miracle cessa. Il ne s’est point renouvelé depuis.
Quoique toujours stérile, le vieil arbre est encore en honneur dans le pays, où circule volontiers ce dicton: «Rare et précieux comme l’huile de sureau.»
J’aime les légendes (ce que Minorel appelle mes Contes bleus); je suis honteux vraiment de n’en point avoir trouvé une plus digne d’être recueillie; mais les environs de Paris, peuplés de philosophes en blouses, sont pays peu légendaires, et celle-ci, toute minime qu’elle soit, pourrait bien rester unique durant la course que j’entreprends.
Enfin, j’avais franchi cette rue immense de quatre ou cinq kilomètres de longueur, qui, de la Courtille, s’étend à l’extrémité de Romainville; je voyais devant moi s’ouvrir une vaste plaine silencieuse, presque déserte, sans murs ni maisons; je respirais.
Le célèbre voyageur Le Vaillant, en abordant pour la première fois les solitudes de la Cafrerie, dit s’être senti tout à coup pénétré d’une joie inconnue: nulle route tracée ne s’offrait à son regard; l’ombre d’une ville ne pesait plus sur lui; l’air réconfortatif de la liberté pénétrait en plein dans ses poumons; il ne dépendait plus que de lui-même, il en était fier, il en était heureux. J’éprouvai alors quelque chose de semblable. Les derniers liens qui me tiraient encore vers Paris semblaient s’être rompus; mon ardeur de voyage, un instant attiédie, se réveilla. Je songeais à prolonger le cercle de ma promenade jusqu’à Villemonble, Montfermeil, le Raincy, même jusqu’à la forêt de Bondy, ces lieux si chers à ma mémoire de botaniste. C’était trop présumer de mes forces peut-être; mais n’avais-je pas deux jours devant moi? En deux jours aujourd’hui on va de Paris à Florence; j’aurais du malheur si, dans le même espace de temps, je ne pouvais aller de Paris à Marly-le-Roi.
Cependant, je me sentais déjà fatigué, moins par la marche que par la chaleur. Quoiqu’il fût à peine huit heures et demie du matin, le soleil, dans cette plaine découverte, devenait incommode. Mon parapluie nuisait à la liberté de mes mouvements; ma vieille boîte de fer-blanc elle-même pesait plus à mes épaules qu’autrefois. Comme son maître, avait-elle pris du poids en prenant de l’âge?
Sur un tertre sablonneux, je vis une jolie arabette en pleine fleur; je la cueillis, et, comptant l’analyser à ma prochaine station, j’ouvris ma boîte.... j’eus alors le secret de sa lourdeur. Elle contenait trois petits pains de gruau, un poulet rôti, un morceau de veau froid. Madeleine, qui ne s’inquiétait guère de mes conquêtes florales, n’avait vu dans ma boîte de fer-blanc qu’un garde-manger portatif. Excellente fille! elle n’avait pas voulu que je pusse me passer de sa cuisine! Ah! j’ai de bons serviteurs!...
D’ordinaire, je ne déjeune pas avant midi; à mon grand étonnement, l’appétit m’était venu. La vue du poulet y fut pour quelque chose; la marche et le grand air pour le reste. Mais pouvais-je manger sans boire? D’ailleurs, ami du confortable, je ne comprends un repas qu’à la condition d’un siége et d’un abri.
Un souvenir plus que décennal s’éveilla dans mon esprit. Au bout du sentier suivi par moi, j’entrevoyais les collines du Trou-Vassou. J’allais trouver là un asile hospitalier, de bonnes gens qui riraient à ma venue et déjeuneraient avec moi!... Mais dix ans écoulés!
Cette réflexion refroidit mon cerveau. Ralentissant le pas, je cherchai le long de la route une maisonnette où bien des fois j’avais été reçu naguère comme un ami. Je ne la retrouvai plus et m’en inquiétai.
Qu’étaient devenus ses habitants? Thérèse doit avoir de vingt à vingt-deux ans aujourd’hui. Elle est mariée, sans doute; sans doute aussi son mari l’aura emmenée au loin; son père et sa mère l’ont suivie.... Mais la maison, l’ont-ils donc emportée avec eux? Je ne pouvais m’expliquer sa disparition complète.
Je dus chercher un autre abri.
Dix minutes plus loin, sous l’ombre du fort de Noisy-le-Sec, m’apparut un pignon rouge, une enseigne de cabaret. En qualité de touriste, je n’avais pas le droit de me montrer difficile sur le gîte. Quelques soldats du 40e de ligne buvaient et riaient dans un coin; je m’attablai non loin d’eux, et tirai mes victuailles de ma boîte de fer-blanc, qu’ils prirent sans doute pour un bidon de nouvelle espèce. Sans attendre mes ordres, le garçon m’apporta une bouteille de cette rinçure de cuve, décorée du nom de vin de pays. Résigné à tout, et le poulet me semblant un bien noble personnage pour être exhibé en pareil endroit, j’allais entamer mon morceau de veau, quand mes yeux se rencontrèrent avec deux prunelles grises, surmontées de sourcils épais; au-dessus des sourcils se développait une abondante chevelure blanche, qui, grâce à des favoris et à un cordon de barbe de même couleur, encadrait une figure, alors contractée sous une impression de profond étonnement.
Cette figure, c’était celle du cabaretier.
«Comment, c’est vous, père Ferrière? lui dis-je, après une inspection rapide de sa personne.
—Ah! je ne m’étais pas trompé!» s’écria-t-il en frappant dans ses mains; et tout aussitôt faisant lestement disparaître ma bouteille de rinçure, il la remplaça par une autre, à cachet rouge, vin d’officier, mit un second verre sur la table et s’assit en face de moi.
Je demandai au garçon deux assiettes et deux couverts, et tirai le poulet de sa boîte. Les soldats du 40e ouvraient de grands yeux affamés.
«En quelle qualité êtes-vous ici? dis-je à Ferrière.
—C’est moi le chef de l’établissement,» me répondit-il.
Et son front rayonna d’orgueil.
«Voilà donc pourquoi je n’ai plus retrouvé la maisonnette à sa place?
—La maisonnette a descendu dans les fossés du fort, ainsi que le petit lopin de terre; c’est une affaire entre le gouvernement et moi.
—Et l’affaire a été bonne?
—Pas mauvaise, pas mauvaise, dit-il en clignant de l’œil, puisque je ne dois rien sur l’établissement, que la cave est pleine et que je vends en gros et en détail.»
L’orgueil qui tout à l’heure ne rayonnait que sur son front resplendit alors sur toute sa personne.
«Donc, père Ferrière, aujourd’hui vous voilà riche?
—Je ne dépends plus de mon cheval, du moins, et cela grâce à vous et au gouvernement.
—Comment, grâce à moi?
—Eh bien, et les deux poules!»
Ces derniers mots demandent une explication.