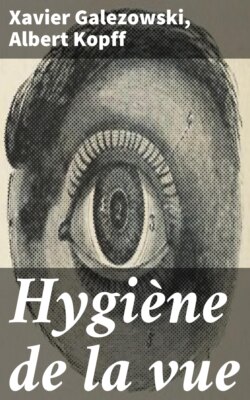Читать книгу Hygiène de la vue - Xavier Galezowski - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION
ОглавлениеTable des matières
«Tels sont les yeux, tel est le corps», a écrit Hippocrate.
Cet aphorisme, vrai au Ve siècle avant l’ère chrétienne, époque à laquelle il a été écrit, n’a fait qu’augmenter d’importance et de justesse avec les nombreuses époques scientifiques qui se sont écoulées depuis. Aujourd’hui, l’hygiène oculaire peut être considérée comme une application à la vue, des règles tracées par l’hygiène générale, étant donnés les liens qui unissent la plupart des affections oculaires aux grandes diathèses de l’organisme.
Les rapports entre l’hygiène oculaire et l’hygiène générale sont nombreux; nous voyons en effet la plupart des différents états constitutionnels retentir sur l’organe de la vision et un très grand nombre d’affections de l’œil n’être pour ainsi dire que la signature d’un état général qui y produit une localisation déterminée. L’alcoolisme, la tuberculose, le lymphatisme, l’arthritisme, la goutte, les affections cardiaques, l’albuminurie, le diabète, l’anémie, la chlorose, la grossesse, la ménopause, l’ataxie locomotrice, présentent constamment des déterminations oculaires; et souvent même, la manifestation oculaire existe seule pour révéler au médecin l’état général latent.
Les maladies aiguës, éruptives ou inflammatoires, telles que: rougeole, diphthérie, etc., exercent aussi leur influence sur la vue, comme du reste toutes les causes qui à un moment donné arrivent à ébranler plus ou moins profondément l’organisme.
En dehors des diverses influences qui peuvent agir sur la vue, l’œil en lui-même n’est-il pas l’organe le plus utile, le plus précieux et le plus noble; et à ce seul titre ne mérite-t-il pas des précautions et des soins spéciaux, dans le but de le conserver dans son intégralité et d’assurer le fonctionnement régulier de ses parties constitutives?
Les fonctions dont l’œil est chargé sont évidemment celles qui ont la plus grande importance dans la vie de l’homme, et qui lui sont le plus nécessaires pour se mettre en relation avec le monde extérieur, pour en apprécier les formes, les rapports et les beautés, et pour éveiller son imagination, d’après les impressions communiquées au cerveau par l’intermédiaire des nerfs optiques; et ce n’est pas sans raison que l’on regarde la cécité comme étant le malheur le plus affreux qui puisse affliger l’humanité.
Les anciens avaient l’intuition de l’influence exercée par une bonne hygiène sur le sens de la vue; et Hippocrate, Galien, Celse, Paul d’Egine, ajoutent souvent à leur thérapeutique locale la recommandation de donner des soins généraux hygiéniques.
Dans les traités de médecine et de chirurgie des époques qui suivent, on trouve aussi des conseils hygiéniques à l’usage des yeux. Et aujourd’hui, après les immenses progrès qu’a réalisés l’ophtalmologie, au point d’être devenue la plus exacte et la plus complète des sciences médicales, n’est-il pas nécessaire de lui tracer des lois hygiéniques spéciales et bien précises? En résolvant ce problème, nous répondrons aux besoins urgents du moment; d’autant plus que, s’il est une branche de l’hygiène dont les principes soient ignorés ou négligés par le public, et même par des médecins, c’est incontestablement l’hygiène oculaire.
Les divers modificateurs qui agissent sur l’organisme entier ont aussi une action plus ou moins directe sur l’œil; aussi la pratique de l’hygiène générale est-elle nécessaire avant tout. Étant données, d’une part, l’extrême délicatesse des différentes parties de l’œil, et de l’autre, la part prépondérante que cet organe prend à tous les actes de la vie, il paraît nécessaire de connaître spécialement comment il se comporte au milieu des modificateurs de toute sorte qui viennent agir sur lui et comment il peut résister à leur action. Dès la naissance, l’œil se trouve exposé à des causes nuisibles, et jusqu’à la mort et dans toutes les conditions sociales, il rencontre sans cesse des ennemis contre lesquels il importe de savoir se garantir. Que de maladies et d’infirmités seraient évitées si l’on connaissait bien ces ennemis et si l’on savait quelles armes il faut leur opposer! C’est dans ce but que nous avons conçu l’idée d’écrire l’hygiène de la vue.
Nous nous proposons d’étudier l’œil dans les différentes phases de l’existence et dans les principales conditions sociales, de rechercher la part qui dans certaines maladies doit être attribuée à telle ou telle influence, et surtout d’indiquer les règles prophylactiques à mettre en pratique pour le préserver de ce qui lui est nuisible.
L’hygiène tient aujourd’hui, et à juste titre, une place prépondérante dans la pratique médicale; la prophylaxie devient la préoccupation de plus en plus grande du médecin et le législateur y apporte sa sanction en donnant force de lois aux préceptes de la science. Les sociétés d’hygiène se multiplient dans toutes les villes importantes, et des congrès internationaux se réunissent périodiquement pour discuter les grandes questions qui intéressent la santé publique.
Au milieu de ce mouvement général, il nous a paru bon d’attirer l’attention sur les règles hygiéniques et prophylactiques qui sont spéciales à l’œil, assurés que c’était faire ainsi un travail utile.
Nous diviserons notre étude en deux grandes parties:
I. L’Hygiène privée;
II. L’Hygiène publique.
Dans la première partie, nous étudierons toutes les questions qui se rapportent aux individualités: les âges, les conditions d’hérédité, les différentes conformations des yeux (myopes, hypermétropes, etc...), et l’action de certains modificateurs (tabac, alcool.....) sur les yeux.
Dans la deuxième partie, nous nous occuperons des influences exercées par les modificateurs sur la vue des collectivités: influences météorologiques; influence de la lumière, ce modificateur essentiel de l’œil; influence des écoles, de l’éclairage... et des professions.
Pour faciliter la lecture de notre livre aux personnes qui ne sont pas initiées à l’anatomie de l’œil, nous plaçons avant de commencer, trois figures qui leur permettront de se rendre compte des différentes parties qui constituent le globe de l’œil (Fig. 1, 2 et 3).
Dans la figure 1, on voit: 1, l’iris qui se contracte, selon la plus ou moins grande quantité de lumière; 2, la pupille qui se montre à travers la cornée transparente; 3, la partie antérieure de la sclérotique, que l’on voit entre les paupières, et que l’on appelle vulgairement le blanc de l’œil; 4, la paupière supérieure; 5, la paupière inférieure.
Fig. 1. — Parties extérieures de l’œil (Dalton).
Fig. 2. — Coupe schématique de l’œil et de ses annexes.
La figure 2 représente: a, la peau des paupières; b, la conjonctive ou membrane muqueuse qui tapisse les paupières; c, la cornée transparente; d, la sclérotique; e, l’iris; f, le cristallin ou lentille chargée d’accommoder la vue aux distances, et qui devient opaque dans la cataracte;g, le corps vitré, concourant à la réfraction des rayons lumineux par sa parfaite transparence à l’état normal et servant de support à la rétine par sa consistance égale à celle du verre fondu; h, le nerf optique et la rétine; i, la rétine, membrane servant à la perception de la lumière et des couleurs; j, la choroïde, membrane servant: par sa partie antérieure ou ciliaire, à la nutrition des milieux transparents de l’œil; et par sa couche pigmentaire, à l’absorption des rayons qui ont déjà produit leur impression sur la rétine, comme cela a lieu dans les appareils optiques; k, l’orbite; l, l, les muscles externes de l’œil, qui font mouvoir le globe oculaire dans tous les sens.
Fig. 3. — Section verticale du globe de l’œil.
La figure 3 montre: 1, la sclérotique; 2, la choroïde; 3, la rétine; 4, le cristallin; 5, la membrane hyaloïde entourant le corps vitré 8; 6, la cornée; 7, l’iris.