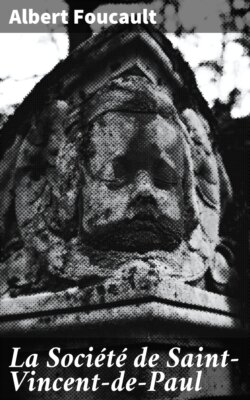Читать книгу La Société de Saint-Vincent-de-Paul - Albert Foucault - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE RÈGLEMENT (1835)
ОглавлениеLe 15 octobre 1834, Ozanam écrivait à l’un de ses amis: «Nous vous amènerons à Paris une bande de bons Lyonnais qui grossiront toutes nos réunions.» Il tint si bien parole qu’à la rentrée le nombre des membres de la Conférence atteignait la centaine.
La première conséquence de ce développement inespéré fut un nouveau déménagement. La salle du rez-de-chaussée de la place de l’Estrapade étant trop exiguë pour donner asile à une assistance aussi nombreuse, Bailly lui ouvrit dans le même immeuble, les portes de l’amphithéâtre, qui servait aux réunions de la Conférence d’histoire et contenait environ 300 places.
La seconde conséquence fut de tout autre importance: Plus que jamais, le sectionnement de la Conférence paraissait nécessaire à ses fondateurs. Les inconvénients d’une réunion trop nombreuse, s’aggravaient de jour en jour. Non seulement on sentait compromise cette affectueuse intimité qui avait présidé à la fondation de l’Œuvre, mais, en outre, les séances elles-mêmes perdaient leur caractère originel. Absorbées presque complètement par la distribution des bons et par la présentation et l’admission des candidats nouveaux, elles ne laissaient plus qu’un temps insuffisant pour le compte rendu des visites aux familles indigentes et l’exposé de leurs besoins: elles devenaient administratives. Il fallait, sans retard, prévenir le danger, qui, de ce chef, menaçait l’avenir de la Conférence.
Le 16 décembre 1834, Ozanam, d’accord avec Le Prévost, et sur le conseil de Sœur Rosalie, saisit la réunion d’une proposition tendant à ce qu’il fût formé dans le sein de la Conférence trois sections distinctes, se réunissant à part, une fois par semaine, ayant chacune sa caisse, son secrétaire, son trésorier et se reconstituant en assemblée générale le premier mardi de chaque mois.
Cette proposition souleva une émotion considérable: «L’esprit de sincère fraternité, nous dit Mgr Ozanam, qui régnait entre les membres de la Société avait resserré si étroitement les liens d’amitié qui les unissaient, que la seule pensée d’une séparation les révoltait.» Beaucoup d’entre eux d’ailleurs concevaient difficilement des séances qui ne fussent pas presidées par celui qu’ils appelaient familièrement «le père Bailly».
Le Président nomma une commission de 7 membres pour examiner la proposition et l’avis de celle-ci fut que «le moment n’était pas encore venu de lui donner suite». Mais, dès la séance suivante, Arthaud la reprenait à son compte, en réclamant une décision de la Conférence elle-même: Bailly renvoyait la question devant la Commission précédemment nommée, qu’il complétait par l’adjonction de 3 nouveaux membres et dès le lendemain, 31 décembre, celle-ci se réunissait dans son salon et sous sa présidence.
Tel était l’intérêt qui s’attachait à la question que plusieurs confrères, n’appartenant pas à la commission, voulurent se rendre à la réunion et même prendre part à la discussion. Celle-ci fut chaude et devint bientôt assez vive: l’opposition des esprits et l’émotion générale ne faisaient que grandir lorsque l’horloge sonna minuit. A ce moment, Bailly, très ému lui-même, se leva et dit: «Une nouvelle année commence, embrassons-nous, et laissez-moi le souci de prendre des dispositions convenables pour donner satisfaction à tous les vœux.» Et sur ce mot, tous se levèrent et s’embrassèrent cordialement, en s’adressant des souhaits réciproques de bonheur.
Bailly avait bien trouvé une forme élégante pour mettre fin à une réunion agitée, révélant la surexcitation des esprits; mais la question n’avait pas fait un pas vers sa solution. Après réflexion, il crut opportun de nommer deux Commissions et en indiquant leur composition, à la séance du 6 janvier 1835, il «exhorta les membres de la Conférence à la résignation et au calme jusqu’à la décision qui serait rendue dans un mois .»
Les deux commissions se mirent d’accord sur la nécessité d’un sectionnement mitigé, et le 17 février, «M. le Président, dit le provès-verbal de la séance, annonce qu’après avoir pris l’avis des Commissions nommées dans la séance du 6 janvier, il a reconnu qu’il était utile que la Société fût partagée en 3 bureaux qui s’assembleraient séparément chaque mardi pour voter les secours ordinaires et s’entretenir des familles visitées. La réunion des bureaux serait suivie d’une séance commune, dans laquelle on discuterait les mesures d’intérêt général. La composition de chaque bureau serait donnée à la prochaine séance.»
En effet, le 24 février, Bailly désignait bien les membres de chaque bureau: mais il n’y en avait plus que 2 au lieu de 3. Le premier prenait le nom de Section du Faubourg St-Jacques et devait visiter les pauvres du XIIe arrondissement et de la Cité. Le second, appelé Section du Faubourg St-Germain, se chargeait des pauvres des Xe, XIe, et Ier arrondissements .
§
Cette organisation un peu hybride était vouée au sort de toutes les mesures transactionnelles qui cherchent à concilier des conceptions nettement contradictoires. Elle ne pouvait pas durer.
Les inconvénients du nouveau régime se révélèrent dès qu’il fut appliqué. Tantôt la première section avait terminé sa distribution de bons avant la seconde, et ne savait comment employer le temps jusqu’à l’arrivée de celle-ci. Tantôt, au contraire, la seconde section avait marché plus vite et son arrivée soudaine jetait le trouble parmi les membres de la première. D’un autre côté, le nombre des membres, dans chaque section s’accroissait de semaine en semaine, et souvent la double séance se prolongeait fort avant dans la soirée. Ce dernier inconvénient était surtout sensible pour les membres appartenant à des quartiers éloignés.
Et c’est pourquoi, Clavé, l’un des 6 fondateurs, qui habitait au Faubourg du Roule, après s’être entendu avec quelques confrères habitant son quartier, formula le désir de voir ériger pour eux une section séparée qui tiendrait ses séances sur leur paroisse. Il était bien impossible de repousser une requête si légitime, car du Roule à la rue de l’Estrapade, elle était vraiment longue, la double course imposée chaque semaine au zèle charitable de ces jeunes hommes. On créa donc une troisième section: celle de St-Philippe du Roule. Sa première séance se tint chez Clavé, le 25 mai 1835. Ozanam et Lallier y assistaient.
Cet exemple fut immédiatement suivi par un confrère habitant le quartier Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, qui, lui non plus, n’est pas très voisin de la place de l’Estrapade. Ayant obtenu l’admission de 3 candidats nouveaux habitant dans son voisinage, il demanda, en leur nom et au sien, l’érection d’une nouvelle section qui tiendrait ses séances sur le territoire de leur paroisse. La requête fut admise, et le 30 juin 1835 vit la création d’une quatrième section, celle de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle.
On se trouvait, au bout de 4 mois, en présence de quatre sections, dont les deux premières tenaient séparément — et dans le même immeuble — une partie seulement de leur séance qui se terminait en commun — non sans inconvénients d’ailleurs; tandis que les deux dernières tenaient leur séance complète, isolément, chacune sur sa paroisse, et ne se réunissaient aux premières qu’accidentellement, dans des séances générales, dont le but était de maintenir entre les 4 sections l’unité d’esprit et d’action sous la paternelle direction de Bailly. La première de ces réunions générales se tint le 19 juillet 1835, fète de saint Vincent de Paul, au siège de l’Œuvre, place de l’Estrapade. Ce fut le prototype des assemblées générales.
Cette anomalie de régime ne pouvait se prolonger bien longtemps. Il fallut rendre son indépendance à la section du Faubourg St-Germain et lui trouver un local où, comme ses sœurs du Roule et de Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, elle tiendrait isolément ses séances. Bailly obtint qu’elle fût hospitalisée dans un immeuble situé au coin de la rue Cassette et de la rue de Vaugirard, où s’était installée la Société St-François Régis fondée et dirigée par Gossin. Et c’est ainsi que fut révélée à ce dernier l’existence d’une Œuvre dont il devait, neuf ans plus tard, devenir le Président Général.
La Section de St-Germain d’ailleurs, demeura quelques mois seulement au siège de la Société St-François Régis, car dès le 11 mai 1836 le curé de St-Sulpice lui offrait, pour tenir dorénavant ses séances, un vaste local dépendant de son église, chauffé et éclairé à ses frais, afin disait-il, qu’elle pût «ne rien distraire de ses recettes pour les pauvres».
En fait, les mesures proposées par Ozanam se trouvaient adoptées: la nécessité en avait imposé l’application. Les rameaux peu à peu commençaient à se détacher du tronc, sans cesser d’ailleurs d’y puiser leur sève.
§
Si le nombre des membres de l’Œuvre allait croissant, les ressources étaient encore bien modestes, et par suite, son action très limitée. De mai 1833 au 31 décembre 1834, les recettes ne s’étaient élevées qu’à 2.480 fr. L’exercice 1835 avait accusé un léger progrès, soit pour les 4 sections: 3.466 fr. de recettes et 3.414 fr. de dépenses. Parmi celles-ci on voit figurer l’impression de bons au nom de la Société pour remplacer ceux que Sœur Rosalie avait prêtés jusque-là, et qui ne pouvaient plus satisfaire aux besoins des quatre sections disséminées dans Paris; et aussi, pour la première fois, l’acquisition de bons de fourneaux émis par la Société Philanthropique.
Pareil budget était fort modeste, même à une époque où la livre de viande ne coûtait que 40 centimes, et le kilo de pain six sous. Mais l’espoir de le voir prochainement grossir n’était pas téméraire, non pas seulement à raison de l’augmentation constante du nombre des confrères, qui, au mois de décembre 1835, étaient près de 250, mais encore par suite de l’intérêt que l’Œuvre suscitait autour d’elle. Certains établissements catholiques d’enseignement secondaire, comme Juilly et Stanislas, qui lui fournissaient de nombreuses recrues, lui envoyaient en outre des subventions; de même l’atelier de Ingres, où, sur l’initiative d’un zélé confrère, Janmot, se faisaient des quêtes périodiques au profit de l’Œuvre.
Celle-ci, d’ailleurs, était de plus en plus connue et appréciée. On recourait à elle pour faire aux adultes des cours du soir, pour placer et pour obtenir des apprentis, et même pour procurer du travail aux ouvriers en chômage.
D’autre part, elle semblait devoir, dans un avenir très prochain, gagner la province, et même l’étranger.
Curnier, de Nîmes, n’avait oublié ni les enseignements qu’il avait puisés, ni les résolutions qu’il avait annoncées, à la séance du 10 juin 1834. Le 24 octobre suivant, il annonçait à Ozanam la création imminente, à Nîmes, d’une Conférence de charité, pour laquelle il avait obtenu déjà 7 adhésions; et le 10 février 1835, Ozanam avait pu lire à ses confrères parisiens une lettre annonçant la constitution définitive de cette Conférence, et manifestant le désir de celle-ci d’être rattachée à l’Œuvre de St-Vincent de Paul fonctionnant à Paris.
Par ailleurs, certains étudiants appartenant aux Conférences parisiennes, allaient se trouver, leurs études terminées, obligés de regagner leur province. Ne serait-ce pas, incessamment, le cas d’Ozanam lui-même? Plusieurs d’entre eux, annonçaient, comme lui, l’intention de créer une Conférence dans la ville où ils allaient s’établir.
Enfin, Janmot était parti pour Rome, où bientôt le rejoignait son confrère Claudius Lavergne, et tous deux s’essayaient à fonder une Conférence dans la ville des Papes.
On pouvait donc entrevoir le jour où l’Œuvre essaimerait un peu de tous côtés et réaliserait, en partie du moins, le rêve caressé par Ozanam. Sans doute, elle était encore bien modeste; mais son avenir était gros de promesses. Aussi ses chefs estimèrent-ils le moment venu d’organiser son fonctionnement dans la forme nouvelle que lui imposait son développement rapide, et de lui donner une constitution. Bailly décida la rédaction d’un règlement général qui servirait de lien, dès à présent, aux quatre Conférences existant à Paris, et, dans l’avenir, à toutes les Conférences qui désireraient s’affilier à l’Œuvre.
§
Le 8 décembre 1835, fête de l’Immaculée Conception, aux quatre Conférences réunies sous sa présidence, Bailly donnait lecture de ce règlement qui, pour la première fois qualifiait l’Œuvre «Société de St-Vincent de Paul». Il en avait confié la rédaction à Lallier, mais il s’était réservé d’écrire lui-même un préambule précisant le but et l’esprit de l’Œuvre et qui, sous le titre d’ «Observations Préliminaires» est fidèlement reproduit, depuis cent ans, dans les éditions successives du manuel de la Société.
Ce règlement n’était pas seulement la codification des usages suivis pendant les deux années et demie qui s’étaient écoulées depuis la fondation. C’était en même temps la sage prévision des nécessités que devait imposer son développement.
Il définit le caractère de la Société : association de piété et de charité, ayant pour premier objet de son activité la visite du pauvre à domicile, mais ne considérant comme lui étant étrangère aucune œuvre charitable, quelle qu’en soit la forme.
La réunion de plusieurs membres de la Société constitue une Conférence.
La Conférence est administrée par un bureau comprenant Président, Vice-Président, Secrétaire et Trésorier; elle nomme elle-même son Président, qui choisit à son tour les autres membres du bureau. Le rôle de chacun, l’ordre des séances, les prières à réciter au début et à la fin de chaque réunion, la lecture de piété, la présentation et l’admission des nouveaux membres, la distribution des bons et des secours extraordinaires, l’admission des familles, la quête, tout est prévu et réglé par des dispositions dont la sagesse a été démontrée par l’expérience.
Toutes les Conférences relèvent d’un Conseil de Direction chargé de maintenir l’esprit de la Société, le respect du règlement, l’uniformité des usages, et de servir de lien entre elles.
Dans ce but, le Conseil de Direction réunit les Conférences en assemblées générales 4 fois par an, le premier dimanche de Carême; le dimanche du Bon Pasteur, jour anniversaire de la translation des reliques de saint Vincent de Paul; le 19 juillet, fête de son saint patron; et le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception. A ces réunions, chaque Conférence doit rendre compte des faits intéressants de sa vie quotidienne.
Et le règlement se termine par le rappel des deux fêtes annuelles de la Société, S décembre et 19 juillet, adjurant tous les confrères de prier en ces jours «pour la prospérité de la foi catholique, pour l’accroissement de la charité parmi les hommes, et pour attirer la bénédiction de Dieu sur l’Œuvre dont ils font partie».
Il ajoute enfin, pour rassurer les consciences timorées «Aucune des obligations imposées par ce règlement n’est obligatoire de conscience, mais la Société en confie l’accomplissement au zèle de ses membres, et à leur amour pour Dieu et pour leur prochain.»
Ce règlement frappe surtout par l’esprit de prévision qui l’a inspiré.
Au mois de décembre 1835, la Conférence de charité, à peine âgée de trente mois, vient de se séparer en 4 sections; une Conférence analogue, qui d’ailleurs ne vivra pas, s’est fondée à Nîmes; des essais encore infructueux sont tentés à Rome, et c’est tout! Et, dans cette situation singulièrement modeste, un des fondateurs de l’Œuvre, assurément incapable de prévoir son rayonnement futur, n’hésite pas à écrire: «La Société reçoit dans son sein tous les jeunes gens chrétiens qui veulent participer aux mêmes œuvres de charité, en quelque pays qu’ils se trouvent», et à fixer, dans tous leurs détails, les règles d’une organisation qui subira la double épreuve d’un siècle entier et d’une expansion mondiale, sans autres modifications que les compléments inévitables exigés par une prospérité croissante.
§
Extraites en partie d’un opuscule rédigé jadis par saint Vincent de Paul, à telle enseigne qu’on a pu écrire que le véritable législateur de la Société avait été son saint patron lui-même, les «Observations Préliminaires» rédigées par Bailly, échappant à la sécheresse inévitable du règlement, l’illuminent et le vivifient en précisant l’esprit de la Société, le but qu’elle poursuit et les moyens qu’elle doit employer pour l’atteindre. C’est son décalogue. Un siècle a passé sur lui, sans qu’une seule pierre de cet édifice ait été ébranlée: toutes, au contraire, ont été successivement consolidées par les chefs qui se sont succédé à la direction de l’Œuvre.
Celle-ci repose sur trois assises: Piété, Charité, Humilité.
Et d’abord la Piété, caractère primordial de la Conférence de Charité dans l’esprit de ses fondateurs. Ce qu’Ozanam avait eu surtout en vue, c’était la préservation religieuse et morale, la sanctification personnelle de la jeunesse universitaire, de «ces oiseaux de passage, éloignés pour un temps du nid paternel et sur lesquels l’incrédulité, ce vautour de la pensée, plane pour en faire sa proie...» C’est pour eux qu’il a voulu créer «un abri qui les protège... un point de ralliement pour le temps de leur exil... une association d’encouragement mutuel, où ils trouveraient «une espèce d’hospitalité morale» afin que «les mères chrétiennes aient quelques larmes de moins à répandre, et que leurs fils leur reviennent comme elles les ont envoyés ».
Bailly ne l’oublie pas. «C’est, dit-il, un mouvement de piété chrétienne qui nous a réunis. C’est pourquoi nous ne cherchons pas ailleurs que dans l’esprit de la religion, dans les exemples et les paroles de N.-S., dans les enseignements de l’Église et la vie des Saints, les règles de notre conduite.» La première fin d’une Conférence est «de maintenir ses membres, par des exemples et des conseils mutuels, dans la pratique d’une vie chrétienne.»
La Société toutefois, n’exige de ses membres aucune pratique spéciale et surérogatoire de piété : elle ne demande à celui qui désire franchir sa porte que la soumission aux exigences de l’Église, la pratique de ce qui est «de précepte» et rien de plus. Cela suffit, en effet, pour l’assurer que ce nouveau membre, s’il n’édifie pas, est du moins susceptible d’être édifié.
Après l’amour de Dieu, l’amour du prochain, la Charité 1 Et aux premiers rangs de son prochain, le membre de la Société de St-Vincent de Paul rencontre ses confrères et les pauvres qui lui sont confiés.
Nulle part, en dehors des ordres religieux, la confraternité des associés ne doit être comprise et pratiquée plus large et plus complète que dans la Société de St-Vincent de Paul. Elle demande à ses fils plus que des égards et des prévenances les uns pour les autres, «une bienveillance mutuelle, du fond du cœur, et sans bornes» conditionnée par «l’abnégation de soi-même, le détachement de son propre sens et l’acquiescement facile à l’avis des autres».
Mais plus encore, c’est envers les indigents par lui secourus que doit s’exercer la charité du Confrère.
Il a pour mission d’aller les visiter à domicile, de leur porter des secours proportionnés à leurs besoins, de s’intéresser à eux, de recevoir leurs confidences, de leur prêter appui, de se faire leur guide et leur ami, au point qu’ils deviennent «sa famille».
Il ne saurait oublier que le secours en nature, toujours insuffisant, d’ailleurs, pour assurer à lui seul leur existence, est, avant tout la clef qui lui ouvre la porte, non pas seulement de leur taudis, mais aussi de leur âme, et lui permet ainsi de mettre à leur disposition une sollicitude, un dévouement qui, eux, sont inépuisables.
Le Confrère de St-Vincent de Paul doit s’efforcer d’arracher le pauvre à sa misère en lui procurant du travail s’il n’en a pas, des soins s’il est malade, un asile s’il est infirme, d’assurer l’éducation de ses enfants et leur placement lorsque l’heure en est venue, de tout faire en un mot, pour l’amélioration de son sort matériel, mais aussi et surtout, dans la mesure du possible, de le ramener à la pratique de ses devoirs, de rétablir sa mentalité morale et religieuse, en régularisant les unions illégitimes, en provoquant les baptêmes et les premières communions des enfants, en les affiliant à un patronage, en procurant à tous les membres de la famille des lectures honnêtes.
Telle est la tâche du Confrère de St-Vincent de Paul. Cette tâche, il doit la poursuivre en toute humilité. Ozanam écrivait un jour à Lallier, — en faisant sienne la formule adoptée par saint Vincent de Paul — «Servi, inutiles sumus». Tel est le témoignage que doivent se rendre ceux qui s’unissent pour servir Dieu et les hommes ». Tout au plus peut-on permettre à la Société de se «laisser voir» mais non point de «se faire voir».
Et Bailly d’écrire: «Tenant à honneur d’être réputés les moindres d’entre nos frères, nous nous garderons de toute envie, non seulement les uns à l’égard des autres, mais encore à l’égard d’autres sociétés, avant, comme la nôtre, pour but le soulagement du prochain... Quoique nous aimions davantage notre petite association, nous l’estimerons toujours moins excellente que les autres: nous ne verrons en elle, comme elle est en effet, qu’une œuvre formée par on ne sait qui ni comment, née d’hier, et qui peut mourir demain...»
Peut-être, à l’heure présente, après un siècle de bénédictions divines semblant prouver que Dieu a fait cette œuvre sienne, est-il plus difficile de la considérer comme une œuvre «née d’hier et qui peut mourir demain» : mais ces conseils n’en prouvent pas moins dans quelle atmosphère d’humilité ses fondateurs entendaient la maintenir.
Tel est le résumé des «Observations Préliminaires» rédigées par Bailly. Le caractère, le but et l’esprit de la Société s’en dégagent nettement: ils n’ont jamais varié. C’est vraiment sa constitution. Demeurée intacte, elle est aussi respectée aujourd’hui qu’il y a cent ans.
§
Le règlement, lu pour la première fois à l’Assemblée générale du 8 décembre 1835 et approuvé par elle, devait entrer immédiatement en vigueur. Il fallait donc constituer le Conseil préposé à la direction des Conférences actuelles et futures.
Bailly se trouvait Président, par droit de naissance pourrait-on dire. Personne n’eût conçu d’ailleurs qu’il en pût être autrement. Il nomma: Vice-Président, Le Prévost, que son zèle et sa maturité désignaient à son choix; Trésorier, Devaux, le trésorier de la première heure, et Secrétaire, Brac de la Perrière, que son départ de Paris devait faire remplacer par Lallier dès 1837. Ozanam, sollicité pour la vice-présidence s’était récusé en invoquant la nécessité, où il allait se trouver incessamment, de quitter Paris pour venir s’établir à Lyon.
Les 4 groupements parisiens, considérés jusqu’ici comme des sections deviennent dès lors des Conférences indépendantes et s’appellent Conférences St-Etienne du Mont, St-Sulpice, St-Philippe du Roule et Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Chacune d’elles aura son Président et ne sera plus dirigée, comme par le passé, par des Vice-Présidents délégués à titre temporaire et trop fréquemment renouvelés. Cette individualité proclamée leur confère une indépendance relative sous le contrôle du Conseil de Direction dont le rôle d’ailleurs va s’élever et s’élargir au fur et à mesure que le développement de l’Œuvre va s’affirmer.
Une ère nouvelle vient de naître pour cette petite Société. Agée de 2 ans et demi, elle sort de l’obscurité de son humble berceau, dégagée de ses langes, et prête à grandir, s’il plaît à Dieu.