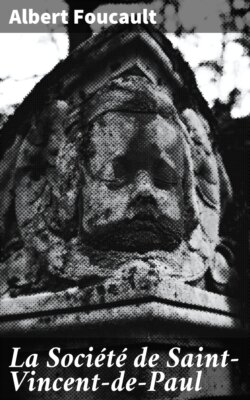Читать книгу La Société de Saint-Vincent-de-Paul - Albert Foucault - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
INTRODUCTION
ОглавлениеTable des matières
La Société de St-Vincent de Paul a été fondée au mois de mai 1833. Avant de conter sa naissance et sa vie, peut-être n’est-il pas inutile de rappeler sommairement dans quelle atmosphère elle allait venir au monde.
La monarchie de juillet naquit d’un mouvement antidynastique, assurément, mais qui fut aussi un mouvement antireligieux.
La guerre au christianisme déchaînée par la Révolution n’avait laissé derrière elle que des ruines: Pendant 30 ans la France avait ignoré Dieu, et si le Concordat, nécessité politique, avait pu rétablir la légalité du culte il n’avait pas restauré dans les âmes une mentalité religieuse, dont l’Empire, au surplus, redoutait l’indépendance morale. Poursuivre cette restauration, c’était pour la Monarchie rétablie, une œuvre difficile et dont elle ne pouvait espérer le succès qu’à la condition d’y apporter une extrême prudence. Or la solidarité entre le trône et l’autel fut trop étroite et trop apparente, pour que n’en fût pas irritée une opinion publique, foncièrement athée et si ombrageuse que Napoléon lui-même avait eu quelque peine à la désarmer.
De là, sous la Restauration, une opposition vigilante, toujours en armes, systématique comme toute opposition, dénaturant tous les actes du pouvoir pour y découvrir la trace d’un levain religieux menaçant l’indépendance individuelle, et entretenant ainsi l’opinion publique dans un état permanent de suspicion et d’irritation en même temps contre le Gouvernement et contre l’Église.
Vienne une faute politique du pouvoir, offrant une occasion favorable à l’émeute, et celle-ci se déchaînera tout naturellement, en même temps et avec la même violence, contre l’un et l’autre. Le 29 juillet 1830, on pillait, à la même heure, les Tuileries et l’Archevêché.
§
La Monarchie de Juillet était tenue à beaucoup de ménagements vis-à-vis d’une opinion publique à laquelle elle devait son élévation. Le nouveau Souverain, renonçant à tout autre sacre que celui de l’Hôtel de Ville, biffa des actes royaux la formule consacrée par les siècles: «Roi par la grâce de Dieu» et raya de la Charte la phrase énonçant que «la religion catholique est la religion de l’État «.Les Chambres, décidèrent de sièger aux jours des plus frandes fêtes de l’Église. Le Gouvernement supprima le traitement des cardinaux, contrairement aux stipulations du Concordat. Il déclina même la charge, cependant inhérente au pouvoir, d’assurer la sécurité du clergé, et la conservation des monuments religieux. Le 14 février 1831, sept mois après les journées de Juillet, il laissa saccager, sous les yeux de la force publique inactive, l’église St-Germain-l’Auxerrois — qui ne devait être rendue au culte que 7 ans plus tard — et, de nouveau, l’archevêché, que Mgr de Quélen se voyait contraint d’abandonner précipitamment devant la fureur des émeutiers, pour aller chercher un refuge ignoré, rue St-Jacques, dans le couvent des Dames de St-Michel, où il résidait encore en 1834.
Et ces effervescences d’impiété n’étaient pas l’œuvre exclusive d’une populace ignorante; c’est la jeunesse des écoles qui menait la foule à l’assaut, encouragée par la bourgeoisie et par la majorité des classes dites «éclairées». Elles n’étaient pas non plus te privilège de la capitale: les pillages d’églises accompagnés de violence sur la personne des prêtres se multipliaient aux quatre coins de la France: et, de même, les interventions hostiles d’autorités malveillantes, tantôt pour obtenir la suppression ou la réduction d’un traitement d’évêque ou de curé, tantôt pour réquisitionner l’église afin d’y célébrer les funérailles d’un schismatique, tantôt pour imposer subitement, au milieu de l’office, le chant solennel d’une Marseillaise qui ne pouvait attendre.
La prudence interdisait aux prêtres de sortir revêtus du costume ecclésiastique qui les eût exposés aux pires outrages. Même en 1832, pendant l’épidémie de choléra, Lacordaire, alors jeune prêtre, ne pouvait pénétrer, qu’habillé en laïque, dans les hôpitaux où il venait confesser quelque mourant. La consigne donnée par les évêques à leur clergé était de «s’effacer et de se taire». Le nonce avait dû quitter Paris, et c’est seulement en 1843 qu’il y revint. Ozanam, dans sa lettre à M. Dufieux du 6 décembre 1849, parle de «ces huées qui, il y a 20 ans, poursuivaient les fidèles jusque dans l’église.»
Journalistes, littérateurs, professeurs, écrivains, orateurs, tous célébraient à l’envi les funérailles de la Papauté, de l’Église, et de la religion catholique. Henri Heine écrivait: «La vieille religion est radicalement morte: elle est déjà tombée en dissolution: la majorité des Français ne veut plus entendre parler de ce cadavre, et se tient le mouchoir devant le nez quand il est question de l’Église .» Musset traduisait l’état d’âme de son époque dans son apostrophe fameuse:
Dors-tu content Voltaire?...
Il est tombé sur nous, cet édifice immense
Que de tes larges mains tu sapais nuit et jour!
Pour dissiper le malaise qui étreignait les âmes, se présentaient des systèmes ingénieux et variés, à la recherche d’un culte nouveau. Des sectes poussaient et disparaissaient comme des champignons vénéneux. Les disciples de l’abbé Chatel, de Babeuf de Fourier, de Saint-Simon, offraient des religions originales devant lesquelles la foule souriait.
«On eût dit, écrit Thureau-Dangin, une immense chaudière où les idées de toutes sortes, les chimères, les sophismes, les croyances, les passions étaient jetés pêle-mêle, bouillonnaient et fermentaient .» Sainte-Beuve écrivait: «l’Humanité attend; elle se sent mal, c’est un vaste naufrage.» Et Victor Hugo ouvrait ses Chants du Crépuscule par ce cri désenchanté
«De quel nom te nommer, heure trouble où nous sommes?
§
Que pouvait l’Église pour venir au secours de ce peuple désorbité ? Une extrême réserve s’imposait au clergé à raison des suspicions et des hostilités dont il était victime. Un incident modeste, mais bien suggestif, révèle son impuissance. En 1832, au cours de l’épidémie de choléra sévissant sur Paris, son archevêque, Mgr de Quélen, offrit sa propriété de campagne, à Con-flans, pour servir de maison de convalescence. Sa généreuse proposition fut repoussée par le Conseil Général auquel sans doute elle apparut comme une menace d’ingérence cléricale.
Mais «la souche d’où germent la vie et les œuvres de l’Église est indestructible... Coupez, fauchez, essayez de refouler la sève qui en jaillit, vous verrez tout à coup cette sève éclater sur d’autres points en rejetons jeunes et vigoureux .»
Les courtes années de la Restauration avaient permis au clergé catholique de jeter en terre de France une semence qui devait plus tard germer et fleurir.
La «Congrégation» qu’un esprit de solidarité trop étroit devait condamner, avait donné le jour à certaines œuvres destinées à lui survivre. Telles: la société des «Bonnes Œuvres», qui visitait les malades dans les hôpitaux, venait au secours des prisonniers et inaugurait la visite du pauvre à domicile; la société des «Bonnes Etudes,» groupement de jeunes gens se réunissant pour discuter entre eux des questions de littérature, d’histoire ou de philosophie et dont l’animateur était un grand homme de bien: Bailly; la société «St-François Régis» pour la régularisation des unions illégitimes dont l’initiative appartenait à un magistrat distingué : Gossin. Ces œuvres, il est vrai, avaient été emportées par la Révolution de Juillet: plantes trop frêles pour résister à l’orage. Recrutées surtout dans la jeunesse universitaire, elles s’étaient éteintes faute d’aliment, car en 1830, Paris ne paraissait pas sûr, et son atmosphère semblait délétère, aux familles chrétiennes de province, qui se refusaient à lui confier leurs fils.
Cependant, cette jeunesse catholique demeurait, restreinte il est vrai, dispersée, presque invisible, mais susceptible d’être ralliée par des chefs. Or ceux-ci ne tardaient pas à paraître: Bientôt, Lamennais, Montalembert, Lacordaire la groupaient, l’enthousiasmaient, lui rendaient le sentiment de sa force et de ses devoirs. Et du modeste bataillon entraîné par eux se détachait, avec la supériorité éminente du talent et de la foi, un jeune étudiant, arrivant de sa province, qui, avec cinq de ses camarades, allait fonder une toute petite œuvre de charité : «la Société de St-Vincent de Paul.»