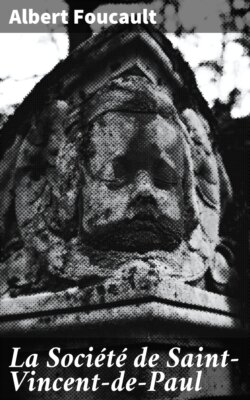Читать книгу La Société de Saint-Vincent-de-Paul - Albert Foucault - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA VIE DE L’ŒUVRE (1840-1844)
ОглавлениеLe besoin d’une autorité supérieure dirigeant effectivement la Société tout entière n’a pas été la seule cause de la création du Conseil Général. Celle-ci a été provoquée aussi — et surtout peut-être —, par la nécessité d’établir un lien entre toutes les conférences, créées et futures, conformément au vœu qui s’élevait de toutes parts.
A ce vœu, comment le Conseil Général a-t-il donné satisfaction? Il s’est efforcé de remédier à l’isolement des conférences par des circulaires présidentielles périodiques, par la diffusion des procès-verbaux de ses assemblées générales, et par la publication d’un rapport annuel.
Comme circulaires, les Conférences n’avaient reçu jusqu’ici que 4 lettres du secrétaire, assez espacées, et tendant surtout à amorcer avec elles une correspondance. Cela ne répondait que faiblement au désir d’Ozanam pressant constamment, dans ses lettres personnelles, son ami Lallier de se faire le tuteur de toutes les conférences existantes. Avec le Conseil Général apparaissent les circulaires du Président Général. œuvre doctrinale tendant à maintenir les Conférences dans une voie uniforme, en leur rappelant sans cesse les principes auxquels elles doivent demeurer fidèles et en leur transmettant les décisions adoptées pour assurer le développement de l’Œuvre dans le cadre tracé.
Les procès-verbaux des assemblées générales deviennent, eux aussi, un lien permanent entre toutes les Conférences, car, d’une part, toutes reçoivent régulièrement un extrait très complet de ces procès-verbaux, et de l’autre, ces assemblées subissent une transformation progressive qui leur donne un intérêt d’ordre plus général.
Aux résumés sommaires présentés jadis par chaque président des Conférences parisiennes, se sont ajoutées d’abord les communications du secrétaire général sur les Conférences de province, accompagnées plus tard de la lecture de quelques lettres émanant d’elles; puis, il est devenu nécessaire de remplacer ces renseignements épars par deux rapports globaux, l’un sur Paris et l’autre sur la province. Mais bientôt, les rapporteurs désignés ne se sont plus contentés de cette tâche ingrate consistant à relever les progrès du recrutement des confrères ou l’importance croissante des recettes et des dépenses. A ces détails un peu trop secs, ils ont ajouté, puis substitué, des sujets particuliers. Et ainsi, s’est accentuée une marche rapide vers la spécialisation des rapports, encouragée par le Conseil Général, puisque aucun d’eux ne peut être lu à l’assemblée générale, sans lui avoir été préalablement soumis.
Cette transformation a eu, pour résultat, d’apporter aux assemblées générales une variété devenue nécessaire pour en assurer l’intérêt. A cette époque, où ils n’atteignaient pas, à Paris, le chiffre de 1.200, les Confrères se rencontraient à ces Assemblées plus nombreux que de nos jours, où l’on en compte plus de 5.000. Le zèle des aïeux se serait-il refroidi chez leurs descendants?
La diffusion des procès-verbaux de ces assemblées générales est un lien constant entre conférences: mais, bien plus encore le rapport annuel qui vient régulièrement, au cours de l’été, trouver non seulement chacune d’elles, et par elle ses membres actifs, et ses membres honoraires, mais aussi les démissionnaires, retirés dans une résidence où ils se trouvent isolés, et où ce touchant souvenir les décide parfois à fonder, dans leur entourage, une conférence nouvelle.
Le premier de ces rapports généraux, qui vont paraître chaque année jusqu’en 1912, fut publié au mois d’août 1842. Il embrasse toute la période écoulée depuis la formation de la «Conférence de Charité » — (mai 1833) — jusqu’au 31 décembre 1841. Les rapports suivants, ne traitent naturellement que de l’exercice écoulé. Ces petits volumes, d’une centaine de pages environ, passent en revue toutes les Conférences, signalent ce que présente d’intéressant la vie de chacune d’elles, examinent ensuite les œuvres entreprises ou suivies par la Société, et fournissent une statistique des confrères, suivie d’un état complet des recettes et dépenses. Les témoignages d’approbation émanant de l’Épiscopat complètent cette revue annuelle. Rapports et procès-verbaux établissent un courant d’activité charitable, transmettant les pulsations de ce corps jeune et vigoureux qu’est la Société, et éveillant nécessairement une émulation féconde.
Comment telle conférence, à ses premiers pas, ne se sentirait-elle pas tressaillir d’ambition en voyant une de ses sœurs parisiennes compter 140 confrères et secourir 270 familles, et telle autre dont chaque membre visite hebdomadairement 8 ou 10 familles? Chaque conférence connaît, par la lecture de ce rapport, d’un côté, les œuvres nombreuses qui se multiplient: patronages, apprentissage, militaires, détenus, placement, hospitalisation, cours de catéchisme, de religion, d’instruction générale, bibliothèques, diffusion de bonnes lectures, etc., et de l’autre, les résultats obtenus: régularisations d’unions illégitimes, légitimations d’enfants voyant effacer la tache de leur état civil, baptêmes tardifs, premières communions et confirmations d’adultes, conversions d’israélites, de protestants ou de catholiques brouillés depuis de longues années avec la loi du Christ, derniers sacrements sollicités et reçus avec ferveur par de vieux pécheurs récalcitrants auxquels on a facilité leurs derniers pas sur les chemins de l’éternité : C’est tout cela que chaque confrère apprend dans le coin le plus reculé de sa province, c’est tout cela qui éveille en lui les nobles ambitions du dévouement et du don de soi-même. Comment trouverait-on lien plus éloquent?
§
On ne saurait être surpris, dans ces conditions, du développement rapide de l’œuvre, de la vitalité des Conférences, de leur esprit d’initiative. A Paris 33 d’entre elles, alimentées par un budget d’environ 100.000 fr., et comprenant 1.177 membres actifs, secourent 2.900 familles et patronnent 1.500 enfants. En province, voici la conférence de Colmar qui, un an après sa fondation, compte déjà 54 membres et secourt 180 familles: celle de Moulins, en 8 mois, a su grouper 57 confrères; celle de Valenciennes après sept mois d’existence, visite 200 familles et a régularisé déjà 36 unions illégitimes; celle de Nantes compte 150 confrères actifs, soutenus par 136 membres honoraires et consacre à 260 familles un budget annuel de plus de 20.000 fr.; celle de Metz, aux ressources non moindres, secourt 322 familles formant un total de 1.053 indigents; celle de Nancy a 86 membres actifs visitant 400 familles; celle de Toulouse 145 Confrères et 577 familles, celle d’Angers procure du travail à domicile, en leur donnant à filer, à 492 femmes. Et à côté de ces conférences prospères, combien touchantes ces sœurs modestes qui naissent soit dans les établissements d’instruction secondaires à Yzeure, à Felletin, à Montolieu, à Nantes, à Poitiers, soit, et plus encore, dans de petites communes rurales comme Troissy et Vincelles, au diocèse de Châlons, qui ne comptent respectivement que 800 et 500 habitants, Quintin près de St-Brieuc, St-Jean. sur Mayenne, aux environs de Laval, Beaumont le Ronce, au diocèse de Tours, les Touches et Nort, au diocèse de Nantes.
Et que d’œuvres entreprises par ces Conférences hantées du souci de porter remède à toutes les misères! Parmi ces -œuvres, certaines ont disparu, soit parce qu’elles ne répondaient plus à aucun besoin, soit parce qu’elles se sont fondues dans des œuvres spéciales indépendantes de la Société. Mais combien d’autres, dont la création remonte à cette époque lointaine, se sont perpétuées; combien, après une éclipse plus ou moins longue, ont été reprises par des conférences qui croyaient les créer et ne faisaient que les ressusciter, combien de germes se sont épanouis plus tard, en fondations importantes.
Les œuvres de patronage, d’apprentissage, de placement, de caisses de loyers, les vestiaires, les ouvroirs, la diffusion des bonnes lectures et des almanachs, les bibliothèques adoptées, dès cette époque, par la plupart des conférences, n’ont jamais cessé d’être pratiquées. Mais à côté d’elles, voici l’œuvre de la visite dans les hôpitaux, et l’œuvre des prisons adoptées déjà, dans certaines villes, comme Toulon et Caen, qui subiront une longue éclipse. D’autre part, l’origine des secrétariats de famille, on la trouve dans l’installation à Tours dès 1841, d’un bureau où chaque dimanche, quelques confrères reçoivent les pauvres, «écoutent leurs demandes, leurs plaintes, leurs réclamations, et, d’après les renseignements donnés, rédigent les pétitions, les lettres, et autres actes qu’ils jugent nécessaires» — l’origine des maisons du peuple, la voici dans les magasins organisés la même année à Montpellier, pour acheter en gros et fournir au prix coûtant les denrées et les vêtements nécessaires aux indigents, — l’origine de l’œuvre des «logements» ouvriers, n’est-ce pas la construction en 1842 par la Conférence de Lille de maisons à loyers réduits permettant de soustraire les familles visitées aux dangers du taudis? Est-il téméraire de songer aux Cercles Catholiques d’ouvriers en voyant prospérer à Lille et à Tourcoing l’œuvre de St-Joseph ouvrant chaque dimanche à 600 travailleurs un lieu de réunion où ils trouvent, en plus des exercices du culte, «des jeux, des rafraîchissements, des instruments de musique? »
La variété de ces œuvres montre l’activité intense et progressive de la Société à cette époque. On sent tout l’élan d’un corps jeune, sain, vigoureux, dans lequel la vie surabonde.
§
Le rôle important joué par le Conseil Général pendant ces trois années et demie si bien remplies ne fut pas, naturellement, sans entraîner pour lui quelques soucis: mais il lui procurait aussi des satisfactions profondes.
Un regard jeté sur sa vie interne révèle les embarras au milieu desquels se débattait son service financier. Le secrétariat général avait à faire face à des charges relativement lourdes: loyer, personnel, frais de correspondance, frais d’impression surtout, nécessités par l’envoi des règlements, des circulaires, des procès-verbaux d’assemblées générales, des rapports annuels, etc... et quoique l’on eût pris soin de répartir quelques-unes de ces charges entre lui et le Conseil de Paris, qui demeurait dans le même local, il n’en avait pas moins à supporter des dépenses assez élevées. D’autre part, les Conférences de province dont les ressources étaient insuffisantes — et c’était le cas de beaucoup d’entre elles à leur naissance — sollicitaient des subventions que le Conseil Général n’avait guère le courage de refuser. Il ne pouvait pas davantage repousser les indigents de passage, qui, munis de la recommandation d’une conférence de province, venaient frapper à sa porte.
Or, aucune ressource régulière n’avait été prévue pour faire face aux dépenses du Conseil Cénéral. Tandis que le Conseil de Paris avait trouvé le moyen d’alimenter sa caisse en obtenant de ses conférences le prélèvement d’un dixième consenti spontanément par les conférences parisiennes sur leurs recettes extraordinaires, aucune source à laquelle elle put aller puiser régulièrement n’avait été réservée à la Caisse du Conseil Général. Celui-ci, pour subvenir à ses besoins, en était réduit à donner, chaque année, un sermon de charité qui était pour lui l’occasion de gros soucis, et ne lui rapportait qu’une somme insuffisante pour faire face à ses besoins. En fait, sa trésorerie était toujours défaillante, De temps à autre quelqu’un de ses membres présentait une proposition tendant à lui assurer des ressources normales. Mais ces propositions échouaient invariablement devant la répugnance instinctive de ces hommes, qui, réunis pour organiser la charité, ne pouvaient se résigner à détourner, pour satisfaire à des exigences administratives, une part, si minime fût-elle, des sommes recueillies pour soulager la misère. A peine le Conseil Général consentait-il à laisser parfois soupçonner sa détresse, et recevait-il, de temps à autre, quelques offrandes volontaires de Conférences informées et touchées de son dénuement: Maigres ressources bien vite épuisées! En vérité, il demeurait, bien réellement, le Conseil Général de la Pauvreté.
Ce souci pécuniaire n’était pas le seul qu’il connût. L’immeuble de la place de l’Estrapade qui avait été le berceau de la «Conférence de Charité » était demeuré le siège de la Société. C’est là qu’étaient installés les bureaux du secrétariat général et du Conseil de Paris — là que, chaque semaine se réunissaient les deux Conseils — là que se tenaient quatre fois par an, dans le grand amphithéâtre, les assemblées générales. Or, en 1843, l’immeuble fut vendu par son propriétaire à des acquéreurs qui se proposaient de le démolir: la Société fut dans la nécessité de déguerpir.
Mais où aller? Encore bien que la crise du logement fût inconnue à cette époque, il n’était pas facile de trouver un immeuble pouvant satisfaire à tous les besoins de pareil locataire. Une commission spéciale s’y employa sans succès pendant plusieurs mois: il fallut séparer les services. Les secrétariats trouvèrent à se loger provisoirement, tant bien que mal, et plutôt mal que bien, 37, rue de Seine, où ils demeurèrent 18 mois: les Conseils acceptèrent avec reconnaissance, quoiqu’elle fût nécessairement assez incommode pour eux, l’hospitalité temporaire que voulut bien leur offrir le curé de St-Sulpice dans les dépendances de son église. C’est seulement au cours de l’année 1845 que Conseils et secrétariats se trouveront réunis à nouveau, 8, rue Garancière, dans un local où ils demeureront jusqu’au 15 juillet 1854.
Quant aux assemblées générales, après de longues recherches infructueuses, une démarche auprès de la commission générale des Hospices de Paris, propriétaire d’un vaste amphithéâtre au parvis Notre-Dame, fut favorablement accueillie; et c’est là qu’elles se réunirent depuis le mois de décembre 1843 jusqu’en 1848, date à laquelle il leur fallut chercher asile à leur tour dans les dépendances de l’église St-Sulpice.
§
Cependant ces petits soucis de la vie quotidienne s’effaçaient devant les satisfactions que le Conseil Général trouvait dans l’accomplissement de sa tâche. A côté des progrès de l’œuvre, il avait la joie de recevoir des approbations, des encouragements, des concours d’autant plus précieux qu’ils étaient souvent imprévus.
Si quelques autorités civiles s’étaient, au début, montrées hostiles, d’autres, estimant à leur valeur les services que pouvait rendre une Conférence de St-Vincent de Paul, n’hésitaient pas à les utiliser. A Paris, dès la fondation de la «Conférence de Charité » le bureau de bienfaisance du XIIe arrondissement avait appelé à lui quelques-uns de ses membres: et cet exemple fut suivi dans plusieurs villes de province. Bien plus, lors des inondations du Rhône, en 1840, le préfet de Lyon n’hésita pas à confier aux Conférences établies dans cette ville le soin de répartir entre les malheureux sinistrés du faubourg de Vayse, les six cent mille francs de secours officiels qui lui avaient été concédés pour eux. D’autre part, un peu partout, des maires, des préfets favorisaient l’éclosion et facilitaient la tâche des conférences, leur apportant personnellement leur concours pécuniaire, allant même parfois jusqu’à demander leur inscription comme membres honoraires. Il arrivait que des municipalités, des conseils généraux, des ministères même, octroyaient des subventions pour les œuvres annexes fondées par les Conférences. Celle du Havre par exemple, avait obtenu du Ministère de l’Instruction publique, pour la création de ses deux salles d’asile, deux subventions successives de 4.500 fr. et de 4.000 fr. en même temps qu’une allocation annuelle de 1.000 fr. du Conseil Municipal. Partout où se fondait une œuvre de militaires, c’était du consentement et avec le concours des chefs de corps qui souvent lui apportaient l’encouragement de leur présence aux cérémonies solennelles comme la première communion ou la confirmation de leurs soldats. A Paris, le Conseil Général entretenait les plus courtoises relations avec les deux préfets et le Ministre de l’Intérieur, auxquels il envoyait, d’ailleurs, ses rapports annuels. La Cour, elle-même, lui manifestait ses dispositions bienveillantes, et il avait eu sa part dans les largesses dont la naissance du Comte de Paris avait été l’occasion. Le Roi, la Reine, les princes royaux répondaient volontiers à l’appel qui leur était adressé par certaines conférences de Paris ou de province: le duc d’Aumale, passant à Rome, avait été rendre visite à la Conférence de St-Vincent de Paul, et lui avait laissé une généreuse offrande. Que de chemin parcouru en dix ans!
Mais ce que la Société avait ambitionné par-dessus tout, et cela dès ses premiers pas, c’était l’approbation et la faveur du clergé. Celui-ci, au début, s’était quelque peu réservé, surpris par cette nouveauté d’un apostolat laïque se poursuivant à côté et en dehors de lui. Mais bientôt s’était produit une évolution aussi heureuse que rapide: l’épiscopat fut vite conquis.
A Paris, l’archevêque prodiguait à la Société les témoignages de sa haute estime, parlant d’elle avec éloges dans ses mandements d’intronisation et de carême, présidant fréquemment ses assemblées générales, lui donnant pour conseil ecclésiastique un de ses prêtres les plus estimés, son promoteur, l’abbé Buquet, directeur du collège Stanislas, dont il allait faire incessamment un de ses vicaires généraux, confiant enfin à la Société le soin de procéder aux enquêtes nécessaires pour éclairer sa charité sur les demandes de secours qui lui étaient quotidiennement adressées, et reconnaissant ce léger service en la comprenant dans son budget d’aumônes.
En province, c’est avec le concours des évêques et souvent même sur leur initiative, que se fondaient la plupart des conférences nouvelles. Et ce n’est pas seulement une approbation théorique que Nos Seigneurs apportaient à l’Œuvre, c’est un concours effectif, demandant eux-mêmes au siège social les documents nécessaires pour la fondation d’une Conférence, offrant un salon de leur palais épiscopal pour tenir les séances, présidant les réunions solennelles, célébrant la messe des fêtes annuelles, prononçant eux-mêmes le sermon de charité devant alimenter la caisse, apportant personnellement un concours pécuniaire, et s’inscrivant parfois sur la liste des membres honoraires.
Sans doute l’envoi régulier du rapport annuel, accompagné d’une lettre manuscrite, à tous les évêques de France, contribuait à entretenir et à développer cette haute bienveillance. Mais elle s’explique mieux encore assurément par le nombre des vocations ecclésiastiques qui se déclaraient au sein des conférences et qui en faisaient une véritable pépinière sacerdotale: le rapport de 1843 constate que la Société a donné 110 de ses confrères au clergé de France!
Et voici que pour couronner cette extrême bienveillance de l’épiscopat, l’Œuvre trouve un accueil riche d’espérance dans la capitale du monde chrétien, auprès du Souverain Pontife lui-même, qui veut bien agréer avec une bonté toute particulière les premières démarches faites auprès de lui pour obtenir des faveurs spirituelles au profit de ses membres. Déjà paraît à l’horizon l’aurore de cette récompense rêvée depuis longtemps par Ozanam et qui ne tardera plus guère: un bref apostolique consacrant la Société de St-Vincent de Paul, lui apportant les bénédictions spéciales du Souverain Pontife, et accordant à ses membres l’inestimable faveur de nombreuses indulgences.
Cette faveur, cependant, ce n’est pas Bailly qui va la recueillir. Dans sa circulaire du 1er mars 1844, il écrivait: «Il n’est pas toujours bon que la direction d’une œuvre chrétienne demeure éternellement aux mêmes mains: elle court alors le danger de se personnifier dans ses chefs et de ne vivre tout au plus que leur vie d’homme... c’est ce qui nous a fait insister plusieurs fois auprès de nos confrères pour que nous fussions remplacés dans les fonctions que nous avons remplies nous-même jusqu’à ce jour: l’intérêt bien entendu, l’avenir de notre chère Société les appelle depuis longtemps en d’autres mains.»
De gros soucis personnels vinrent bientôt confirmer chez Bailly la résolution d’abandonner la présidence, et le 9 mai 1844, au cours de la séance du Conseil Général, il donnait officiellement sa démission, résignant ses pouvoirs aux mains des deux vice-présidents généraux: Ozanam et Cornudet. Ozanam, prenant possession du fauteuil, exprimait l’émotion du Conseil devant la décision prise par son président, priait ses confrères de bien vouloir, pour l’instant, la garder secrète, et ajournait à huitaine la continuation de la séance. Pour la première fois, allait jouer la procédure, assez complexe, prévue par le règlement, pour l’élection d’un Président Général.
A la huitaine suivante, la séance s’ouvrait en l’absence de Bailly, sous la présidence d’Ozanam. Le Conseil décidait d’accepter la démission donnée et d’insister auprès de Bailly pour qu’il voulût bien, du moins, demeurer membre du Conseil Général; puis il nommait une commission administrative, composée du bureau et de trois autres membres, chargée d’assurer les services jusqu’à l’entrée en fonctions d’un nouveau Président Général. Enfin, Bailly survenant, Ozanam lui faisait part des décisions prises, le remerciait des services par lui rendus à la Société, et le priait, conformément aux dispositions de l’article 40 du règlement, de bien vouloir désigner le confrère qu’il croyait opportun d’élire en son lieu et place. Bailly indiqua Léon Cornudet, vice-président général. Cette proposition n’était pas sans causer quelque embarras au Conseil, car Léon Cornudet, maître des requêtes au Conseil d’État, ne pouvait accepter la charge à lui proposée, ses fonctions ne lui laissant pas les loisirs nécessaires. Ozanam, sollicité par ses confrères, se trouvait dans le même cas, étant absorbé par ses devoirs de professeur en Sorbonne. C’est alors que Le Prévost proposa Gossin, membre de la Conférence St-Sulpice, et président de la Société St-François Régis, fondée par lui 20 ans plus tôt. C’était un homme d’œuvres connu et considéré de toute la France catholique.
La majorité des voix nécessaire pour la désignation du candidat avait été fixée aux deux tiers des membres du Conseil, soit 9 bulletins sur 13. Le vote auquel il fut procédé le 21 mai donna à Gossin 11 voix, auxquelles les deux voix dissidentes se rallièrent immédiatement afin de lui assurer l’unanimité, et dès le lendemain le Conseil se rendait en corps auprès de lui pour le prier d’accepter la désignation dont il était l’objet.
Gossin refusa, considérant comme son devoir de demeurer exclusivement consacré à la direction de la Société St-François Régis, à laquelle il avait sacrifié déjà, 4 ans plus tôt, sa fonction de vice-président de l’œuvre de la Propagation de la Foi. Le Conseil Général insista, lui demandant de réfléchir et de consulter avant de prendre une décision définitive. Les instances du R. P. de Ravignan, avec lequel il avait noué jadis, lorsque tous deux siégeaient à la Cour de Paris, des relations intimes, celles de l’archevêque de Paris lui faisant dire par son grand vicaire, l’abbé Buquet, «qu’il descendait envers lui, jusqu’à la prière», finirent par triompher de sa résistance, et le 31 mai, il cédait au vœu du Conseil Général.
Une circulaire, signée des deux vice-présidents et du secrétaire, fut adressée à tous les présidents de Conférences pour leur communiquer la lettre de démission de Bailly, la désignation par le Conseil Général de Gossin, et la lettre d’acceptation de ce dernier, et pour les inviter, conformément au règlement, à communiquer ces pièces à leurs confrères, à prendre leur avis et à transmettre celui-ci au secrétariat général avant le 10 juillet, leur rappelant en outre, que jusqu’à consommation de l’élection, toutes les conférences devaient réciter le Veni Creator à chacune de leurs séances afin d’appeler sur l’importante décision qui allait être prise les bénédictions de l’Esprit-Saint.
Cent seize Conférences répondirent, dont cent onze pour approuver le choix du Conseil Général, de sorte que le 23 juillet, celui-ci pouvait déclarer l’élection consommée. Trois jours plus tard, Gossin tenait sa première assemblée générale sous la présidence de l’archevêque de Paris.