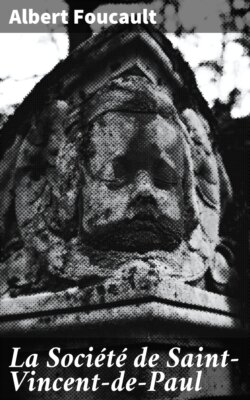Читать книгу La Société de Saint-Vincent-de-Paul - Albert Foucault - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE BREF APOSTOLIQUE (1845)
ОглавлениеGossin était l’homme d’œuvres par excellence, et son choix était des plus heureux.
Il n’appartenait à la Société que depuis six mois, c’est vrai, mais dès son entrée à la Conférence St-Sulpice, Bailly, sachant sa valeur, lui avait offert au Conseil Général une place qu’il avait déclinée en invoquant son incompétence, mais qui lui demeurait réservée pour un avenir prochain.
Fils de l’ancien lieutenant général du Baillage de Bar, député aux États Généraux et procureur général, syndic de la Meuse, qui, pour avoir protesté contre l’exécution de Louis XVI avait été, le 22 juillet 1794, condamné à mort, exécuté à la barrière du Trône, et inhumé au cimetière de Picpus, il était entré lui-même dans la magistrature, et y avait fait, sous la Restauration, une rapide et brillante carrière. Lorsque survint la Révolution de 1830, ne voulant pas prêter serment au nouveau souverain, il était descendu de son siège et s’était fait inscrire au barreau de Paris.
Depuis près de 20 ans, il consacrait ses loisirs aux œuvres les plus variées: Société St-François Régis dont il avait été le fondateur en 1825, et dont il était demeuré le très actif président, Œuvres de la visite des hôpitaux, des prisons, des jeunes détenus, des prisonniers pour dettes; de la Propagation de la Foi, dont il avait été le vice-président, etc. Ainsi avait-il acquis une expérience précieuse en même temps qu’une certaine notoriété dans les milieux charitables, de telle sorte que le Conseil Général, en présentant sa désignation à la ratification des Conférences, pouvait écrire à juste titre que M. Gossin était un homme «dont la sagesse consommée et les hautes vertus avaient, depuis longtemps, fixé l’estime publique, et dont le nom était connu des pauvres, aimé des catholiques, et respecté de toutes les opinions.»
Dès sa désignation, Gossin s’était plongé dans une étude minutieuse du passé de la Société, et son esprit fort délié avait perçu rapidement, non pas seulement la nature, le caractère, l’esprit de l’Œuvre qu’il importait essentiellement de maintenir, mais aussi les améliorations qui pouvaient être introduites dans le fonctionnement de sa direction générale. Et dans son discours d’installation à l’assemblée générale du 25 juillet 1844, il marquait, avec une certaine légèreté de touche, cette double tendance qui devait inspirer l’exercice de sa présidence. Tout en rendant hommage aux services rendus à l’Œuvre par son prédécesseur, à «l’action habilement circonspecte de son autorité, à son rôle de modérateur, au lent et froid accueil qu’il faisait à toute proposition de nouveautés », et en proclamant que cela lui avait permis de «préserver la Société des périls qui entouraient son berceau» il laissait entendre implicitement que ces périls ne lui semblaient plus aussi redoutables.
L’évolution qui lui paraissait désirable dans la direction de l’Œuvre avait l’approbation du Conseil Général, peu à peu renouvelé, complété, rajeuni et qui lui apportait un précieux concours . Elle exigeait cependant une certaine prudence, car l’élection même de Gossin avait révélé, chez quelques-unes des plus anciennes conférences de province, un esprit d’indépendance qu’il importait de ménager. Ces Conférences, protestant contre le rôle prépondérant du Conseil Général dans l’élection du Président, avaient refusé d’y prendre part. L’incident allait même se prolonger par une attitude de froide réserve qui dura plusieurs années, et ne céda que devant la charitable mansuétude du père de famille vis-à-vis de ses filles aînées. Le fait était à retenir pour un chef circonspect comme Gossin; il lui rappelait combien étaient fragiles les assises sur lesquelles reposait alors l’autorité du Conseil Général et de son Président.
C’est qu’en effet, le premier Président Général, Bailly s’était nommé lui-même; il avait ensuite, à lui seul et sans consulter quiconque, désigné les membres du Conseil Général; et par conséquent ni l’un ni les autres ne pouvaient se réclamer de la moindre délégation, du moindre mandat émanant de leurs confrères. Gossin, il est vrai, avait été choisi, lui, par les membres du Conseil Général, dont la proposition avait été soumise, conformément au règlement, à l’unanimité des Conférences. Mais la résistance de quelques-unes, et non des moindres, suffisait pour attirer son attention sur la précarité du pouvoir centralisé entre ses mains et celle du Conseil. La prudence lui commandait de rassurer les conférences sur le caractère de son autorité. Dans sa première circulaire (15 août 1844) il écrivait: «A Dieu ne plaise que nous entendions vous imposer jamais aucun joug, vous soumettre à aucune loi, vous astreindre à aucune servitude. Mais dans l’occasion, nous vous expliquerons, et en toute simplicité, le Conseil et moi, ce que nous croirons entrer le mieux dans l’esprit de notre chère Société : la charité qui nous dictera nos paroles, sera aussi en vous pour les accueillir.» Il était vraiment impossible, pour un chef, d’être plus discret. Mais voici qu’un événement de haute importance, allait donner à son autorité des assises plus solides, précisément à l’heure où, dans quelques cas, exceptionnels il est vrai, elle allait avoir à s’exercer.
§
On a vu que, dès novembre 1838, Ozanam avait proposé au Conseil de direction de solliciter du Souverain Pontife Grégoire XVI, un bref accordant des indulgences spéciales aux membres de la Société, et que sa suggestion avait été écartée.
Deux ans plus tard, la conférence de Nîmes, à peine reconstituée, avait fait à Rome, à l’insu du Conseil, et pour son compte personnel, des démarches en vue d’obtenir cette même faveur. Dès sa première séance (31 janvier 1841), le Conseil Général, enfin constitué, s’était ému de cette initiative locale, et avait invité la conférence de Nîmes à suspendre ses négociations auprès de la Cour de Rome. Nîmes s’inclina: mais le prélat romain qui avait bien voulu se charger de sa requête, répondit que le dossier était engagé dans la filière des bureaux de l’administration pontificale, qu’il n’était plus en son pouvoir de l’arrêter dans sa course, et que la seule chose encore possible était de demander l’extension aux conférences parisiennes des faveurs spirituelles sollicitées par la Conférence de Nîmes.
Le Conseil Général, mesurant de suite l’étendue de la faute commise en 1838, résolut de tout faire pour ressaisir, au bénéfice de la Société tout entière, la direction des négociations en cours, et chargea de cette mission diplomatique un de ses membres, le Vte de Melun, qui se rendait à Rome au mois d’août 1841. Il arrivait malheureusement un peu tard, juste à point pour apprendre que la requête de Nîmes avait été favorablement accueillie. Cependant, d’une part, le Saint Père n’avait concédé aux confrères de Nîmes que des indulgences partielles, sous des conditions, d’ailleurs assez restrictives: d’autre part, cette concession n’avait pas encore été promulguée: on pouvait obtenir qu’elle demeurât inopérante, et reprendre la question pour solliciter des faveurs plus larges et plus générales au profit de la Société tout entière.
Le Conseil Général saisit de la question Mgr Affre, archevêque de Paris, dont l’entremise lui avait été signalée comme utile. Mais l’affaire traîna dans les bureaux de l’administration archiépiscopale pendant près d’une année, à telle enseigne qu’au mois d’août 1842, le représentant à Rome du Conseil Général invitait celui-ci à se hâter en lui signalant que plusieurs conférences, suivant l’exemple donné jadis par celle de Nîmes, avaient pris l’initiative de formuler des demandes individuelles. Au mois de mars 1843 de Baudicour, secrétaire général, partit pour Rome, et au cours d’un séjour de trois mois dans la ville éternelle, engagea et suivit les démarches nécessaires pour introduire au nom du Conseil Général, et au bénéfice de toutes les Conférences placées sous sa direction, une requête officielle. Celle-ci soulevait quelques difficultés à raison de la généralité des faveurs sollicitées et du caractère essentiellement laïque de l’Œuvre, qui ne pouvait être considérée ni comme une congrégation, ni comme une confrérie.
Une fois la cause introduite et en bonne voie, de Baudicour revint à Paris, confiant la suite des négociations au Bon de Bock, président, à Rome, de la Conférence des étrangers. Celui-ci les poursuivit avec intelligence et dévouement, si bien que par un bref daté du 10 janvier 1845 Grégoire XVI octroyait à la Société un ensemble de faveurs spirituelles comblant tous ses vœux.
Ce bref accorde, aux conditions ordinaires de confession et de communion préalables, une indulgence plénière, reversible au bénéfice des âmes du purgatoire, non seulement aux membres du Conseil Général et des divers Conseils institués par lui, mais encore, à tous les membres actifs des Conférences d’abord au jour de leur réception, ou de leur promotion à une fonction différente; puis, aux quatre fêtes annuelles de la Société, pourvu qu’ils assistent à la messe célébrée pour elle à cette occasion ainsi qu’à son assemblée générale; — ensuite, une fois par mois, au jour choisi par eux, pourvu qu’ils aient assisté à toutes les séances du mois, ou tout au moins à trois sur quatre, du groupement auquel ils appartiennent; — enfin, à l’article de la mort; cette dernière au bénéfice de toute personne appartenant à la Société à quelque titre que ce soit.
Et l’octroi de ces indulgences si largement dispensées est combiné de telle sorte que le confrère appartenant en même temps à une Conférence, à un Conseil particulier, à un Conseil central, peut bénéficier de l’indulgence mensuelle en chacune de ses trois qualités.
De même en est-il des indulgences partielles de sept ans et sept quarantaines attachées par le bref apostolique, sans considération cette fois de confession et de communion préalables, à tous les actes professionnels du confrère de St-Vincent de Paul: assistance à la séance de son Conseil, de sa conférence ou de toute autre réunion: — visite du pauvre à domicile, de l’enfant à son école, de l’apprenti ou de l’ouvrier à son atelier, du malade à son hôpital, du condamné dans sa prison; — assistance à la messe de requiem dite pour le repos de l’âme d’un confrère, ou présence au convoi mortuaire d’un indigent secouru. Tout cela est nettement et expressément formulé dans le bref du 10 janvier 1845.
§
L’octroi de ce bref généreux accordant à la Société et à ses œuvres une si haute et si complète consécration, était pour elle un événement capital. Le Conseil Général était mieux placé que quiconque pour en apprécier toute la portée et mesurer son retentissement probable sur l’avenir. Il lui appartenait de donner à ce document la plus rapide et la plus grande publicité possible.
Il ne pouvait être promulgué dans aucun diocèse sans être accompagné d’une ordonnance d’exequatur émanant de l’évêque. En conséquence il fut immédiatement imprimé : chaque exemplaire fut revêtu d’une mention attestant son authenticité et signée par le Nonce du Saint-Siège, revenu depuis peu reprendre ses fonctions diplomatiques auprès du Gouvernement français; ainsi complété, il fut adressé à chacun des membres de l’épiscopat, accompagné d’une lettre autographe du Président Général sollicitant l’agrément du prélat; et quelques semaines s’étaient à peine écoulées que presque tous les évêques de France avaient accordé leur exequatur, souvent même dans les termes les plus flatteurs pour la Société.
En même temps, le Conseil Général demandait à l’archevêché de Paris une instruction commentant le bref apostolique, et celui-ci, accompagné des ordonnances d’exequatur et de l’instruction approuvée par l’abbé Dupanloup, alors vicaire général de Paris, était adressé à Messieurs les curés et aux présidents de toutes les Conférences existantes, en même temps qu’annexé au Rapport annuel de l’année 1844 qui n’avait pas encore paru.
Une messe solennelle d’actions de grâces était célébrée et une lettre officielle de remerciements était adressée au Bon de Bock pour le concours précieux apporté par lui aux négociations de la Société avec la Cour Romaine: et quelques semaines plus tard, lui était envoyée, en témoignage de gratitude, une relique de saint Vincent de Paul accordée, dans ce but, par les Pères Lazaristes.
Le Conseil Général, au surplus, ne devait pas tarder à faire appel de nouveau au dévouement charitable et aux capacités dïplomatiques du Bon de Bock. Le bref faisait une part très restreinte, dans ses largesses, aux membres honoraires et aux bienfaiteurs de l’Œuvre. Les premiers ne Lénéficiaient que de l’indulgence plénière accordée à l’occasion des 4 fêtes annuelles de la Société, et de l’indulgence. «in articulo mortis» et celle-ci, seule, profitait aux bienfaiteurs. Or, cette dernière catégorie est la seule à laquelle, dans la Société, puissent appartenir les femmes, dont le concours pécuniaire, souvent si précieux, méritait assurément gratitude.
Le Bon de Bock reprit son rôle de négociateur et obtint, à la date du 12 août 1845, un bref complémentaire dans lequel le Souverain Pontife accordait à tous ceux, quel que soit leur sexe, qui s’engageraient à une aumône fixe et régulière, une indulgence mensuelle, soit plénière, soit de sept ans et sept quarantaines, soit d’un an seulement, suivant que cette aumône serait adressée au Conseil Général, à un Conseil provincial ou particulier, ou à une Conférence. En outre, une indulgence de sept ans et sept quarantaines était accordée mensuellement à toute personne quêtant au profit du Conseil Général, ou d’un Conseil provincial ou particulier, le jour et par le fait même de la quête. Ainsi les membres honoraires, les bienfaiteurs et bienfaitrices, bénéficiaient de faveurs nouvelles venant s’ajouter à celles qui leur avaient été précédemment octroyées.
Ce second bref, comme celui qu’il complétait, fut soumis à l’exequatur des Évêques, commenté par le vicaire général Dupanloup, distribué au clergé et aux Conférences, et publié avec le rapport annuel de 1844.
Cette procédure donna même naissance à un petit incident qui ne fut pas sans causer une légère émotion, d’ailleurs passagère, au Conseil Général: S. Em. le Cardinal de la Tour d’Auvergne, évêque d’Arras, qui avait accordé très volontiers son exequatur au bref apostolique du 10 janvier, la refusa tout net au bref complémentaire du 12 août. Le Président Général, quelque peu troublé, s’en vint soumettre le cas au Nonce apostolique, qui calma de suite son inquiétude en lui apprenant que la seule conséquence de ce refus serait l’impossibilité de publier ce bref complémentaire dans les églises du diocèse d’Arras, mais qu’il n’empêchait point les fidèles de bénéficier des faveurs accordées, dans ce ressort épiscopal aussi bien que dans tout autre.
L’octroi de ces grâces, tombant comme une manne bénite sur tous les membres de la Société, était pour celle-ci un événement considérable non pas seulement en soi, mais encore à raison des termes du bref qui les accordait. Celui-ci révélait une étude et une connaissance complète de l’Œuvre, de son but charitable, de son caractère essentiellement laïque, de son organisation, de sa hiérarchie, et de chacune des œuvres actuellement pratiquées par elle. Et c’est tout cela qui recevait une consécration solennelle, aux yeux du monde catholique tout entier, du père commun des fidèles. D’autre part, en réservant le privilège de ces faveurs aux seuls conseils institués, aux seules Conférences agrégées par le Conseil Général, le Souverain Pontife investissait officiellement celui-ci d’une autorité mondiale, et assurait définitivement cette unité de l’Œuvre tant désirée par ses fondateurs et quelquefois menacée. Bientôt connue de la catholicité tout entière, cette bénédiction souveraine accordée au début même de la présidence Gossin, et qui devait en demeurer l’événement le plus mémorable, allait avoir d’importantes conséquences.
§
Cette présidence n’a duré que 3 ans et 3 mois (23 juillet 1844 1er novembre 1847). Ce fut une belle période de croissance pour la Société. Lorsqu’au mois de novembre 1847, Gossin, atteint dans sa santé, se vit obligé de résigner ses fonctions, Ozanam, vice-président général, écrivait dans la lettre qu’il lui adressait, au nom de la Société, pour le remercier des services par lui rendus: «Le 23 juillet 1844, au moment où vous preniez la conduite de la Société, elle comptait 5 conseils et 144 conférences... aujourd’hui, vous laissez 26 conseils et 369 conférences dont 94 à l’étranger.» Ainsi donc 21 nouveaux conseils institués et 225 nouvelles conférences agrégées voilà le bilan de ces trois années.
Ce qui frappe tout d’abord, pendant cette période, c’est l’expansion de l’Œuvre à l’étranger. Alors qu’au mois de juillet 1844, elle ne possédait au delà des frontières de France que 3 conférences: (2 à Rome, et 1 à Nice) voici qu’en novembre 1847, elle en compte 94. Comment ne pas relier cette croissance subite à la consécration solennelle que vient de lui accorder le Souverain Pontife?
Devant elle, s’est inclinée la Belgique, soumettant enfin à l’obédience du Conseil Général les 10 conférences précédemment existantes sur son territoire, auxquelles 14 autres se sont successivement ajoutées au cours de ces trois années, de telle sorte qu’en 1847 la Belgique compte au total 24 conférences secourant plus de 2.000 familles.
A cette conquête s’ajoute celle de l’Angleterre. Le rapport annuel publié en 1844, parlant de la Conférence de Boulogne-sur-Mer, dit à ce sujet: «De toutes les œuvres de la Conférence, la plus glorieuse, parce qu’elle doit être la plus féconde en résultats, c’est la fondation de la Conférence de Londres. C’est à Boulogne, en effet, qu’un jeune Anglais, protestant récemment converti, amené par un de nos confrères à une des réunions de la conférence, apprit à connaître et à aimer l’Œuvre de St-Vincent de Paul. Il en porta dans son pays l’esprit et les règlements, et peu de temps après, nos confrères ont appris la fondation d’une conférence de l’autre côté du détroit.»
Ce que ne dit pas le rédacteur, de Baudicour, c’est le concours très utile qu’il apporta lui-même à ce jeune Anglais, en se rendant à Londres pour assurer la création nouvelle, dont la vitalité fut telle qu’au mois de novembre 1847, l’Angleterre comptait 17 conférences. Notre jeune Anglais avait été cet «homme graine» que, plus tard, le Président Baudon rêvait de rencontrer en tous pays.
L’Irlande était animée d’une même ferveur. N’est-elle pas l’ «Ile des Saints?». La première Conférence fut fondée à Dublin, au mois de février 1845. Dix mois après la capitale en comptait 5, et son exemple était si rapidement suivi dans dix autres villes, qu’au cours de l’année 1847, pendant l’affreuse épreuve qui allait fondre sur elle et émouvoir l’Europe entière, 16 conférences s’épanouissaient sur le sol de cette verte Erin décimée par la faim.
Au cours de l’année 184G, un de nos confrères de France, passant à La Haye, eut l’heureuse inspiration de chercher à implanter la Société en Hollande, et ses entretiens avec les catholiques notables de la capitale aboutirent à la création d’une première conférence. Celle-ci rencontra tout d’abord des obstacles multiples: elle en triompha, et bientôt l’Œuvre, encouragée par le haut clergé, favorisée d’une autorisation royale malgré son caractère nettement catholique, se répandit dans les principales villes avec une telle rapidité qu’à la fin de l’année 1847, la Hollande présentait un effectif de 15 conférences si pleines de sève qu’à Schiedam, par exemple, 12 confrères visitaient 235 familles, soit une moyenne de 20 familles par confrère!
Au début de cette année 1847, un jeune médecin venu faire ses études à Paris, et, celles-ci terminées, retournant au Canada pour y exercer sa profession, n’eut garde d’oublier la Société de St-Vincent de Paul à laquelle il appartenait à Paris comme membre actif de la Conférence St-Séverin. Il sema la bonne graine d’abord à Québec; et en l’espace d’une seule année il arriva avec le concours du clergé et des fonctionnaires de l’ordre le plus élevé, à fonder dans ce pays où la foi demeure si vivante, 11 conférences, réunissant plus de 1.100 confrères et distribuant plus de 35.000 francs de secours dans leur premier hiver.
Ce n’était pas la première apparition de l’Œuvre sur le nouveau continent: elle y avait pris pied déjà, en 1845, au Mexique où la première conférence, bientôt suivie de deux autres, avait été créée sous l’impulsion de l’archevêque de Mexico qui lui avait remis «la garde» d’une de ses églises avec toutes les dépendances nécessaires à un large établissement, et sous l’autorisation du Gouvernement, qui lui avait confié «l’Hospice des Femmes Folles» avec la disposition de tous ses revenus.
De même, en 1846, la Société s’était implantée aux États-Unis, modestement, d’abord à Saint-Louis, puis en 1847 à New York.
A côté de ces plantations d’arbustes précoces à floraison rapide, voici des semences d’apparence moins brillante qui germeront plus lentement, mais qui ne sont pas moins précieuses.
A Edimbourg, une conférence est fondée en 1845 par Mgr Gillis, coadjuteur, qui avait conservé le souvenir de la réception déférente à lui faite, le 24 février 1839, à Paris, par la Société réunie en assemblée générale. Et cette première conférence écossaise trouve d’abondantes ressources non pas seulement dans la libéralité du clergé catholique lui abandonnant pendant tout un trimestre le produit des quêtes faites à l’église, mais encore dans la générosité de certains protestants notables lui envoyant de larges aumônes.
A Munich, la maison royale, le ministère, la nonciature unissent leurs concours pour l’établissement de la première Conférence bavaroise. Le ministre de l’Intérieur, lui-même, tient à honneur d’en faire partie, et à peine fondée, elle reçoit un legs de 3.000 florins, soit à l’époque 7.200 francs.
A Genève, en plein centre de protestantisme, un confrère de St-Sulpice en villégiature trouve le moyen de surmonter tous les obstacles accumulés sous ses pas, et de fonder une conférence qui, dès sa seconde année, compte 80 confrères.
A Gênes, les résistances du gouvernement sarde, dont l’autorisation est nécessaire, cèdent devant les efforts conjugués du Cardinal archevêque et du Cte de Brignole-Sales, ambassadeur à Paris, lequel accepte le titré de Président honoraire de la Conférence qui lui doit le jour . Celle-ci va voir quadrupler ses ressources en un an.
A Constantinople, en pleine capitale musulmane, une première Conférence favorablement accueillie des autorités, aidée par le concours pécuniaire de quelques mahométans fortunés, ne se contente pas d’assister 4.000 malades; elle essaime successivement, grâce au concours zélé des Sœurs de St-Vincent de Paul, d’abord en Grèce, à Santorin, puis à Smyrne, où, pour la première fois, la Société pénètre en Asie.
L’Afrique, elle aussi, ouvre ses portes: En 1846, plusieurs anciens confrères de France, se rencontrant à Alger, ont la pieuse pensée, sur l’initiative du secrétaire général de Baudicour qui s’y trouvait de passage, de se réunir pour entreprendre au sein de la population cosmopolite où ils se trouvaient un peu noyés une véritable croisade de charité ; et ainsi l’Œuvre s’implante sur cette terre musulmane, en même temps que les premiers éléments de la nouvelle église d’Afrique.
§
Cette expansion de la Société à l’étranger devait nécessairement entraîner certains développements dans son organisation.
Dès 1836 et 1837 dans les quelques villes de province qui comptaient plusieurs Conférences: Lyon, Bordeaux, Toulouse, s’était constitué spontanément un conseil particulier local leur servant de lien, et remplissant, auprès d’elles, le rôle du Conseil de direction auprès des Conférences parisiennes. Les dispositions complémentaires du règlement, adoptées en 1839, avaient sanctionné, par l’adoption de quelques articles nouveaux, cette création dont la pratique avait démontré l’utilité, et avaient fixé la composition, le rôle, le fonctionnement de ces Conseils particuliers, intermédiaires naturels entre les Conférences et le Conseil Général. Sous la présidence de Gossin. la multiplication des Conférences entraîna l’institution par le Conseil Général de 24 nouveaux Conseils particuliers, dont 13 à l’étranger.
Mais les Conférences groupées dans ces Conseils particuliers étaient celles-là seules qui appartenaient à une même ville, c’est-à-dire le petit nombre. Les autres, la majorité, se trouvaient isolées, fort éloignées souvent du Conseil Général, abandonnées en fait à une indépendance qui pouvait avoir de fâcheuses conséquences. Et ce danger apparaissait plus grave au fur et à mesure que des conférences naissaient dans des contrées plus éloignées, en Afrique, en Amérique.
De la nécessité de relier entre elles ces Conférences étrangères isolées naquit, sur l’initiative du Conseil Général, un rouage nouveau. Ce rouage, il est vrai, ne devait faire l’objet d’un règlement qu’en 1850, après quelques années d’expérience, conformément à l’usage suivi dans la Société, où l’on préfère attendre, pour leur donner un caractère officiel, que les fondations aient subi l’épreuve du temps. Mais en fait, il commença de fonctionner dès 1845. Ce fut le «Conseil supérieur» primitivement nommé Conseil provincial , groupant, en principe, toutes les Conférences d’une même nation, isolées ou réunies en Conseils particuliers, et servant de lien entre elles et le Conseil Général. Ainsi furent institués successivement les Conseils supérieurs de Grande-Bretagne, des États de l’Église, de Belgique, d’Irlande et des Pays-Bas. Ces Conseils supérieurs étaient spécialement chargés d’instruire les demandes d’agrégation présentées par les conférences nouvelles, et d’assurer les relations de toutes les Conférences de leur ressort avec le Conseil Général en leur transmettant les avis et décisions de celui-ci.
Cette création s’imposait. On ne pouvait demander ni au Conseil Général qu’il connût la langue de tous les peuples qui se rangeaient successivement sous son contrôle, ni à toutes les Conférences étrangères qu’elles adoptassent la langue française pour correspondre avec lui. Un Conseil supérieur établi dans la capitale de chaque pays étranger, y remplirait en premier lieu, le rôle d’interprète nécessaire. D’autre part, si le Conseil Général devait veiller à maintenir uniforme dans ses grandes lignes le caractère de l’Œuvre commise à ses soins, il n’en reconnaissait pas moins aux Conférences une grande liberté, en ce qui concerne par exemple les formes variées sous lesquelles, à côté de l’œuvre fondamentale de la visite du pauvre à domicile, elles entendaient exercer la charité. Il lui fallait donc, dans ses directives générales, tenir compte des mœurs, des traditions, des exigences nationales. Il ne pouvait le faire utilement sans l’assistance d’un représentant autorisé, capable de l’éclairer de ses avis et de faire, en même temps, accepter ses décisions. Ce n’est point une tâche aisée de faire collaborer à une œuvre commune des hommes séparés par leur langue, leurs lois, leurs coutumes et leur caractère: au moins faut-il les connaître pour adapter les directives aux nécessités locales. Enfin la multiplication des Conférences imposait au Conseil Général une charge déjà lourde, que l’avenir laissait prévoir de plus en plus pesante. Une certaine décentralisation commençait à paraître nécessaire. Ces considérations diverses avaient dicté la création des Conseils supérieurs.
§
Ce qui facilitait cette décentralisation, c’était la consécration officielle de l’autorité du Conseil Général par le bref du 10 janvier 1845, qui réservait exclusivement aux Conférences agrégées et aux Conseils institués par lui le bénéfice des indulgences accordées. Un pouvoir, quel qu’il soit, ne peut sans imprudence abandonner la moindre de ses prérogatives tant qu’il n’est pas fermement établi sur une base inébranlable. En consolidant son autorité, en la légalisant, si on peut dire, aux yeux du monde catholique, le bref permettait au Conseil Général de la déléguer en partie lorsqu’il le jugeait utile. En même temps, il mettait entre ses mains une arme puissante aux yeux des consciences chrétiennes, et dont certains incidents allaient démontrer la valeur et l’utilité.
On méconnaîtrait, en effet, la nature humaine, même améliorée par la pratique de la piété et de la charité, si l’on supposait que l’expansion d’une œuvre comme celle-ci pouvait se poursuivre sans soulever aucun de ces conflits, à la racine desquels on trouve presque toujours les exigences d’un amour-propre corporatif ou personnel. Quelques-uns se sont produits sous la présidence de Gossin. Il devait les résoudre avec cette expérience des œuvres, ce tact personnel et cet esprit de charité qui caractérisaient sa manière, et lui dictaient les solutions de nature à concilier les plus larges concessions de détail avec la défense énergique dès principes. Le maintien de l’unité, ce fut à peu près l’unique but dans lequel il ait jamais fait acte d’autorité. Mais sur ce point il était intransigeant.
On sait la résistance opposée par la Belgique depuis 1842, aux décisions du Conseil Général exigeant, pour l’agrégation de ses Conférences, la modification de leurs statuts. Pas plus que son prédécesseur, Gossin ne céda sur cette question de principe. Le bref triompha de cette résistance. La Belgique, émue de ne pas le voir promulguer sur son territoire, comprit enfin la nécessité de s’incliner: au cours de l’année 1845 elle se rangea sous l’obédience du Conseil Général, acceptant les modifications imposées par lui.
A côté de la Belgique, les Pays-Bas, allaient donner au Conseil Général bien d’autres soucis. Le Conseil particulier de La Haye, régulièrement institué, était présidé par M. de Haan, fondateur de la première conférence hollandaise, animateur très dévoué et très apprécié du Conseil Général. Mais lorsque celui-ci décida la création d’un Conseil supérieur des Pays-Bas, et que la présidence en fut confiée à un haut fonctionnaire du ministère des Cultes, M. Lux, un premier conflit naquit de ce fait que le président du Conseil supérieur étant, de droit président du Conseil particulier de la ville où il siège. M. de Haan allait se trouver dépossédé de sa fonction, ce qu’il n’acceptait pas. Pour résoudre le différend, M. Lux approuvé par le Conseil Général, délégua M. de Haan à la présidence du Conseil particulier. Mais celui-ci n’en voyait pas moins lui échapper la direction morale qu’il avait, en fait, exercée jusque-là, sur toutes les Conférences hollandaises. Il refusa de reconnaître l’autorité du Conseil supérieur, et il émit la prétention de continuer à correspondre directement avec le Conseil Général. Celui-ci ne pouvait accepter pareille atteinte à la hiérarchie, et par suite à la discipline et à l’unité. Ses remontrances étant demeurées vaines, il se vit dans la pénible nécessité de prononcer la dissolution du Conseil particulier et de confier au Conseil supérieur le soin de le remplacer provisoirement. Le Conseil particulier refusa de se soumettre à cette décision et entreprit des démarches auprès de l’administration hollandaise, en vue de se faire reconnaître officiellement par elle, ce qui lui conférerait, pensait-il, un avantage signalé sur le Conseil supérieur, et lui permettrait peut-être de rallier à lui toutes les Conférences de Hollande. C’était la révolte avec menace de schisme au sein des Conférences hollandaises. Ce schisme, il le fallait empêcher à tout prix. Le Conseil supérieur, forcé d’accepter la lutte sur le terrain administratif, obtint les 6 septembre et 1er octobre 1847 deux rescrits royaux autorisant le fonctionnement de la Société aux conditions de son règlement général et lui accordant la personnalité morale avec droit de posséder. Ce succès du Conseil supérieur mettait fin au conflit. Peu à peu les dissidents se soumirent et la paix se rétablit entre les Conférences hollandaises qui prirent, par la suite, un magnifique essor. Mais on conçoit facilement la persévérante fermeté qu’avait dû montrer le Conseil Général au cours de cette campagne de 18 mois. Ne pas faire acte d’autorité en pareil cas, ç’eût été, pour lui, la chose est évidente, manquer à son devoir.
Il en faut dire autant à propos du conflit qui, au cours des années 1845 et 1846, divisa les Conférences de Versailles. Cette ville possédait trois Conférences: deux d’entres elles demandaient l’institution d’un Conseil particulier, mais la troisième (Conférence St-Louis) s’y opposait et présentait une protestation signée de tous ses membres. Ses motifs n’étaient cependant pas de ceux qui pouvaient arrêter le Conseil Général, car elle se contentait d’exposer qu’étant la plus ancienne et la plus nombreuse, et ses deux sœurs cadettes ayant été fondées par des confrères qui s’étaient séparés d’elle à la suite de quelques désaccords, elle ne pouvait accepter de subir leur loi dans un Conseil particulier où elles formeraient nécessairement la majorité. Après toute une année de négociations sans résultats, le Conseil Général passa outre, et institua le Conseil particulier de Versailles. Aussitôt, protestation de l’évêque disant au Conseil Général ses regrets de n’avoir pas été consulté, et sa désapprobation de la mesure prise; puis, protestation de la Conférence St-Louis refusant de reconnaître le Conseil particulier nouvellement institué. Le Conseil Général tint ferme, maintint sa décision, ne répondit à aucune de ces protestations afin de ne pas envenimer la situation, et compta sur le temps pour faire son œuvre. Et de fait, un an plus tard, tous ces incidents étaient oubliés et la paix rétablie entre les Conférences de Versailles.
Même résultat à Nantes où la situation, toute différente il est vrai, n’en réclamait pas moins l’intervention d’une autorité supérieure pour ramener la Conférence au respect du règlement, dont elle s’était terriblement écartée. Très nombreuse — 150 membres — disposant d’un budget assez élevé — près de 25.000 fr. — et d’ailleurs fort active, elle poursuivait sa carrière charitable en toute indépendance suivant des règles à elle propres. Aucune quête n’était faite aux séances, les confrères payant, ni plus ni moins que dans un cercle, une cotisation fixe annuelle. Les réunions — une par quinzaine seulement — étaient celles d’un parlement au petit pied, où s’échangeaient de longs discours sur des propositions préparées et rédigées à l’avance par le bureau, jouant le rôle de ministère. Elle prétendait statuer elle-même, sur l’agrégation des Conférences venant à se fonder autour d’elle. Le Conseil Général ne pouvait guère, dans ces conditions, continuer de la reconnaître pour une de ses filles. Au mois de juin 1845, de Baudicour se rendit à Nantes pour essayer de ramener la Conférence dans la bonne voie. Au mois d’août suivant, le Conseil Général insista dans le même sens. Vains efforts. Mais lorsque fut promulgué le bref du Souverain Pontife et que la Conférence constata que ne répondant pas aux conditions exigées elle ne bénéficiait pas des indulgences octroyées, elle céda brusquement, renonça à son attitude indépendante, rentra dans le giron de la Société, en adopta le règlement, et se sectionna en 3 conférences qui furent agrégées par le Conseil Général et unies sous l’égide d’un Conseil particulier régulièrement institué.
Ces quelques cas, si exceptionnels qu’ils fussent, établissaient bien la nécessité d’une autorité forte concentrée aux mains du Conseil Général. Son absence eût fait courir à l’unité de l’Œuvre de gros dangers, d’ailleurs faciles à prévoir. La Providence y pourvut par l’intervention du Souverain Pontife qui, seul, pouvait conférer au Conseil Général une autorité rayonnant sur le monde entier. Pour n’apparaître qu’accessoire, ce bénéfice du bref n’en avait pas moins une sérieuse importance pour l’avenir de la Société.