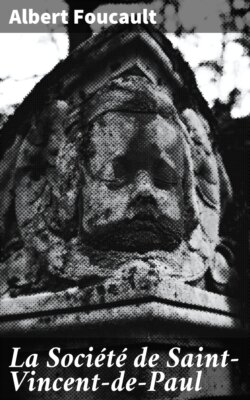Читать книгу La Société de Saint-Vincent-de-Paul - Albert Foucault - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE CONSEIL DE DIRECTION (1836-1839)
ОглавлениеLe Conseil de Direction, tel qu’il venait d’être créé, ne devait vivre que quatre années, à l’expiration desquelles il apparaissait manifestement insuffisant. Rapidement le développement de l’Œuvre allait faire éclater ce cadre trop étroit car, dès ce moment, elle prenait son essor.
Au cours de ces quatre années, 12 Conférences nouvelles naissent à Paris et 23 en province.
En 1836, ce sont: à Paris les deux Conférences St-Merry et St-Roch, et, en province, la première Conférence de Lyon, sous l’impulsion d’Ozanam. Celle de Nîmes ne peut triompher des difficultés qui l’ont assaillie dès le lendemain de sa naissance, et morte en bas âge, elle ne ressuscitera qu’en 1840. D’autre part, à Rome, les tentatives de Janmot, de Claudius Lavergne et de leurs camarades, n’ont abouti qu’à des visites individuelles dans les hôpitaux, bientôt interrompues par une épidémie de choléra qui disperse les jeunes artistes; et c’est seulement en 1842 qu’elie se reconstituera, à l’éloquent appel du R. P. de Ravignan.
En 1837, l’Œuvre ne compte aucune fondation à Paris, mais 9 créations en province: 3 à Toulouse, 2 à Lyon et à Rennes, 1 à Nantes et 1 à Dijon dans un faubourg de la ville, Fontaine-les-Dijon, qui se glorifie d’avoir donné le jour à saint Bernard.
L’année 1838 apporte 3 naissances à Paris: St-Nicolas des Champs, St-Germain des Prés et St-François Xavier des Missions fondée par la Conférence St-Sulpice: mais la province n’en compte plus que 5. Nancy, Metz, qui s’enthousiasme pour l’Œuvre en écoutant la parole ardente de l’abbé Lacordaire, Langres, Cambrai, Quimper.
Enfin, voici l’année 1839, au cours de laquelle quinze Conférences nouvelles apparaissent au firmament de la Société ; sept à Paris; St-Séverin, fondée par la Conférence St-Sulpice, St-Louis d’Antin, Œuvre commune du curé de la paroisse et du maire de l’arrondissement: St-Médard, création des Ecoles Normale et Polytechnique; St-Nicolas du Chardonnet, patronnée par l’abbé Dupanloup, alors directeur du Séminaire; Notre-Dame des Victoires; Ste-Marguerite, et Notre-Dame de l’Abbaye au Bois. La province apporte huit fondations nouvelles à Saint-Claude, Angers, Bordeaux, Arras, Aix, Moulins, où pour la première fois, naît dans une maison d’éducation — le petit séminaire d’Yzeure — une conférence composée des élèves des classes supérieures. D’autres s’annoncent, d’ailleurs. L’abbé Buquet, directeur du Collège Stanislas, au cours d’une assemblée générale qu’il honore de sa présence, déclare son intention de fonder dans son établissement, une conférence qui réunira ses rhétoriciens, ses philosophes et ses anciens élèves. Enfin les conférences de Troyes, Montpellier, Grenoble vont être constituées dès le mois de janvier suivant.
Le nombre des confrères est de 242 au 31 décembre 1835, de 388 à la fin de 1837, de 659 au 31 décembre 1838, et de 1068 à la fin de 1839. Le montant des recettes annuelles s’est élevé successivement à 9.000, 17.000, 33.000 et 54.830 francs. L’Œuvre est en marche.
§
Le Conseil de Direction, cependant, paraît avoir quelque peine à dépouiller le caractère de bureau central d’une conférence unique divisée en quatre sections, et ne pas bien saisir le rôle d’animateur qui lui incombe. Il ne se réunit que 4 fois par an à la veille des assemblées générales qui se tiennent dans l’amphithéâtre de la place de l’Estrapade, et il borne son activité à la préparation de celles-ci. Dans leur organisation, il se préoccupe surtout de sauvegarder le principe d’humilité et c’est pourquoi il écarte toute proposition tendant à donner à ces réunions le lustre que leur apporterait la présence d’un membre de l’épiscopat. Mgr de Quélen mourra en 1839 sans avoir honoré une seule de ces réunions de sa présence, et c’est seulement en 1840 que Mgr Affre inaugurera la série de ces présidences épiscopales qui deviendront par la suite presque traditionnelles.
Est-ce dans le même esprit que le programme de ces assemblées générales est maintenu si modeste, si monotone, qu’il ne présente qu’un intérêt relatif? Après la présentation des membres nouvellement admis, chaque président vient rendre compte de la vie de sa Conférence pendant les quelques semaines écoulées depuis la précédente assemblée générale. De même, les présidents des deux Œuvres déjà fondées par les Conférences de Paris, celle des jeunes détenus, et celle des apprentis orphelins. Puis Bailly signale quelques décisions prises par le Conseil de direction, annonce la création des Conférences nouvelles; et la séance se termine par une allocution de l’ecclésiastique venu remplir le rôle de Président d’honneur, qui le plus souvent est l’abbé Faudet, curé de la paroisse.
Les décisions du Conseil de direction communiquées par le Président Général n’ont, elles-mêmes, rien de sensationnel A peine peut-on relever l’impression et la distribution des cartons de prières — (encore actuellement en usage) — afin d’assurer l’uniformité des invocations pieuses dans toutes les Conférences, — l’envoi aux Conférences de province d’un extrait des procès-verbaux de chaque assemblée générale afin d’établir avec elles un lien permanent — les mutations dans le personnel du Conseil de direction, — la répartition entre les Conférences d’un don de 1.000 francs transmis par Mgr de Quélen, à l’occasion de la naissance du Comte de Paris. Les autres communications portent sur des questions de détail, menue monnaie d’une direction.
Certains confrères sentent la nécessité de galvaniser ces séances un peu mornes et s’y efforcent. Le président de la Conférence St-Sulpice, tel jour, substitue à son compte rendu habituel un rapport sur les résultats moraux et religieux obtenus par ses confrères; et, tel autre jour, expose non sans humour, comment s’est effectuée l’installation de sa Conférence dans le nouveau local, offert par M. le Curé, les confrères s’étant transformés en menuisiers, peintres et vitriers pour organiser, en quelques jours et sans frais, la salle nue, mise à leur disposition dans les dépendances de l’église.
Le Président de la Conférence St-Etienne du Mont, raconte l’invraisemblable odyssée de trois Persans arrivant à Paris et venant frapper à sa porte, pour quêter la somme de 6.000 fr., indispensable au rachat de leur femme et de leurs enfants réduits en esclavage par le fisc de leur pays, insuffisamment désintéressé par la saisie et la vente de tout ce qu’ils possédaient. Après avoir obtenu de la charité française la somme désirée et adressée directement à leur évêque, ils quitteront Paris, heureux et reconnaissants, et regagneront leurs pays, conduits de Conférence en Conférence jusqu’à Marseille, où ils trouveront payé le passage à bord du bateau qui leur permettra de rejoindre leurs familles libérées.
Le Conseil de direction sent bien la nécessité de varier par quelques innovations, le menu de ces Assemblées générales. Il y ajoute tout d’abord la lecture des lettres périodiques qu’il réclame des Conférences de province, et ensuite, lorsque, par bonne fortune, la présence à Paris d’un de leurs présidents coïncide avec une assemblée générale, une communication verbale, et par cela même plus vivante, sur le fonctionnement de leur Conférence. Mais ces communications extraordinaires sont rares et les Assemblées générales souffrent d’une monotonie qui cadre mal avec la jeunesse d’une Œuvre dont les aspirations tendent naturellement à un développement rapide.
§
On éprouve la même impression un peu décevante à scruter la vie interne du Conseil pendant ces quatre années. Il semble que sa préoccupation principale soit d’éviter toute innovation, par crainte qu’elle ne menace la vie, fragile encore assurément, du jeune arbuste confié à ses soins. Il pousse la prudence aux extrêmes limites, sous l’influence d’un président auquel son âge impose le rôle de modérateur de la jeunesse ardente dont il est entouré, et qui l’exerce avec une telle conscience qu’on ne voit aboutir aucune des propositions dont le Conseil est saisi. Soit que votées elles ne soient pas communiquées aux Conférences et demeurent ainsi lettre morte, soit que profondément modifiées, elles reçoivent des solutions rapidement jugées inexécutables, soit qu’elles subissent un ajournement indéfini tantôt en termes exprès, tantôt virtuellement, par la remise de leur application à une date ultérieure et imprécise, leur sort — en fait — est le même: elles n’aboutissent pas. Il semble que le Conseil, sans parti pris assurément, mais inconsciemment, et presque instinctivement, ait adopté pour règle de conduite de paralyser toute initiative, toute modification, et de figer la Société, immobile, dans son état présent.
Dès le mois de mars 1837, Ozanam, alors président de la Conférence de Lyon, adresse au Conseil deux propositions: la première tend à l’institution d’une messe annuelle de Requiem pour tous les confrères décédés au cours de l’année. Il était difficile de l’écarter: aussi est-elle immédiatement adoptée, mais avec ce correctif qu’on choisira ultérieurement la date de cette cérémonie et l’église où elle sera célébrée. Et comme 18 mois plus tard ce double choix n’était point encore fait, le 22 juillet 1838 Ozanam revient à la charge. En fait, ce ne sera qu’en 1839 que cette messe sera dite à Paris, et le Conseil, dans un excès de prudence, décide qu’elle ne peut être célébrée, suivant le désir exprimé, à St-Germain-l’ Auxerrois, sous prétexte qu’une réunion de jeunes gens dans cette église, pourrait éveiller les susceptibilités de l’autorité, à raison des souvenirs qui planent sur elle, depuis son sac par la populace en 1831!
La seconde proposition d’Ozanam tendait à constituer une classe de membres correspondants de la Société recrutée parmi les anciens confrères qui, ayant quitté Paris, leurs études terminées, et réintégré leur province, ne pouvaient y fonder une Conférence locale. Cette fois, la proposition fut expressément écartée comme de réalisation trop difficile. Alors Ozanam, toujours préoccupé de ne pas laisser s’évaporer le zèle des anciens confrères isolés dans leur province, propose que, chaque année, un rapport général sur la marche de l’Œuvre soit imprimé et envoyé, non pas seulement aux Conférences, mais aux anciens confrères, qui seront ainsi maintenus en rapports directs avec la Société. Et sans doute, cette fois son vœu est accueilli, mais avec cette réserve qu’il y aura lieu de choisir ultérieurement l’époque de cette publication, après avoir pris, au préalable, l’avis des Conférences de province. Et du fait de cet ajournement déguisé, 4 années s’écouleront, et le Conseil de direction aura vécu, avant que cette mesure soit réalisée. Le rapport annuel, voté en principe le 22 juillet 1838, paraîtra pour la première fois au mois d’août 1842.
Le nombre croissant des Conférences de Paris avait amené le Conseil à décider, dès le 21 avril 1838, que, dorénavant les comptes rendus individuels des présidents à l’assemblée générale seraient remplacés par un rapport d’ensemble confié à un confrère désigné par lui. La mesure fut immédiatement appliquée, et Lamache, un des fondateurs de la Société, donna lecture, huit jours plus tard, d’un rapport géneral (assemblée générale du 29 avril 1838). Mais dès la seance suivante, 22 juillet, la tradition des comptes rendus individuels était reprise et ce sera seulement 18 mois plus tard — (décembre 1839) que le Président Général s’inclinera devant l’impossibilité matérielle d’infliger à ses confrères la lecture successive de quinze comptes rendus individuels, et mettra définitivement en application la mesure votée par le Conseil le 12 avril 1838!
Le Prévost, vice-président général, préoccupé de l’absence d’initiative et de direction du Conseil, qui laissait flottantes les rênes de l’autorité et ne réalisait pas, suivant lui, l’union désirable entre les Conférences, demanda, le 22 juillet 1838, que soient dorénavant mensuelles les séances du «Conseil extraordinaire» — celles qui groupaient, autour du bureau, les présidents des Conférences parisiennes, — afin de mieux assurer entre elles la liaison si souvent souhaitée par la rencontre plus fréquente de leurs représentants attitrés. La proposition fut adoptée dès la séance suivante — (25 novembre 1838) — avec mention que cette décision serait communiquée à la prochaine assemblée générale. Mais le procès-verbal de cette dernière — (9 décembre 1838) — est muet sur ce point et si le «Conseil extraordinaire» se réunit effectivement un mois après le vote de la proposition de Le Prévost, c’est, malgré les protestations de celui-ci, la seule fois que cette décision est appliquée.
Ozanam avait émis le vœu, plusieurs fois renouvelé, que le Conseil sollicitât du Souverain Pontife la faveur d’un bref accordant certaines indulgences aux membres de la Société. Sa proposition fut finalement écartée — (25 novembre 1838; — sous prétexte que l’Œuvre était «trop peu de chose» pour formuler de pareilles prétentions. La conséquence de cette décision ne se fit pas attendre. Une Conférence de province prit l’initiative de faire, à Rome, des démarches en vue d’obtenir, pour elle personnellement, cette faveur insigne; et ces démarches ne furent pas sans créer plus tard quelques embarras au Conseil, lorsqu’il voulut reprendre la question dans l’intérêt général!
Ces quelques exemples pourraient être facilement multipliés. En réalité, la direction de l’Œuvre se perd dans des détails, et n’accueille vraiment aucune des propositions d’ordre - général dont elle est saisie. Pour celles-ci, les bureaux de la place de l’Estrapade sont de véritables oubliettes.
Il faut cependant reconnaître au Conseil de direction le mérite d’une création dont la durée prouvera suffisamment l’utilité : l’institution des Circulaires générales. Le besoin d’union se manifestait constamment et partout: Union entre les Conférences de Paris et de province, union avec les anciens confrères isolés: ce sont là des vœux qui venaient constamment assiéger le Conseil. Dès le mois de février 1837, il essaya de les exaucer, du moins partiellement, et décida que l’envoi aux Conférences de province des extraits du procès-verbal de chaque assemblée générale serait accompagné d’une lettre rédigée par le secrétaire du Conseil et ayant pour but de nouer des relations entre elles et le Conseil de direction. Au cours des années 1837-1838 quatre de ces lettres furent successivement envoyées par Lallier; elles furent le germe des circulaires générales qui, plus tard, devaient être régulièrement adressées à toutes les Conférences par les Présidents successifs du Conseil Général.
§
Si pendant cette période de trois ans, la direction de la Société paraît somnolente, par contre, l’activité surabonde dans les Conférences; la vie de l’Œuvre s’est réfugiée chez elles.
Et d’abord le nombre des confrères s’accroît avec rapidité. La Conférence St-Sulpice voit le nombre de ses membres atteindre la centaine. Comprenant la nécessité d’essaimer, elle fonde successivement, le 23 février 1838, la conférence St-François Xavier des Missions, et dès le début de l’année 1839, la Conférence St-Séverin. La voici mère et bientôt grand’mère de Conférences, car celle de St-François Xavier des Missions va, dès l’année suivante, créer à son tour une conférence nouvelle à Ste-Valère, aujourd’hui Ste-Clotilde.
La Conférence St-Etienne du Mont est exclusivement composée de ces «oiseaux de passage» que sont les étudiants venant vivre quelques courtes années au quartier latin. Sa composition, par une conséquence inévitable, se renouvelle en partie chaque année: malgré ces conditions défavorables, son effectif ne descend jamais au-dessous de 70 à 80 membres.
La Conférence Notre-Dame de Bonne Nouvelle, au mois de décembre 1835, réussit un coup de maître: avec la complicité de M. le curé, elle absorbe une œuvre préexistante de piété et de charité, composée d’hommes mûrs, qui s’appelait «la Confrérie du St-Sacrement», et qui vivotait péniblement. De ce fait, elle double son effectif, et en même temps elle amorce cette transformation du personnel des Conférences qui, fondées exclusivement pour les jeunes gens, verront bientôt accourir au milieu d’elles des hommes de tous âges, appartenant à toutes les professions, de telle sorte qu’à l’ardeur de la jeunesse viendra se mêler, non sans profit, l’expérience de la maturité.
Comment ne pas citer encore la Conférence St-Merry, fondée le 18 août 1836, sur l’initiative de M. le curé avec deux membres seulement, et qui, trois mois plus tard, en compte 41 et près de 75 avant que l’année soit écoulée?
Naturellement, le nombre des familles visitées augmente dans la même proportion que le nombre des confrères. En 1837 la Conférence St-Sulpice visite 125 familles; 82 autres figurent en instance d’admission sur ses registres: elles n’attendront pas bien longtemps puisqu’un an plus tard 200 sont secourues par elle. La Conférence St-Merri compte 125 familles le 1er février 1837, 170 le 1er mars 1838, 200 le 1er décembre de la même année; il est tel de ses membres qui visite régulièrement sept familles chaque semaine.
Et chaque Conférence rivalise de zèle pour améliorer et pour étendre son champ d’action: celle de St-Etienne du Mon! prescrit, pour chaque famille visitée, la rédaction d’un bulletin de renseignements complet qui sera la première assise d’un dossier individuel permettant à chaque nouveau visiteur de connaître, avant même de les avoir vues, les familles qui lui sont confiées, et à la Conférence de statuer, en pleine connaissance de cause, sur l’importance des secours ordinaires ou extraordinaires qui lui sont demandés pour elles.
Celle de Notre-Dame de Bonne Nouvelle s’associe à l’Œuvre du curé de la paroisse qui, chaque vendredi, réunit 250 pauvres dans son église pour leur faire entendre une messe accompagnée d’une courte instruction. Et ce sera le germe de l’Œuvre de la Sainte Famille à laquelle, plus tard, la Conférence St-Sulpice donnera sa forme définitive.
Beaucoup d’initiatives heureuses sont prises dès cette époque par les Conférences: mais il faut bien constater que cette médaille a son revers, et ce revers, c’est leur détresse, dont le cri vient retentir sans cesse aux séances du Conseil de direction et aux assemblées générales. Le nombre croissant des familles secourues vide sans cesse les caisses des Conférences, véritables tonneaux des Danaïdes, aussitôt épuisés que remplis. Et c’est en vain, la plupart du temps, qu’elles appellent à leur secours la caisse centrale du Conseil de direction, car celle-ci, n’ayant pas de ressources propres, se trouve le plus souvent vide. C’est la misère appelant à son aide la pauvreté !
Quelques confrères s’élèvent contre l’imprudence d’une charité qui ne sait pas se modérer. Mais le Président du Conseil répond très justement que les Conférences n’ont pas été créées pour thésauriser, qu’elles doivent compter sur la Providence, et que celles qui multiplient leurs charités sans trop se soucier du lendemain méritent plutôt des félicitations que des reproches. Et les Conférences cherchent à se tirer d’affaire par leurs propres moyens. Malgré l’avis contraire consigné dans la circulaire de juillet 1838, la conférence St-Merri donne un sermon de Charité. Et le succès de celui-ci est tel que plusieurs autres conférences suivent son exemple. Il faut bien vivre!
§
Cependant cette activité des conférences contraste chaque jour davantage avec l’inertie du Conseil mis à leur tête, et l’Œuvre en souffre. Ce corps, jeune, plein de vie, et dont le développement est rapide, a besoin d’une autre hygiène que celle de son enfance. Tout le monde le sent et des symptômes inquiétants se révèlent. Un certain relâchement se produit dans les relations entre le centre et la circonférence. Quelques villes possédant plusieurs conférences, — Lyon, Toulouse, Rouen —, dont le besoin d’union ne trouve pas une satisfaction suffisante auprès du Conseil de direction, ont constitué un conseil local analogue à celui-ci, reliant les Conférences de la ville, les dirigeant, et jouant sur place, le rôle rempli par le Conseil extraordinaire pour les Conférences parisiennes. Et cette mesure apparaît comme une menace de schisme, le prodrome d’une séparation qui serait la mort de la Société.
Précisément à cette époque, la composition du Conseil de direction se trouve, en partie, renouvelée. Dès le début de l’année, le secrétaire, Lallier, auteur du règlement primitif, et le trésorier Devaux, tous deux anciens fondateurs de la Conférence de Charité, quittent Paris définitivement, et regagnent, le premier sa Bourgogne, et le second sa Normandie. Pour les remplacer, le Président a fait choix de MM. de Baudicour et de Riancey, et il se trouve que l’un et l’autre sont pénétrés des besoins nouveaux de la Société et de la triple nécessité d’assurer entre les Conférences une union plus étroite par une organisation de la direction plus concentrée et plus souple en même temps, de créer, d’autre part, des liens entre la Société et les anciens confrères qui l’ont quittée pour aller vivre isolés dans leur province, et enfin de fixer le rôle de toutes les personnes de bonne volonté qui offrent leur concours à l’Œuvre, sous quelque forme que ce soit.
Trois mois à peine après sa nomination de secrétaire, l’occasion s’offrait à de Baudicour d’exposer ses idées.
La première édition du règlement se trouvait épuisée, et, le 16 juin 1839, Bailly réunissait le bureau du Conseil de direction pour prendre les mesures nécessaires à sa réimpression. Le secrétaire émit immédiatement l’avis qu’il y avait lieu, non pas seulement de réimprimer, mais de compléter le règlement sur un certain nombre de points. Cette proposition souleva tout d’abord les protestations du Président qui la déclara dangereuse, et de nature à ébranler les assises de l’Œuvre, un règlement une fois adopté ne devant être modifié qu’en cas d’absolue nécessité, et celui de la Société suffisant parfaitement à ses besoins actuels. Mais ce dernier point fut précisément celui que contesta de Baudicour dans sa réplique, en exposant le développement rapide de l’œuvre, ses nouveaux besoins, les dangers qui menaçaient son unité à défaut d’une forte organisation, et tout spécialement la crainte qu’on pouvait éprouver de voir, quelque jour prochain, les Conférences de province se grouper en Sociétés particulières, si l’on ne créait pas, à Paris, un organe central, distinct du Conseil des Conférences parisiennes, et exclusivement chargé des intérêts généraux, planant au-dessus des Conseils locaux et des Conférences isolées, concentrant entre ses mains tous les pouvoirs de direction et de contrôle, et maintenant ainsi fortement l’unité de la Société. Ces arguments frappèrent le bureau à ce point qu’il chargea de Baudicour de rédiger, sur cette question, un rapport qui serait soumis au Conseil extraordinaire, celui-là même qui réunissait les présidents des Conférences de Paris. La brèche était, dès lors, ouverte, par laquelle allaient pénétrer dans la place, les réformes souhaitées par les Conférences.
La séance au cours de laquelle on devait entendre et discuter les propositions de Baudicour avait été fixée au 14 juillet. Pas un président ne manqua au rendez-vous. Le secrétaire exposa toutes les modifications qu’il lui semblait utile d’apporter au règlement primitif dans l’intérêt de l’Œuvre. Elles portaient non plus seulement sur la transformation du Conseil de direction et son sectionnement en Conseil Général de la Société et en Conseil Particulier de Paris, mais encore sur la création de Conseils Particuliers en province, ainsi que sur le statut à donner aux anciens confrères ayant quitté leur conférence, aux membres honoraires et aux bienfaiteurs que les Conférences commençaient à cueillir en grand nombre.
Cet exposé rencontra l’approbation générale du Conseil le bureau fut chargé de la rédaction des nouveaux articles à introduire dans le règlement, et huit jours plus tard, le 21 juillet, Bailly communiqua à l’assemblée générale les décisions de principe prises par le Conseil.
Le nouveau règlement fut rédigé, imprimé, et finalement envoyé à toutes les Conférences, au mois de décembre 1839, accompagné d’une lettre circulaire du secrétaire, exposant les motifs des diverses modifications adoptées et les commentant. Celles-ci peuvent, au surplus, se résumer en quelques lignes: Le Conseil de direction, dont l’actuelle composition sera complétée par la nomination de plusieurs membres, devient Conseil Général de la Société, exclusivement chargé des intérêts généraux de celle-ci, ayant autorité sur tous les Conseils particuliers et toutes les Conférences isolées existant actuellement ou venant à se fonder en quelque lieu que ce soit.
Dans toute agglomération où vivent plusieurs conférences est constitué, pour les unir et les diriger, un Conseil particulier composé des présidents et des vice-présidents des Conférences. Ce Conseil ayant son bureau, sa caisse propre, relève du Conseil Général. Les présidents et vice-présidents de Conférences seront nommés par le président du Conseil particulier, partout où il en existe. A Paris, la présidence du Conseil particulier reviendra au Président du Conseil Général ou à son délégué.
Les confrères isolés, ayant quitté leur conférence pour aller s’établir dans une ville où il n’en existe pas, peuvent s’affilier comme membres correspondants à la Conférence la plus voisine de leur nouvelle résidence, remplissant, individuellement chez eux, le rôle de membres actifs et recevant le rapport annuel qui sera publié par le Conseil Général.
La Société admet dès membres honoraires reçus dans les mêmes conditions que les membres actifs, n’assistant pas aux séances de la Conférence, ne visitant pas de familles, mais contribuant par une offrande annuelle aux charges de la Conférence et convoqués à toutes ses réunions extraordinaires.
Elle admet également des souscripteurs ou bienfaiteurs, quel que soit leur sexe, qui, eux, ne sont pas membres de la Société, mais qui apportent à la Conférence un concours charitable sous quelque forme que ce soit.
Quelques dispositions de détail complètent ces modifications générales.
Et voici définitivement fixée cette fois, en 59 articles, et telle qu’elle figure au manuel encore aujourd’hui, la constitution de la Société de St-Vincent de Paul solidement assise désormais sur un règlement qui va lui permettre une remarquable expansion, tout en sauvegardant son unité.