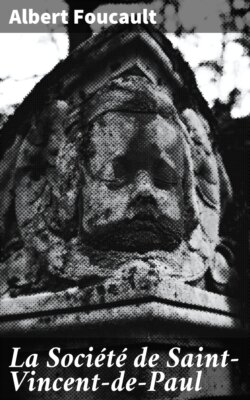Читать книгу La Société de Saint-Vincent-de-Paul - Albert Foucault - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES PREMIERS PAS (1833-1834)
ОглавлениеLa démarche dont avait été chargé le trésorier Devaux auprès de la Sœur Rosalie fut accueillie par elle avec une bienveillance toute maternelle. Elle prodigua ses encouragements, ses conseils et son concours à ces jeunes gens. Dès la seconde séance, chaque membre se trouva pourvu d’une famille à visiter et de bons à lui remettre. A chaque réunion les membres exposaient la situation et les besoins de leurs pauvres, et recevaient les bons qu’ils leur portaient dans le courant de la semaine. Ils croyaient ainsi leur projet réalisé définitivement et «ne varietur». La Providence n’allait pas tarder à dissiper leur illusion.
Dès le mois de juin, à la 3e ou 4e séance, Lallier, demandait à la Conférence d’admettre un de ses anciens camarades du Collège Stanislas, Gustave de la Noue, étudiant en droit, fils d’un Conseiller à la Cour d’Orléans. Cette proposition inattendue causa une émotion qui se traduisit immédiatement en objections; l’intimité existant entre les six membres de la Conférence allait se trouver compromise par l’introduction d’un étranger connu d’un seul d’entre eux; et puis, qui pouvait répondre que ce nouveau venu n’aurait pas de l’Œuvre une conception différente de la leur? Non, vraiment, il semblait préférable de tenir obstinément fermée la porte de la Conférence de Charité.
Cet ostracisme ne cadrait pas du tout avec les idées d’Ozanam. Pour lui, le but principal de la Conférence de Charité, c’était de grouper les étudiants catholiques, isolés, éloignés de leur famille, auxquels il fallait offrir une sorte d’hospitalité, en les associant pour une œuvre de charité . N’écrivait-il pas, le 21 juillet 1834, à l’un de ses cousins: «Je voudrais que tous les jeunes gens de tête et de cœur s’unissent pour quelque œuvre charitable et qu’il se formât, par tout le pays, une vaste association généreuse pour le soulagement des classes populaires.» Son intervention emporta l’assentiment de la réunion, et Gustave de la Noue fut admis — 7e confrère — non compris le président Bailly.
Cette décision de principe était plus grosse de conséquences qu’on ne l’avait prévu. La porte, si difficilement entrouverte, ne devait plus se refermer: elle allait, au contraire, et de suite, s’ouvrir toute grande devant une affluence de candidats. Le 8e fut Le Prévost. Il a raconté lui-même comment il entra à la Conférence de Charité sur la proposition qui lui en fut faite par quelques-uns de ses membres, prenant leur repas dans le même restaurant que lui . Un peu plus âgé que ses confrères, animé d’un zèle ardent, il allait prendre rapidement une influence heureuse. C’est lui qui devait fonder plus tard la congrégation des Frères de St-Vincent de Paul.
Et puis voici de nouvelles recrues: Emmanuel de Condé, présenté par Bailly; Charles Hommais, ancien élève de Stanislas, présenté par Lallier; Henri Pessonneaux, Chaurand et Gignoux, présentés par Ozanam, tous étudiants. A la fin de l’année scolaire, en 3 mois, le nombre des Confrères avait plus que doublé, ils étaient 15; 15 jeunes gens unis non pas seulement par une conformité de sentiments pieux et charitables, mais aussi par une amitié cordiale qui s’épanchait souvent, même au cours des séances, en saillies d’une franche et juvénile gaieté.
Les ressources de l’Œuvre étaient fort modestes; la bourse d’un étudiant n’a jamais été très garnie. Mais le paternel Bailly, de temps à autre, laissait tomber dans le chapeau du trésorier, quêtant ses confrères, quelques écus qui «faisaient sensation». C’était le prix des articles donnés, gratuitement d’ailleurs, et presque chaque semaine, à la Tribune Catholique son journal, par quelques-uns des membres de la Conférence, plus spécialement par Ozanam. Et ainsi cette œuvre naissante vivait comme il avait été prévu, avec les seules ressources provenant de la charité de ses jeunes membres, cependant peu fortunés.
Leur piété ne le cédait en rien à leur charité. On les avait vus, au mois de juin, sur l’initiative d’Ozanam, s’adjoindre quelques amis et s’en aller, une trentaine, à pied, jusqu’à Nanterre, pour y prendre part à la procession de la Fête-Dieu, pèlerinage joyeux, et protestation vivante contre l’interdiction récente des processions à Paris.
Survinrent, à la fin d’août, les vacances universitaires; nos jeunes gens se séparèrent pour deux mois, rentrant dans leur famille, et se donnant rendez-vous pour la rentrée prochaine, au mois de novembre suivant.
§
Dès leur retour à Paris, la Conférence de Charité dut déménager. La Tribune Catholique, le journal de Bailly dans les bureaux duquel elle avait jusqu’ici tenu ses séances, avait fusionné avec l’Univers Religieux, récemment fondé par l’abbé Migne; les locaux de la rue du Petit-Bourbon-Saint-Sulpice lui étaient désormais fermés. Bailly lui offrit l’hospitalité dans une pièce située au rez-de-chaussée de l’immeuble qui abritait la Conférence d’histoire, 11, place de l’Estrapade, et dont lui-même occupait un étage avec sa famille. C’est dans ce rez-de-chaussée que pendant toute l’année 1833-1834, la Conférence tint ses séances, chaque mardi, à 8 heures du soir.
Ozanam, rentrant à Paris, avait amené avec lui un petit groupe de jeunes Lyonnais: Quelques anciens élèves du collège de Juilly furent présentés: on se trouva subitement 25.
Devant ce développement subit, il parut nécessaire de régulariser le fonctionnement de l’Œuvre. Il fut décidé que chaque séance ferait l’objet d’un procès-verbal succinct, rédigé par un secrétaire qui serait adjoint au président Bailly et au trésorier Devaux pour constituer le bureau de la Conférence. Chaurand fut nommé secrétaire. Le premier procès-verbal qu’il rédigea fut celui de la séance du 17 décembre 1833.
Il révèle, d’une part, que chaque membre de la Conférence visitait plusieurs familles, et d’autre part que déjà la Conférence commençait à être connue et appréciée dans son quartier, puisque l’un des administrateurs du Bureau de bienfaisance de l’arrondissement, sollicitait le concours des confrères pour remplir les fonctions de Commissaires. Bien entendu sa requête fut accueillie, et plusieurs membres acceptèrent immédiatement cette nouvelle charge, notamment: Chéruel, Labarthe, de Francheville, Antonin Serre, Ozanam et Lallier. Deux d’entre eux devaient même être par la suite nommés administrateurs: Chaurand en 1835, Lallier en 1836.
Le procès-verbal de la séance suivante nous présente un édifiant tableau; c’est le second volet de ce dyptique qui résume l’esprit de l’Œuvre: Charité et Piété. C’est le mardi 24 décembre, veille de Noël: à la fin de la séance, Devaux trésorier, qui la préside en l’absence de Bailly, propose à ses confrères de réciter, avant de se séparer, les matines de la Nativité. La proposition est acceptée avec enthousiasme. Et l’on ne peut sans émotion se représenter ce groupe de 25 jeunes gens récitant pieusement l’Office, à l’heure où la plupart de leurs camarades s’adonnent aux plaisirs dangereux d’un réveillon profane.
§
Le caractère accentué de piété, qui marquait d’un cachet spécial cette œuvre exclusivement laïque lui faisait désirer vivement l’approbation et le concours, tout au moins moral, du clergé.
Pourquoi s’était-elle fondée en dehors de lui?... Pourquoi cette dérogation aux usages qui n’admettaient alors de groupement catholique que dûment approuvé par l’autorité ecclésiastique et doté par elle d’un directeur spirituel? C’est qu’elle était une nécessité de l’heure. Mgr Ozanam, écrivant la vie de son frère, l’a nettement précisé : «Les préventions, dit-il, qu’inspirait, à cette époque, le clergé aux chrétiens médiocrement instruits et peu pratiquants, auraient été un motif de répulsion pour les jeunes gens sur lesquels on voulait précisément exercer une salutaire influence... A défaut de préjugés, le respect humain les en aurait éloignés: Les quolibets et les railleries les plus offensantes ne leur auraient assurément pas manqué, si le clergé avait eu la haute main sur leur association... Lorsque les premiers membres de la Société de St-Vincent de Paul formèrent la résolution de se livrer aux œuvres de charité, il n’y avait pour eux aucune obligation d’en informer l’autorité ecclésiastique, ni d’obtenir son approbation pour exécuter leur pieux dessein... Et ce qui démontre d’une manière péremptoire que les fondateurs n’ont pas fait fausse route, c’est l’approbation que la Société de St-Vincent de Paul a reçue des Souverains Pontifes... qui ont trouvé bon qu’elle prît et gardât le caractère d’œuvre laïque... et jugé, qu’ainsi constituée elle pourrait servir utilement les intérêts de la religion .»
Bailly était bien placé pour accréditer la Conférence de charité auprès de l’autorité ecclésiastique, car il était fort apprécié d’elle; et dès qu’il avait vu l’Œuvre prendre un essor qui semblait répondre de son avenir, il en avait entretenu d’abord son curé, l’abbé Faudet, successeur, à St-Etienne-du-Mont, de l’abbé Olivier, et ensuite l’archevêque, Mgr de Quélen. Le procès-verbal de la séance du 31 décembre 1833 relate: «M. le Président... rapporte les bienveillantes paroles de Mgr l’archevêque au sujet de la Société, ainsi que l’approbation qu’y a donnée M. le Curé de la Paroisse.»
Ce dernier témoigna même le désir de demeurer en communication avec elle, pour l’éclairer dans la distribution des secours . La Conférence ne pouvait dédaigner une collaboration si précieuse. En conséquence, le secrétaire, Chaurand, fut chargé de se rendre auprès de M. le curé tous les quinze jours; ce qu’il faisait le mardi matin, rapportant le soir même, à la séance, les renseignements fournis sur les familles indigentes visitées ou à visiter.
Quant à Mgr de Quélen, dès le début du mois de janvier 1834, il voyait venir à lui trois des fondateurs de la Conférence de Charité, Ozanam, Lamache et Lallier, désireux de reprendre auprès de lui les démarches tentées sans succès par eux l’année précédente, pour obtenir l’institution, dans la chaire de Notre-Dame, d’un cours d’apologétique chrétienne approprié aux exigences de l’époque, et spécialement destiné à combattre l’enseignement athée de la Sorbonne.
De ces démarches, les «Origines de la Société de St-Vincent de Paul» donnent ce compte rendu savoureux:
«L’audience eut lieu le jour indiqué, — 13 janvier 1834 — dans le salon de Mgr de Quélen. Le prélat eut la condescendance d’exposer aux trois jeunes gens les mesures prises pour réaliser leur vœu... Plusieurs prédicateurs choisis parmi l’élite de son clergé devaient successivement occuper, pendant les dimanches du Carême, la chaire de Notre-Dame, et y prêcher sur des sujets de nature à captiver l’attention de leurs jeunes auditeurs.
«Les trois envoyés avaient été chargés par leurs amis de demander que l’enseignement spécial, objet de la pétition fût confié, soit à l’abbé Lacordaire, soit à l’abbé Bautain. Ils témoignèrent donc le désir d’avoir l’un de ces deux orateurs, exprimant franchement, et avec la plus respectueuse déférence la crainte qu’une série de prédicateurs, donnant chacun un sermon sur un sujet différent, ne produisît pas les résultats que l’on pouvait attendre d’un enseignement unique et fortement coordonné.
«Pendant que la conversation suivait son cours sur ce terrain délicat, la porte s’ouvrit et on annonça l’abbé de Lamennais. Mgr de Quélen se leva aussitôt, courut au-devant de lui, lui prit la main, et se tournant vers les jeunes gens: «Voilà, Messieurs, leur dit-il, l’homme qui vous conviendrait. Si ses forces et sa voix lui permettaient de se faire entendre, il faudrait ouvrir toutes grandes les portes de la cathédrale, et elle ne serait pas assez vaste pour contenir la foule des auditeurs. » — «Oh, moi, Monseigneur, répondit Lamennais, ma carrière est finie .» Les trois jeunes gens s’étaient levés au moment de l’entrée du nouveau visiteur: ils prirent congé de l’archevêque, et se retirèrent.
«Le lendemain, un journal publiait, en tête de ses colonnes, un court récit de la réception des trois jeunes gens et de l’incident relatif à l’abbé de Lamennais. Émus de cette indiscrétion, Ozanam et Lallier, après en avoir conféré avec Lamache, qui ne pouvait se joindre à eux, se rendirent dès dix heures du matin chez Mgr de Quélen, qui vint les recevoir dans son antichambre. Ils s’empressèrent de lui exprimer leurs regrets de la publicité intempestive donnée par une feuille publique à la conversation de la veille. Mgr de Quélen se fit apporter le numéro du journal qu’il n’avait pas encore lu, et, après avoir parcouru l’article: «Ces journalistes n’en font jamais d’autres», dit-il. Et comme les deux jeunes gens lui renouvelaient leurs excuses, il s’approcha en les rassurant, entoura de ses bras leurs deux têtes, et les attirant à lui dans une même étreinte, les embrassa paternellement. «Les prédicateurs que je vous destine, ajouta-t-il, sont réunis dans mon salon. Je vais vous présenter à eux, et, pendant que je vais déjeuner, vous leur expliquerez ce que vous voulez.»
«Ainsi introduits dans le salon, les deux amis s’y trouvèrent en présence des orateurs désignés pour porter la parole à Notre-Dame durant le carême suivant . La présentation faite, et l’archevêque s’étant retiré, la conversation s’engagea entre les jeunes gens, qui cherchaient à expliquer de leur mieux quelle sorte d’enseignement ils désiraient, et les prédicateurs, qui se faisaient fort de répondre à toutes leurs vues. On ne tarda pas à s’animer, et pendant que les plus calmes causaient debout auprès du foyer, M. l’abbé Thibault — depuis évêque de Montpellier — discutait vivement avec Ozanam, tout en faisant le tour du salon. A un moment où ils se trouvaient à l’extrémité de la pièce opposée à la porte, parlant à haute voix, l’archevêque rentra, M. l’abbé Thibault étendant vers lui les bras, s’écria: «Monseigneur, nous nous entendons avec ces Messieurs: nous nous entendons parfaitement. — Si vous ne vous entendez pas — répliqua l’archevêque en souriant, on vous entend bien.» Les jeunes gens se retirèrent après avoir remercié le prélat de son extrême bonté.»
La combinaison adoptée par Mgr de Quélen ne devait pas, ne pouvait pas avoir le succès qu’il en espérait; mais dès l’année suivante, nos étudiants obtenaient la réalisation de leur rêve. En 1835, l’abbé Lacordaire, alors âgé de 33 ans, inaugurait ces Conférences d’apologétique chrétienne auxquelles son verbe magnifique allait donner un éclat singulier, et qui, depuis un siècle, groupent, chaque année, au pied de la chaire de Notre-Dame, une foule considérable, avide d’entendre une parole, toujours éloquente, l’entretenir des vérités éternelles.
Pour leur début dans la carrière de l’apostolat, nos jeunes ancêtres comptaient un beau succès!
§
Le 4 février 1834 est une date dans la vie de la «Conférence de Charité » : c’est le jour de son baptême. Elle s’était bien mise, dès sa fondation, sous la protection du grand saint qui personnifie la charité et l’humilité : mais elle n’avait pas été plus loin. Or, ce jour-là, Le Prévost, au nom de plusieurs confrères, émit le vœu que la Conférence se plaçât de façon plus étroite sous le patronage de saint Vincent de Paul, qu’une invocation lui fût adressée au cours des prières prononcées au début et à la fin de chaque séance, et que sa fête fût célébrée solennellement par la Conférence. Cette proposition fut accueillie avec enthousiasme, et à partir de ce jour la «Conférence de Charité » s’appela la «Conférence de St-Vincent de Paul».
Ozanam, de son côté, manifesta le désir que l’Œuvre se mît également sous la protection de la Sainte Vierge, l’invoquât dans ses prières, et choisît l’une de ses fêtes pour l’honorer d’une manière spéciale. Sa proposition fut adoptée comme la précédente, à l’unanimité ; l’Ave Maria fut ajouté aux prières de chaque séance, la fête de l’Immaculée Conception fut choisie. Ainsi, depuis près d’un siècle, le 19 juillet et le 8 décembre, demeurent les deux fêtes de la Société.
Le procès-verbal de cette même séance révèle que, dès cette époque, la Conférence s’employait à distribuer de bonnes lectures à ses familles indigentes, et fondait dans ce but une bibliothèque; que, d’autre part, elle distribuait régulièrement des vêtements à ses pauvres, grâce à l’institution d’un vestiaire alimenté par les confrères. Bibliothèque et vestiaire, voilà donc les deux premières œuvres fondées par la Conférence: et cela caractérise son double but: satisfaire aux besoins moraux et matériels du pauvre.
Deux mois plus tard la Conférence trouvait une occasion spéciale d’affirmer sa dévotion au saint patron qu’elle venait de choisir.
Pendant la Révolution, le corps de saint Vincent de Paul avait été transporté en province pour le soustraire à toute profanation: les iconoclastes de 1793 n’avaient pu détruire que sa châsse vide. En 1834, cette précieuse relique était déposée depuis quelques années déjà, au collège de Roye, en Picardie, et les Pères Lazaristes avaient décidé de la réintégrer dans leur chapelle de la rue de Sèvres. Des fêtes furent organisées par eux à cette occasion: la Conférence de St-Vincent de Paul s’y associa avec une pieuse émotion, dont on retrouve la trace dans ces quelques lignes des «Origines».
«Bailly, président de la Conférence, obtint pour elle la permission de visiter, dès la veille de la cérémonie, les reliques du Saint. Avertis et heureux de cette faveur, les membres de la Conférence se rendirent, au nombre d’environ 60, dans la matinée du 12 avril, à la chapelle des Lazaristes. Après avoir entendu la messe, ils passèrent dans la salle voisine, où le corps se trouvait exposé, revêtu de ses ornements sacerdotaux... Tous les assistants s’agenouillèrent, se recueillirent et prièrent en silence. Puis, chacun vint, à son tour, baiser les pieds de celui qui, pareil à son divin Maître, avait passé sur la terre en faisant le bien.» Chaque confrère avait, d’ailleurs, voulu contribuer individuellement à l’acquisition de la nouvelle châsse du saint patron de la Conférence.
Cette même dévotion amenait à Clichy, le 20 juillet suivant, dimanche consacré par cette paroisse à fêter solennellement celui qui avait été jadis son curé, un groupe important de confrères revendiquant l’honneur de porter sa châsse sur leurs épaules pendant tout le cours de la procession. Là, comme à Nanterre, où nos jeunes gens avaient renouvelé le 27 mai, jour de Fête-Dieu, leur pèlerinage de l’année précédente , la population fut grandement édifiée par la pieuse manifestation des Confrères de St-Vincent de Paul: le clergé leur en manifesta sa reconnaissance.
§
L’abbé Faudet voulut donner à la jeune Conférence, sa paroissienne, une preuve manifeste de sa bienveillance et lui fit connaître son désir d’assister à une de ses réunions. Le 27 juin 1834, sous sa présidence, se tint la première séance solennelle de l’Œuvre, séance au cours de laquelle, un rapport, lu par de la Noue, sur son origine et son fonctionnement, constate que les dépenses de l’année se sont élevées à la modeste somme de 1.401 francs... M. le curé clôtura la réunion par une allocution cordiale, paternelle, et pleine d’encouragements pour ses jeunes auditeurs.
Bientôt les appels au dévouement des confrères commencèrent à se multiplier. La Sœur Rosalie réclamait et, naturellement obtenait, quelques-uns d’entre eux pour aller enseigner l’orthographe à des ouvriers de la rue de Vaugirard. Les Sœurs de la rue des Fossés St-Victor en demandaient deux pour instruire des vérités de la religion un jeune tuberculeux moribond, qui, grâce à eux, faisait une fin fort édifiante. Mlle Dumartray, fondatrice de l’Œuvre de la Miséricorde, sollicitait et obtenait le concours de plusieurs pour la distribution de ses secours et les diverses fonctions de son Œuvre. M. de Belleyme, président du Tribunal civil de la Seine leur ouvrait, dans un but de moralisation, les portes de la maison de correction pour jeunes détenus, située rue des Grès, au quartier des Écoles. Et pendant plus de deux années, jusqu’au jour où cette maison fut supprimée, un certain nombre de confrères, parmi lesquels Le Prévost, Ozanam, Lamache, Le Taillandier, venaient s’enfermer chaque semaine, pendant quelques heures, dans ce «lazaret moral» où leur apostolat se heurtait à l’ignorance religieuse la plus complète, à l’impiété la plus farouche, de gamins de 15 ans proclamant leur athéisme avec fanfaronnade.
Fort heureusement, le nombre des confrères augmentait de mois en mois, au point même de faire naître, dans l’esprit de ses premiers fondateurs, la crainte de se voir acculés, quelque jour prochain, à la nécessité de dédoubler la Conférence, dont les séances devenaient de plus en plus difficiles et perdaient chaque jour davantage leur caractère originel d’intimité.
Une autre question même apparaissait à l’horizon, celle de la création de Conférences en province: A la séance du 10 juin, Ozanam avait présenté un de ses camarades de Lyon, maintenant établi à Nîmes, et qui, de passage à Paris, avait manifesté le désir d’assister à une réunion de la Conférence. Fraternellement accueilli, et fort impressionné, Curnier avait remercié de l’accueil qui lui était fait, et annoncé sa ferme résolution de fonder à Nîmes une Conférence en tous points semblable à celle de Paris.
Ainsi se terminait l’année 1833-1834, riche assurément de résultats obtenus, plus riche encore d’espérances conçues. Nos étudiants quittaient Paris, joyeux des progrès de leur Œuvre, et la conscience d’autant plus tranquille que, cette fois, la visite des pauvres ne devait plus être, comme l’année précédente, suspendue pendant la durée des vacances. Plusieurs membres de la Conférence, parmi les recrues nouvelles, demeuraient à Paris toute l’année, et considérant que la misère, elle, ne prend pas de vacances, acceptaient d’assurer la visite des familles pendant l’absence de leurs confrères.
L’Œuvre était en bonne voie: quinze mois lui avaient suffi pour obtenir des résultats aussi substantiels qu’imprévus.