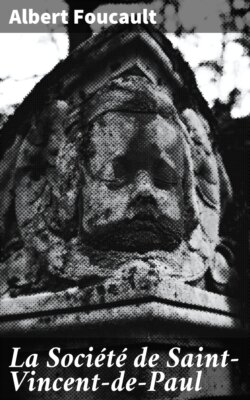Читать книгу La Société de Saint-Vincent-de-Paul - Albert Foucault - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA NAISSANCE (1833)
ОглавлениеAu mois de novembre 1831 arrivait à Paris, pour y achever ses études de droit, un jeune homme de 18-ans, dont les parents habitaient Lyon, où son père exerçait la médecine.
Né à Milan pendant l’occupation française (28 avril 1813), il avait grandi, dit-il, «sur les genoux d’un père chrétien et d’une sainte mère.» Sa formation morale et religieuse avait été complétée par un professeur éminent du collège de Lyon, l’abbé Noirot, dont Francisque Sarcey dira plus tard qu’il était «un grand pétrisseur d’âmes.» Il avait fait ses débuts dans la vie active, en consacrant ses loisirs d’étudiant à la rédaction d’articles de journaux, voire même à la publication d’une brochure contre le Saint-Simonisme qui lui avait valu — à 17 ans — les félicitations de Lamartine. Ce jeune homme s’appelait Frédéric Ozanam.
D’heureuses circonstances allaient défendre le jeune provincial contre les dangers de l’isolement, et calmer l’anxiété que causait à M. et Mme Ozanam la présence de leur fils dans ce Paris, où l’émeute sévissait encore à l’état endémique. Quelques semaines à peine après son arrivée, il se voyait offrir l’hospitalité par un compatriote lyonnais, l’illustre Ampère, membre de l’Institut, au foyer duquel il trouvait une intellectualité supérieure, une sentimentalité religieuse très vivante, un charme prenant.
Le but de Frédéric Ozanam, en venant à Paris, n’était pas seulement d’y poursuivre ses études juridiques et littéraires. Il l’a dit lui-même dans l’avant-propos de la «Civilisation au Ve siècle». «Touché d’un bienfait si rare — (la foi) — je promis à Dieu de vouer mes jours au service de la vérité.» Et sa correspondance nous révèle par quel moyen il entendait rendre ce service fructueux. Son rêve était de grouper «des jeunes gens pensant et sentant comme lui... travaillant ensemble à l’édifice de la science, sous l’étendard de la pensée catholique. »
Or, ce groupement de jeunesse, il avait existé à Paris, pendant les dernières années de la Restauration: c’était la société des Bonnes Etudes, dirigée par Bailly qui dès 1832 essayait de la reconstituer en réunissant quelques étudiants catholiques pour traiter de questions d’histoire, de droit, de littérature, de philosophie. On appelait cette réunion la «Conférence d’Histoire».
Frédéric Ozanam s’empressa de pénétrer dans ce petit cénacle. C’était, le meilleur terrain pour rencontrer et connaître les étudiants catholiques, peu nombreux alors, dispersés dans Paris, et s’ignorant les uns les autres.
Il y prit, en même temps, contact avec une jeunesse universitaire appartenant à toutes les opinions, car rapidement la Conférence d’Histoire avait ouvert ses portes à tous contradicteurs et était devenue un champ clos où s’affrontaient toutes les théories religieuses, historiques, philosophiques ou sociales, soutenues avec cette chaleur et cette intransigeance que n’a point encore émoussées l’expérience de la vie. Et la question religieuse était, alors, trop brûlante pour ne pas se retrouver au terme de toutes les discussions. Un des membres les plus assidus de ces réunions hebdomadaires écrira plus tard, en parlant d’elles: «On traitait de omni re scibili et quibusdam aliis, mais, la question religieuse se mêlait à tout .»
Frédéric Ozanam conquit bien vite, dans ce milieu, une prééminence indiscutée, non pas qu’il exerçât sur son entourage une séduction physique: de taille médiocre, et sans élégance, d’allure timide et plutôt embarrassée, de tenue négligée, les yeux gris, doux, plutôt tristes au repos, il n’attirait pas, tout d’abord, l’attention. Il ne possédait aucun de ces avantages extérieurs souvent précieux à l’orateur. Mais lorsque sous une impression vive, il prenait la parole pour la défense des idées qui lui étaient chères, alors, sitôt surmontée cette gêne du début, définie par Lacordaire «ce mal d’éloquence qui s’empare de quiconque dit son âme devant un auditoire», il révélait tout l’éclat de ses facultés: érudition remarquable, acquise par un travail intense, et servie par une mémoire prodigieuse: maturité d’esprit surprenante chez un si jeune homme, imagination vive et cependant disciplinée, parole élégante, colorée, persuasive, révélant l’exquise sensibilité d’une âme embrasée de convictions ardentes, réalisant l’idéal de l’éloquence tel que Fénelon la conçoit «la forte et persuasive manifestation d’une âme noblement inspirée.» De là cette primauté due à sa supériorité intellectuelle et reconnue d’autant plus volontiers par ses camarades que son caractère attirait toutes les sympathies par une modestie parfaite.
Bien vite il fut considéré comme un chef, et dès ce moment on le retrouve partout et toujours à la tête de cette petite phalange de jeunes étudiants décidés à défendre leur foi. Lorsque quelques-uns d’entre eux se trouvèrent froissés dans leurs convictions religieuses par les propos agressifs des professeurs en Sorbonne Letrosne et Jouffroy, c’est Ozanam qu’ils chargèrent de formuler leurs protestations; et il le fit avec une telle insistance que Jouffroy, notamment, se vit obligé de s’excuser et de promettre à l’avenir une plus grande réserve, couvrant sa retraite de cette réflexion mélancolique, mais suggestive; «Messieurs, il y a 5 ans, je ne recevais que des objections dictées par le matérialisme... aujourd’hui, les esprits ont bien changé : l’opposition est toute catholique. »
Ozanam était le «Saint Pierre de ce petit Cénacle». Lui-même se plaint, dans une lettre adressée à l’un des siens, qu’on veuille faire de lui une sorte de chef de la Jeunesse catholique . Et il n’avait pas 20 ans! Suivant l’expression de Lacordaire, «tout fleurissait vite dans cette âme que le temps et l’éternité pressaient de vivre.»
§
Parmi les étudiants qui se groupaient autour d’Ozanam à la Conférence d’histoire, il en est deux: Lamache et Lallier, qui formaient avec lui une sorte de directoire, appelé «commission d’études».
Un jour que Lallier s’entretenait avec un des membres de ce petit groupe, Le Taillandier, celui-ci manifesta la lassitude que lui causaient ces discussions, stériles suivant lui, et dit combien il lui semblerait préférable de fonder entre étudiants catholiques une association de piété et de charité. Cette suggestion, rapportée à Ozanam et à Lamache, allait bientôt germer dans l’esprit de nos jeunes gens, et reparaître tout à coup à l’issue d’une séance orageuse de la Conférence d’histoire.
Un étudiant, faisant l’éloge du scepticisme de Byron, avait fort malmené la religion catholique. Ozanam l’avait comme d’habitude vivement défendue: mais il sortit de la réunion très frappé de l’objection formulée par ses adversaires qui lui disaient: «Vous avez raison si vous parlez du passé ; le christianisme a fait, autrefois, des prodiges; mais actuellement, il est mort! Vous qui vous vantez d’être catholiques, que faites-vous? Où sont vos œuvres, les œuvres qui prouvent votre foi, et qui puissent nous la faire adopter?»
Et Mgr Ozanam ajoute, après avoir rappelé ce souvenir: «Il se retirait tout pensif, réfléchissant à la justesse de l’espèce de défi que leurs adversaires leur avaient jeté, lorsqu’il rencontra, au seuil de la porte, Le Taillandier profondément affecté, lui aussi, de ce qu’il venait d’entendre. «Que faut-il donc faire pour être vraiment catholiques, se dirent-ils... Ne parlons pas tant de charité... faisons-la plutôt, et secourons les pauvres!» Le soir même, honteux d’avoir compris si tard la charité pratique, tous deux portaient, de leurs propres mains, à un pauvre de leur connaissance, le peu de bois qui leur restait pour se chauffer pendant les derniers jours de l’hiver .»
Et voilà déjà réalisée, avant même d’avoir été formulée, l’idée mère d’où va naître, quelques semaines plus tard, la Société de St-Vincent de Paul!
Assurément cet acte individuel n’était pas une réponse suffisante au défi de l’adversaire, il n’était pas davantage la complète satisfaction de ce besoin de charité qui sollicitait ces jeunes gens et retentissait, comme un appel, au fond de leur âme généreuse. Mais à la séance suivante de la commission d’études, chez Lamache, Ozanam fit part à ses deux camarades de la pensée qui l’obsédait: «N’éprouvez-vous pas comme moi, leur disait-il, le besoin d’avoir en dehors de cette conférence militante, une autre réunion, composée exclusivement d’amis chrétiens et toute consacrée à la charité ? Ne vous semble-t-il pas qu’il est temps de joindre l’action à la parole et d’affirmer, par des oeuvres, la vitalité de notre foi?»
«Après un demi-siècle de distance, écrit Lamache en 1882, cette petite scène est toute présente à ma mémoire. Il me semble voir les yeux d’Ozanam chargés de tristesse, mais en même temps, pleins d’ardeur et de feu. Il me semble entendre cette voix qui décelait l’émotion profonde de l’âme.»
Quelques jours plus tard se tint chez un camarade, Antonin Serre, une seconde réunion, à laquelle fut convié Le Taillandier, de qui l’on se rappelait la suggestion première. Ozanam y résumait sa pensée dans ces mots: «Pour que notre apostolat soit béni de Dieu, une chose lui manque; les œuvres de la charité : la bénédiction des pauvres est celle de Dieu!» Et ce fut au cours de cet entretien que l’un de nos quatre étudiants s’écria tout à coup; «Eh bien, fondons une Conférence de charité.»
§
Et sans doute, ils savaient bien ce qu’ils voulaient faire, mais plus riches d’enthousiasme que d’expérience, peu familiarisés avec les contingences de la vie, et spécialement de la vie parisienne, ils n’apercevaient pas très clairement la voie qui les conduirait au but désiré. Car ces quatre jeunes gens, tous quatre étudiants en droit de seconde année, n’étaient âgés que de 19, 20 et 22 ans, et trois d’entre eux arrivaient de leur province.
Ils sentirent qu’il leur fallait recourir aux conseils d’un homme expérimenté qui les aiderait à traduire en actes leurs intentions généreuses. Cet homme, il était tout indiqué, c’était le directeur de leur Conférence d’histoire, Bailly, âgé de 40 ans, marié, père de famille, professeur de philosophie, propriétaire et directeur d’un journal fondé par lui, «La Tribune Catholique», Bailly dont la vie était consacrée aux œuvres, et qui était en relations suivies avec la Sœur Rosalie, la providence des indigents du quartier Mouffetard. C’est à lui qu’il fallait s’adresser.
Ozanam lui fut député par ses camarades pour exposer leur désir, et solliciter ses conseils et son concours.
Sa démarche fut d’autant mieux accueillie qu’elle était particulièrement opportune. Mme Bailly, femme très pieuse et très charitable, avait récemment accepté, sur la demande de Sœur Rosalie, d’aller porter des secours à domicile à quelques familles indigentes. L’accueil qui lui avait été fait l’avait découragée, et de cette expérience malheureuse, M. et Mme Bailly avaient conclu que c’était là «œuvre d’hommes et plus spécialement de jeunes gens». La démarche d’Ozanam, venant proposer la fondation d’une œuvre de Jeunes, pratiquant la charité sous cette forme de la visite du pauvre à domicile, semblait une réponse providentielle aux réflexions de M. et de Mme Bailly. Les ouvertures d’Ozanam furent donc accueillies avec empressement.
Mais s’il approuvait l’idée, Bailly ne dissimulait pas ses appréhensions sur la forme que ces jeunes gens désiraient donner à leur zèle charitable, et en homme prudent, il leur conseilla d’aller prendre l’avis du curé de la paroisse (St-Etienne-du-Mont). Or, l’abbé Olivier — plus tard évêque d’Evreux —, comme beaucoup d’ecclésiastiques de cette époque, se défiait des initiatives laïques. Il accueillit nos étudiants avec autant de scepticisme que de bonhomie, les félicita de leurs bonnes intentions, et finalement les congédia en leur conseillant, sur un ton à demi goguenard, de consacrer leur zèle à faire le catéchisme aux enfants pauvres.
Cette suggestion n’eut naturellement aucun succès, car elle ne répondait nullement au but que ces jeunes gens s’étaient proposé. Ce qu’ils voulaient pratiquer, c’était la visite du pauvre à domicile; et c’est ce qu’ils répétèrent à Bailly en venant lui rendre compte de leur démarche auprès de M. le curé, et de la déception qu’elle leur causait.
Devant la persistance de leurs désirs, Bailly se laissa convaincre: mais il leur fit observer qu’ils n’étaient que quatre, et que c’était bien peu pour fonder une œuvre. Immédiatement Ozanam indiqua deux autres étudiants fréquentant assidûment la Conférence d’histoire, et bien connus d’eux: Clavé et Devaux. Il se chargea de les inviter à faire partie de l’œuvre projetée, et ceux-ci acceptèrent avec empressement.
Restait à trouver le local où se réuniraient périodiquement ces jeunes volontaires de la charité. Bailly leur offrit le bureau de rédaction de son journal. La Tribune Catholique, 18, rue du Petit Bourbon St-Sulpice . Il poussa même plus loin la bienveillance en acceptant la présidence de cette œuvre naissante, à laquelle son expérience, son dévouement et son autorité allaient rendre d’inappréciables services.
Et c’est ainsi qu’au mois de mai 1833. un soir, à 8 heures, se rendaient dans les bureaux de la Tribune Catholique, pour y tenir leur première réunion, sous la présidence de Bailly, six jeunes gens dont voici les noms en suivant l’ordre de leur âge:
Lamache, Paul, 22 ans, étudiant en droit, habitant hôtel Corneille.
Clavé, Félix, 22 ans, étudiant, habitant chez ses parents au Faubourg du Roule.
Le Taillandier, Auguste, 22 ans, étudiant en droit, habitant chez son père, rue de Fleurus.
Devaux, Jules, 21 ans, étudiant en médecine, habitant hôtel de l’École de Droit.
Ozanam, Frédéric, 20 ans, étudiant en droit, habitant en hôtel, 7, rue des Grés .
Lallier, François, 19 ans, étudiant en droit, habitant en hôtel rue St-Jacques .
§
Cette première réunion offre ceci de curieux, qu’elle s’est déroulée suivant un programme qui est encore à l’heure présente, et depuis 100 ans, celui de toutes les séances de Conférences se tenant à travers le monde. Présidée par Bailly, elle s’ouvrit par la récitation du Veni sancte Spiritus suivie d’une lecture de piété empruntée à l’Imitation de Jésus-Christ. Le président prononça une courte allocution, dont le caractère est résumé dans cet extrait. «Si, disait-il, vous voulez être utiles aux pauvres et à vous-mêmes, faites de votre charité une œuvre, moins de bienfaisance que de moralisation et de christianisation, vous sanctifiant vous-même par la considération de Jésus-Christ souffrant dans la personne du pauvre.»
On arrêta ensuite les grandes lignes de l’Œuvre.
Son rôle essentiel serait la visite à domicile des familles indigentes auxquelles on remettrait des secours, non pas en argent, mais en nature, au moyen de bons délivrés sur les commerçants du quartier, et payés à ceux-ci par la Conférence.
Les séances seraient hebdomadaires.
Les ressources normales proviendraient des quêtes faites aux séances, chaque membre fournissant, suivant ses moyens, une contribution dont lui seul fixerait et connaîtrait le montant.
Quant au nom qu’il importait d’adopter pour l’Œuvre, les opinions échangées se rallièrent à la dénomination de «Conférence de Charité » par analogie avec la «Conférence d’histoire» a laquelle appartenaient tous ses membres, et au sein de laquelle son idée première était née.
Une fois prises ces décisions d’ordre général, il fallut résoudre les questions d’ordre pratique.
On décida de demander à Sœur Rosalie, de la Congrégation des Sœurs de St-Vincent de Paul, qui dirigeait, rue de l’Epéede Bois, un véritable ministère de la charité, une liste de familles indigentes à visiter, et de la prier en même temps de bien vouloir prêter à la Conférence un certain nombre des bons employés par elle, en attendant que celle-ci puisse en émettre elle-même. Devaux, nommé trésorier, fut chargé de cette démarche.
La séance se termina par la quête, faite par le trésorier muni de son chapeau, en guise de bourse, et par la récitation de la prière «Sub tuum prœsidium».
La Société de St-Vincent de Paul était fondée!
Œuvre bien modeste assurément et dont nul ne prévoyait alors la surprenante destinée!
Ozanam a raconté dans son discours de Livourne (1er mai 1853) que, quelques semaines après la fondation de la «Conférence de Charité », un de ses amis, qui s’était laissé séduire par les doctrines saint-simoniennes, lui disait avec une affectueuse pitié : «Mais qu’espérez-vous donc faire? Vous êtes huit pauvres jeunes gens, et c’est avec cela que vous avez la prétention de secourir les misères d’une ville telle que Paris! Fussiez-vous encore tant et tant, vous n’y pourriez pas grand’chose. Nous, au contraire, nous élaborons des idées et des systèmes qui réformeront le monde et extirperont la misère à jamais. En un instant, nous ferons pour l’humanité, ce que vous ne pourrez faire en plusieurs siècles.»
Quelles ont été les œuvres du saint-simonisme? il serait cruel de le rechercher. Quant à la Société de St-Vincent de Paul, elle comprenait en 1930, 10.500 conférences répandues à travers le monde, groupant 160.000 membres actifs, et consacrant annuellement au soulagement de la misère humaine une somme de 170 millions.