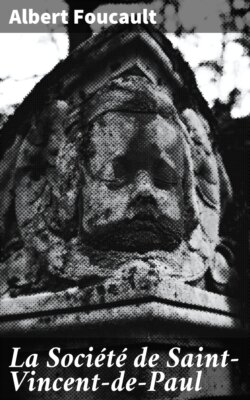Читать книгу La Société de Saint-Vincent-de-Paul - Albert Foucault - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE CONSEIL GÉNÉRAL (1840-1844)
ОглавлениеEn fait, la nouvelle organisation de la Société n’a pas fonctionné dès le lendemain du nouveau règlement. Si le Conseil de direction a tenu sa dernière séance le 26 janvier 1840 et si le Conseil particulier de Paris lui a immédiatement succédé, tenant sa première réunion le 16 février suivant, par contre, le Conseil Général ne s’est constitué qu’un an plus tard. Sa première séance s’est tenue le 27 décembre 1840. Pourquoi? La cause de ce long retard échappe à toute investigation.
Sa première conséquence est que, pendant tout le cours de l’année 1840, le Conseil de Paris cumule ses fonctions normales et celles de Conseil Général. En réalité, le Conseil de direction se survit sous un autre nom: le bureau n’a pas changé, les membres non plus; la seule différence est que les séances sont plus fréquentes, elles sont maintenant mensuelles; mais leur ordre du jour est le même que par le passé : préparation des assemblées générales, correspondance des conférences de province avec les avis et conseils qu’elle comporte, etc. Les questions d’intérêt général et celles qui concernent exclusivement les conférences parisiennes s’entremêlent au cours des délibérations comme jadis aux séances du Conseil de direction. Celui-ci semble avoir simplement changé de nom: on ne peut pas dire que la transition se fait entre l’ancien et le nouveau régime: ce dernier n’est pas encore né, il est seulement conçu.
Cependant, des modifications adoptées, les Conférences parisiennes recueillent un profit certain. La mensualité des réunions du Conseil établit entre elles une liaison plus efficacè et leur permet notamment d’examiner en commun les œuvres annexes adoptées ou susceptibles d’être adoptées, soit par l’ensemble des conférences, soit par chacune d’elles individuellement.
Or deux œuvres créées par les sections de la Conférence de Charité, c’est-à-dire, dès avant 1836, étaient demeurées, à raison même de la date de leur naissance, œuvres de la Société : celle des jeunes détenus et celle des apprentis orphelins.
La première, fondée au mois de juillet 1834 par la Conférence St-Etienne du Mont, — la seule qui existât à cette époque, — avait pour but la moralisation des adolescents internés dans la maison de correction établie dans l’ancien couvent des Jacobins, rue des Grès — aujourd’hui rue Cujas. — Elle n’avait donné aucun résultat appréciable, aucune satisfaction aux zélés confrères qui avaient eu le courage d’entreprendre cette tâche ingrate, et elle tomba d’elle-même lorsque la démolition de l’ancien couvent des Jacobins pour le percement de la rue Soufflot entraîna le transfert de la maison de correction au couvent des Madelonettes, rue des Fontaines, dans un quartier trop lointain pour permettre à la Conférence St-Etienne du Mont d’y poursuivre son œuvre.
La seconde, celle des apprentis orphelins, avait été fondée au mois de novembre 1835, dans les circonstances suivantes: Les Conférences St-Etienne du Mont et St-Sulpice, ayant vu décimer par la mort quelques-unes des nombreuses familles visitées par elles, s’étaient préoccupées d’assurer le sort des enfants devenus orphelins. On loua pour eux un modeste logement dans lequel ils furent recueillis sous la surveillance d’une personne pieuse, jouant vis-à-vis d’eux le rôle de mère de famille, et pourvoyant, aux frais des conférences, à leur nourriture et à leur entretien. Certains confrères venaient, à tour de rôle, leur donner des leçons de lecture, d’écriture, d’arithmétique. Quant à ceux d’entre eux qui avaient atteint l’âge d’apprendre un métier, on en faisait des apprentis imprimeurs, ce que facilitait singulièrement le voisinage de l’imprimerie dont Bailly était, 2, place de la Sorbonne, le propriétaire-directeur. De là le nom de l’Œuvre des apprentis orphelins.
Le nombre de ces enfants ne tarda pas à s’accroître: Dès le 12 avril 1836, il fallut transporter la petite colonie dans un appartement plus spacieux situé rue Copeau — aujourd’hui rue Lacépède. — Un confrère, jeune étudiant, de Kerguelen. poussa le dévouement jusqu’à venir s’installer dans l’immeuble pour assumer la direction de l’orphelinat.
Bientôt les conférences prirent l’habitude de diriger vers la rue Copeau, pour y passer leur après-midi du dimanche, les jeunes apprentis des familles visitées par elles. Ces nouveaux clients furent rapidement une centaine. C’était confondre deux œuvres différentes qui ne pouvaient pas marcher longtemps du même pas: celle des apprentis orphelins internes, et celle des externes, qui était œuvre de patronage.
Et puis, dès 1839, de Kerguélen, ayant terminé ses études, quitta Paris pour regagner sa province: il fut impossible de lui trouver un successeur. Le Prévost, déjà surchargé de fonctions multiples, accepta bien de le remplacer à titre intérimaire; mais il demandait instamment à être déchargé de ce lourd fardeau.
D’autre part le nombre croissant des orphelins et des patronnés du dimanche entraînait une augmentation constante des frais, auxquels la loterie annuelle ne pouvait plus suffire. Les appels de l’œuvre au Conseil, aux Conférences, aux confrères, se multipliaient, marqués au coin d’une certaine anxiété. Dans son ultime séance du 26 janvier 1840, le Conseil de direction avait cru résoudre ces difficultés en assurant à l’œuvre des ressources spéciales, et en la confiant à un directeur assisté d’un comité. Mais celui-ci, quelques mois plus tard, se présentait devant le Conseil de Paris, un rapport à la main, et réclamait une réforme radicale: suppression de l’internat, trop coûteux; placement des orphelins comme apprentis ordinaires chez des patrons choisis, où ils trouveraient le logement et la nourriture, et réunion de ces enfants le dimanche seulement comme pour les externes patronnés.
Ce rapport était l’œuvre du Vte de Melun, dont la compétence en matière de charité et l’esprit pratique d’organisation étaient déjà singulièrement appréciés. Ses propositions furent adoptées par le Conseil qui lui confia la direction de l’Œuvre (6 juillet 1840). Et celle-ci cessa d’être l’Œuvre des apprentis orphelins pour devenir l’œuvre du patronage.
A côté de cette œuvre dépendant du Conseil de Paris plusieurs étaient proposées par les Conférences.
C’était d’abord l’œuvre du placement des ouvriers sans travail: Elle était née à la Conférence St-Médard, sur l’initiative de quelques confrères, bientôt groupés en un Comité, qui, devant les résultats obtenus, proposait au Conseil particulier de faire cette œuvre sienne, afin d’en étendre le bénéfice à toutes les Conférences parisiennes (15 avril-17 mai 1840). La requête fut accueillie, et l’Œuvre fut confiée à un comité spécial installé au siège de la Société, 11, place de l’Estrapade.
C’était ensuite l’Œuvre des militaires, fondée d’abord à Lyon, étendue par la suite à Dijon et à Bordeaux, avec un plein succès. Or, précisément deux régiments, l’un de Dijon, l’autre de Bordeaux, venant à Paris tenir garnison, les Conférences de ces deux villes, demandaient au Conseil de Paris de continuer auprès de chacun d’eux l’œuvre entreprise. Le Conseil n’osa pas la faire sienne, mais il confia le soin de la poursuivre aux Conférences ayant une caserne dans leur voisinage, et il invita les confrères appartenant aux autres Conférences parisiennes à leur apporter leur concours individuel (15 avril-17 mai- 16 juillet 1840).
Enfin, l’on voit cette même année apparaître le germe d’une œuvre qui devait, après une longue éclipse, renaître en 1925 avec une organisation perfectionnée: l’œuvre de la visite des malades dans les hôpitaux. Un membre de la Conférence Notre-Dame de l’Abbaye aux Bois, étudiant en médecine, externe à l’Hôpital de la Pitié, demandait que des confrères vinssent visiter les indigents soignés à son hôpital. Le Conseil, réservant l’avenir, l’engagea à poursuivre la réalisation de son projet, à recruter pour un essai modeste des confrères visiteurs, et à lui communiquer ultérieurement les résultats de sa campagne.
A côté de ces œuvres parisiennes, d’autres étaient nées en province. A Dijon avait été fondée l’œuvre des Petits Savoyards pour donner quelques éléments d’instruction religieuse aux enfants qui, chaque année, se répandaient alors en France en qualité de ramoneurs. Les Conférences de Lyon soignaient gratuitement les indigents malades à domicile, en chargeant du soin de les visiter les médecins qu’elles comptaient dans leur sein et en faisant délivrer les médicaments par deux pharmaciens moyennant un abonnement annuel de 400 francs. D’autre part Rennes avait fondé une salle d’asile dont la direction était confiée aux sœurs de la Providence, et qui rencontrait un tel succès qu’il lui fallut rapidement en créer trois autres pour abriter 500 enfants. Dijon imprimait et distribuait à profusion un almanach catholique. Les confrères de Metz se relayaient pour aller, chaque soir, faire une lecture commentée dans les prisons et les dépôts de mendicité de la ville; à Bordeaux, ils pénétraient, le dimanche, dans les prisons pour donner, eux-mêmes, dans la chapelle, des conférences réconfortantes: Nantes fondait l’Œuvre du prêt aux ouvriers; Lyon répondait à l’appel du Patronage des Libérés qui sollicitait le concours des confrères et Ozanam l’apprenait au Conseil de direction dans une lettre qui contait en même temps l’épilogue de la surprenante odyssée des Persans dans les termes suivants: «Questionnés par nous, dit-il, sur les différents pays qu’il leur avait fallu traverser pour arriver en France, ils n’ont pu nous répondre que par des mots décousus, mais qui peignent bien leur pensée: «Russe bien méchant, point de pain, toujours marcher; Polonais bon, pleurer, mais pauvre; Prussien, s’en aller vite, officier police; Français beau, riche, grand, généreux, aimer toujours.» Et Ozanam ajoute: «Ces bons Persans vont donc porter au loin un magnifique souvenir du nom français... La Société de St-Vincent de Paul est intervenue à sa manière dans les affaires d’Orient, ce n’est peut-être pas la plus mauvaise».
§
L’activité du Conseil de Paris et l’importance de son rôle avaient nécessité l’ouverture de ses bureaux, place de l’Estrapade, chaque jour de 11 heures à 2 heures sous la direction d’un secrétaire. Mais en même temps s’accusait l’urgence de le décharger de ses fonctions de Conseil Général intérimaire, et l’on ne saurait être surpris de voir Ozanam revenir avec insistance sur la nécessité de créer rapidement cet organe de direction générale qui, pour avoir été prévu par le nouveau règlement, n’en demeurait pas moins, en fait, inexistant.
Enfin, son vœu fut exaucé : au cours de l’assemblée générale du 8 décembre 1840. Bailly annonça la naissance prochaine du Conseil Général, et la première séance de celui-ci se tint le 27 décembre suivant. Il était composé du bureau de l’ancien Conseil de direction, demeuré à la tête du Conseil de Paris, Bailly, Le Prévost, de Baudicour et de Riancey qui conservaient leurs fonctions respectives de président, vice-président, secrétaire et trésorier, et auxquels se trouvaient adjoints! de Villeneuve-Bargemont, Ozanam, Cornudet, Lauras, Tessier et Baudon, ce dernier tout jeune encore — âgé de 21 ans, — et qui devait diriger plus tard la Société, pendant 38 ans, avec une incomparable maîtrise. Dès le mois suivant, à ces noms s’ajoutait celui d’un confrère qui allait mériter, par la suite, le glorieux surnom de «Ministre de la Charité » : le Vte de Melun.
Le Conseil Général, ainsi constitué, fonctionna sous la présidence de Bailly, jusqu’au 15 mai 1844, c’est-à-dire exactement pendant 3 ans et 5 mois, avec quelques légères modifications dans sa composition. Tessier et de Villeneuve-Bargemont se retirèrent; de Raincourt y fut appelé le 5 janvier 1843, Ferrand de Missol, Rivollet et de Saint-Maur y entrèrent le 20 mai de la même année.
Le travail fourni par le Conseil Général pendant cette période fut important. Ses séances d’abord mensuelles, devinrent bientôt bimensuelles et souvent même hebdomadaires. Le bureau prit l’habitude de se réunir en outre chaque semaine. Deux vice-secrétaires, l’un pour Paris, l’autre pour la province, furent adjoints au secrétaire général, et la correspondance devint bientôt assez lourde pour qu’il fallût la répartir entre les membres du Conseil avec mission de préparer les réponses.
Le rôle incombant au Conseil était complexe: Asseoir son autorité afin de pouvoir imposer à toutes les Conférences une règle de vie uniforme, au moins dans ses grandes lignes: les conseiller, les guider, servir de lien pour cimenter ces pierres un peu disjointes qui semblaient souvent sollicitées par une force centrifuge; défendre l’Œuvre contre tout ce qui, du dedans ou du dehors, menaçait de compromettre son esprit ou son avenir; favoriser son expansion en conquérant l’estime et les sympathies des catholiques et spécialement du clergé ; toutes ces tâches diverses se présentaient à lui pêle-mêle, au jour le jour, sous l’aspect de questions encore neuves, réclamant d’immédiates solutions, qui allaient être les premières assises de traditions appelées à régir la Société pendant de longues années.
Ces questions se multipliaient naturellement avec le développement de l’Œuvre. Si au 31 décembre 1839 elle ne comptait que 39 Conférences — 16 à Paris et 23 en province — elle devait en juillet 1844, en comprendre 144 — 32 à Paris, 109 en province et 3 à l’étranger (2 à Rome et 1 à Nice, alors dans les États Sardes). Et ce ne sont pas là des cadres vides, car du 31 décembre 1839 au 31 décembre 1843 on voit s’élever le nombre des membres actifs de 1.068 à 4.561, celui des membres honoraires de 152 à 2.291; les bienfaiteurs sont 3.725: et voici que naît la catégorie des membres aspirants qui déjà sont au nombre de 207.
Les recettes qui s’élevaient en 1839 à 54.000 fr., se montent pour l’année 1843 à 356.000 fr. permettant de distribuer à 10.000 familles des secours de toute nature, parmi lesquels émergent 440.000 kilogrammes de pain. Cette petite Conférence de charité fondée en 1833 par six jeunes gens sans ressources, enserre déjà, après dix ans écoulés, la France entière dans un réseau charitable.
§
Ce développement rapide, le Conseil Général a d’abord à le régulariser. Il pose ce principe qu’aucune conférence ne pourra faire partie de la Société sans avoir reçu de lui une lettre officielle d’agrégation, qui sera accordée sur demande accompagnée d’un petit dossier comprenant le règlement adopté par l’impétrante et l’approbation des autorités ecclésiastiques locales. Ce règlement doit prévoir comme œuvre fondamentale la visite du pauvre à domicile et ne contenir aucune disposition importante qui soit en contradiction avec le règlement général de la Société. A ces prescriptions qui lui semblent nécessaires au maintien de l’unité, il attache, à juste titre, une telle importance qu’il ne cède jamais devant les objections élevées contre elles. S’il n’obtient pas satisfaction, l’agrégation se trouve indéfiniment ajournée. Le plus souvent, il arrive à triompher, mais au prix d’une persévérance patiente qui, parfois, se prolonge pendant des années: l’agrégation des Conférences de Belgique en offre un exemple saisissant.
Dès le mois d’août 1842, le Cardinal Sterchx, archevêque de Malines, annonçait au Conseil Général, heureux de recevoir cette bonne nouvelle, son intention d’implanter l’Œuvre en Belgique. Mais Bruxelles, en janvier 1843, envoyait un dossier révélant que l’œuvre fondée était en réalité une confrérie de la Sainte Vierge dont le règlement n’avait rien de commun avec celui de la Société de St-Vincent de Paul. L’agrégation ne pouvant être accordée dans ces conditions, le Conseil Général demanda la modification des statuts. Bruxelles ne répondit pas, essaima dans quelques villes voisines, et six mois plus tard, écrivit au Conseil Général pour lui annoncer son développement, et la création d’un comité central, qui serait heureux, disait-il, d’entretenir avec le Conseil Général de Paris des relations «fraternelles». Celui-ci répondit avec tous les ménage ments voulus, que des rapports «fraternels», si précieux qu’ils fussent, étaient insuffisants et que l’agrégation comportait des relations familiales d’une autre nature. Une année s’écoula après laquelle Bruxelles formula une demande officielle d’agrégation pour son comité central et les conférences relevant de lui. La réponse ne pouvait varier: la nature, l’esprit, le règlement des Conférences belges étaient tellement différents de ceux de l’Œuvre fondée à Paris, que la demande ne pouvait être accueillie. En vain Bruxelles envoya un délégué spécial plaider sa cause devant le Conseil Général; le délégué se heurta à une question de principe sur laquelle aucune concession n’était possible. Et ce ne sera qu’après avoir consenti aux modifications voulues dans la constitution de ses conférences, que la capitale de la Belgique, en 1845, sous la présidence Gossin, entrera dans le giron de la Société, lui apportant d’un seul coup, sous la direction d’un Comité, dix conférences déjà prospères, prémices d’une floraison magnifique.
S’opposer à ce que les Conférences nouvelles se créent en dehors du cadre et de l’esprit de la Société, ce n’est pas la seule tâche du Conseil Général; il lui faut encore veiller à ce qu’une fois fondées, elles ne s’en écartent pas. Pour cela, il examine de près les rapports particuliers qui, conformément à ses instructions, lui sont adressés périodiquement par les Conférences pour alimenter le programme des assemblées générales et le rapport annuel dont la publication avait été décidée. Ces rapports particuliers sont répartis entre les membres du Conseil qui les étudient, exposent en séance les observations suggérées par leur lecture, et les traduisent, après avis du Conseil, en lettres d’approbation ou d’improbation adressées aux Conférences.
Certaines d’entre elles ont choisi pour président un ecclésiastique: elles sont invitées à le remplacer par un laïque. D’autres tiennent leurs séances au domicile privé de leur président ou d’un confrère: il leur est instamment recommandé de chercher un local mieux qualifié, soit dans les dépendances de l’église, soit au siège des œuvres catholiques, mais non pas, comme l’a fait certaine Conférence de grande ville, dans la salle d’audience du Tribunal de commerce. Il en est qui consacrent une part de leur activité à des œuvres féminines comme les patronages de jeunes filles; le Conseil Général les invite à s’en désintéresser et à les transmettre progressivement, sans éclat, soit à des œuvres de dames, soit au clergé paroissial. La conduite de certains confrères a donné naissance à des critiques malheureusement justifiées; le Conseil saisit l’occasion pour indiquer les mesures qui devront être adoptées pour l’admission des nouveaux membres: présentation préalable par deux confrères au président de la Conférence; enquête par celui-ci ou son délégué ; vote par la Conférence. Un confrère devient-il indésirable? Le président doit faire auprès de lui les démarches nécessaires pour obtenir sa retraite spontanée, et c’est seulement en cas de résistance invincible, que réduit à faire acte d’autorité, il le démissionnera d’office.
Par ailleurs, afin de maintenir l’esprit de l’œuvre, le Conseil n’hésite pas à rappeler souvent le principe d’humilité auquel les Conférences doivent demeurer aussi fidèles qu’au devoir de charité. Plusieurs d’entre elles, publient non seulement des comptes rendus flatteurs de leur activité, mais encore des éloges, voire même de véritables oraisons funèbres de confrères retournés à Dieu; le Conseil Général n’hésite pas à blâmer ces accès de vanité. De même, il interdit à tout confrère de se prévaloir de son titre de membre de la Société, non seulement dans toute publication dont il serait l’auteur, mais encore dans toute correspondance étrangère à sa fonction.
Combien d’initiatives lui paraissent trop hardies ou trop contraires au caractère de la Société pour pouvoir être accueillies! Comment pourrait-il approuver la fondation et l’administration par telle Conférence d’une fabrique de toile pour procurer du travail à ses pauvres, ou la création par telle autre, au profit des indigents visités par elle, d’une Société de Secours Mutuels, dont elle assume la direction et la responsabilité ?
Les observations du Conseil Général, au surplus, ne portent pas toujours sur des questions de pareille gravité. A celle-ci, il signale que dans les instructions imprimées qu’elle distribue à ses apprentis, elle a commis la faute lourde de ne pas dire un mot de leurs devoirs religieux; à celle-là, qu’elle ne visite pas assez de familles, étant donnés le nombre de ses membres actifs et le montant de ses ressources; à cette autre, qu’elle consacre une somme disproportionnée à ses frais généraux et à ses dépenses de bureau. Et ces menues observations prouvent avec quel soin le Conseil Général exerce son contrôle.
Son rôle, d’ailleurs, il ne le remplit pas seulement en rectifiant spontanément les décisions et les tendances qui lui semblent défectueuses, mais encore en répondant aux consultations qui lui sont constamment demandées, en soutenant les conférences dans les difficultés qu’elles rencontrent sur leur chemin, en les défendant au besoin comme ses enfants.
Quelques-unes d’entre elles, en province, se heurtaient, au lendemain de leur naissance, aux exigences de l’autorité civile. Tel préfet, tel maire, tel commissaire de police s’opposait aux réunions de la conférence qui n’avait pas demandé son autorisation pour venir au monde. Un maire de grande ville autorisant la conférence à donner une loterie au profit de ses œuvres venait ensuite s’emparer, du produit de la fête au nom du bureau de bienfaisance, en alléguant que celui-ci seul, avait qualité pour répartir des fonds destinés à secourir les indigents. Certaines conférences, inquiètes, n’attendaient pas d’avoir été molestées pour demander s’il n’était pas opportun, pour elles, de solliciter une autorisation administrative qui, au surplus, apparaissait à quelques-unes, à tort d’ailleurs, comme devant les habiliter à recevoir des dons et des legs.
Les décisions du Conseil Général, sur ce groupe de questions, furent marquées au coin d’une sage prudence. Encore bien qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposât l’obligation d’une autorisation préalable pour les réunions d’associations charitables, il estima que, la paix étant pour elles la première des nécessités, il importait essentiellement d’éviter tout conflit avec les autorités; qu’en conséquence, partout où celles-ci réclamaient une demande d’autorisation, elle serait formulée, mais que, par contre, aucune Conférence ne prendrait spontanément l’initiative d’en présenter une. Enfin, dans les cas de conflits irréductibles, il n’hésita pas à proposer son intervention auprès des autorités supérieures, voire même auprès de M. le Ministre de l’Intérieur.
A côté de ces questions d’intérêt juridique, il en était d’autres, nombreuses, posées par telle ou telle conférence, sur des points de détail, dont la solution demandait à être sagement pesée parce que destinée à faire jurisprudence. C’est ainsi que le Conseil Général est appelé à décider: que les domestiques attachés à la personne ne seront pas admis comme confrères; que la visite des familles indigentes secourues doit être régulièrement faite chaque semaine; que les conférences de campagne peuvent, tout aussi bien que les conférences urbaines, être groupées sous l’égide d’un conseil particulier; que si les confrères conservent toute liberté de s’occuper individuellement et suivant leurs préférences des questions politiques à l’ordre du jour, il n’en saurait être de même des Conférences; que les patronages, bien loin d’être réservés aux seuls enfants fréquentant les écoles congréganistes, doivent être largement ouverts à tous ceux qui désirent y être admis, etc.
Et ces divers exemples, pris parmi beaucoup d’autres, indiquent suffisamment la variété des consultations demandées au Conseil Général, et l’importance de sa fonction directrice.