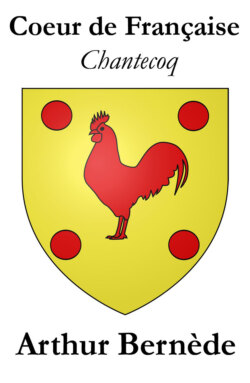Читать книгу Coeur de Française (Chantecoq) - Arthur Bernede - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Chapitre V : Bertha Stegel
ОглавлениеDans un vaste salon lourdement somptueux et dont les hautes fenêtres, garnies de tentures de brocart aux crépines d’or, s’ouvrent sur la Wilhelmstrasse, une jeune fille vêtue d’une robe noire très simple et coiffée d’un chapeau garni de tulle attendait, debout, laissant errer ses yeux sur les portraits suspendus aux murs et représentant des officiers allemands de tous grades, en grand uniforme de cuirassiers blancs, uhlans, hussards de la mort, depuis le grand Frédéric jusqu’à nos jours.
Parmi toutes ces figures sévères de guerriers imposants se détachaient, tel un couple de grands seigneurs égarés au milieu d’un camp de reîtres, deux belles toiles ovales du dix-septième siècle, entourées d’un cadre en chêne doré. L’un représentait un gentilhomme aux traits réguliers, au regard énergique à l’attitude toute de noblesse et de dignité. L’autre personnifiait une femme d’une rare beauté dont la toilette de cour rehaussait l’éclat, mais dont le regard mélancolique et doux inspirait, sans qu’on pût s’en défendre, un sentiment de sympathie voisine de la pitié :
— C’est singulier, murmurait la jeune fille, on dirait que ces deux portraits sont plutôt faits pour être accrochés aux murs du palais de Versailles que chez le chef de l’Etat-major de l’armée allemande.
S’approchant encore, cherchant les signatures, elle parvint à les distinguer, constatant, toute surprise :
— Mais c’est de Rigaud… le grand peintre de Louis XIV…
Comme, instinctivement, ses yeux allaient vers la toile voisine, — un maréchal du temps de Frédéric, — elle remarqua avec étonnement qu’il ressemblait beaucoup, dans sa poudre et sous son armure, au grand seigneur et aussi à la belle dame de France.
Le portrait suivant, un colonel de hussards, leur ressemblait aussi, mais déjà moins… et le type si nettement racé se continuait ainsi à travers la lignée, toujours se transformant, pour s’effacer tout à fait et reparaître encore dans le dernier cadre, celui d’un jeune officier de la Garde de Guillaume II, roi de Prusse et Empereur d’Allemagne.
— Est-ce que, par hasard, le général von Talberg serait d’origine française ?… se demandait l’inconnue dont la curiosité s’était éveillée à la vue de tous ces soldats d’outre-Rhin qui semblaient la regarder avec une sorte de haine farouche.
Mais une portière se soulevait et un planton, un immense uhlan coiffé de son schapska et profilant sa haute silhouette sur le seuil d’une porte à deux battants, lança d’une voix rauque :
— Le général vous attend !
La jeune fille suivit le soldat qui l’introduisait dans un grand cabinet à l’ameublelïlent gothique et au fond duquel, devant une table chargée de paperasses et de dossiers méticuleusement rangés, un général en petite tenue se tenait assis.
A la vue de la jeune fille, von Talberg se leva tout d’une pièce, automatiquement, à l’allemande.
C’était un homme magnifique, dans toute l’acception du mot ; si sa structure et sa stature étaient celles d’un colosse, ses traits fins et réguliers, encadrés d’une barbe brune à peine grisonnante, son regard clair et loyal, son front haut et dégagé, révélaient une origine aristocratique et une intelligence d’élite.
— Mademoiselle Bertha Stegel, n’est-ce pas ?… interrogea von Talberg d’une voix bien timbrée.
— Oui, général.
— Vous venez de la part de l’agence Friedmann ?
— Oui, général.
— Soyez la bienvenue.
Désignant à la visiteuse un fauteuil placé en face de lui, le chef d’Etat-major ajouta :
— Veuillez vous asseoir, je vous prie.
La jeune fille obéit.
Tirant d’un sac de cuir qu’elle portait à la main une liasse de papiers retenus par une faveur bleue qu’elIe dénoua, elle les déposa sur le bureau ; et dans l’allemand le plus pur, nuancé de l’accent très net des provinces du nord :
— Général, dit-elle… si vous voulez prendre connaissance… ce sont mes actes d’état civil et mes certificats.
Avec la plus grande attention, le général se mit à examiner les papiers que la jeune fille venait de lui remettre ; puis, au bout d’un instant, il reprit :
— Vous êtes née à Rostock, dans le grand-duché de Mecklembourg, et vous avez vingt-deux ans… Vous avez déjà été institutrice dans plusieurs familles…
— Dans deux seulement, général, rectifia l’inconnue, l’une à Dantzig, l’autre à Thorn.
— Je vois que l’on a été très satisfait de vous… Qui vous a donné l’idée de venir à Berlin ?
— L’espoir de m’y faire une situation meilleure qu’en province.
— Vous êtes orpheline ?
— Oui, général.
— Mais vous avez sans doute encore de la famille ?
— Quelques parents éloignés que j’ai perdus de vue.
— La maison Friedmann, en qui. j’ai la plus grande confiance, vous recommande à moi d’une façon toute particulière.
« Les très bons renseignements qu’elle me donne sur vous, joints, je ne le cache pas, à l’excellente impression que vous me produisez, me décident à vous prendre chez moi.
— Je vous remercie, général, répondit la jeune fille, et j’ose espérer que vous n’aurez qu’à vous féliciter de mes services.
Von Talberg, tout à fait conquis par les manières distinguées et la façon si correcte dont s’exprimait la jeune institutrice, poursuivit avec bienveillance :
— Avant de vous présenter à ma fille, il est indispensable que vous connaissiez son caractère, ses goûts et ses aptitudes. C’est une enfant très douce, mais facilement impressionnable…
« Elle est souvent en proie à de longues crises de mélancolie que j’attribue à la mort de sa mère, survenue il n’y a que cinq ans. dans des circonstances tragiques… un terrible accident d’automobile… Alors elle s’enferme dans un mutisme dont rien ne peut la faire sortir ; elle se réfugie dans sa chambre et pleure pendant de longues heures.
« Le travail immense que m’imposent mes fonctions m’empêche de m’occuper de cette chère enfant autant que je le voudrais…
« Les parents qui pourraient me suppléer demeurent les uns à Hambourg, les autres à Dresde… et Frida, de nature peu liante, ne semble pas tenir à se faire des amis…
« C’est une petite sauvageonne que vous aurez bien de la peine à apprivoiser… Je vous la confie… Il ne me reste plus qu’à vous présenter à votre élève.
Le chef de l’Etat-major ayant appuyé sur le bouton d’une sonnette électrique, le uhlan colosse apparut aussitôt s’arrêtant, immobile, dans l’encadrement de la porte.
— Ulrich, commanda le général, allez prévenir Melle von Talberg que je désire lui parler.
Le planton abaissa la main, fit demi-tour et disparut.
Quelques instants après, la porte s’ouvrait de nouveau…
Une mignonne et frêle créature, vêtue d’une robe blanche et le visage encadré d’une soyeuse chevelure blonde, surgit, telle ne apparition divine.
— Ma fille, attaqua le géneral, je te presente Melle Bertha Stegel que je t’ai choisie pour institutrice.
La jeune fille s’avançait déjà vers Frida, le sourire aux lèvres… lorsque, pénétrant en coup de vent dans la pièce, un officier en uniforme de colonel d’infanterie saxonne, dont le visage glabre, rasé à la de Moltke, portait les traces du plus vif bouleversement, accourut jusqu’au chef de l’Etat-major en criant :
— Je vous demande pardon, mon général…
— Qu’y a-t-il, colonel Hoffmann, pour que vous vous permettiez…
— Mon général, expliqua le nouveau venu dont la voix tremblait à la fois d’émotion et de colère, le lieutenant Wilhelm Ansbach a disparu et…
— Taisez-vous, malheureux, interrompit von Talberg en désignant du regard l’institutrice et son élève.
Mais à peine avait-il proféré cette phrase qu’un cri déchirant retentissait.
Frida venait de s’évanouir dans les bras de Bertha Stegel.
Déjà le général von Talberg s’était précipité vers son enfant : il aida la jeune fille à la déposer sur un fauteuil.
Très ennuyé, le colonel Hoffmann roulait des yeux effarés.
Avec un sang-froid merveilleux, l’institutrice s’était emparée d’une carafe d’eau et, mouillant son mouchoir, elle l’appliqua sur les tempes moites de la jeune fille qui, peu à peu, revenait à elle et murmurait, s’efforçant de réagir :
— Ce n’est rien… un simple étourdissement…
Bien vrai… vous vous sentez mieux ?… interrogeait l’institutrice avec empressement.
Avant de répondre, Frida l’enveloppa d’un long regard interrogateur, comme si elle voulait tout de suite savoir ce qu’il y avait dans l’âme de sa future compagne.
Puis, tandis que sa tête retombait languissante sur son épaule, elle fit d’une voix faible :
— Je voudrais me retirer dans ma chambre.
— Frida !… s’écria le général visiblement angoissé.
— Oui… répéta la jeune fille, je voudrais m’en aller… toute seule…
Des larmes plein les yeux, la jolie Berlinoise s’était levée et faisait déjà quelques pas mal assurés vers la porte, lorsque Bertha Stegel, s’approchant d’elle, lui dit d’une voix très douce en lui offrant son bras:
— Appuyez-vous sur moi, mademoiselle… et permettez-moi de vous accompagner.
La fille du général s’arrêta et lançant un regard fait de curiosite inquiete vers celle qui venait de lui parler avec tant d’affectueuse bonté, tandis qu’un sourire d’une melancolie étrange errait sur ses lèvres pâlies, elle dit simplement :
— Venez, mademoiselle.
Et telles deux sœurs improvisées, Bertha et Frida s’éloignèrent, déjà rapprochées par cette sorte de lien mystérieux que certaines douleurs semblent si bien créer entre certaines âmes.
Etonné et rassuré tout à la fois, von Talberg les suivit du regard jusqu’au moment où la lourde portière retomba derrière elles. Puis, comme s’il se parlait à lui-même, il murmura :
— Elles doivent se comprendre toutes deux… elles n’ont plus de mères !…
Revenant vers le colonel Hoffmann, dont les yeux vifs, pétillants, ardents, formaient un contraste frappant avec son allure raide, compassée, presque automatique, il fit sur un ton de violent reproche :
— On n’a pas idée d’une pareille maladresse !…
« Comment, c’est vous, le chef de notre Bureau de renseignements, qui, sans vous occuper s’il n’y a personne chez moi, venez m’annoncer d’une façon aussi brutale une nouvelle qui, jusqu’à nouvel ordre, doit rester ignorée de tous !…
« Cela me surprend de votre part, colonel Hoffmann… Vous n’aviez habitué à plus d’adresse et de sang-froid !..
— Excusez-moi, mon général, balbutia l’officier aussi penaud qu’un écolier pris en faute ; mais jamais je n’avais ressenti une émotion, pareille… Songez donc, mon général, au moment de toucher au but… car il les avait, les papiers… il les tenait, les plans…
Alors, le chef de l’Etat-major, frappant un grand coup sur la table avec un presse-papier en bronze massif, interrompit, d’une voix tranchante, acerbe :
— Colonel Hoffmann, je vous prie de mettre un peu d’ordre dans vos idees et de m’exposer avec methode l’événement qui vous amène.
— A vos ordres mon général, obtempéra le colonel.
Domptant immédiatement ses nerfs surexcités, le policier en uniforme exposa brièvement
— Mon général, il y a dix jours, j’avais reçu un télégramme chiffré du lieutenant Wilhelm Ansbach, parti depuis six mois en mission extraordinaire…
Ce télégramme, expédié et daté du 8 septembre dernier à dix heures et demie du soir, à la Bourse de Paris, m’annonçait sans autres détails que Wilhelm Ansbach avait réussi à mettre la main sur le plan d’un aéro de combat à la veille d’être accepté par le ministre de la Guerre français.
« Le lieutenant ajoutait qu’il serait le surlendemain, au plus tard, à Berlin,dans mon cabinet, avec les précieux documents…
« Au bout de trois jours, ne voyant rien venir, je commençai à m’inquiéter… J’envoyai un premier télégramme, en langage convenu, à l’adresse du lieutenant, c’est-à-dire M. Jacques Müller, poste restante, à Vincennes.
« Ne recevant aucune réponse, je m’adressai à Emma Lülckner qui dirige si habilement notre contre-espionnage à Paris, et avec laquelle Wilhelm Ansbach était en rapports…
« J’appris que cet officier, ainsi qu’il me l’avait télégraphié, s’était bien emparé des plans en question ; qu’il était parti, la nuit même, dans une excellente auto de course qu’Emma Lückner lui avait fournie et qu’il se dirigeait à toute vitesse vers la frontière…
Depuis… plus rien !…
« Alors, mon général, avant de vous en référer, j’ai envoyé un de nos meilleurs limiers faire sur place une enquête et le viens d’apprendre qu’après avoir suivi jusqu’au delà de Lunéville les traces de l’auto pilotée par le lieutenant Ansbach, il les avait perdues définitivement.
Le colonel Hoffmann conclut :
— A mon avis, le jeune officier a été assassiné… Par qui et dans quelles circonstances ?… Je ne saurais vous le dire. Mais maintenant j’estime qu’il n’y a plus d’espoir de le retrouver et que nous devons porter le deuil de ce vaillant qui est mort au service de la patrie.
— Eh bien ! moi, s’écria le général von Talberg, qui avait écouté son subordonné avec la plus grande attention, je prétends que nous devons continuer nos recherches jusqu’à ce que les ténèbres qui enveloppent cette mystérieuse affaire soient complètement dissipées… Il faut que Wilhelm Ansbach se retrouve mort ou vivant !…
« Vous m’entendez, colonel Hoffmann ?… mort ou vivant !…
Tandis que ses yeux lançaient un éclair fait à la fois de haine ardente et d’énergique défi, le chef du Bureau des renseignements, redressant sa haute taille et portant la main à la visière de son casque, prononça :
— A vos ordres, mon général !…