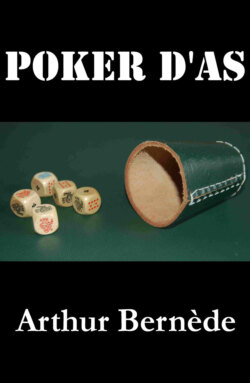Читать книгу Poker d'As - Arthur Bernede - Страница 6
III : Le malheur près de la porte.
ОглавлениеL’Infernal-Bar était une des innombrables boîtes de Montmartre qui, après la guerre, ont poussé sur la butte Montmartre comme autant de champignons plus ou moins vénéneux.
L’extérieur représentait une grossière contrefaçon en carton-pâte des sublimes portes de l’Enfer de Rodin. Puis, c’était un étroit vestibule éclairé en rouge et que l’on ne faisait que traverser pour pénétrer dans un vaste cabaret à l’aspect de grotte, dont le plafond, imitant la pierre, était soutenu par des colonnes camouflées en fausses stalactites et stalagmites… Tout autour, une corbeille de loges un peu surélevées et, plus bas, des tables rangées de façon à laisser vide un espace en demi-cercle qui servait de dancing et se terminait par une entrée de caverne obscure qui s’illuminait pour les entrées de ballet, principale attraction de la maison.
Sous la projection de lumières aux teintes changeantes, des couples assez chics exécutaient les danses les plus modernes, au son d’un orchestre de musiciens costumés en diables, ainsi que le barman qui, debout derrière son comptoir, procédait, avec la dextérité d’un prestidigitateur, à la confection de nombreux cocktails, et les garçons, en diables également, s’empressaient autour des consommateurs, faisant sauter bruyamment les bouchons de champagne.
Tout à coup, l’orchestre se tut. Les projecteurs s’éteignirent… Les danseurs mondains, qui, pour la plupart, étaient des habitués, regagnèrent leurs tables.
A peine s’y étaient-ils installés que la caverne du fond s’illumina, laissant apparaître une immense chaudière d’où sortit d’abord un jet de flammes, puis d’où jaillirent de jolies diablesses armées de petites fourches. C’était une troupe de girls qui, bondissant dans la salle, à la lueur d’un éclairage de pourpre, se mit à exécuter une série de pas assez originaux.
Ces ébats eurent le don de soulever l’enthousiasme des snobs et des snobinettes qui formaient la majorité du public.
Tandis que les applaudissements crépitaient et que les girls se préparaient à continuer leur numéro, deux hommes, d’une élégance un peu suspecte, l’un grand, élancé, au type de bellâtre étranger, sentant le métèque à plein nez, l’autre, petit, au nez retroussé, aux yeux en vrille, au sourire inquiétant, s’entretenaient à voix basse près d’une table sur laquelle deux consommations étaient servies. En face d’eux, une chaise vide semblait attendre un troisième client.
— Ah çà ! grommelait le bellâtre, est-ce que Poker d’As nous laisserait tomber ?
— Pourquoi dis-tu cela, Soreno ?
— D’ordinaire, il est très exact… Et, ce soir, il est en retard d’au moins une heure.
— A Paris, on ne fait pas toujours ce que l’on veut.
— Vois-tu, Aryadès, qu’il se soit défilé !
— Je connais Poker d’As. Ce n’est pas un type à jouer un pareil tour à des amis.
— Est-ce qu’on sait ?…
— Tais-toi, le voici…
Un homme de quarante-cinq ans environ, en habit, sous un mac-farlane à revers de soie et dont la silhouette élégante contrastait avec la flétrissure que le vice et sans doute aussi le crime avaient mise sur son visage, s’avançait vers les deux métèques.
Sans prononcer un mot, lentement, il s’assit sur la chaise vacante.
Remarquant son air soucieux, Soreno interrogeait :
— Alors, ça ne va pas ?
Poker d’As eut un sourire énigmatique et, d’un geste de la main, il fit signe à ses compagnons de se taire.
Soreno, après avoir adressé un léger signe de tête à Aryadès, regarda autour de lui afin de s’assurer qu’il n’était pas observé. Et il reprit sur un ton de sourde menace : — Poker d’As, il est temps que tu tiennes tes promesses.
Poker d’As eut un haussement d’épaules tout de flegmatique dédain.
Moins violent que son camarade, très insinuant, au contraire, mais plus dangereux à coup sûr, Aryadès intervenait à son tour : — Tu ne devrais pas oublier que, sans Soreno et moi, tu serais encore au Transvaal, au bagne, où tu avais été envoyé à perpétuité pour vol, meurtre, etc. Nous t’avons tiré de là à nos risques et à nos frais.
— Et tu nous avais juré, ponctuait Soreno…
Brutalement, les sourcils froncés, Poker d’As interrompait : — Que si vous me faisiez évader, nous nous rendrions tous les trois à Paris pour une grosse affaire !
— Voilà trois mois que nous attendons, observait Aryadès.
Eh bien ! s’écriait Poker d’As, dont le visage avait pris une expression vraiment satanique, demain soir je tiendrai parole.
— Tu peux bien maintenant, déclarait Soreno, nous raconter de quoi il s’agit.
— J’ai dit : demain.
— Pourquoi pas tout de suite ?
— Parce que…
— Tu n’as pas confiance en nous ?
— Autant que vous avez confiance en moi…
— Ce n’est pas une réponse…
— Laisse-le, conseillait Aryadès… Il n’est pas de bonne humeur.
— Je suis de très bonne humeur, protestait Poker d’As… Seulement… voilà… un coup comme celui que je prépare… ça demande de la réflexion… Mais ce que je peux déjà vous dire, c’est que vous verrez demain soir que je sais tenir mes promesses.
Une ruée de nouveaux clients envahissait la salle. L’un d’eux, un jeune homme aux allures distinguées et qui semblait quelque peu dépaysé dans ce milieu dont il n’était certainement pas un habitué, eut un mouvement de surprise en apercevant Poker d’As.
— Regardez donc… murmura-t-il à l’un de ses compagnons.
— Quoi ?
— Ce personnage attablé… avec deux individus plutôt suspects…
— Où donc ? Là, à droite. Tiens, mais l’on dirait…
— Le comte de Rhuys. En effet, c’est bien lui.
— Singulière façon de fêter sa réception à l’Académie !
Poker d’As, qui avait entendu cette réflexion, eut un sourire gouailleur… Et il se prit à grommeler entre ses dents : — Maintenant, à nous deux, monsieur mon frère.
Cet homme, nos lecteurs l’ont déjà deviné, n’était autre que celui que Mme de Rhuys avait cru reconnaître, c’est-à-dire Jean, son second fils, l’autre…
Ainsi qu’elle le prévoyait, le malheur était à sa porte !…
À la même heure, à l’hôtel de Rhuys, quelques intimes étaient venus féliciter le nouvel académicien.
Entouré de ses amis, M. de Rhuys faisait part à ceux-ci de ses impressions de séance… La marquise et la jolie Huguette cherchaient, non pas à bannir, mais à dissimuler leur angoisse secrète et à faire preuve, envers toutes et tous, de leur amabilité coutumière, lorsqu’un valet de pied annonça : — Monsieur Hervé de Kergroix.
A ce nom, Huguette sentit passer en elle le frisson d’un bonheur subit… Hervé, très élégant dans son frac impeccable, s’avança d’abord pour saluer Mme de Rhuys et serrer la main que lui tendait le comte Robert… Puis il revint vers Huguette qui, elle aussi, un peu tremblante, lui offrit la main. Hervé la prit et la serra avec une sorte de réserve volontaire. Mlle de Rhuys s’aperçut que son regard, son image, son attitude trahissaient en lui une froideur embarrassée… Aussitôt, la joie si brève qu’elle venait de ressentir fit place à une déception douloureuse qu’Hervé remarqua aussitôt… Ses yeux se fixèrent sur Huguette avec tendresse et il entrouvrit la bouche… On eût dit qu’il allait lui faire un aveu, une révélation… Mais, aussitôt, il se reprit, resta muet et quitta Huguette pour adresser ses salutations à d’autres personnes.
Comprenant qu’il devait des excuses à M. de Rhuys, il se rapprocha de lui et, avec un embarras grandissant, il lui dit : — J’espère, mon cher maître, que vous avez bien voulu me pardonner mon absence cet après-midi.
Le comte Robert répondit par un signe affirmatif… Et, profitant de ce que le cercle d’hommes de lettres et de mondains qui l’entourait se brisait pour s’attaquer aux rafraîchissements qu’un laquais en grande livrée faisait circuler sur de larges plateaux, il dit à Hervé, avec beaucoup de bienveillance : — J’ai besoin de vous parler très sérieusement.
Hervé n’en parut pas étonné. On eût même dit que ces quelques mots le libéraient du grand poids moral qui, visiblement, l’oppressait.
— Veuillez me suivre, invitait M. de Rhuys.
Occupés, les uns à potiner, les autres à se bourrer de sandwiches, de petits fours, ou à vider des coupes de champagne et des verres d’orangeade, les invités ne s’aperçurent pas de la disparition du maître de la maison et du jeune industriel, qui étaient passés tous deux dans un luxueux cabinet de travail communiquant directement avec la pièce qu’ils venaient de quitter.
Après avoir indiqué à Hervé de s’asseoir en face de lui, M. de Rhuys prenait place sur un siège, devant un admirable bureau Louis XV qui aurait pu rivaliser avec le chef-d’œuvre de Riesener, juste gloire de notre musée des Arts décoratifs, au Louvre.
— Mon cher ami, attaquait-il, vous savez toute l’amitié, toute l’estime que j’ai pour vous… Depuis la mort de vos parents, je me suis habitué à vous considérer comme mon fils.
— Et moi, déclarait Hervé avec élan, à vous aimer comme un père.
— Alors, s’écriait le père d’Huguette, pourquoi avez-vous cessé tout à coup de nous voir ?
Kergroix garda le silence. Le regard rempli d’une tristesse soudaine, on eût dit qu’il cherchait à éviter celui que le comte fixait obstinément sur lui.
— Tous ces derniers temps, reprit-il avec gêne, j’ai été très pris à l’usine.
— Je veux bien en convenir… Mais pourquoi nous avez-vous téléphoné que vous n’aviez pas pu vous rendre à l’Académie parce qu’un accident imprévu s’était produit dans l’un de vos ateliers ?
Hervé se tut encore.
— Vous avez dû vous douter, reprenait le comte Robert, qu’il m’était facile de contrôler la non-exactitude de ce prétexte.
Le jeune homme baissa le front.
Avec fermeté, M. de Rhuys martelait :
— Je ne veux pas qu’il y ait de malentendu et encore moins de mystère entre nous… Hervé, je veux savoir la vérité, toute la vérité.
— Je vous en supplie, monsieur, s’écriait Kergroix avec un accent d’étrange désespoir, ne me forcez pas à vous répondre.
A son tour, le comte Robert se tut ; et la même question que sa mère lui avait posée dans l’après-midi lui revint à l’esprit.
— Saurait-il ?
Dissimulant avec peine son inquiétude, il s’en fut vers Hervé qui, non moins ému, s’était levé et, le saisissant par le bras, il lui cria : — Vous n’avez pas le droit de vous réfugier ainsi dans l’équivoque… Je veux tout savoir, vous m’entendez ?… Tout ! … Je le veux, il le faut !
La gorge contractée, Kergroix murmura :
— J’aime votre fille !
— Je le savais, déclara M. de Rhuys en desserrant son étreinte.
Le jeune industriel se laissa tomber sur un siège… Le comte Robert l’observa un instant. Puis, s’avançant vers lui et dominant sa secrète anxiété, il lui demanda, d’un ton redevenu bienveillant, presque paternel : — Vous croyez peut-être qu’Huguette ne vous aime pas ? Eh bien ! moi, je vous affirme qu’elle vous adore.
Contrairement à son attente, ces paroles parurent grandir encore le désespoir d’Hervé.
De plus en plus étonné, le comte reprit :
— Vous redoutez que je vous refuse sa main ? Rassurez-vous, je suis prêt à vous l’accorder !
— Hélas ! mon cher maître, soupirait Kergroix, je n’ai pas le droit de vous la demander.
— Pourquoi ?
— Je ne suis pas libre.
— Une liaison ?
— Oui, une liaison que je ne peux pas rompre.
— Par crainte du scandale ?
— Non, par devoir, par pitié.
Profondément affecté, M. de Rhuys hocha la tête d’un air découragé. Puis il fit : — Comment avez-vous pu, mon pauvre enfant, vous laisser prendre ainsi ?
Hervé expliquait :
— Quand j’ai connu cette femme, Huguette était encore presque une enfant et elle ne m’inspirait qu’une affection toute fraternelle. Mais, à mesure qu’elle grandissait, je me sentais attiré vers elle par un sentiment de plus en plus vif que je croyais être encore de l’amitié, lorsqu’un soir, au bal de l’ambassade d’Angleterre, son charme m’enveloppa d’une lumière si pénétrante que je vis clair en moi. J’aimais Huguette d’amour, et d’un tel amour que je ne croyais pas qu’il pût en exister d’aussi grand au monde…
— Alors ?…
— Je voulus rompre avec… mon amie. Elle ne m’adressa aucun reproche… Elle ne chercha pas à me retenir et je ne vis même pas de larmes apparaître au fond de ses yeux qui me regardaient avec tristesse, mais sans amertume. Elle me dit simplement : « Va et sois heureux ! »
— Eh bien ?
— Le même soir, mon associé, Pierre Boureuil, me prévenait qu’elle avait voulu se tuer… Pouvais-je contre signer, par mon départ, un arrêt de mort auquel elle n’avait échappé que par miracle ?… Non ! Terrifié de la responsabilité que j’assumerais, je lui jurai de ne jamais la quitter.
— C’est effrayant ! murmura M. de Rhuys d’une voix sourde.
— Qu’avez-vous ? interrogeait Kergroix.
Le comte, haletant, répliquait :
— Huguette, elle aussi, peut en mourir.
Bouleversé, Hervé s’écriait :
— C’est abominable !… Non ! non ! cela ne se peut pas… cela ne sera pas…
Faisant appel à tout son sang-froid, M. de Rhuys demandait : — Quelle est cette femme ?
— Une malheureuse, définissait le jeune industriel… Un jour, il y aura bientôt trois ans, elle se présenta à l’usine pour demander du travail. Elle me dit qu’elle était seule au monde. Elle manifestait à la fois tant de dignité et tant de détresse que je l’accueillis sans hésiter. Je n’eus pas à le regretter. Elle était excellente dactylographe… et puis si douce, si sérieuse, si appliquée à son travail… si simplement dévouée… J’en fis ma secrétaire… Bientôt je crus l’aimer et elle se donna à moi… Mais jamais elle ne voulut accepter de moi une autre situation que celle qu’elle devait à son travail… Telle est la triste vérité.
— Et son passé ?
— Le peu qu’elle m’en a raconté me donne à penser qu’il a dû être un vrai calvaire.
— Mon pauvre ami !
Douloureusement, Kergroix poursuivit :
— Vous dire ce que je souffre, surtout après ce que vous venez de me confier, est impossible !… Huguette ! ma chère Huguette !… Moi qui donnerais ma vie pour elle !… Car c’est elle que j’aime, elle seule, je vous le jure !…
Avec cette volonté sereine qui n’appartient qu’aux âmes d’élite, le comte Robert déclarait : — Il ne faut pas qu’il y ait de sacrifiée… ni mon enfant, ni cette pauvre fille. Laissez-moi réfléchir… Ayez confiance en moi. Si Dieu le veut, nous sortirons de cette impasse… et Dieu le voudra ! Je vous remercie, monsieur, de m’avoir parlé ainsi…
— Maintenant, vous comprenez pourquoi je me suis éloigné de vous, et j’ose espérer que vous me pardonnez.
— Mon cher enfant, le seul reproche que j’ai le droit de vous adresser est que vous auriez dû me parler tout de suite avec la même franchise que ce soir. Mais je tiens à vous le répéter, soyez sûr que tout ce qui dépendra de moi pour assurer le bonheur d’Huguette et le vôtre dans le repos de votre conscience sera fait, avec toute la sincérité de l’affection que je vous porte.
— Encore merci, et au revoir.
— A bientôt, j’espère ?
— Au revoir, mon cher maître.
— Ayez confiance !
Après avoir serré la main du comte, Kergroix se retira.
Dès qu’il fut parti, une portière se souleva et Mme de Rhuys s’avança vers son fils. Son trouble évident signifiait qu’elle n’avait rien perdu de l’entretien précédent.
— Mère, s’écriait Robert, vous avez entendu ?
— Oui.
— Que faire ?
— Nous en reparlerons tout à l’heure, quand nos invités seront partis.
Mais la porte du salon s’ouvrait, démasquant Huguette qui, les yeux pleins de larmes, s’écriait : — Hervé vient de partir. On eût dit qu’il faisait semblant de ne pas me voir… et, lorsque je me suis avancée vers lui… c’est à peine s’il m’a dit adieu. Père, que s’est-il passé ?… Il ne m’aime pas, n’est-ce pas ?
Le comte fit un geste de dénégation ; mais la jeune fille insistait : — Je sens bien qu’il se passe quelque chose de grave.
Et elle se jeta dans les bras de sa grand-mère.
— Il ne m’aime plus ! sanglotait-elle. Il ne m’aime plus ! Et fermant les yeux, renversant sa tête en arrière, elle s’effondra sur le tapis avant que la marquise ait eu le temps de la retenir.
Vite, M. de Rhuys la transporta sur une chaise longue, puis se précipita dans le salon, où les invités commençaient à s’étonner de la disparition successive de leurs hôtes.
Se dirigeant vers un homme d’un certain âge qui, avec des airs de galanterie un peu surannés, s’entretenait avec la duchesse de Sallabris et la célèbre romancière Eve Myrtale, il fit à voix basse : — Docteur, voulez-vous venir un instant ?… Huguette vient de se trouver mal.
Le médecin, qui n’était autre que le célèbre professeur Martineau, s’empressa de suivre le comte Robert.
La duchesse de Sallabris, qui avait tout entendu, s’empressa de faire circuler la fâcheuse nouvelle ; et un mouvement de retraite s’esquissa.
Le professeur Martineau s’approcha d’Huguette, qui commençait à rouvrir les yeux… Il lui prit le pouls… et constata qu’il battait régulièrement.
— Allons, ça ne sera rien, fit-il… La fatigue de cette journée… Il faut que cette charmante jeune fille s’en aille tout de suite faire dodo.
— Te sens-tu assez forte pour monter dans ta chambre ? interrogeait la marquise.
— Oui, grand-mère.
Huguette, soutenue par son père, se redressa.
— Je vais mieux, fit-elle.
— Appuie-toi à mon bras, invitait Mme de Rhuys.
Elles s’en furent toutes deux par une porte qui donnait sur un couloir où elles prirent l’escalier qui conduisait au premier étage.
Le comte Robert regarda le médecin. Celui-ci n’avait plus cette expression d’optimisme qu’il manifestait un instant auparavant… Et, le front barré d’un pli, il fit : — Mon cher comte, voilà une enfant à laquelle il faut éviter toute émotion. Sinon !…
M. de Rhuys frémit… Sa femme était morte d’une maladie de cœur…
Dissimulant son angoisse, le comte Robert s’en fut, avec le docteur Martineau, rejoindre ses invités qui, aussitôt, l’entourèrent, lui demandant tous à la fois des nouvelles, s’apitoyant en des formules banales : — Quel dommage… au soir d’un si beau jour !
— Espérons que cela ne sera rien.
— Demain, nous téléphonerons pour avoir des nouvelles.
— Tous nos hommages à la marquise.
Enfin ce fut l’exode, et M. de Rhuys se retrouva seul avec le professeur Martineau.
— Rien de grave ? fit-il d’une voix angoissée.
— J’espère que non… Mais je ne puis pas encore me prononcer. Je reviendrai demain examiner plus sérieusement cette chère enfant… Au revoir, mon cher maître et ami.
— A demain.
Le professeur parti, le comte Robert se préparait à rejoindre sa fille lorsque sa mère reparut.
— Qu’a dit le docteur ?… interrogea-t-elle.
— Qu’il fallait éviter à Huguette toute espèce d’émotion.
— Mon Dieu !…
— Il reviendra demain.
— Pourvu que…
— Ma pauvre Marie-Louise, n’est-ce pas ?…
— Je vois que nous avons eu la même pensée…
— Ce serait affreux !
— Oh ! oui, trop affreux… !
Alors la marquise eut ce cri :
— Il faut la sauver !
Avec une expression de noblesse infinie, le comte Robert décidait : — Il faut les sauver…
— Tous les deux ?…
— Tous les trois !…