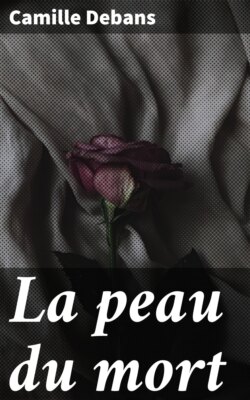Читать книгу La peau du mort - Camille Debans - Страница 10
VII
ОглавлениеPendant toute la journée qui suivit cette nuit terrible, Georges s’occupa des déclarations, courses et mesures à prendre pour enterrer son frère.
A diverses reprises il se trouva en contact avec les personnes qui avaient connu particulièrement Remi. Pas une ne conçut le moindre doute sur son identité. Prudent Pascalin, qui s’employa le mieux qu’il put pendant cette journée, n’eut pas l’ombre d’un soupçon, et lorsque le soir Georges se coucha pour la première fois dans le lit de son frère, il put se dire que son rôle serait des plus faciles à remplir.
L’heure des obsèques arriva.
Laurence, malgré toutes les supplications de Largeval, avait voulu suivre le convoi. Grâce à une rare force d’âme, elle était parvenue à tout cacher à sa fille, qui souffrait beaucoup.
Mais elle avait éprouvé le besoin de pleurer encore, et de crier et d’exalter sa douleur. Peut-être même cette cérémonie, qui lui brisa le cœur, fut-elle un puissant et heureux dérivatif à la contrainte qu’elle avait dû s’imposer devant Geneviève.
Georges mena le deuil.
Dans son grand costume noir, il fit un effet prodigieux sur ceux qui avaient été ses amis intimes, et qui ne pouvaient tarir sur l’inconcevable ressemblance des deux frères.
Laurence elle-même ne put se soustraire à l’influence de ce fait avec lequel pourtant elle était familiarisée, et il lui sembla d’autant plus avoir son mari sous les yeux, que précédemment elle l’avait vu en grand deuil, à l’occasion de la mort de son père à elle.
Au cimetière, Georges éprouva une sensation dont bien peu d’hommes ont eu la surprise.
Une personne du cortége sortit de la foule–c’était un des plus anciens camarades de celui qu’on croyait étendu pour l’éternité dans la fosse–et fit en quelques mots l’éloge du mort.
L’émotion de l’orateur était sincère, elle gagna la plupart des assistants. Laurence ne put se contenir et éclata. La scène fut déchirante.
Seul, Largeval, quoique au fond de son âme il éprouvât un amer chagrin en songeant qu’on enterrait son frère Remi, pour qui toujours il avait eu la plus vive affection, Largeval ne put s’empêcher de sourire intérieurement, et lorsque les devoirs de sa situation l’obligèrent à serrer, en guise de remerciement, la main de celui qui venait de parler, il baissa les yeux de peur que quelqu’un n’y surprît sa pensée.
Néanmoins, il mit dans cette poignée de main une effusion d’autant plus sincère qu’il était lui-même on ne peut plus flatté d’avoir été l’objet de ce petit événement oratoire.
Mais il eut quelques instants après un cruel serrement de cœur, lorsqu’il vit avec quelle banale indifférence ceux-là même qui venaient de verser une larme sur son cercueil causaient de celui qui passait pour être décédé.
Il sut alors quels avaient été ses vrais amis, et il eut la douleur de constater qu’ils n’étaient pas prodigieusement nombreux.
Quand il eut reconduit Laurence chez elle, Largcval regagna son domicile, ou plutôt celui de son frère.
Deux jours pleins s’étaient écoulés depuis le moment où il avait changé d’état.
Tout le monde le prenait pour Remi, et il avait une rare audace...
Mais cela ne l’empêchait point d’agir avec prudence. Il se disait en effet que tel ou tel événement, attendu par son frère et dont lui-même n’avait aucune idée, pourrait se présenter, et qu’il fallait être sur ses gardes.
Et puis, il avait encore un passage excessivement délicat à franchir. L’échéance semestrielle de la fameuse rente viagère tombait le quatrième jour après la mort de Remi. Allait-on s’apercevoir de la fraude? Sortirait-il encore triomphant de cette épreuve suprême?
Ce fut donc avec un atroce serrement de cœur qu’il se rendit dans les bureaux de la compagnie d’assurances, où l’on devait lui compter–si un accident ne survenait pas, sept mille cinq cents francs. Dès la veille il s’était mis au courant de ce qu’il lui faudrait faire; il avait étudié la situation topographique de la caisse pour ne pas montrer d’hésitation.
Ce fut donc d’un pas ferme, mais avec une véritable terreur, qu’il entra dans la grande salle où son sort allait se décider. Un garçon de bureau le salua.
Il se dirigea la sueur au front vers un guichet, frappa doucement et, se penchant pour se faire voir, dit d’une voix un peu étranglée:
–Je viens toucher les arrérages de ma rente…
Georges fut interrompu par le caissier qui lui dit:
–Toujours exact donc, monsieur Largeval?
–Ille faut bien.
–La première fois que je ne vous verrai pas le1er mars ou le1er septembre, je pourrai bien dire que vous êtes mort.
Cette réflexion tomba comme un coup de marteau sur Georges, qui eut cependant assez de présence d’esprit pour répondre:
–Mort, ou tout au moins bien malade.
Sur le point qui le préoccupait le plus, d’ailleurs, il était entièrement rassuré. Le caissier ne doutait pas le moins du monde qu’il ne fût Remi, et tout marchait sur des roulettes.
Mais pendant que l’on échangeait ainsi quelques paroles banales, l’employé préparait sa besogne.
–Vous avez votre certificat de vie? demanda-t-il.
–Le voici, répondit Georges en tirant la pièce de sa poche.
–Ah! parfait. Veuillez être assez bon pour me signer ce reçu.
Malgré lui, Largeval fit un mouvement en arrière.
–Qu’avez-vous? lui demanda le caissier avec intérêt.
–Oh!! C’est nerveux, purement nerveux, répondit le nouveau rentier, qui sentait sa gorge en feu et ses cheveux inondés de sueur.
–Signez donc!
Machinalement, Largeval prit la plume, mais il hésita encore.
–C’est un faux, un véritable faux que je vais commettre, se dit-il.
Au fond, la substitution elle-même n’était pas autre chose qu’un acte de faussaire plus audacieux que ceux dont on a l’habitude d’apprécier les conséquences; mais ce faux-là n’avait pas de côté palpable, tangible, comme l’action de mettre un nom qui n’est pas le sien, au-dessous d’un reçu.
Georges n’avait certainement pas pensé à cela lorsqu’il s’était introduit dans la peau de son frère.
Il s’était figuré qu’il n’avait qu’à vivre heureux et tranquille, et, tête baissée, il s’était jeté dans une existence où des incidents imprévus, semblables à celui-là, pouvaient l’arrêter à chaque pas.
Mais il n’avait pas le temps de s’amuser à réfléchir. Il fallait signer ou dire:–Je suis un pauvre diable qui ai commis une action misérable.
A quoi on aurait certainement répondu:
–Vous êtes un voleur, rien de moins.
Largeval signa donc, mais quelqu’un qui l’eût observé aurait été bien étonné de son attitude.
La main tremblante, les yeux fixes, la bouche à demi ouverte, il prit la plume qu’on lui tendait, et se rappelant la signature de son frère, qui d’ailleurs avait eu à peu près la même écriture que lui, il écrivit: Remi Largeval, et escorta le nom d’un paraphe.
Après quoi, le caissier, de sa voix tranquille, compta:
–Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept… sept mille et vingt-cinq louis, sept mille cinq cents francs.
Il se produisit alors chez Georges un autre phénomène. Cet argent qui n’était pas à lui, il n’osa pas d’abord le toucher. Le crime qu’il avait commis prenait des formes auxquelles il lui était impossible de se soustraire et qui l’écrasaient, lui, honnête pendant tant d’années.
–C’est un engrenage, pensa-t-il. Il faudra que j’y passe tout entier.
Il ne croyait pas si bien dire.
–Prenez votre argent, monsieur Largeval, lui dit le caissier d’une voix quelque peu impatiente, il y a beaucoup de monde derrière vous, et j’ai beaucoup d’échéances aujourd’hui.
Georges ramassa ses billets de banque et le rouleau de vingt-cinq louis; il les mit dans sa poche, à même, sans trop savoir ce qu’il faisait, et sortit en s’essuyant les tempes.
Une fois dehors, le grand air lui rendit sa présence d’esprit.
–Je suis bien sot, se dit-il, de me laisser abattre à chaque instant par un incident nouveau. Il faut pourtant m’attendre à mille événements qui devront me surprendre, et que je devrai accueillir sans manifester le moindre étonnement.
C’est une étude à faire, reprit-il, et il est nécessaire que je m’y applique tout de suite.
Comme il achevait cette réflexion, il vit se planter devant lui, Montussan qui s’écriait:
–Eh! c’est M. Largeval en personne.
–Moi même, cher monsieur; vous m’avez donc reconnu?
–D’autant plus que, depuis la fameuse nuit, vous savez? j’ai eu l’honneur de faire la connaissance de monsieur votre frère ainsi que de sa famille.
–Mon pauvre frère! dit Largeval d’une voix lamentable.
–Que voulez-vous dire? interrogea Montussan. Mais vous êtes en grand deuil! je ne m’étais pas aperçu de cela. Est-ce que.?
–Hélas! monsieur, le jour même où vous l’avez vu, j’ai eu la douleur de le voir tomber à mes pieds, frappé d’apoplexie.
Largeval disait cela sur un ton pénétré qui n’était pas joué le moins du monde, car, en réalité, il éprouvait un sentiment de profonde tristesse, chaque fois qu’il parlait de la mort de son frère.
Montussan restait stupéfait.
–Mais alors que vont devenir Mme Largeval et cette délicieuse enfant que j’ai eu l’honneur de conduire chez elle?
–Le jour de l’accident, oui, je sais cela. Mon frère m’en a parlé.
–Elles sont pauvres, très-pauvres, je crois.
–Mais ne suis-je pas là? Dieu merci, dit Largeval. Tant que ce sera en mon pouvoir, elles ne manqueront de rien.
–Et ce ne sera que juste, monsieur, car je ne crois pas qu’il existe au monde une jeune fille qui excite une plus vive sympathie que mademoiselle votre nièce.
Montussan prononça ces paroles avec une animation qui ne lui était pas habituelle.
–Personne, reprit-il encore, ne mérite plus qu’elle d’être heureuse, et si ma bonne chance voulait que je pusse m’employer à son bonheur, croyez, monsieur, que je le ferais avec un entier dévouement.
–Je vous remercie en son nom et au mien, monsieur, répondit Largeval, qui sentait une larme de gratitude dans ses yeux.
–Mais je ne vous ai pas encore demandé comment elle va; si sa blessure est en voie de guérison.
–Elle est aussi bien que possible, répondit Largeval. Seulement, la pauvre enfant ignore encore la mort de son
père, et nous ne sommes pas sans inquiétude sur les dangers qu’elle peut courir lorsque nous serons réduits à la lui apprendre.
–En effet, il faudrait retarder ce moment le plus qu’on pourra,
–Si donc vous alliez visiter ces dames, reprit Georges, vous seriez assez aimable de ne point paraître au fait du malheur qui nous a frappés.
–Je vous le promets.
Largeval fit un pas pour continuer sa route, lorsque Montussan l’arrêta et lui dit:
–Et mes voleurs, n’en avez-vous pas entendu parler? Ne s’est-il rien passé qui pût vous donner quelque indice sur ce qu’ils avaient fait dans votre jardin?
–Non, vraiment. Je ne sais. Les événements qui se sont déroulés depuis ne m’ont d’ailleurs pas laissé un moment pour y penser, répondit Largeval un peu gêné.
Sur ce dernier mot on se sépara. Montussan entra dans un café, où il se mit à boire du punch jusqu’à satiété, pour ne pas employer un autre mot, et Georges rentra chez lui pour se débarrasser de la somme qu’il venait de toucher.
Après avoir mis six mille cinq cents francs sous clef, il sortit avec un billet de mille francs dans sa poche et se rendit chez Laurence.
–Ma chère, lui dit-il, dès qu’il fut assis en face d’elle, par tout ce que m’a raconté votre mari le jour même de.
Geneviève était là, Mme Largeval fit un signe discret.
–..... le jour même de son départ, vous devez être dans une position momentanément difficile. J’aimais beaucoup mon frère, et je veux faire pour vous et pour sa fille tout ce que doit un bon parent.
–Hypocrite! ne put s’empêcher de murmurer Laurence.
Largeval n’entendit pas ou ne voulut pas comprendre. Quoi qu’il en soit, il tira de sa poche le billet de mille francs, et, le déposant sur un petit meuble:
–Voici, dit-il, quelques ressources que vous me permettrez de vous offrir, et...
–Geneviève, mon enfant, dit Laurence, retire-toi un instant dans ta chambre. J’ai besoin de causer en particulier avec M. Remi.
Georges, en entendant cela, ouvrit de grands yeux naïfs et surpris. Geneviève obéit à sa mère et disparut.
–Monsieur, lui dit alors Laurence, la mort de mon pauvre Georges vient de dénouer les liens de parenté qui nous unissaient.
–Que voulez-vous dire?
–Que, devenue veuve, je ne vous suis plus rien ou, pour mieux dire, vous n’êtes plus rien pour moi. C’est pourquoi je ne puis ni ne dois accepter la somme que vous venez de m’offrir, quel que soit le sentiment qui vous ait poussé à cette démarche.
–Comment! vous refusez?
–Positivement.
–Mais pourquoi?
–Pourquoi? C’est vous, vous! qui me demandez pourquoi? Eh! ne le savez-vous pas assez, pourquoi? Auriez-vous formé le projet de me forcer à vous le rappeler?
Georges resta silencieux.
Evidemment il y avait un secret entre sa femme et son frère. Et ce secret devait être d’une certaine gravité pour que Laurence prît, dans sa position désespérée, la détermination de repousser son aide. Mais quel était ce secret? Ce qu’il y avait de certain, c’est que Largeval ne pouvait pas paraître seulement surpris de ce qu’on lui disait s’il tenait à continuer son rôle.
–Ecoutez, ma chère Laurence, dit-il, j’ai pu avoir des torts envers vous.
–Vous daignez le reconnaître, dit ironiquement Mme Largeval.
–Mais je croyais que la mort de Georges était un de ces événements qui amènent d’ordinaire, entre parents brouillés, un rapprochement dont je serais heureux.
Laurence resta froide et hautaine.
–Je vous demande pardon pour le passé et je m’en repens, ajouta-t-il à tout hasard. Si j’ai commis des actes ou prononcé des paroles qui vous ont animée contre moi, je vous supplie de les oublier.
–C’est impossible.
–Si votre rancune est trop forte, insista Georges, qui, par un désir fort naturel espérait faire dire à Laurence ce qu’elle avait à reprocher à Remi, si votre rancune contre moi est trop forte, acceptez au moins pour votre fille.
–Ma fille et moi saurons nous passer de vos bienfaits et j’ajoute même que je suis indignée de l’audace avec laquelle vous venez me les proposer.
–Ainsi, vous refusez décidément?
–Eh! puis-je faire autrement?
–Soit, fit Largeval. Ne vous étonnez donc pas si je provoque la réunion d’un conseil de famille qui prendra plus souci de vos intérêts que vous-même.
–Je vous en défie! s’écria Laurence.
–Mais quelle est donc, pensa Georges étonné, la faute qu’a pu commettre mon frère pour que ma femme parle avec cette terrible assurance.
Puis il ajouta tout haut:
–De quoi vivrez-vous?
–Dieu y pourvoira. N’en prenez pas souci.
Cela dit, Laurence fit entendre à Largeval qu’elle désirait voir cette visite prendre fin, et elle se leva pour ne laisser aucun doute à cet égard.
–Ainsi, reprit-Georges d’une voix émue, je n’ai pas à espérer que vous viendrez de temps en temps me voir…
–Oh! pour cela, non.
–Et si Geneviève désirait entretenir des relations de bonne parenté avec son oncle?… car la mort de mon frère ne peut pas faire qu’elle ne soit ma nièce…
–Si Geneviève désirait pareille chose, je tâcherais de l’en dissuader.
–Mais, encore une fois, pourquoi? s’écria Georges qui se butait dans l’obscurité de suppositions plus invraisemblables les unes que les autres.
Pour toute réponse, Laurence fit un pas vers la porte, et force fut à Georges de prendre congé.
–Me permettrez-vous, au moins, de venir prendre de vos nouvelles?
–Oh! vous n’y tenez guère, n’est ce pas?
–Mais je vous assure, au contraire, que j’y liens beaucoup.
Laurence avait ouvert la porte. Georges extrêmement troublé, ne comprenant rien à ce qui lui arrivait, sortit ma– chinalement et descendit à pas lents cet escalier qui était le sien, cet escalier qu’il ne devait gravir désormais que rarement, et encore au cas où on lui permettrait de le monter.
Il s’en alla consterné, ne sachant qu’imaginer.
–Quelle peut être la mauvaise action que Remi a commise? se demandait-il. Qu’a-t-il pu faire pour froisser, pour indigner à ce point Laurence, qui est bonne, qui est indulgente? Je m’y perds! Cela paraît fort grave, car c’est avec un accent bien extraordinaire qu’elle m’a dit:
–Je vous en défie!
Ah! par ma foi, si je ne puis ni lui offrir de l’argent, ni lui être utile en quoi que ce soit, si je dois renoncer à la voir, à lui parler, s’il faut que je n’aie même plus la consolation d’embrasser Geneviève, c’était bien la peine de changer ma position contre celle de Remi.
C’était bien la peine de me faire voleur et faussaire, car il ne faut plus en douter, je suis aujourd’hui l’un et l’autre.
Ainsi, je suis tombé dans cet abîme par affection pour ma femme qui ne veut ni me recevoir ni me visiter jamais, par affection pour ma fille, que je ne reverrai qu’en guettant sa sortie de temps en temps.
Tout en faisant ces amères réflexions, il rentra dans le pavillon de la rue Serpente.