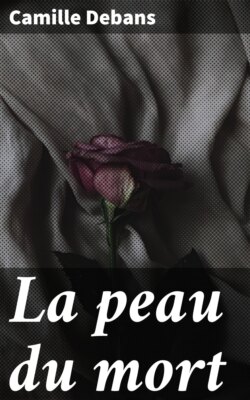Читать книгу La peau du mort - Camille Debans - Страница 5
III
ОглавлениеAvant qu’ils pussent se rendre compte de ce qui leur arrivait, les deux amis furent pris au collet, secoués, renversés, redressés et finalement fort maltraités.
Mais leur étonnement ne diminua guère quand ils s’aperçurent à qui ils avaient affaire.
Ce n’étaient point, comme on pourrait le croire, des bandits qui les attaquaient, mais, au contraire, des gardiens de la paix. Ceux-ci, depuis la gare Montparnasse, les surveillaient pendant qu’eux-mêmes filaient l’homme qui venait de sauter dans le jardin.
–Ah! nous vous y prenons, dit le chef de l’escouade. Emballés, mes agneaux, et en route pour le poste!
–Ils nous prennent pour des voleurs, fit Riaux qui commençait à ne plus s’amuser.
–Flagrant délit d’escalade, reprit l’agent, dans une maison habitée, la nuit. Vous aurez votre compte.
–Doucement, donc! fit tout à coup Montussan.
–De quoi? riposta un agent, faudrait peut-être prendre des mitaines avec ces messieurs.
–Mettez-leur les cabriolets, commanda le brigadier.
On sait que le cabriolet, en argot de police, est une petite corde qui, nouée d’une certaine façon autour du poignet ou de la main d’un homme, l’empêche absolument de faire la moindre tentative pour se sauver ou pour résister.
En ce moment même, Montussan poussa un éclat de rire sonore et franc.
–C’est admirable, dit il.
–Qu’est-ce qu’il raconte, celui-là?
–Tu trouves-ça drôle, toi? demanda Riaux tout déconcerté.
–Mais certainement, fit Montussan. C’est même très-heureux et, pour mon compte, je suis enchanté de ce qui nous arrive.
On se préparait à leur mettre les cabriolets.
–Eh! vous voyez bien que c’est inutile, dit Riaux, Hâtez-vous plutôt de nous conduire chez le commissaire de police qui ne tardera pas à nous mettre en liberté; car si vous nous prenez pour des voleurs, vous vous trompez joliment.
–Voyez-vous ça!
–Eh! laisse donc dire le brigadier, mon cher Riaux.
–Qui êtes-vous alors? demanda l’agent un peu étonné par les façons de ses prisonniers.
–Nous sommes, répondit le peintre, des imbéciles et nous devrions être couchés depuis longtemps.
–Vous vous moquez de nous, par-dessus le marché! clama le brigadier furieux. Allons, allons, au poste et pas de résistance.
–Qui parle de vous résister d’abord, dit Montussan. Pour mon compte, je suis ravi que vous m’ayez arrêté. Il ne pouvait m’arriver d’événement qui me procurât plus de plaisir.
–Ah! ah! vous êtes goguenard.
–Et sincère. Sergent, écoutez-moi.
–Je vous écouterai au poste.
–Vous allez faire une sottise.
–J’en accepte la responsabilite, déclara le gardien de la paix.
–Elle pourrait vous coûter extrêmement cher, déclara Montussan d’un ton si sérieux que le brigadier en fut ébranlé.
–Vous voulez me faire poser, dit-il.
–Prenez garde, reprit Montussan, prenez garde, en ne voulant pas nous écouter sur-le-champ, d’être cause qu’un crime se commettra, là, dans ce jardin, pendant que vous traînerez au violon deux hommes qu’on relâchera demain matin à votre barbe.
–Un crime!
–Oui, monsieur. Vous nous avez pris pour des malfaiteurs, n’est-ce pas?
–Parfaitement.
–Eh bien! le malfaiteur était devant nous, et par simple curiosité nous le suivions depuis Montmartre. Il nous a fait traverser à sa poursuite les rues les plus isolées de Paris. Ici près, rue Hautefeuille, il a été rejoint par un complice auquel il avait donné rendez-vous en lui écrivant un mot sur la table en marbre d’un marchand de vin de la rue Saint-Lazare, au coin de la rue Taitbout. Vous voyez que nous précisons. Ils sont entrés ensemble rue du Jardinet et nous les avons vus franchir le mur au pied duquel vous nous avez trouvés.
–Mais pourquoi étiez-vous vous-même juché sur les épaules de monsieur?
–Je ne voulais pas perdre le fruit de ma poursuite et je tâchais de voir ce qu’ils faisaient dans le jardin.
–Qui êtes-vous donc?
–Moi, je me nomme Montussan et je n’exerce aucune profession. Monsieur est peintre et chevalier de la Légion d’honneur.
Le brigadier salua.
–Vous conviendrez au moins, monsieur, dit-il, que c’est une singulière occupation pour un homme décoré que de faire la courte échelle à un camarade dans les rues à deux heures après minuit.
–Vous avez raison, dit Riaux.
–Brigadier, dit à demi-voix un des gardiens de la paix qui voulait faire du zèle, est-il bien sûr que monsieur soit. ce qu’il dit?
Ces quelques mots firent réfléchir le brigadier.
–Mais enfin quel intérêt aviez-vous à suivre les deux hommes dont vous parlez?
–Je pensais, dit Montussan, que cela ferait un bon chapitre de roman.
Les sergents de ville se mirent à rire.
–Ce particulier nous croit trop bêtes, grommela l’un d’eux.
–A qui appartient ce jardin? demanda le bohème, toujours avec le même ton d’autorité.
–Est-ce que je sais, moi? répliqua le brigadier.
–De quelle maison dépend-il au moins?
–Allons! marchez. Vous vous expliquerez avec le commissaire.
–Eh! laisse donc aller les événements, dit Riaux à Montussan.
–Mais ne vois-tu pas, riposta celui-ci, que les agents ont seuls qualité pour entrer dans une maison à cette heure-ci. Il ne nous reste donc d’autre chance de savoir le mot de l’énigme qu’en pénétrant avec eux dans le jardin pour le fouiller.
Puis, se tournant vers le chef des gardiens de la paix:
–Brigadier, dit-il, un quart d’heure de retard peut être la cause d’un malheur irréparable. Songez sérieusement à ce qui vous attend si vous refusez de croire à ma déclaration. Je vous donne ma parole d’honneur que deux hommes paraissant avoir de très-mauvaises intentions viennent de passer par-dessus cette muraille.
Ces paroles produisirent leur effet. Le brigadier hésita une fois de plus.
–Vous devez connaître, reprit Montussan, la porte de la maison dont ce jardin dépend.
–Sans doute, dit l’agent.
–Eh bien! pourquoi n’iriez-vous pas réveiller le portier et fouiller la maison? Vous ne nous lâcherez pas pour ça.
–Oui, mais je la connais, dit le brigadier. Pendant que nous entrerons et que nous chercherons, les autres qui sont peut-être vos complices repasseront la muraille et vous nous aurez mis dedans.
–Oh! vous n’êtes guère malin, fit Montussan.
–Eh! dites donc, vouss! tachez de ne pas m’insulter.
–C’est donc bien difficile, continua le bohème, de mettre deux ou trois hommes en sentinelle, aux extrémités de cette muraille et de couper ainsi la retraite à nos gaillards s’ils essayaient de se sauver.
Le brigadier resta un moment absorbé, puis se tournant vers ses subordonnés:
–Au fait, leur dit-il, qu’est-ce que nous risquons? Vous allez toujours tenir ces bavards-là. Au premier symptôme de résistance, le cabriolet.
En ce moment deux autres sergents de ville passaient rue Hautefeuille. On les appela et ils furent mis en faction comme l’avait indiqué Montussan.
Puis la petite troupe se dirigea vers la rue Serpente.
Après avoir marché quelques minutes, les gardiens de la paix et leurs prisonniers arrivèrent devant une antique porte ventrue à l’arcade évasée comme on en trouve encore pas mal dans le faubourg Sbint-Germain et en province.
Le brigadier sonna longuement et attendit. Mais la porte resta close. Sans doute le concierge n’avait pas l’habitude d’être réveillé à cette heure indue.
–Sonnez fort! dit Montussan.
L’un des agents agita si longuement la sonnette qu’on l’entendit tinter du dehors. Néanmoins, ce fut sans résultat.
–Le portier s’entend peut-être avec les brigands, fit un des hommes de police.
–Oh! que non, répondit le bohème. Car dans ce cas ils n’auraient pas eu besoin de risquer l’escalade. Il faudrait plutôt craindre qu’on ne l’eût déjà assommé.
–Frappez contre la porte avec les pommeaux de vos sabres, commanda le brigadier à ses hommes.
Ceux-ci allaient obéir, lorsqu’on entendit une voix derrière la lourde porte.
–Qui sonne? que voulez-vous?
–Ouvrez, répondit assez niaisement le brigadier qui n’osait ajouter «au nom de la loi», n’ayant aucun mandat olficiel.
–Ouvrir à cette heure-ci! Qui êtes-vous encore une fois? Je ne reconnais pas votre voix.
–C’est la police, dit Montussan, ouvrez donc dans votre intérêt.
–Ah! mon Dieu! la police! dans mon intérêt, fit la voix.
Et presque aussitôt, la porte s’entre-bâilla doucement.
Puis les costumes des gardiens de la paix ayant sans doute rassuré le prudent personnage, il la rabattit toute grande.
–Est-ce vous qui êtes le concierge de la maison?
–Le portier, oui, monsieur.
A cette rectification, Montussan fit un pas en avant pour centempler ce phénomène qui n’admettait pas la qualification de concierge.
Le brave homme était en chemise, les pieds dans des sandales et commençait à grelotter. C’était pour le moment tout ce qu’on pouvait savoir de lui, la nuit étant très-noire, et le vestibule de la maison se trouvant totalement dépour-’ vu de luminaire.
–Voici deux… le brigadier hésita, il ne savait comment désigner Montussan et Riaux.
–Deux noctambules, souffla le bohème.
–Deux rôdeurs de nuit plutôt, reprit le brigadier.
–C’est la même chose.
–Enfin, continua le malheureux agent impatienté, voici deux messieurs.
–C’est ça.
–Qui prétendent que des voleurs se sont introduits dans le jardin de votre immeuble, par le mur de la rue du Jardinet.
–Dans mon jardin! répéta le portier.
–Et nous venons pour nous assurer qu’on ne nous trompe pas.
–Des assassins, peut-être! gémit l’homme au cordon.
–Vous allez être assez bon pour nous servir de guide afin que nous puissions exercer les recherches nécessaires.
–Avec plaisir; je passe une culotte et je suis à vous.
Il rentra dans sa loge et alluma une bougie.
Alors on put le voir. C’était un petit homme prodigieusement large. Sa figure, sa poitrine, son ventre, tout cela s’était déployé en largeur. Son buste formait presque un carré parfait supporté par des jambes courtes et minces. Ses bras étaient si longs que malgré soi on cherchait dans son dos une bosse absente.
Abrités sous un front proéminent, brillaient deux petits yeux gris, qui étaient probablement ce qu’il avait de plus étroit dans la figure, car sa bouche était large, son nez largement épaté, ses oreilles disposées en larges feuilles de chou et toute sa peau était trouée de larges traces de variole.
Avec ça, un air naïf, craintif et bon.
–J’ai, dit-il, deux lanternes à puissants réflecteurs. Faut-il les allumer?
–Sans doute, dit Montussan, qui semblait prendre le commandement de l’expédition, nous n’avons pas de ménagements à prendre, puisque les issues sont gardées.
Cinq minutes après, les quatre agents, Montussan et Riaux, guidés et éclairés par le concierge, pénétraient dans le jardin et se dirigeaient tout d’abord vers l’endroit où les deux hommes avaient dû franchir le mur.
–Passez par ici, messieurs, à droite du pavillon, dit le concierge.
–Est-il habité ce pavillon? dit Montussan.
–Oui, monsieur.
–Par qui?
–Par un rentier, M. Largeval, le plus honnête, le plus charmant, le plus estimable des locataires, répondit le portier.
–Et généreux naturellement? fit le bohème.
–Ah! tenez, messieurs, proclama le concierge sans répondre à Lucien, nous voici arrivés au pied de la muraille.
–Très-bien, dit Montussan qui avait pris une lanterne. Voyez, brigadier, un arbuste cassé, la terre piétinée, puis la trace de leurs pas imprimée dans le sol humide.
–Oh! oh! remarqua le portier, ils se sont dirigés tout droit vers le pavillon. Les empreintes sont faciles à suivre et parlent clairement.
–Ici ils ont fait une halte. Portier, abaissez votre fanal. dit le brigadier.
–C’est probablement quand ils ont entendu le bruit que vous avez fait en courant, pour vous em parer de nous, brigadier.
–C’est bien possible.
–S’ils ont compris ce qui se passait, ils ont dû bien rire. Après un temps d’arrêt, ils ont repris leur marche vers le pavillon.
–Oui. Tiens, ici, ces traces disparaissent.
Montussan se pencha en laissant traîner la lumière de sa lanterne sur le sol et dit:
–Mais non. Les traces ne disparaissent pas le moins du monde. Seulement les deux filous ont mis le pied sur l’asphalte qui fait une ceinture bitumée au pavillon. C’est moins visible, mais il est encore facile de les suivre.
–En effet, dit un des gardiens de la paix, je vois ici des indices laissés par la terre qu’ils avaient à leurs souliers.
–En voici encore sur le perron du pavillon, appuya Riaux.
–Je crois bien! ajouta Montussan qui était accouru, on dirait même qu’ils ont secoué vigoureusement leurs chaussures, comme s’ils avaient été sûrs d’entrer.
–C’est vrai, dit le brigadier stupéfait, nous les aurons dérangés.
–La porte est-elle ouverte?
–Non, fit un sergent de ville en appuyant dessus.
–Alors ils sont cachés dans le jardin. C’est maintenant qu’il faut manœuvrer avec prudence.
–Rien ne sera plus facile que de les trouver. En s’éloignant de la maison, ils ont dû laisser d’autres empreintes. Ilsuffit de découvrir l’endroit où elles commencent.
Toute cette conversation, depuis l’entrée dans le jardin. avait lieu à demi-voix, et si la scène avait eu des témoins, ceux-ci eussent été fort embarrassés pour dire de quoi il s’agissait.
Montussan et le brigadier, qui portaient les lanternes, cherchèrent tout autour de la maison.
Avec une attention méticuleuse ils suivirent d’un bout à l’autre le rebord de l’espèce de trottoir qui protégeait le pavillon contre l’humidité. Ils ne trouvèrent pas la moindre trace de retraite..
–Il est on ne peut plus clair, dit Montussan, que les deux individus que nous avons suivis se sont approchés du pavillon.
–C’est évident.
–Mais rien ne prouve qu’ils s’en soient éloignés ensuite.
–Alors, dit le brigadier, vous pensez qu’ils s’y sont introduits?
–Je n’en sais rien. Mais c’est possible. S’ils ont eu le temps d’y pénétrer, rien ne les a empêchés de fermer soigneusement la porte et d’attendre, dans une tranquillité parfaite, que nous soyons partis.
Il y a un moyen bien simple de nous en assurer, dit le brigadier, c’est de réveiller le locataire et de lui demander s’il n’a rien entendu. Qu’en pensez-vous, concierge?
–Portier, s’il vous plaît.
–Portier tant que vous voudrez, mais qu’en pensez-vous?
Pour toute réponse le portier se mit à frapper à tour de bras sur la porte, pendant que Montussan sonnait avec non moins d’énergie.
–M. Largeval! M. Largeval! criait tout le monde.
Au bout de quelques minutes de ce vacarme, une fenêtre s’ouvrit au premier étage.
–Est-ce vous, monsieur Largeval? demanda le portier en braquant une lanterne sur son locataire.
–Ah§mon Dieu, Pascalin, que signifie un pareil charivari?
Le portier s’appelait Pascalin.
Donc, Pascalin répondit:
–Ne craignez rien, monsieur, il n’y a aucun danger. Ce sont des gardiens de la paix qui ont vu un homme, ou plutôt deux hommes.
–Sapristi, mon ami, que vous êtes prolixe, interrompit Moniussan. Voulez-vous, monsieur, être assez bon pour descendre cinq minutes?
Le locataire grommela quelques paroles de mauvaise humeur, comme un homme furieux d’avoir été dérangé de son sommeil. Puis, il referma la fenêtre, et, quelques secondes après, on distingua un pas assez lourd sur l’escalier.
–Faut-il ouvrir? demanda-t-on à l’intérieur.
–Oui, monsieur Largeval, ouvrez, n’ayez pas peur, dit Pascalin.
Ces éternelles recommandations de ne rien craindre, de n’avoir pas peur, firent que Riaux se rapprocha du portier pour l’examiner, et il s’aperçut que ce malheureux était sous l’empire d’une terreur folle, qu’il cherchait à dissimuler en parlant le plus possible.
Cette frayeur durait depuis l’entrée des agents, mais elle grandissait à mesure que le moment approchait où le dénouement était probable.
il se disait avec effroi que les brigands étaient armés jusqu’aux dents et qu’ils n’allaient faire qu’une bouchée de tout ce monde.
Pendant que Riaux découvrait cela, on entendait un bruit de verrous tirés, de verrous qui devaient être formidables, si on en jugeait par le bruit qu’ils faisaient. Puis une clef tourna deux fois dans la serrure fermée à double tour.
–En tout cas, dit le brigadier, s’ils sont entrés dans le pavillon, ce ne peut être par une porte aussi soigneusement barricadée.
M. Largeval parut alors sur le seuil, en robe de chambre, coiffé du foulard pacifique et traditionnel, les yeux gonflés, la mine ahurie.
Iltenait à la main un bougeoir qui éclairait sa figure assez insignifiante au premier abord.
–Qu’y a-t-il donc, s’il vous plaît? demanda-t-il.
–Nous avons acquis la certitude, répondit le brigadier, que deux hommes de mine extrêmement suspecte se sont introduits, dans votre jardin.
–Des voleurs! s’écria Largeval avec une épouvante réelle.
–Probablement, appuya le brigadier.
–Voyez, voyez, Pascalin, ce qui arrive, dit le locataire effaré. Je vous ai dit assez souvent que la clôture n’était pas suffisante.
–Et croyez-vous, riposta le portier, que je ne l’aie pas dit au propriétaire. J’ai autant d’intérêt que vous à ce que la maison soit bien close. Je suis aux premières loges pour être assassiné, ajouta-t-il avec un frisson.
–Dites à la première loge, mon ami, fit Montussan, et ce sera presque un mot.
Pascalin ne comprit pas, mais il reprit:
–Si le propriétaire habitait la maison et qu’il eût des alertes comme celle de cette nuit, il n’hésiterait pas à faire mettre des broussailles sur la crête du mur.
–Vous discuterez cela demain, fit observer Montussan. Pour le moment nous devons dire à monsieur que les traces des deux hommes sont très-visibles jusqu’à la porte du pavillon.
–Et ensuite?
–Et comme ensuite rien ne nous indique que ces messieurs aient pris le large, il faut qu’ils se soient évanouis comme des fantômes.
–Ce qui n’est pas probable, remarqua judicieusement le brigadier.
–Ou bien qu’ils aient pénétré chez vous.
–Chez moi? fit Largeval en bondissant. Entrez, messieurs, ne restez pas ainsi à la porte. Chez moi! des voleurs! des assassins! Je me souviens bien que dans le demi-sommeil, quelques instants avant de m’endormir tout à fait, il m’a semblé entendre marcher dans les allées.
–Ah! vous voyez, interrompit vivement Pascalin.
–Mais, continua Largeval, il se produit souvent des bruits si singuliers autour du pavillon, que je ne m’en suis pas inquiété.
–Vous paraissez d’ailleurs être consciencieusement fermé chez vous, dit Riaux.
–Ce n’est pas une raison. On dit que les voleurs ont tant de tours dans leur sac et qu’ils savent si bien ouvrir une poite sans déranger ni verrous ni serrure que je ne répondrais point qu’ils ne sont pas ici.
–Auraient-ils pu y pénétrer par le sous-sol? demanda le brigadier.
–Oh! non, répondit Largeval avec empressement.
–Et par les persiennes du rez-de-chaussée?
–Toutes les persiennes sont doublées en tôle.
–Alors, ils ne se sont certainement pas introduits chez vous. Nous allons nous retirer.
–Non pas, s’il vous plaît, fit Largeval. Je ne me coucherai jamais sans être absolument certain qu’il n’y a pas de malfaiteurs dans ma maison.
–Mais puisqu’ils n’ont pu entrer.
–N’importe. Je vous supplie de faire une perquisition et de visiter jusqu’au moindre recoin.
Sur de pareilles instances, les sergents de ville crurent devoir se rendre au désir du locataire, et tout le monde entra.
–Voyons d’abord les caves, dit le brigadier.
On descendit. Largeval offrit quelques fines bouteilles aux représentants de l’autorité. On trinqua à la santé de l’ordre de choses et de son auguste famille, selon l’usage, puis on remonta au rez-de-chaussée.
–Commençons par nous assurer, dit Montussan, qu’aucune persienne n’a été sciée, qu’aucune fenêtre n’a été fracturée.
Tout était en parfait état de conservation.
La visite au premier étage et au grenier qui le surmontait n’offrit rien de bien intéressant. On fouilla tous les coins et recoins, jusqu’aux plus secrets.
Rien, on ne trouva rien.
La petite troupe fut même obligée de se retirer, parfaitement convaincue que les malfaiteurs en question n’avaient pu pénétrer dans la maison.
–C’est égal, disait Montussan visiblement désappointé, c’est bien extraordinaire.
–Il ne nous reste plus qu’à explorer le jardin, dit le brigadier.
De nouvelles perquisitions, opérées dans tous les sens et recommencées deux ou trois fois, n’amenèrent pas de résultats plus heureux.
On souhaita la bonne nuit à Pascalin et l’on se retira.
–Ils se sont envolés! se disait Montussan, qui était devenu songeur.
Quant à Riaux, c’était avec une certaine satisfaction qu’il voyait arriver le moment où il pourrait enfin rentrer chez lui. Mais le peintre et le bohème furent ramenés à la triste réalité, lorsqu’ils entendirent le brigadier reprendre la parole en ces termes:
–Tout ça, c’est très-bien; mais à présent il faudrait savoir si ces deux gaillards-là ne se sont pas moqués de nous.
–Quels gaillards? demanda Pascalin surpris de ces paroles.
–Mais ces deux que voilà. Nous les avons pincés au moment où ils escaladaient le mur.
En entendant ces paroles, le portier, qui se trouvait à côté de Riaux, fit un bond énorme.
–Mais c’est donc des repris de justice? murmura-t-il d’une voix altérée.
–Non, pas repris, portier, pris seulement, et pas pour longtemps.
–C’est ce que nous allons voir, opina le brigadier d’un ton sentencieux.
–Ce sera tout vu dans une heure, je pense, riposta Montussan, qui calculait que le jour ne devait pas être loin.
–En route, mes petits, reprit l’agent. En passant, nous relèverons de leur faction les camarades que nous avons laissés dans la rue du Jardinet.
Le jour naissait lorsqu’ils arrivèrent au poste. Mais il fallut longtemps attendre un commissaire de police qui, après les avoir interrogés, les fit mettre en liberté purement et simplement à neuf heures et demie.