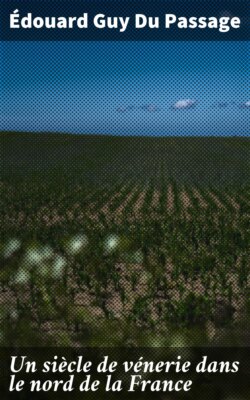Читать книгу Un siècle de vénerie dans le nord de la France - Édouard Guy Du Passage - Страница 27
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеLOUIS-MARIE PERSONNE DE LA CHAPELLE DE SONGEONS Chevalier du Lys, Lieutenant de Louveterie
Les de Songeons
Table des matières
DANIEL-Louis Personne de la Chapelle était fermier général de la Maréchaussée de France, puis capitaine des chasses à Versailles. Quand on réduisit le personnel de la vénerie, en 1774, Daniel-Louis Personne de la Chapelle quitta sa charge et acheta du Maréchal de Boufflers le Marquisat de Songeons, terre très importante, dotée d’un superbe parc dessiné par Le Nôtre et d’un fort beau château bâti par Michel de Conflans, Marquis d’Armentières.
Son fils, Louis-Marie Personne de la Chapelle de Songeons, fut nommé conservateur des forêts royales pour le Beauvaisis, vers 1786. Dès 1784, ce Songeons possédait une meute pour loups, qu’il augmenta en 1796. Ne s’occupant que de chasse et d’agriculture, Louis-Marie n’émigra point. En 1793, déclaré suspect, il allait être incarcéré à Chantilly, lorsque le citoyen Prieur se porta garant du civisme du citoyen Personne. D’opportuns cadeaux vinrent confirmer les Commissaires du Salut Public dans leur attitude bienveillante, la Révolution n’ayant pas exercé, dans le Beauvaisis, les mêmes ravages qu’en Picardie et surtout qu’en Artois, Louis-Marie chassa à courre de 1784 à 1840: c’est un bail. Fort riche, encore plus dépensier, il menait dans sa terre grand train, n’autorisant sa femme, née de Grasse, à se rendre à la grand’messe de Songeons qu’en voiture attelée à la d’Aumont; aussi, quand ses dévotions l’appelaient de grand matin à l’église, la pieuse fille de l’Amiral de Grasse, était-elle heureuse de réquisitionner un âne pour s’y rendre.
Leur fils, Hector, avait suivi l’étoile de Napoléon et fait toutes les campagnes de l’Empire comme sous-intendant militaire. Au lendemain du désastre de Waterloo, Madame de Songeons était follement inquiète de son fils et, n’en ayant aucune nouvelle, était dans des transes mortelles. Ce fut le brave Lebeau, élevé à Songeons par ses soins et profondément attaché à ses maîtres, qui vint, par son dévouement, la tirer d’embarras. Monté sur la Blanche, sa jument de chasse, il partit aussitôt, sans rien dire, dans la direction du Nord, et, malgré son ignorance géographique, grâce à son flair de chasseur, il sut néanmoins, à travers mille difficultés, retrouver son jeune maître sur la frontière, en pleine retraite avec l’armée française. Le voyant sain et sauf, il prit à peine le temps de lui demander, pour sa mère, une ligne au crayon, et, reprenant sa route, rentrait d’une traite à Songeons, apportant à sa maîtresse le calme dont elle avait si grand besoin et qu’il avait été lui chercher avec autant de cœur que d’intelligence. Cette touchante anecdote n’est-elle pas à l’honneur de cette classe de piqueux que nous prisons si haut.
A la Restauration, Louis-Marie de Songeons vint avec Lebeau et son équipage chasser avec le Prince de Condé, l’auguste propriétaire de Chantilly. Revenu d’émigration, établi en camp volant dans son domaine dévasté, le Prince n’avait pu encore reconstituer sa vénerie, mais son ardeur cynégitique était telle que Songeons ne put y tenir et lui laissa Lebeau et une partie de son équipage. Lors d’un déjeuner à Chantilly, le Duc d’Aumale communiquait à Monsieur Aristide de Songeons le compte rendu de deux laisser-courre de l’équipage de son aïeul, consignés dans le livre de chasse du Prince de Condé. Le 14 septembre 1816, l’équipage de Songeons, sur la brisée de Lebeau, prit en deux heuree une bête rousse au poteau de Malasisse.
Le 25 septembre 1816, Auguste Lebeau a été blessé par un sanglier qui lui a mis trois côtes à découvert, aux étangs de Commelles, son fusil ayant pris l’humidité et ayant raté.
Pour remercier son voisin de son amabilité, le Prince de Condé fit don à Monsieur de Songeons de deux tableaux des galeries de Chantilly. Ces deux toiles, œuvres de Berteaux, représentent, l’une, Louis-Joseph de Bourbon chassant et demandant un renseignement à un bûcheron; l’autre, un rendez-vous, où le Prince, entouré de ses gentilshommes, chausse ses bottes en écoutant le rapport, tableau d’un très joli effet et inspiré d’une façon visible par le carton d’Oudry, représentant Louis XV au rendez-vous et allant enfourcher un de ces jolis pie-bai.
Louis-Marie Personne de Songeons eût, sa vie durant, une meute nombreuse composée de chiens français issus de croisements identiques à ceux de Messieurs du Parcq et de Sarcus, ses amis, et de chiens anglais qu’il avait achetés à Lord Werbroock. Il m’a été donné de voir deux croquis de Lord Stanhope, le diplomate anglais, familier de Songeons, représentant Fauvette, une des lices du chenil. C’est le type de harrier le plus élégant qu’on puisse trouver.
Louis-Marie de Songeons continua jusqu’à la vieillesse la plus avancée à conduire son équipage, aidé de ses deux piqueux, Grandin et Lebeau; ce dernier devait par la suite devenir le premier piqueux du prince de Wagram, à Grosbois.
Le Louvetier du Beauvaisis sut donner à ses deux petits-fils, Émile et Aristide, le feu sacré, et je ne puis mieux faire que de feuilleter le livre des chasses d’Aristide pour remémorer ces souvenirs de jadis.
Sous la Restauration, en Beauvaisis comme en Picardie, nombre de châtelains possédaient une petite meute d’une quinzaine de briquets, la plupart avec beaucoup de sang normand. C’étaient le Vicomte Dary, Monsieur du Parcq, Monsieur Michel Wallon, le Comte Maximilien de Béthune. L’équipage de la Villetertre avait toutefois un ensemble beaucoup plus homogène et c’est de ce chenil et de celui de Songeons que sortirent les premiers chiens de Picard Piqu’Hardy’.
Octobre 1837
Équipage de mon grand-père. Rendez-vous au bois du Parc au Gros-Chêne, près Beauvais. Attaqué un grand sanglier; pris en trois heures, servi d’un coup de carabine par Monsieur de Bully-d’Hécourt, maire de Beauvais. On en attaque un second qui est tiré, blessé à une trace, et enfin achevé par Monsieur de Bully-d’Hécourt. Au retour, mon grand-père prend mon frère Émile dans ses bras et le met à cheval sur le grand sanglier, étendu mort dans la cour de la maison de Beauvais.
Novembre 1837.
Équipages de mon grand-père et du Comte Maximilien de Béthune. Attaqué un cerf à sa troisième tête en forêt de la Neuville-en-Hez; pris en quatre heures.
Octobre 1838.
Rendez-vous au bois de Crillon. Attaqué un grand loup dans les bois de Cagny; tué en débucher par Bernard, fermier à Martincourt. Présence de mon grand-père, de mon père et de mon beau-frère, le Comte de Lunzi (je montais Petit Lion).
Août 1843.
Equipage du Comte Maximilien de Béthune. Rendez-vous à la Baraque, forêt de Chelles. Attaqué un louveteau noir; pris en une demi-heure. Présence du Comte Charles de Grasse, du Comte de Lastours, de Monsieur Michel Wallon et de la Comtesse d’Ailly.
Octobre 1844.
(Louis-Marie Personne de Songeons est décédé. L’équipage est à son fils Hector; toutefois, étant de très forte corpulence, pas très ingambe, ce sont ses fils qui chassent.) Mon équipage devait chasser avec celui de Monsieur de Béthune une portée de louvarts au bois de Caumont. Je pars pour promener mes chiens, qui attaquent au bois de Limermont un louvart qui débuche, passe au bois de Fontaine, débuche, passe au bois de Rubilly, débuche et rentre au bois de Caumont où mes chiens l’étranglent dans la côte du Chapitre (je montais Veneur).
Novembre 1846.
Mon équipage attaque au bois de Moncheaux un brocard, pris après trois heures de chasse dans les haies de Formerie. Présence de mon frère Emile, de Messieurs Ducrocq, Dupuis, etc.
Novembre 1850.
Équipages Thélu, de Morgan et le mien réunis. Attaqué en forêt de la Neuville-en-Hez une vieille laie, qui se fait battre dans toute la forêt et n’est prise qu’à cinq heures du soir et servie par Monsieur Salette de Clermont.
Août 1853.
Équipages Thélu et le mien réunis. Nous prenons un grand loup à Achy.
A la même époque, Émile de Songeons achetait en Belgique une petite meute avec laquelle il se mit à chasser le lièvre.
Octobre 1853.
Equipage de beagles de mon frère Émile. Attaqué à Songeons un lièvre au bois du Forestel; pris en une heure et demie au bois de Fontaine, Présence de Frédéric Gibert.
De Novembre 1853 au 15 Avril 1854.
Déplacements à la Neuville-en-Hez de l’équipage d’Émile. Trois chevreuils pris dans la saison. Ces chiens n’ont pas assez de vitesse pour le chevreuil.
La tenue de Louis-Marie de Songeons, portée par ses petits-fils, était bleue à parements et poches rouges, galonnées de vénerie, et le bouton un loup fuyant surmonté d’une banderolle avec la devise: «A moi Saint-Hubert». Le seul portrait qu’on ait de ce grand veneur est dû à la fille de son piqueux, Lebeau, qui le représente en tenue de Capitaine de Louveterie.