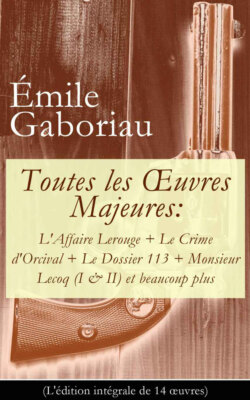Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 23
IV MADAME DE MONTESPAN.
MADEMOISELLE DE FONTANGES.
ОглавлениеLe jour où la duchesse de La Vallière, emportée par son amour, osait, au mépris des ordres de Marie-Thérèse, lancer en avant son carrosse et arriver la première près de Louis XIV, il y eut autour de la reine comme un cri d'indignation arraché par l'audace de la favorite.
—Pour moi, dit une des dames, Dieu me garde d'être jamais la maîtresse du roi; mais, si j'étais assez malheureuse pour cela, je n'aurais jamais l'effronterie de paraître devant la reine.
Cette dame plus vertueusement indignée que les autres était la marquise de Montespan. Et lorsqu'ainsi, devant la reine, elle prenait parti pour l'épouse contre la favorite, son audace était bien autrement grande que celle de La Vallière; car en ce moment même elle travaillait à renverser la pauvre duchesse, et, la veille de ce jour peut-être, sa chambre s'était mystérieusement ouverte pour le roi.
Françoise-Athénaïs de Rochechouart-Mortemart appartenait à l'une des plus nobles et des plus anciennes familles du royaume; elle était née en 1641. Toute jeune, elle était venue à la cour, et, sous le nom de Tonnay-Charente, avait brillé, à côté de La Vallière, au milieu de l'escadron fringant des filles d'honneur de Henriette d'Angleterre.
Brouillonne, intrigante, médisante à faire frémir, se moquant de tout, elle réussit à se faire chasser de chez Madame, qui était la bonté même. Comme elle avait envie de prendre son essor, elle se décida à choisir parmi les nombreux et honorables partis qui se présentaient.
Elle épousa en 1663 un homme de cœur et d'esprit, Henri Louis de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, petit-fils de ce riche Zamet, chez qui la belle Gabrielle prit son dernier repas. Le roi signa au contrat.
La jeune marquise, elle avait vingt-trois ans, commença par donner un fils, un héritier à son mari, le duc d'Antin; c'était l'usage du temps. Nommée surintendante de Marie-Thérèse, elle sut capter la confiance de la reine par sa dévotion affectée et par ses médisances contre la pauvre La Vallière.
Madame de Montespan était mariée depuis moins de dix-huit-mois, lorsqu'elle chercha, semble-t-il, à disputer le cœur de Monsieur à un de ses petits amis, le chevalier de Lorraine. Elle perdit sa peine. Elle écouta alors, dit-on, l'irrésistible Lauzun; mais cette passion, d'ailleurs tenue fort secrète, ne dura qu'un jour.
Lauzun en la quittant voulut reconnaître ses faveurs par de bons offices, et il parla fort avantageusement au roi de la marquise de Montespan. Louis XIV fit la sourde oreille, il aimait encore La Vallière et la marquise ne lui avait jamais plu.
Le roi la connaissait de longue date, et seul peut-être de sa cour, il n'avait point admiré cette superbe beauté. Il l'avait vue jeune fille dans les salons de Madame; mariée, il la retrouvait chaque soir chez la reine, et ne semblait faire aucune attention à elle. Peut-être la redoutait-il. Louis XIV détestait l'esprit et les femmes spirituelles; or madame de Montespan passait pour une des plus redoutables railleuses de la cour. Ses bons mots armés en guerre blessaient mortellement, lorsqu'ils ne tuaient pas. Elle avait cette verve caustique si amusante pour tous ceux qui se croient à l'abri, et qui semblait un des priviléges de sa famille; on disait: «l'esprit des Mortemart.»
On peut le dire hardiment, jamais la superbe marquise de Montespan n'eût succédé à la timide La Vallière dans le cœur de son amant, sans un de ces hasards vulgaires qui, presque toujours, décident souverainement des destinées, hasard qui la jeta sur le chemin du roi.
C'était pendant cette joyeuse promenade de Flandre, en 1667. Toute la cour, à la suite de la reine, s'était établie en camp-volant à Compiègne, et, en attendant le roi, menait la plus joyeuse vie du monde. Madame de Montespan, avec un luxe de prudence, un peu exagéré peut-être pour une femme de trente ans, ne voulut pas demeurer seule, elle demanda asile à madame de Montausier, et vint mettre sa vertu et sa réputation sous la clef «de cette dame si austère.»
Un soir, le roi arrive, les fourriers avaient oublié son logement; l'appartement voisin de celui de la reine avait été donné à Mademoiselle. Louis XIV ne veut déranger personne, il déclare qu'en campagne le plus humble logis lui suffit, et il se contente d'une petite chambre qu'un simple escalier de quelques marches séparait seul de l'appartement occupé par madame de Montausier. Pour plus de sûreté, comme «cette reine des Précieuses» avait sous sa garde la vertu des filles d'honneur, on plaça une sentinelle sur l'escalier. Sentinelle perdue.
Toutes ces précautions dont se bastionnait la vertu de madame de Montespan devaient irriter la tentation. La curiosité prit le roi. Il vit là des difficultés à vaincre, de l'adresse à déployer. C'était une aventure, il la courut. César vint, il vit, il triompha. Ou plutôt non, tout le triomphe fut pour la marquise. Le lendemain, on ne replaça plus de sentinelle dans l'escalier.
La surprise, le mystère, les périls presque, donnaient un piquant attrait à cette bonne fortune. Il y avait mille obstacles; et que de précautions à prendre! L'escalier à franchir, sans être vu, la porte à forcer, bien discrètement; la reine logeait au-dessous, il fallait marcher sur la pointe du pied, puis, on pouvait éveiller madame de Montausier: que dirait cette dame «aux mœurs si sévères?» Hélas! faut-il le dire, madame de Montausier dormit autant que le souhaitait le roi.
À dater de cette première nuit, le roi sembla prendre en affection sa petite chambre, il s'y enfermait des journées entières, pour travailler, et souvent ses travaux le retenaient jusqu'à une heure fort avancée de la nuit. La reine était pleine d'inquiétude de cet excès de labeur, elle craignait que le roi ne compromît sa santé, mais Louis la rassurait, et lui faisait comprendre les pénibles nécessités du métier de roi.
Enfin, au bout de huit jours, ou plutôt de huit nuits, le roi était amoureux fou de madame de Montespan.
Et certes, la marquise en valait la peine. Un matin, au temps de sa plus grande faveur, elle était à sa toilette et se faisait des mines dans son miroir, lorsqu'il lui arriva de dire:
—Le roi devait bien à la dignité de sa couronne de prendre pour maîtresse la plus belle femme de son royaume.
Cette présomption superbe était, il faut l'avouer, admirablement justifiée. La marquise de Montespan, au dire de tous ses contemporains, et ce qui est mieux, de ses contemporaines, était la plus belle femme de la cour.
Beauté plantureuse et exubérante, elle était le vivant contraste de la blonde et frêle La Vallière; elle étalait avec orgueil des épaules et des bras admirables, et une gorge dont les splendeurs n'avaient pas de rivales; ses traits étaient réguliers, un peu virils, peut-être, ou du moins trop nettement accusés, son teint éblouissant de fraîcheur; elle avait la bouche sensuelle, la lèvre un peu épaisse, mais des dents magnifiques; ses yeux brûlaient de passion ou pétillaient de malice, selon les sentiments qui l'agitaient; enfin, elle avait une chevelure opulente, ses pieds et ses mains étaient d'une délicatesse exquise et d'une rare perfection de modelé.
Malgré cette beauté si rayonnante, madame de Montespan n'était cependant pas sympathique. Elle pouvait inspirer des désirs furieux, mais non un véritable amour, comme la douce et tendre La Vallière; remuer les sens, mais non le cœur. On se rend compte de la puissance de cette femme si belle, lorsqu'on regarde avec réflexion le beau portrait qui nous en est resté; elle est là dans tout l'épanouissement de sa riche nature; les seins nus, elle allaite un enfant beau comme elle, comme elle éclatant de vie et de fraîcheur. Et cependant elle ne séduit pas, une pensée méchante plisse imperceptiblement le coin de sa bouche moqueuse, on attend l'épigramme cruelle, enfin on lit dans cet œil aux lueurs phosphorescentes son terrible caractère.
Légère, capricieuse, hardie, hautaine, tous ses goûts étaient des passions, toutes ses passions des orages. Jalouse, tyrannique, un rien lui portait ombrage; la mobilité de ses caprices eût lassé toutes les patiences; ses dédains étaient écrasants. Son égoïsme était plus grand encore que celui de Louis XIV, jamais elle n'aima personne, pas plus son amant que son mari, elle n'aima pas même ses enfants. Son esprit cruel était sans pitié, pas un ridicule, pas un travers ne lui échappaient, et souvent elle immola ses meilleurs amis, ses plus dévoués, au seul plaisir de dire un mot plaisant. Ses emportements étaient incroyables, ses colères furieuses; une de ses contemporaines la peint d'un trait: «C'était un ouragan.»
C'est à cette femme que Louis XIV sacrifia La Vallière, la bonne, la dévouée La Vallière, le seul amour vrai de sa vie. Avec madame de Montespan la tempête entrait à Versailles.
Cette nouvelle passion du roi déjoua pendant quelques mois l'incessant espionnage organisé par les courtisans autour de la personne du maître; les trois ou quatre confidents de Louis XIV gardèrent scrupuleusement le secret. L'orgueil toujours croissant de madame de Montespan finit par donner l'éveil, et du jour où l'on tint le premier fil de cette intrigue, tout l'écheveau fut bientôt déroulé.
Ce fut un rude échec pour la réputation de madame de Montausier: on se demandait comment «l'Alceste femelle» avait pu prêter les mains à la double infidélité du roi, et donner à des amours adultères l'abri de son manteau d'austérité.
La reine, qui avait la plus grande confiance en la surveillante des filles d'honneur, fut plus particulièrement indignée; elle la fit venir, afin d'avoir avec elle une explication. Madame de Montausier nia tout, mais la reine ne parut pas convaincue.
«On me mande, disait Marie-Thérèse, que c'est madame de Montausier qui conduit cette intrigue, qu'elle me trompe, que le roi ne bougeait d'avec madame de Montespan chez elle.... Je ne suis dupe de personne, j'en sais plus qu'on ne croit[36].»
La duchesse de La Vallière, elle aussi, était depuis longtemps au courant de tout, mais, comme la reine, elle se contenta de pleurer sans mot dire; depuis longtemps elle s'attendait à voir le roi la quitter pour une autre. «Ma beauté m'a abandonnée, disait-elle tristement, le roi a fait de même.»
Comme toujours en pareille occurrence, le trop confiant marquis de Montespan fut le dernier informé de ce qui se passait. Il l'apprit cependant, et, comme «il était original en tout,» il ne fut que médiocrement satisfait de l'honneur que le roi lui faisait en aimant la marquise.
Comme cependant on ne savait rien de positif, le marquis pensa que le plus court était d'emmener sa femme dans leurs terres. La marquise refusa net de le suivre. Une scène d'intérieur s'ensuivit, scène si orageuse vers la fin, que M. de Montespan leva la main sur sa femme.
—Eh bien! oui, le roi m'aime! s'écria la marquise avec un geste de défi, le roi m'aime. Et maintenant, frappez si vous l'osez.
Le marquis osa; il osa même si fort, que madame de Montespan, échevelée, les habits en désordre, s'enfuit de l'hôtel conjugal et alla demander l'hospitalité aux époux Montausier. Ils étaient l'un et l'autre trop bons chrétiens et trop habiles courtisans pour laisser à la porte une pauvre femme, la maîtresse du roi, sans refuge; ils l'accueillirent comme une bénédiction de Dieu, et lui firent fête. Ils pensaient qu'avec madame de Montespan la fortune et la faveur allaient entrer dans leur maison.
Le marquis de Montespan, un entêté, ne se tint pas pour battu. Il pensa que son titre de mari lui donnait quelques droits, et directement il se rendit chez madame de Montausier pour reprendre sa femme.
Ce fut un esclandre épouvantable: la marquise, aidée de sa protectrice, se défendit comme une lionne contre son mari qui voulait l'entraîner de force. Le marquis allait être le plus fort, lorsque madame de Montausier appela ses domestiques à la rescousse. Ils accoururent, se faisant arme de tout, et M. de Montespan dut battre en retraite devant un ennemi par trop supérieur en nombre. Mais il ne s'éloigna pas sans avoir passé sa fureur sur madame de Montausier; «il lui dit des choses horribles, et mêla ses reproches des injures les plus atroces.»
Cette terrible scène fit une telle impression sur madame de Montausier, déjà souffrante à ce moment, qu'elle tomba malade sérieusement, et se mit au lit pour ne plus se relever. Au moins son mari fut récompensé, «Alceste fut nommé gouverneur du Dauphin.»
Lorsque la marquise éplorée vint informer le roi de ce qui s'était passé, il entra dans une fureur impossible à décrire. Il n'osait pourtant rien entreprendre contre le mari de sa maîtresse, il se contenta de lui faire conseiller de se tenir tranquille.
Le malheur est que le marquis de Montespan ne voulait pas se tenir tranquille. Ne pouvant empêcher qu'on lui prît sa femme, il prétendait avoir la liberté de ne s'en pas montrer satisfait, et, qui plus est, de le publier partout.
Moins de trois jours après cette aventure, le marquis parut au lever de Louis XIV vêtu de noir de la tête aux pieds, et le visage lugubre, «comme un homme qui aurait enterré toute sa famille.»
—Avez-vous donc perdu quelqu'un, marquis? lui demanda le roi de son air le plus bienveillant.
—Non, Sire, répondit-il brutalement, je porte le deuil de ma femme.
Et il se retira gravement, au milieu de l'ébahissement général, laissant les courtisans véritablement stupéfaits de l'audace de cet original et de l'incompréhensible longanimité du roi.
Ce n'était pourtant pas encore assez pour le marquis: il fit draper son carrosse de noir, et aux quatre coins, en guise de panaches, il fit placer des cornes,—ses armes parlantes, disait-il. Puis, avec cet équipage fantastique, il se promena par tout Paris.
C'était plus que n'en pouvait supporter Louis XIV; il écrivit à son ministre pour châtier l'insolent:
«Monsieur Colbert, il me revient que Montespan se permet des propos indiscrets. C'est un fou que vous me ferez le plaisir de suivre de près et de chasser de Paris.»
On ne le chassa pas. Pour l'avoir toujours sous la main, on le mit à la Bastille.—Une douche à un cerveau malade. Après cet acte éclatant de justice souveraine, Louis XIV dormit plus tranquille, et madame de Montespan étala avec plus d'orgueil encore l'immense ampleur de ses jupes.
On pensait que le roi laisserait éternellement le marquis à la Bastille, comme assurément il en avait le pouvoir; on se trompait. Un beau matin, on lui ouvrit les portes, et on lui donna une belle escorte pour le reconduire à sa terre de Guienne. On essaya même de l'avilir en lui faisant accepter de l'argent. On l'inscrivit sur une liste de pensions, mais il ne voulut jamais en toucher les quartiers.
Arrivé en Guienne, Montespan poussa jusqu'au bout sa lugubre vengeance, un des actes les plus courageux de cette époque de platitudes rampantes. Il fit prévenir tous les gentilshommes de sa province que la marquise était morte, il s'obstina à porter le deuil, et chaque mois il faisait chanter une messe en musique pour le repos de l'âme de sa défunte femme.
Tout ce scandale ne suffit pas à Louis XIV; ses relations doublement adultères dévoilées, il entreprit de les justifier, bien plus, de les glorifier. Au nom de sa toute-puissance, il prétendit déifier ses passions, réhabiliter sa favorite, et changer en honneur insigne l'opprobre qu'il infligeait au mari.
Les courtisans, troupe plate et servile, applaudirent des deux mains à cette prodigieuse audace de Louis XIV; ils firent litière de leur honneur, déclarant par là que tous accepteraient avec joie le rôle de Montespan, cet original qui semblait mépriser l'illustration nouvelle que le caprice royal donnait à sa maison.
Molière prêta le secours de son génie au monstrueux projet de Louis XIV, et l'on joua sur la scène, devant toute la cour, en présence de Marie-Thérèse, de la pauvre La Vallière et de madame de Montausier, à deux pas de madame de Montespan; on joua les mystères de Compiègne, c'est-à-dire Amphitryon.
Sombre page de l'histoire de Molière! N'est-ce pas la fatalité antique qui s'acharne après lui? Le génie est-il donc un si grand crime, que, vivant, il faille en porter la peine?
Molière obéit à Louis XIV. Il fit pour la fantaisie du maître cette terrible comédie, Amphitryon, tout comme il avait fait écrire la Princesse d'Élide, comme il fera représenter Georges Dandin.
Et cependant il n'est pas de ces vils adulateurs qui se traînent à plat ventre autour du trône. Il paie royalement la protection royale. Il achète ainsi le droit de donner des chefs-d'œuvre: la Princesse d'Élide a sauvé Tartufe, Amphitryon ouvre le chemin à Don Juan.
C'est que Molière est seul contre tous. Le grand homme n'a que le roi pour le défendre. Il a déchaîné toutes les haines; les partis, lorsqu'il s'agit de le perdre, d'étouffer sa voix, se donnent la main. Il les a tous flagellés et souffletés de ses vers, abîmés et ridiculisés de son rire. Les dévots ne pardonnent pas Tartufe, les marquis veulent se venger de la critique de l'École des Femmes, Alceste atteint la cour, Pourceaugnac fait grincer des dents à la province. C'est qu'il n'a ménagé ni la ville, ni la cour, ni la bourgeoisie, ni la noblesse.
Il n'en épargne qu'un, celui qui le protège contre les autres, et encore il sent sa chaîne, il gémit tout bas, et tout haut il se plaint de l'esclavage:
Sosie, à quelle servitude
Tes jours sont-ils assujettis!
Notre sort est beaucoup plus rude
Chez les grands que chez les petits.
Ils veulent que pour eux tout soit dans la nature
Obligé de s'immoler.
Et voilà pourquoi Molière s'immole. Mari passionnément épris d'une femme coquette, cette détestable Béjart, le voilà qui glorifie l'adultère. Il pleure des larmes de sang sur les infidélités de sa femme, peu importe, il rira, il fera rire des trahisons conjugales, et, cocu sublime, il jettera à pleines mains le ridicule sur les époux trompés.
Ainsi, nous avons Amphitryon, et Molière-Sosie: mais cherchez bien sous ce rire, vous trouverez la plaie qui saigne; malgré le bruit de cette verve désolante et convulsive, vous entendrez le sanglot sourd. En tel endroit, il secoue sa chaîne et la révolte perce; c'est l'argument du bâton qui seul peut convaincre Molière-Sosie, terrible argument de la loi du plus fort.
Donc, autour de Sosie les voici tous, les acteurs de la comédie ignoble, Molière les a mis en scène. Voici Jupiter-Louis XIV, et Amphitryon-Montespan, et la belle Alcmène-favorite. C'est une apothéose en règle, la divinité excuse la marquise, les cornes de l'époux trompé se changent en couronne triomphale.
Et les courtisans applaudissent à leur opprobre, et Mercure-Lauzun est tout fier et fait la roue.
Un partage avec Jupiter
N'a rien du tout qui déshonore,
Et sans doute il ne peut être que glorieux
De se voir pour rival le souverain des dieux.
Telle est la morale, et cette noblesse, autrefois si fière, n'y trouve rien à redire, et il n'est pas un seul de ces grands seigneurs qui ne soit disposé à porter à sa femme le mouchoir que daignera lui jeter Louis XIV. Tel est le degré d'avilissement où les a réduits ce roi qui tient pour eux la corne d'abondance.
Le véritable Amphitryon
Est l'Amphitryon où l'on dîne,
et les broches tournent du matin au soir dans les cuisines de Versailles, et le couvert est toujours mis chez Louis XIV. Demandez plutôt à Vivonne, il vous montrera les roses qui fleurissent sur ses joues, et le double menton qui bat sa poitrine; il les doit aux perdrix que l'on mange à la table royale.
Comme on pourrait jaser, pourtant, comme un envieux mal avisé pourrait hasarder un blâme, Sosie, avant de se retirer, transmet les volontés de Jupiter-Louis. Écoutez l'oracle, et à bon entendeur salut:
Tout cela va le mieux du monde.
Mais enfin, coupons aux discours,
Et que chacun chez soi doucement se retire.
Sur telles affaires toujours
Le meilleur est de ne rien dire.
Après ce scandaleux étalage d'un amour adultère, après ce monstrueux déni de morale, il semble que Louis XIV n'ait plus aucune mesure à garder; cependant il se contraint encore. Il fait mettre en scène ses amours «qui honorent celles qui en sont l'objet, qui honorent même leurs maris,»—mais il essaie, au moins dans les commencements, d'en dissimuler les suites. On cache donc les premières grossesses de madame de Montespan.
Déjà dans le courant de l'année 1669 elle avait mis au monde une fille qui ne vécut que trois ans; le 30 mars 1670, elle donna au roi un fils qui fut le duc du Maine.
La naissance de ces deux enfants fut tenue extrêmement secrète. Lorsque pour la seconde fois madame de Montespan se trouva enceinte, le roi, malgré l'aversion que lui inspirait Paris s'installa au Louvre où l'étiquette était beaucoup moins sévère, où il était beaucoup moins entouré, ce qui lui permettait de visiter presque tous les jours madame de Montespan à laquelle on avait fourni un prétexte plausible de s'éloigner pour quelques jours de la cour.
«Le terme venu de l'accouchement, une fille de service de la marquise de Montespan, en qui le roi et elle avaient une confiance particulière, monta en carrosse et alla dans la rue Saint-Antoine chercher un nommé Clément, fameux accoucheur, à qui elle demanda s'il voudrait venir avec elle, pour une femme qui était en mal d'enfant. On lui dit que s'il voulait venir, il fallait qu'il consentît à se laisser bander les yeux, parce qu'on ne voulait pas qu'il sût où on le menait.
«Clément, à qui de pareilles choses arrivaient souvent, voyant que celle qui venait le chercher avait l'air honnête, répondit qu'il était prêt à tout ce qu'on voudrait[37].»
Il monta donc en carrosse, les yeux bandés, et s'assit à côté de la fille de chambre. On resta plus d'une heure et demie en route; le cocher, qui avait ses ordres à l'avance, fit faire au carrosse d'innombrables détours, afin de dérouter complétement le chirurgien. Enfin, on s'arrêta. La fille de chambre prit la main du chirurgien, l'aida à descendre, le guida à travers l'escalier et l'introduisit dans un appartement peu éclairé, où seulement il put ôter son bandeau.
Un homme,—le roi,—était debout près du lit; il lui dit de ne rien craindre. Clément répondit qu'il ne craignait rien; il s'approcha de la malade, l'examina attentivement, et dit que l'instant n'était pas encore venu.
Alors, s'adressant au roi, qu'il avait peut-être reconnu, mais qu'il eut l'habileté de traiter comme le premier gentilhomme venu, il demanda «s'il se trouvait dans la maison de Dieu, où il n'est permis ni de boire ni de manger; que pour lui, il avait grand faim, étant parti de chez lui au moment où il allait se mettre à table pour souper.
«Le roi, sans attendre qu'une des femmes qui était dans la chambre s'entremît pour le servir, s'en alla lui-même à une armoire où il prit un pot de confitures qu'il lui apporta, ainsi qu'un morceau de pain, en lui disant de n'épargner ni l'un ni l'autre, qu'il y en avait encore dans la maison. Le roi lui apporta de même une bouteille de vin et lui versa deux ou trois coups.
«Lorsque maître Clément eut bu, il demanda au roi s'il ne boirait pas bien aussi, et le roi ayant répondu que non, il lui dit en souriant que la malade n'en accoucherait pas si bien, et que s'il avait envie qu'elle fût promptement délivrée, il fallait qu'il bût à sa santé[38].»
Cette dernière considération décida Louis XIV: il emplit deux verres de vin, et trinqua avec maître Clément à la santé de la malade.
Sans doute le choc des verres porta bonheur à la marquise, car moins d'une heure après elle était délivrée, et maître Clément annonça que tout danger étant passé, il allait se retirer. On lui banda les yeux de nouveau, et, avec les mêmes précautions prises pour l'amener, on le reconduisit chez lui.
«Lorsqu'on fut arrivé devant la porte de sa maison, sa conductrice lui ôta son bandeau, lui mit dans la main une bourse qui contenait cent louis d'or, et tout aussitôt le carrosse repartit au grand galop des chevaux.
La naissance de l'enfant que madame de Montespan mit au monde l'année suivante, fut cachée avec presqu'autant de soin. Cette fois, la marquise accoucha au château de Saint-Germain. Lauzun, qui était dans la confidence, emporta l'enfant dans les plis de son manteau, et le remit à madame Scarron, qu'on n'avait pas osé introduire au château, et qui attendait dans un carrosse, à quelques pas d'une porte de service.
Voici donc, pour la première fois, la veuve Scarron mêlée au ménage illégitime du roi. «Elle avait le pied dans l'étrier.»
La veuve du cul-de-jatte devait cette heureuse fortune à madame de Montespan elle-même. Lorsqu'il s'était agi de faire élever, loin de la cour, ces bâtards dont le nombre devait aller croissant chaque année, la marquise crut faire un coup de maître en confiant les enfants du roi à quelque créature du parti dévot qui avait fini par accepter La Vallière, et de qui elle avait à cœur d'être acceptée.
Elle désigna donc au roi madame Scarron qu'elle avait autrefois connue chez madame d'Hendicourt, et qui, depuis quelque temps, tournait fort à la dévotion, et s'entourait des plus habiles intrigants du parti. Le roi se sentait peu de sympathie pour cette veuve adroite et discrète, mais madame de Montespan prouva si bien à son amant que cette dame avait précisément le mérite et l'esprit nécessaires pour donner une éducation convenable à des rejetons si illustres, qu'il finit par donner son consentement.
«On fit donc sonder madame Scarron, mais en termes mystérieux. En parlant des enfants, on ne disait pas le nom du père, et on voulait que l'éducation fût très-secrète.» Madame Scarron hésita; elle redoutait, disait-elle, d'aliéner sa liberté et de se donner de trop lourdes chaînes; sa conscience même lui en faisait quelques scrupules. Elle demanda à consulter l'abbé Gobelin, et, après quelques jours, finit par accepter, mais à une condition, c'est qu'on lui déclarerait que les enfants étaient bien du roi.
«Ce mystère qu'on exige de moi, écrivait-elle à M. de Vivonne, le frère de madame de Montespan, peut me faire supposer qu'on me tend un piége. Cependant, si les enfants sont bien au roi, je le veux bien; je ne me chargerais pas sans scrupule de ceux de madame de Montespan. Ainsi, il faut que le roi me l'ordonne; voilà mon dernier mot[39].»
Cette lettre, digne d'Escobar, n'ouvrit pas les yeux à la marquise; plus elle sentait madame Scarron aux mains des dévots, plus elle s'applaudissait de son choix. Aussi elle insista près de son amant afin qu'il donnât un ordre positif. Louis XIV céda, et ce fut pour l'insinuante veuve «le commencement de sa fortune singulière.»
À dater de la naissance de cet enfant (1670), la marquise de Montespan, abandonnant le reste de pudeur qui la faisait s'astreindre au mystère, laissa de côté toute contrainte; il est vrai que sa déplorable fécondité l'eût obligée à de perpétuelles précautions. C'eût été ne pas vivre. Elle préféra déchirer le voile, et désormais elle afficha ses grossesses annuelles. C'était les afficher, en effet, que de les déguiser comme elle le faisait. Elle inventa, dit la princesse de Bavière, «les robes volantes pour ses grossesses, parce qu'on ne pouvait voir la taille sous ces robes. Mais quand elle en prenait une de ce genre, c'était comme si elle eût écrit sur son front qu'elle était enceinte. Chacun disait à la cour: «Madame de Montespan a pris la robe volante, donc elle est grosse.»
D'ailleurs, à quoi bon cacher ces naissances illégitimes? Louis XIV, par un acte véritablement incroyable, ne va-t-il pas les révéler à l'Europe? De sa main, le roi osa écrire le divorce du marquis et de la marquise de Montespan, et bientôt après (1673) il légitima la naissance de ses enfants, les reconnut, et, au mépris de toutes les lois humaines, lui, le roi, il proclama ces bâtards fils de France. Et pas une voix ne s'éleva pour protester contre ce fait inouï, contre cet exorbitant mépris de la morale.
Nous voici arrivé à l'époque la plus brillante du règne du «grand roi.» Versailles est presque terminé. Le dieu s'est assis sur son nuage. Louis XIV a pris possession de cette fameuse chambre où frappe chaque matin le premier rayon du soleil, son emblème.
Le désert est devenu oasis, comme au coup de baguette d'un enchanteur. Pourquoi, hélas! faut-il tant de millions aux enchanteurs terrestres! L'empyrée du roi-fétiche a ruiné la France. Et cependant, que de chefs-d'œuvre! Voici Mansard; c'est lui qui a remué ces montagnes de pierres, échafaudé cette nouvelle Babel; et Le Nôtre, le créateur du paysage, qui a tracé ces lignes, dessiné ces parterres, courbé ces ifs à tous les caprices de sa fantaisie. Lebrun, Mignard, Jouvenet, Audran, Philippe de Champaigne, ont animé les murs de ces salles immenses; ils ont tiré de leur palette des effets merveilleux; ils ont lancé aux plafonds ces nuages légers, scellé dans le mur ces fresques grandioses. Pour orner cet olympe nouveau de Louis XIV, ils ont mis au pillage l'olympe de la Rome païenne. C'est maintenant le bataillon des sculpteurs: Coysevox, Girardon, Puget, Pygmalions de ce peuple de statues qui enchantent les bosquets, se mirent dans les eaux des bassins, et donnent la vie à tout ce paysage magnifique que, du haut de son balcon, le roi peut embrasser d'un seul coup d'œil.
Que le peuple gémisse, de loin on lui montrera Versailles, de très-loin. Tiens, France, voici tes sueurs, voici ton sang, voici ton pain. Et de quoi se plaindrait-on, Louis XIV n'est-il pas le maître de la vie et de la fortune de ses sujets? Colbert, le grand génie du règne, a fécondé la France; on dévore le revenu, demain on pillera le fonds.
Colbert a vu l'abîme, il voudrait arrêter le roi sur cette pente terrible; vains efforts! Il s'est jeté aux genoux du maître et le maître l'a repoussé du pied. Avec la Montespan, Colbert, l'homme de l'industrie, de la paix, de l'agriculture, l'homme du peuple en un mot, n'est plus rien. Tout à Louvois, le ministre de l'incendie du Palatinat, tout à lui, jusqu'au jour où un crime peut-être débarrassera de ses services, devenus importuns comme un remords.
Mais nul autre que Colbert n'avait alors de ces pressentiments lugubres, nul ne comprenait que cet immense échafaudage de puissance était bâti sur le sable, tous les yeux se fermaient à l'avenir.
Et Louis XIV régnait dans le nuage, il avait mené son œuvre de patience à bonne fin, il avait absorbé la France; toutes les gloires, tous les mérites, n'étaient plus que les rayons de son génie; il s'était sacré héros, ses flatteurs l'avaient déclaré Dieu.
C'est que Louis XIV autour de son trône eut, jusque vers la fin de son règne, des flatteurs de génie;—la tête pouvait bien lui tourner un peu. Mais tous ces beaux esprits, ces savants, ces poëtes qu'il protégeait, ont fait son règne, le grand règne. Si l'illusion a duré si longtemps, c'est que toutes ces gloires si fausses vivaient presque réelles dans des pages immortelles. Les gens de lettres ont rendu à Louis XIV plus qu'il ne leur avait donné, et lorsque le poëte s'écrie:
Grand roi, cesse de vaincre ou je cesse d'écrire,
on est tenté de prendre le poëte au sérieux et d'être saisi d'admiration pour ce roi qui
Se plaint de sa grandeur qui l'attache au rivage.
Le règne entier de Louis XIV n'est qu'un passage du Rhin. Peu à peu, la vérité se fait jour. Longtemps on a considéré cet exploit comme un des plus grands faits militaires de France. On croyait sur parole les historiens et les poëtes. Mais un jour, un curieux est venu qui a mesuré le fleuve et le vers de Boileau; le fleuve était de beaucoup le plus petit. Alors la flatterie s'est retournée contre l'idole, et de ce passage du Rhin, fait de guerre des plus simples, l'ode boursoufflée du poëte a fait un exploit héroï-burlesque.
Tout est ainsi dans le règne de Louis XIV, pour qui veut se donner la peine de l'étudier sérieusement.—«Je veux ôter la perruque au grand roi,» disait, il y a quelques mois, un des écrivains les plus éminents de notre siècle; il a tenu parole, mais hélas! la perruque ôtée, il n'est plus rien resté. À chaque instant dans ce règne, sous la pompe du décor, sous le grandiose de la mise en scène, le grotesque apparaît.
La Feuillade élève un autel à son maître, nuit et jour brûlent des lampadaires autour de la statue, voilà l'apothéose. Mais attendez, un Gascon se glisse dans l'ombre et écrit sur le piédestal l'épigraphe oubliée:
Eh sandis! La Feuillade, est-ce que tu nous bernes,
De mettre le soleil entre quatre lanternes?
À la fin du règne cependant, le grotesque disparaît pour faire place à l'horrible. Louis XIV croit expier ses fautes par une Saint-Barthélemy qui dure quinze années. Ce roi fait tout en grand.
L'odieux seul est réel, le reste n'est qu'illusion. Il y a de vrai encore l'avilissement de la noblesse et l'avénement du tiers, l'acheminement à la révolution.
Mais nous sommes encore au temps des grandeurs et des magnificences, et madame de Montespan est souveraine. Elle est définitivement déclarée, elle règne avec un tapage infernal.
La marquise avait élu domicile chez la duchesse de La Vallière; là elle s'était emparée de tout: autour d'elle, ses domestiques, ses créatures, ses amis étaient venus se grouper. Comme pour assurer sa puissance, elle avait appelé à la rescousse tous les Mortemart de la terre, sœurs, frères, cousins. Elle marchait toujours entre ses deux sœurs, belles et spirituellement méchantes comme elle. L'une était la marquise de Thiange; «grande mangeuse et grande buveuse;» l'autre, l'agréable abbesse de Fontevraulte, que le roi avait dispensé de la résidence, et qui, très-exigeante et très-austère pour ses nonnes, faisait gaiement son salut à la cour. Vivonne n'apparaissait, lui, que dans les grandes occasions, il partageait son temps entre la table et la lecture.
La duchesse de La Vallière avait bien essayé de s'opposer à cet envahissement, mais la marquise avait vite comprimé ces velléités de rébellion. Madame de Montespan avait fini par réduire La Vallière au rôle de Cendrillon, elle en avait fait sa première fille de chambre. Elle se faisait habiller et parer par cette pauvre délaissée, la grondant lorsqu'elle était maladroite.—«Pensez-vous, lui demandait-elle quelquefois, que le roi me trouve belle ce soir?»
Le roi la trouvait toujours belle, le matin comme le soir. Véritablement, elle l'avait endiablé, étourdi de son esprit et de sa conversation. Il en avait même un peu peur, comme tout le monde.
Souvent la marquise se mettait avec son amant au grand balcon de Versailles, et, avec une verve étourdissante, elle caricaturait tous les courtisans qui passaient à portée de son regard. «En une minute, elle habillait son homme,» et le roi riait des mille ridicules qu'elle donnait à tous. C'était sa façon de distraire Louis XIV.
Les courtisans appelaient ce genre de récréation passer par les armes de madame de Montespan, c'était pour eux une terreur. La marquise paraissait-elle à une fenêtre avec le roi, en moins de rien les cours étaient vides, c'était comme une déroute générale.
Aux moments de bonne humeur, Louis XIV appelait madame de Montespan une agréable étourdie; d'autres fois, il disait: On ne peut lui en vouloir, c'est une véritable enfant. Enfant terrible, alors. En réalité, il subissait toutes ses brusqueries et lui passait les plus incroyables caprices. Jamais plus fantasque maîtresse ne mit à l'épreuve la patience d'un amant.
Chaque jour, quelque folie nouvelle. Son luxe était insensé, son train princier. Jamais la France n'entretint une favorite avec cette splendeur. Elle avait des toilettes fabuleuses, des parures folles. Quelquefois, le roi lui prêtait les diamants de la couronne, et elle trouvait la force de les porter tous. Dieu sait le poids pourtant! Un jour, Louis XIV eut l'idée, pour recevoir ces fameux ambassadeurs apocryphes destinés à le distraire, de faire coudre tous ses diamants sur un habit, il ne put le garder plus d'une heure, tant il pesait,—c'est Dangeau qui nous l'affirme,—et pour dîner il prit une autre veste.
Rien d'étrange comme les goûts et les amusements de la belle marquise; elle adorait les bêtes. Une partie des splendides appartements que le roi lui avait donnés dans toutes les résidences royales était transformée en ménagerie. Là, elle élevait des chats, des chiens, et même des cochons d'Inde. Elle avait un grand coffre tout rempli de souris blanches, et son grand bonheur était de faire mordiller ses belles mains par ces dégoûtantes petites bêtes, ou de les faire courir sur ses bras et sur ses épaules. Lorsqu'elle ne sortait pas, elle passait ses journées à atteler des souris apprivoisées à un petit carrosse en filigrane et à les faire galoper à travers sa chambre.
Mais que dire des bizarres idées qui traversaient à chaque instant la tête folle de la marquise et que presqu'aussitôt elle mettait à exécution! Un jour, elle envoyait des coussins à l'église pour ses chiens favoris; le lendemain, elle causait au milieu de quelque solennité une horrible confusion; une autre fois, pour une question d'étiquette, elle brouillait presque toute la famille royale.
Ainsi, de sa personnalité bruyante madame de Montespan emplissait ce palais de Versailles, bâti par Louis XIV pour la duchesse de La Vallière. Des éclats de sa gaîté ou de ses colères, du matin au soir retentissaient les grandes salles et les corridors.
—«Cette catau me fera mourir,» disait souvent Marie-Thérèse.
La pauvre reine n'avait pas assez de regrets pour cette douce La Vallière que si longtemps elle avait méconnue; mais il était trop tard, et pour comble d'humiliation et de désespoir, le roi imposait à sa femme la présence presque continuelle de la marquise.
L'ingratitude de madame de Montespan était passée en proverbe, et Lauzun, ce modèle du courtisan, Lauzun à qui elle devait son élévation, lui dut la perte de sa prodigieuse fortune.
Ce favori, qui avait pris pour armes parlantes une fusée, était parti de rien, et par sa seule habileté s'était élevé au plus haut rang à la cour. Un jour, il eut un rêve éblouissant, il faillit épouser Mademoiselle. Pendant vingt-quatre heures il eut l'autorisation du maître, mais le roi, on ne sait pourquoi, retira sa parole.
On dit à Lauzun que le retour du roi provenait de madame de Montespan; le favori n'en voulut rien croire, il était bien certain que la marquise, son ancienne maîtresse, sa créature, lui était une fidèle alliée. Cependant les mêmes propos lui étant revenus de plusieurs côtés à la fois, il voulut s'assurer du fait.
Il alla trouver la marquise, et la pria d'intercéder en sa faveur auprès du roi. La favorite le promit, et en même temps elle jura à Lauzun que plusieurs fois déjà elle avait parlé pour lui.
Lauzun feignit alors de se retirer; mais, profitant de la connaissance parfaite qu'il avait de l'appartement, il se faufila dans la chambre à coucher de la marquise, se glissa sous le lit et attendit.
Presqu'aussitôt madame de Montespan entra, suivie du roi. La conversation tomba sur Lauzun, et le favori put entendre celle qu'il croyait son alliée dire de lui un mal horrible. La colère l'étouffait, mais il réussit à se contenir, sachant bien que s'il faisait un mouvement c'en était fait de lui.
Le roi sorti, il accabla de reproches et d'injures l'ingrate marquise, et il la menaça, si le roi ne consentait à son mariage, de divulguer «ce qu'il avait vu et entendu.» Que voulait dire Lauzun? on ne peut que le conjecturer; mais la chose devait être grave puisqu'on ne trouva qu'une prison perpétuelle pour se mettre à l'abri des indiscrétions de ce favori si audacieux, le seul qui ait jamais osé braver la colère de Louis XIV, mais qui la brava à ce point que le roi levait sa canne pour châtier l'insolent, lorsque, réfléchissant, il fit un des plus beaux actes de sa vie, il ouvrit la fenêtre et jeta sa canne en disant:
«Ainsi je ne serai pas exposé au malheur de frapper un gentilhomme.»
En vain Mademoiselle se traîna aux pieds du roi, pour obtenir non plus une autorisation de mariage, mais la liberté de l'homme qu'elle aimait, le roi fut inflexible; il pleurait avec elle, mais il laissait Lauzun à Pignerol, méditer avec Fouquet sur le danger de déplaire au maître.
Bien des années seulement après cette aventure, Mademoiselle obtint qu'on lui rendît Lauzun, et à quel prix! On lui extorqua une partie de son immense fortune pour en enrichir un des bâtards de la favorite. Ajoutons que Lauzun paya de la plus noire ingratitude le dévoûment si absolu de cette bonne et romanesque Mademoiselle.
À tout moment les frasques de madame de Montespan obligeaient le roi d'intervenir et d'interposer son autorité. Cette liaison du roi était un continuel orage, mais tous ces tourments étaient calculés.
—Savez-vous, marquise, lui disait un de ses amis, qu'à ce jeu vous risquez fort de perdre l'amour du roi?
—Je n'en crois rien, répondit madame de Montespan, en agissant comme je le fais; je distrais Sa Majesté, j'occupe son esprit et son cœur, et il n'a pas le loisir de penser à une autre.
Mais madame de Montespan avait sur le roi un moyen d'influence bien autrement sérieux. Chaque année, avec une désolante ponctualité, elle donnait à son amant un nouveau bâtard, et cette honteuse fécondité emplissait de joie le cœur du monarque.
De ces enfants devait pourtant venir la ruine de la marquise; non d'eux précisément, mais de leur institutrice, madame Scarron. Cette intrigante, qui avait le génie de la patience, n'avait pas tardé à prendre une place très-sérieuse dans le petit ménage de Louis XIV. Chaque enfant de la marquise augmentait son importance. Pour élever tous les bâtards, on avait donné à madame Scarron un vaste hôtel isolé, du côté de Vaugirard, et elle tenait avec une habileté admirable le pensionnat royal. Peu à peu elle avait été admise à saluer le roi d'abord, puis à lui rendre compte de la santé des enfants, et insensiblement, de causerie en causerie, elle était devenue presque nécessaire à Louis XIV.
On reste saisi d'admiration lorsqu'on considère l'œuvre de patience de madame Scarron; c'est la force de l'eau qui goutte à goutte use le rocher. Grain de sable par grain de sable elle comble l'abîme qui la sépare du roi. On se rappelle involontairement en suivant ce magnifique travail de persévérance ces petites araignées qui parfois dans leur toile prennent une mouche énorme: elles ne sautent pas dessus tout d'abord, elles savent se contenir, elles se tiennent à distance; alors, avec un art infini, elles jettent un fil, puis deux, puis des milliers de fils sur la mouche terrible, elles l'enveloppent, la lient, la réduisent à l'impuissance. C'est là, exactement, le labeur de madame de Maintenon: quelle patience! mais aussi quel succès!
Il faut voir cependant quelle était alors l'existence du grand roi, lorsqu'il régnait à Versailles, un peu comme Bajazet au fond de son sérail. Il avait la reine d'abord, sa femme légitime, puis sa maîtresse de la veille, La Vallière, puis celle du présent, la Montespan, et peut-être encore celle du lendemain.
Entre ces trois femmes, il se pavanait et faisait la roue. Parfois il les mettait toutes trois ensemble, dans le même carrosse, et les traînait au grand soleil, l'une enceinte, l'autre pâle encore de ses couches. À ce spectacle inouï d'une reine de France entre les deux maîtresses du roi, les populations, remplies d'étonnement, se demandaient si la morale n'était pas un vain mot, et si toutes les lois humaines n'étaient pas un détestable mensonge.
Et cette trigamie ne suffisait pas encore au grand roi, il égayait l'uniformité de cette vie à quatre par de nombreuses infidélités; à chaque instant on croyait voir surgir un astre nouveau; mais la terrible Montespan, d'un mot, rejetait dans la foule sa rivale d'un jour.
On se demande, en voyant ce scandale étrange, ce que faisaient à la cour ces hommes si pieux, ces saints évêques, ces prêtres dévorés du zèle de Dieu. Ils ne faisaient rien, ils attendaient. Ils secondaient madame Scarron dans son œuvre et préparaient l'heure de la Grâce. Ils savaient que plus les débordements du roi seraient grands, plus, à l'heure de la conversion, ils auraient le droit de se montrer exigeants. Et ils laissaient faire.
Louis XIV, au milieu de la plus grande fougue de ses passions, n'avait jamais cessé, non d'être religieux, il ne le fut jamais, mais d'être dévot. À côté de ses maîtresses, il protégeait toujours les prêtres et les confesseurs; peut-être les considérait-il un peu comme des valets de chambre nécessaires à son salut. Ainsi, jamais il ne manqua à remplir les devoirs qu'impose l'Église, et un saint jour de Pâques put voir ensemble s'approcher de la Sainte-Table le roi, la reine, madame de Montespan et la duchesse de La Vallière. La femme et les deux maîtresses, et encore, à quelques pas, la quatrième, peut-être.
La retraite au couvent de madame de La Vallière fut pour la marquise un coup terrible, mais depuis longtemps prévu. En retenant près d'elle la favorite délaissée, l'habile étourdie savait parfaitement qu'elle liait son amant.
Louis XIV, n'ayant plus qu'une maîtresse en pied, crut pouvoir se permettre quelques infidélités de plus, et chaque jour la jalousie de la marquise éclatait en scènes terribles. À ses côtés elle voyait avec inquiétude grandir, grandir toujours, lentement, peu à peu, mais avec une persistance soutenue, la veuve habile de Scarron; et les choses en étaient venues au point qu'elle voyait une rivale dans cette femme qu'elle était allée chercher dans le lit de Ninon de Lenclos. Elle voulut la faire chasser, trop tard. Le roi ne pouvait plus se passer de la causerie de cette adroite personne.
Déjà l'influence de madame Scarron était énorme; soutenue par toutes les dévotes gens de la cour, elle se préparait à entrer dans le cœur de Louis XIV, incessamment battu en brèche, sur les ruines de son amour pour madame de Montespan.
Le roi vieillissait, les digestions devenaient pénibles, les purges plus fréquentes, la goutte aussi s'en mêlait. Avec l'apparence d'une santé à défier le temps, Louis XIV était vieux avant l'âge; il n'eût pu faire seulement une lieue à cheval.
C'est le moment que choisit madame Scarron pour parler du ciel d'abord, de l'enfer ensuite; elle parla de repentir et de conversion, de morale outragée; le roi prêta l'oreille. Un instant madame de Montespan dut quitter la cour. Mais elle ressaisit bientôt sa puissance.
De ce jour, il y a lutte ouverte entre madame de Montespan et la veuve Scarron. Cette dernière a conquis son premier grade; le roi l'a appelée un jour madame de Maintenon, et ce sera son nom désormais. Dans l'espoir d'éloigner cette rivale, d'autant plus dangereuse que son jeu est plus insaisissable, madame de Montespan essaye de la marier, de lui faire accepter les brillants partis qui se présentent pour elle; toutes ses négociations échouent, comme si madame de Maintenon avait le pressentiment de sa fortune future.
Bientôt, il y eut entre le roi et madame de Montespan une séparation nouvelle; madame de Maintenon y avait plus contribué que personne; elle ne perdait pas une occasion de remettre le roi sur la voie du salut, car c'est sous ce spécieux prétexte qu'elle voila son ambition. Après une revue des mousquetaires, elle s'enhardit jusqu'à dire au roi:
—Que feriez-vous cependant, Sire, si l'on vous disait que l'un de ces jeunes gens est marié et vit publiquement avec la femme d'un autre?
Louis XIV ne répondit pas, mais sans cesse exhorté par Bossuet et par Bourdaloue, il se décida à quitter la marquise. Les deux amants se séparèrent, dit madame de Caylus, s'aimant plus que la vie; le roi partit pour l'armée, madame de Montespan alla cacher sa douleur à Clagny.
Le roi et la favorite firent leurs dévotions chacun de son côté, rien n'était plus édifiant; Louis XIV, tout glorieux de la victoire remportée sur ses passions, disait à Bossuet:
—Eh bien! mon père, vous le savez, madame de Montespan est à Clagny?
—Oui, répondit Bossuet, mais Dieu serait, je crois, plus content si Clagny était à soixante lieues de Paris.
On était à l'époque du Jubilé, et toute la cour, à l'exemple du roi, ne songeait qu'à prendre la haire et le cilice. Madame de Maintenon et ses amis étaient bien convaincus qu'ils étaient à tout jamais débarrassés de madame de Montespan, et ils songeaient à profiter de leur victoire, lorsqu'il y eut chez le royal pénitent une nouvelle et hélas! bien scandaleuse rechute. Ils rentrèrent donc la discipline jusqu'à une occasion nouvelle et meilleure, et de nouveau s'arrangèrent le mieux possible avec les passions du maître.
«Il est avec le ciel des accommodements.»
Et dans le lointain ils entrevoyaient la révocation de l'édit de Nantes, cette prime offerte par le roi pour son salut.
«Le Jubilé étant fini, dit madame de Caylus, il fut question de savoir si madame de Montespan reviendrait à la cour. Pourquoi non? disaient ses parents et ses amis, même les plus vertueux. Madame de Montespan, par sa naissance ou par sa charge, doit y être; elle peut y vivre aussi chrétiennement qu'ailleurs. L'évêque de Meaux fut de cet avis; il restait cependant une difficulté: madame de Montespan, ajoutait-on, paraîtra-t-elle devant le roi sans préparation? Il faudrait qu'ils se vissent avant que de se rencontrer en public, pour éviter les inconvénients de la surprise.
«Sur ce principe, il fut conclu que le roi viendrait chez madame de Montespan; mais pour ne pas donner à la médisance le moindre sujet de mordre, on convint que des dames respectables et les plus graves de la cour seraient présentes à cette entrevue, et que le roi ne verrait madame de Montespan qu'en leur compagnie.
«Le roi vint donc chez madame de Montespan comme il avait été décidé; mais insensiblement il l'attira dans une fenêtre; ils se parlèrent bas assez longtemps, pleurèrent, et se dirent ce qu'on a accoutumé de dire en pareil cas; ils firent ensuite une profonde révérence à ces vénérables matrones, passèrent dans une autre chambre, et il en advint madame la duchesse d'Orléans et ensuite M. le comte de Toulouse.
«Je ne puis me refuser, continue madame de Caylus, de dire ici une pensée qui me vient dans l'esprit. Il me semble qu'on voit encore dans le caractère, dans la physionomie et dans toute la personne de madame la duchesse d'Orléans les traces de ce combat de l'amour et du Jubilé.»
Ce retour désola madame de Maintenon, mais ne lui fit pas perdre l'espérance. Dans une lettre à madame de Saint-Géran, elle se plaint amèrement de la maladresse de M. de Condom:
«Je vous l'avais bien dit, écrit-elle, que M. de Condom jouerait dans cette affaire un personnage de dupe. Il a beaucoup d'esprit, mais il n'a pas celui de la cour. Avec tout son zèle, il a fait précisément ce que Lauzun aurait eu honte de faire; il voulait les convertir, et il les a raccommodés. C'est une chose inutile, madame, que tous ces projets; il n'y a que le père de La Chaise qui puisse les faire réussir. Il a déploré vingt fois avec moi les égarements du roi; mais pourquoi ne lui refuse-t-il pas absolument l'usage des sacrements? il se contente d'une demi-conversion.»
Cette lettre n'explique-t-elle pas admirablement l'odieux caractère de madame de Maintenon, n'y dévoile-t-elle pas, pour ainsi dire, la redoutable ambition qui la dévore? Elle va feindre de quitter la cour, mais le roi la retiendra; s'il lui a échappé deux fois, il n'échappera pas une troisième; le père de La Chaise est là qui veille pour faire réussir ses projets.
Le roi, cependant, n'était même pas à demi-converti. Il avait repris la marquise, et avec elle ses anciennes habitudes. Cette séparation, sans avoir complétement effacé l'amour du roi, l'avait au-moins affaibli, et bientôt de nombreuses infidélités révélèrent à la favorite que son influence diminuait.
Le roi n'eut d'abord que des caprices d'un jour. Il faillit s'arrêter à mademoiselle de Sévigné; mais elle était trop maigre.—«Quel malheur! s'écrie le fier, l'orgueilleux Bussy, elle eût rendu tant de bons offices à notre famille.»
Madame de Soubise dura quelques jours; mais elle craignait la Montespan, et la ménagea. Mandée au moment du caprice, elle se rendait près du roi à la première réquisition; Bontemps, le valet de chambre, venait la chercher, souvent au milieu de la nuit. Elle quittait alors le lit conjugal, sans trop se gêner; son mari était le premier dormeur du royaume. «Une fois, ainsi pressée, dit M. Michelet, elle ne trouvait pas ses pantoufles, cherchait sous le lit, ramonait; le mari dit en songe:—«Eh! mon Dieu! prends les miennes!» et il continua de ronfler.»
Villarceaux essaya de pousser une de ses nièces.—«J'ai ouï parler, dit-il au roi, que Votre Majesté a quelque dessein sur elle; s'il en était ainsi, je la supplie de ne charger nul autre que moi de cette affaire.»
Le roi rit et refusa, il avait mieux. Une toute jeune fille, mademoiselle de Laval, lui avait plu une heure. Elle se trouva enceinte, et pour ne pas légitimer encore un enfant, «Louis XIV écoula sa maîtresse au duc de Roquelaure.» Elle enrichit son mari; aussi, lorsque vint l'enfant, presqu'aussitôt le mariage, le duc de Roquelaure lui fit fête:
«—Je ne vous attendais pas si tôt, dit-il, néanmoins soyez le bienvenu.»
Un instant on crut qu'une jeune et belle fille de Lorraine, mademoiselle du Lude, chanoinesse de Poussay, allait prendre la première place dans le cœur du roi; mais on comptait sans madame de Montespan. La maîtresse en titre fit une querelle terrible à sa rivale, l'étrangla presque, et finit par la chasser de Fontainebleau. Le roi n'osa rien dire, et de cette liaison il ne resta qu'une épigramme railleuse:
La Vallière était du commun,
La Montespan est de noblesse,
Et la du Lude est chanoinesse:
Toutes trois ne sont que pour un.
Mais, savez-vous ce que veut faire
Le plus puissant des potentats?
La chose paraît assez claire,
Il veut unir les trois états.
Tandis que les courtisans se fatiguaient à suivre les passagères amours de Louis XIV, une nouvelle favorite apparut tout à coup, qui d'un seul bond escalada tous les degrés de la faveur, mademoiselle de Fontanges.
C'était une rousse éblouissante, exactement belle de la tête aux pieds; les La Feuillade, courtisans expérimentés, lui firent la courte échelle, madame de Montespan elle-même la détailla au roi:—«J'ai près de moi, Sire, lui disait-elle, une belle idole de marbre.»
Elle fit plus: un jour à la chasse elle enleva d'un geste brusque le fichu qui couvrait les épaules de Fontanges, et appelant le roi:—«Voyez donc, Sire, que tout cela est beau!»
Ce fut tout à fait l'avis du roi, et huit jours après l'idole de marbre était l'idole de la cour.
Madame de Montespan au désespoir eût voulu chasser Fontanges comme elle en avait chassé tant d'autres; mais l'innocente tint bon, elle s'était cramponnée à la faveur et prétendait bien ne céder sa place à personne.
Déjà le roi aimait Fontanges avec l'emportement des vieillards. Plus elle était absurde et folle, plus il se sentait épris. La petite était sotte comme un panier, dit l'abbé de Choisy; peut-être est-ce pour cela qu'il l'adorait. Madame de Montespan l'avait fatigué d'esprit.
Voilà donc Fontanges maîtresse déclarée et duchesse. La tête lui tourna, il y avait de quoi. Elle qui la veille encore «n'avait, dit M. Pelletan, que la cape et l'épée, c'est-à-dire sa beauté,» elle eut tout à coup un palais et des trésors, Versailles et la fortune de la France, et le roi à ses genoux.
Aussi elle prit sans compter, et à pleines mains jeta l'argent par toutes les fenêtres de ses fantaisies. Les grandeurs lui montèrent au cerveau, et véritablement elle se crut reine, elle passait devant Marie-Thérèse sans la saluer. Elle vengea La Vallière et traita ignominieusement madame de Montespan.
Le roi lui donnait cent mille écus par mois, le double en cadeaux, mais il ne parvenait pas à lasser ses prodigalités; elle conduisait grand train, avec huit chevaux, le carrosse de sa fortune, elle semblait vouloir «dévorer son règne en un moment.»
Pour Fontanges, Louis XIV était redevenu jeune; il reprit les diamants, les rubans et les plumes. C'était tous les jours quelque fête nouvelle, chasses, ballets, comédies, jamais le luxe n'avait été poussé si loin.
L'intérieur du roi était, grâce à Fontanges, devenu un enfer. Tandis que la nouvelle sultane régnait avec tout l'emportement de la folie, l'ancienne emplissait l'air de ses cris d'Ariane abandonnée. Chaque matin quelque sujet nouveau de jalousie, de colère, de haine. Entre ces deux femmes madame de Maintenon avait fort à faire, elle courait de l'une à l'autre, essayant de les apaiser, de les réconcilier, mais elle y perdait toute son éloquence si persuasive.
Parfois elle voulait faire de la morale à Fontanges, mais la duchesse d'hier n'entendait pas de cette oreille.—«Quand je serai à votre âge, disait-elle à l'officieuse veuve, je songerai à ma conversion.» Une autre fois elle disait:—«Croyez-vous donc qu'il est aussi aisé de quitter un roi que de quitter une chemise?»
Hélas! c'est le roi qui la quitta. Elle devint enceinte. C'était, on le sait, l'écueil des maîtresses de Louis XIV. Elle perdit sa beauté, et avec sa beauté son amant. Blessée au service du roi, elle demanda sa retraite et alla au fond d'une campagne cacher sa laideur et son désespoir.
Elle éblouit la cour un instant, comme un météore, puis elle disparut. Rose, elle vécut ce que vivent les roses. Elle ne laissait en quittant Versailles, ni un ami, ni un regret, et nul ne se fût souvenu de son nom sans un hasard, un coup de vent, une coquetterie heureuse.
Un jour à la chasse, le vent emporta son chapeau. D'un geste mutin elle réunit en un tour de mains ses admirables cheveux, et les lia avec un flot de rubans. Elle était si jolie ainsi, si mutine, si effrontée, que le roi ravi la pria de toujours porter cette coiffure.
Le lendemain, toutes les dames de la cour qui avaient copié les robes honteusement flottantes de madame de Montespan, copiaient la coiffure de la folle sultane et portaient leurs cheveux à la Fontanges.
La pauvre fille ne survécut guère à sa retraite. Un jour on apprit que Fontanges allait mourir et qu'elle faisait demander le roi. Louis XIV se rendit aux désirs de la malade, madame de Maintenon l'y avait poussé, elle pensait que cette mort ferait une grande impression sur le roi et qu'on en pourrait profiter.
Louis ne reconnut pas la pauvre moribonde, c'était une ombre déjà lorsqu'il s'approcha de son lit. Cette passion devait être extraordinaire en tout, il sembla touché des souffrances de la pauvre fille et pleura.
—Je remercie Votre Majesté, murmura Fontanges, je suis contente puisqu'à mon lit de mort j'ai vu pleurer mon roi.
Elle mourut en accusant madame de Montespan de l'avoir fait empoisonner par un de ses domestiques dans une tasse de lait. Mais elle se trompait, madame de Montespan était incapable d'un tel crime.
La duchesse de Fontanges fut le dernier éclair de passion de Louis XIV; de ce jour il tomba sous la tutelle de madame de Maintenon, qui de plus en plus lui était devenue indispensable.
La marquise de Montespan essaya de lutter encore, mais son règne était définitivement passé. Comme à La Vallière, le roi lui déclara qu'il ne voulait pas être gêné. C'était un ordre formel de quitter la cour; la marquise se résigna, elle partit, laissant à Versailles pour la représenter une armée de bâtards à la tête desquels marchait le duc du Maine, le favori de la vieillesse du roi, l'élu de madame de Maintenon.
La belle, l'orgueilleuse Montespan quitta les robes volantes pour le cilice, l'éventail pour la discipline: c'était la mode alors. Elle essaya à force de mouvement de dissiper son chagrin et de tromper son ennui, «mais le vide s'était fait autour d'elle,» et sans pouvoir trouver une heure de repos ou d'oubli, elle passait sa vie à changer de résidence, «ne se trouvant heureuse que là où elle n'était pas.» Le roi lui donnait vingt mille louis par mois, une belle pension de retraite, et elle les dépensait presque entièrement en bonnes œuvres. Elle dotait des filles pauvres, enrichissait des couvents, ou faisait bâtir des chapelles.
La mort, telle était la grande, l'épouvantable terreur de la marquise de Montespan; elle redoutait jusqu'au sommeil qui en est l'image. Elle ne dormait que dans une chambre resplendissante de lumières, et toujours autour de son lit se tenaient cinq ou six femmes de service, qui devaient jouer ou causer gaîment tandis qu'elle sommeillait.
Était-ce donc un pressentiment? Cette mort tant redoutée arriva à l'improviste tandis qu'elle dormait, et à peine put-elle prononcer quelques paroles.
Louis XIV pleura la marquise de Montespan à peu près comme il avait pleuré la duchesse de La Vallière:
—Depuis que je l'avais congédiée, répondit-il, j'avais espéré ne jamais la revoir.