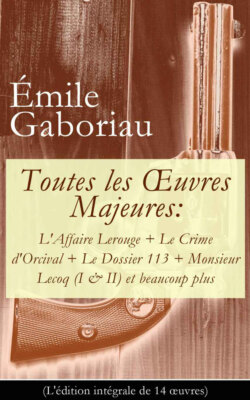Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 26
VII LOUIS XV LE BIEN-AIMÉ.
LES DEMOISELLES DE NESLE.
ОглавлениеLouis XV venait d'atteindre sa quinzième année, et la cour attentive étudiait avec anxiété le caractère du jeune roi, afin de modeler sa conduite sur celle du maître, d'adopter ses goûts, et d'aller au-devant de ses moindres désirs. Mais nul symptôme encore n'éclairait les courtisans attentifs. L'ennui seul se lisait sur les traits du royal adolescent. Il était timide, gauche, irrésolu, dévot. Ainsi l'avait façonné pour son ambition le cardinal Fleury, ce précepteur ministre d'État, qui, sous une doucereuse modestie, dissimula toujours ses rêves de grandeur.
Rien encore ne faisait présager ce que devait être un jour Louis XV, ce sultan blasé du Parc-aux-Cerfs, inamusable amant de madame du Barry. Les vétérans du Palais-Royal, ces parangons effrontés de la débauche, avaient presque envie de crier au scandale. Vainement les grandes dames cherchaient le cœur du jeune monarque; il baissait les yeux, et rougissait sous la hardiesse provocante de ces regards. Oui, il rougissait, ce jeune prince bercé aux chants de cette orgie universelle qui s'appelle la Régence. Et c'est une justice à rendre au duc d'Orléans, à cette époque où toutes les ambitions spéculaient sur les vices, s'il fut athée, blasphémateur, dissolu, il préserva de tout contact impur le royal enfant que la Providence avait commis à sa garde, et dont il devait compte à la France.
Et les grandes dames trouvaient désespérante cette timidité de Louis XV. Il était parfaitement beau à cette époque, et toutes les femmes convoitaient sa possession. «Les dames étaient prêtes, dit de Villars dans ses Mémoires, mais le roi ne l'était pas.» Les courtisans malins allaient répétant que Louis XV attendait les seize ans de l'infante d'Espagne qu'on lui destinait pour épouse, et qui n'avait encore que sept ans. «C'est encore neuf ans de sagesse,» disaient-ils.
Il n'en devait pas être ainsi:
Une grave maladie du jeune roi fit comprendre la nécessité de hâter son mariage; on rompit avec l'Espagne, et on lui fit épouser Marie Leczinska, fille d'un pauvre gentilhomme polonais, roi un instant par la volonté de Charles XII victorieux. L'opinion publique désapprouva cette alliance; nul ne se doutait alors que la pauvre princesse doterait la France d'une de ses plus belles provinces, la Lorraine.
Le mariage du maître n'apporta presqu'aucun changement dans les habitudes de la cour. Louis XV était toujours timide, l'éclat du trône l'importunait, les affaires l'ennuyaient à l'excès, et son cœur sans ressort était toujours prêt à se livrer à quiconque voulait bien le débarrasser des rudes labeurs de son métier de roi.
L'activité qu'il devait à ses sujets, il la dépensait à courre le cerf dans les forêts; c'était vraiment encore merveilleux que ces chasses de la jeunesse de Louis XV, avec toutes ces galantes amazones qui les suivaient, la belle comtesse de Toulouse, mademoiselle de Charolais, mademoiselle de Clermont, mademoiselle de Sens, et tant d'autres héroïnes que nous retrouvons sur les toiles de Vanloo.
Après cinq ans de mariage, Marie Leczinska régnait encore seule, sans partage, sur le cœur de son époux; Louis XV, pendant ces premières années, fut le meilleur et le plus bourgeois des maris. Il ne se contentait pas de dire: «J'aime la reine,» il le prouvait; et, à peine âgé de vingt et un ans, il avait déjà cinq enfants, deux fils et trois filles. Si quelque courtisan audacieux se permettait de l'entretenir de l'amour que ressentait pour lui quelque beauté célèbre, il se contentait de répondre: «—Trouveriez vous la reine moins belle?»
À cette époque donc, il eût été facile à Marie Leczinska de s'attacher le roi, et pour toujours d'enchaîner son cœur comme elle avait enchaîné ses sens. Il ne lui fallait pour cela qu'être un peu la maîtresse de ce roi dont elle était la femme; elle ne le voulut pas.
La nature avait donné à Louis XV un tempérament ardent. Marie Leczinska était froide, et plusieurs couches successives accrurent encore sa froideur. Bientôt les empressements du roi lui devinrent à charge; elle ne prit pas la peine de dissimuler ses impressions; et lorsque le soir, après quelqu'un de ces soupers qui suivaient les chasses, le roi arrivait chez elle échauffé par le vin, elle témoignait hautement son dégoût.
Louis XV, à ce moment, n'avait qu'à choisir, qu'à jeter le mouchoir, toutes les dames de la cour étaient sur les rangs. On lui épargnait même les premières avances, et il trouvait jusque dans ses poches des déclarations aussi audacieuses que celle-ci, que lui adressait mademoiselle de La Charolais:
Vous avez l'humeur sauvage
Et le regard séduisant;
Se peut-il donc qu'à votre âge
Vous soyez indifférent?
Si l'Amour veut vous instruire,
Cédez, ne disputez rien,
On a fondé votre empire
Bien longtemps après le sien.
Le roi soupirait, mais ne disait mot; une timidité farouche, une pudeur innée l'arrêtait encore; mais déjà il n'aimait plus Marie Leczinska.
Ainsi donc, jusqu'à la fin de 1732, rien n'avait transpiré des amours secrètes de Louis XV, s'il en avait eu, lorsque le 27 janvier, dans un souper où il avait bu plus que de coutume, il se leva tout à coup, et porta un toast à sa maîtresse inconnue; il brisa alors sa coupe en invitant les convives à en faire autant.
Le lendemain, les courtisans ne s'abordaient qu'avec ces mots:
—Vous savez? le roi a pris une maîtresse.
Et chacun de se creuser la tête, d'épier, d'interroger pour tâcher de savoir le nom de cette mystérieuse favorite, afin d'obtenir cet honneur insigne d'être pour quelque chose dans les amours du roi.
Mais le toast de Louis XV n'était qu'un jeu, il n'avait pas de maîtresse encore, seulement il songeait sérieusement à en prendre une.
Le cardinal Fleury ne lui laissa pas le temps de choisir. Un conseil fut tenu entre l'ancien précepteur, madame la Duchesse, le duc de Richelieu et les trois valets de chambre, Lebel, Bachelier et Bontemps, afin de savoir quelle femme on pousserait dans le lit du roi.
Après bien des hésitations, l'unanimité des suffrages s'arrêta sur une des dames du palais, amie intime de la comtesse de Toulouse, madame de Mailly, de l'illustre maison de Nesle.
La famille de Nesle, qui pendant longues années eut le privilége de fournir des favorites à la couche royale, était des plus nobles et des plus anciennes; son illustration avait commencé vers le XIe siècle. En 1709, l'aîné de cette maison, Louis III de Nesle, avait épousé mademoiselle de Laporte-Mazarin, dont la galanterie n'avait pas tardé à devenir proverbiale.
Cette dame de Nesle, dame d'honneur de Marie Leczinska, avait passé, trois ou quatre ans avant l'époque où nous sommes arrivés, pour avoir été passagèrement la maîtresse du roi.
Elle était morte en 1729, laissant cinq filles, qui toutes les cinq attirèrent les regards du roi, et dont quatre au moins furent ses maîtresses.
La première, Louise-Julie, celle dont il est question ici, épousa Louis-Alexandre de Mailly, son cousin.
La seconde, Pauline-Félicité, épousa Félix de Vintimille.
La troisième, Diane-Adélaïde, épousa Louis de Brancas, duc de Lauraguais.
La quatrième épousa le marquis de Flavacourt.
Enfin la cinquième, Marie-Anne, qui fut plus tard duchesse de Châteauroux, épousa le marquis de la Tournelle.
C'était donc l'aînée des filles de madame de Nesle que le cardinal Fleury jugea convenable de donner à Louis XV.
Et véritablement ce fut un heureux choix, et pour le roi et pour l'ambitieux cardinal.
Madame de Mailly, née en 1710, était à peu près de l'âge de Louis. Elle n'était pas jolie, mais elle était admirablement bien faite, et avait pour sa toilette plus de goût que toutes les dames de la cour. Son visage était un peu long peut-être, son teint un peu brun, mais son front avait le poli de l'ivoire, et ses yeux étaient pleins de feu et d'éclat.
Timide et réservée, elle était sans ambition, sans connaissance des affaires de l'État, détestait la politique et les choses sérieuses, et, tandis qu'autour d'elle se mêlaient et se croisaient mille intrigues, elle était toujours restée en dehors de toutes les coteries.
On donna une maîtresse au roi, comme on lui avait donné une épouse, sans le consulter. Mais la barrière des passions était franchie, il était entré dans cette voie où il devait faire des pas si rapides.
Toutefois, le respect qu'il avait alors pour la reine l'engagea à tenir cette liaison secrète; le mystère d'ailleurs plaisait à madame de Mailly; elle aimait le roi sans intérêt d'amour-propre, et se trouvait assez heureuse de le posséder.
Les deux années qui suivirent, furent assurément pour Louis XV les plus charmantes de son règne; mettant plus de prix à l'ardeur des sens qu'à la beauté, il s'attacha peu à peu sa maîtresse.
On raconte que dans les premiers temps de sa liaison avec madame de Mailly, il la quittait quelquefois brusquement pour courir chez la reine, ou que, se jetant à genoux, il priait avec ferveur et demandait à Dieu pardon de ses égarements.
Ce transparent mystère eût pu durer longtemps encore. Les courtisans étaient gens trop adroits pour découvrir jamais ce que voulait cacher le maître; mais, vers 1735, les personnes qui entouraient le monarque crurent de leur intérêt que les rapports de madame de Mailly avec le roi devinssent publics, et elle fut déclarée maîtresse du roi.
Deux personnes aussitôt «jetèrent des cris d'aigle:» le père et le mari, le marquis de Nesle et le comte de Mailly. Cette nouvelle eut l'air de les frapper comme un coup de foudre.
On engagea tout d'abord le comte de Mailly à ne plus communiquer avec sa femme; et comme il faisait mine de résister, on le pria d'aller courre le cerf dans une de ses terres fort éloignée de la capitale.
Le marquis de Nesle fut de plus facile accommodement: ses affaires étaient fort dérangées, on lui fit don de cinq cent mille livres et il s'apaisa aussitôt.
C'était faire assez bon marché de l'honneur d'une famille illustre.
La reine «reçut assez tranquillement le coup terrible,» seulement sa piété redoubla; elle passait des journées entières au pied du crucifix, demandant à Dieu la conversion de son époux. Pas une seule fois il ne lui vint à l'idée qu'elle-même par ses rigueurs avait précipité le roi sur cette pente que chacun essayait de lui rendre plus douce.
Forte de son devoir accompli, elle crut qu'il serait au-dessous d'elle de lutter avec les sirènes qui lui avaient ravi le cœur de son époux. Elle courba la tête et adora les décrets de la Providence.
Maîtresse déclarée, n'ayant plus d'apparences à sauver, madame de Mailly resta la même: vainement on s'efforça d'éveiller son ambition; à ceux qui l'engageaient à user, pour sa fortune et pour celle de ses amis, du pouvoir qu'elle avait sur Louis XV, elle répondait invariablement qu'elle «tenait trop à l'amour de l'homme pour jamais le compromettre en essayant de son influence sur le cœur du roi.»
Les années s'écoulaient, et la favorite était heureuse. Le roi paraissait plus épris d'elle que jamais; il ne semblait point songer à lui donner de rivales, car on ne peut appeler infidélités quelques surprises des sens que l'on doit attribuer à Bachelier ou à Lebel, qui déjà s'exerçaient à leur infâme métier de pourvoyeurs. Le cardinal Fleury protégeait presque ouvertement la maîtresse du roi, qu'il appelait, en se servant d'expressions plus énergiques, une bonne fille. La reine, qui avait ouï parler de l'audace des maîtresses de Louis XIV, en était arrivée à remercier le ciel du choix de son époux.
Malheureusement, cette douce existence ne tarda pas à être troublée. Madame de Mailly avait une sœur pensionnaire à l'abbaye de Port-Royal. Cette jeune personne, hardie, décidée, dévorée d'ambition, conçut, du fond de son couvent, le dessein, non-seulement de remplacer sa sœur dans le cœur du roi, mais encore de s'emparer de la confiance qu'il accordait au cardinal. Jouer sous Louis XV le rôle qu'avait joué madame de Maintenon sous Louis XIV, au mariage près, tel était le rêve de l'ambitieuse pensionnaire.
Elle écrivit à sa sœur les lettres les plus tendres et les plus soumises, pour obtenir la faveur de vivre auprès d'elle, «la priant de permettre qu'elle lui servît de dame de compagnie, de secrétaire, de lectrice.» Elle lui parlait avec horreur du couvent où elle vivait enfermée, assurant qu'à coup sûr elle ne tarderait pas à mourir si on l'y laissait.
La comtesse, bonne et sans défiance, se laissa toucher par les prières de la triste recluse, et un beau matin mademoiselle de Nesle fut présentée à la cour.
Pour s'emparer du cœur de Louis XV, elle ne comptait pas sur sa beauté, elle était très laide et ne s'abusait pas sur sa figure; elle savait fort bien que sa taille était courte et épaisse, son cou et ses bras rouges, ses épaules disgracieuses. Pour compenser tous ces désavantages, elle avait son sourire, un sourire divinement railleur, et ses yeux, fort petits, mais pétillants de malice et d'audacieuse gaîté.
Mais elle avait l'imagination vive, le caractère aventureux et hardi, une volonté patiente et implacable; elle se dit qu'elle réussirait grâce à l'originalité et à l'imprévu de son esprit, et elle ne se trompa pas. Dès le premier jour elle se conduisit en coquette consommée.
Louis XV, qui s'ennuyait à trente ans comme Louis XIV s'était ennuyé à soixante-dix, ne tarda pas à trouver une distraction dans l'esprit de la nouvelle venue; et lorsque madame de Mailly s'aperçut des projets de sa sœur, elle reconnut avec effroi qu'il était trop tard pour s'y opposer.
La pauvre comtesse n'avait que deux partis à choisir: céder ses droits ou les partager; elle préféra cette dernière alternative; accord infâme, si on eût pu l'attribuer à l'ambition ou à la cupidité, mais dont la cause fut un amour passionné qui préféra la plus cruelle souffrance à la séparation de l'objet aimé. Elle espérait d'ailleurs que ses complaisances resteraient ignorées. Mais ce n'était pas le but de l'ambitieuse pensionnaire de Port-Royal; elle-même prit à tâche d'afficher ses amours. Louis XV, de son côté, s'ouvrit de son bonheur à quelques courtisans, et, moins de deux mois après l'arrivée de mademoiselle de Nesle à la cour, le secret de madame de Mailly était devenu un vrai secret de comédie: tous les courtisans savaient que le roi avait les deux sœurs pour maîtresses.
Bientôt il fallut songer à donner un état à la cour à la nouvelle venue. C'était un grand faiseur d'enfants que le roi Louis XV, et déjà mademoiselle de Nesle était enceinte et n'allait plus pouvoir dissimuler sa position.
On se hâta donc de chercher un gentilhomme qui voulût bien prêter son nom à la favorite et le donner à l'enfant qui allait venir.
Les avantages attachés à ce mariage étaient: une dot de deux cent mille livres, six mille livres de pension, une place de dame du palais pour la femme, et un logement à Versailles pour le mari.
On trouva, pour accepter cette humiliation, un comte du Luc de Vintimille, petit-neveu de l'archevêque de Paris. L'oncle voulait être cardinal, on lui promit le chapeau, et cette promesse lui fit subir la honte de bénir cette union. M. du Luc père consentit à fermer les yeux moyennant finance, et il profita de la faveur de sa bru pour monter dans les carrosses du roi. Il avait bien au moins droit à cet honneur.
Toutes choses bien arrêtées, bien convenues, la cérémonie du mariage eut lieu.
Mademoiselle, princesse de facile accommodement, prêta aux nouveaux époux, pour y passer leur lune de miel, son château de Madrid, voisin de la Muette.
Le soir des noces, Louis XV déclara qu'il voulait être bon prince jusqu'au bout et faire honneur à la sœur de madame de Mailly; il accompagna donc les époux jusqu'à la chambre nuptiale et présenta la chemise au marié, ce qui était un des plus grands honneurs que le roi pût faire. Les invités se retirèrent alors, et le comte de Vintimille s'esquiva par une porte dérobée, laissant la place au roi. Il fallait bien gagner la pension et la dot.
Chacun savait le lendemain que le roi n'était pas revenu coucher à la Muette, mais nul ne s'avisa de blâmer la conduite du comte du Luc, tant était grand à cette époque le respect pour les caprices du maître.
Le lendemain Mademoiselle, en grande cérémonie, présenta au roi toute la famille Vintimille.
L'ambitieuse élève de Port-Royal touchait à son but. Grâce à sa sœur qui lui était dévouée corps et âme, elle était véritablement la maîtresse absolue du roi de France. Elle s'était emparée de son esprit, madame de Mailly régnait sur ses sens. Les deux sœurs, on le voit, se complétaient admirablement, et puisqu'elles avaient passé par-dessus la jalousie, rien désormais ne les pouvait désunir.
Madame la comtesse de Vintimille se voyait réellement reine de France, lorsque la mort vint la surprendre au milieu de son triomphe.
Prise à la suite de ses couches d'horribles douleurs d'entrailles, elle fut enlevée en quelques heures, sans même avoir pu recevoir les derniers sacrements. Elle laissait au roi un fils, qui porta plus tard le nom d'abbé du Luc. Il était le portrait vivant de son père, et tous ses amis ne l'appelaient jamais autrement que le demi-Louis.
Cette mort inattendue fut un coup de foudre pour Louis XV; «jamais il n'avait paru si touché, et il se laissa aller à donner des marques de sa douleur.» Il se mit au lit, et défendit absolument sa porte à tout le monde. La reine essaya de parvenir jusqu'à lui, mais, même pour elle, la consigne fut maintenue, elle ne fut levée qu'en faveur du comte de Noailles. Le roi pleurait comme un enfant, et ses terreurs religieuses lui revenaient plus terribles que jamais.
La bonne madame de Mailly, elle, était au désespoir: en perdant sa sœur elle avait cru perdre le cœur du roi.
«Sans doute, écrivait-elle à une de ses amies, le roi, mon cher Sire, va s'éloigner de moi pour toujours; il ne tenait à moi que par elle, et comment remplacerais-je pour lui cette pauvre sœur qu'il consultait en tout et qui le faisait tant rire?»
La modestie de madame de Mailly l'aveuglait; le roi revint à elle, plus épris que jamais. Ensemble ils pleuraient cette pauvre Vintimille, mais le temps sécha vite leurs larmes.
Un mois après la mort de la favorite, madame de Mailly avait installé près d'elle une autre de ses sœurs, la duchesse de Lauraguais; les voyages de Choisy avaient repris leur cours, et, comme au temps de madame de Vintimille, Louis XV eut deux maîtresses.
Depuis quelques mois déjà le roi avait remarqué cette troisième demoiselle de Nesle, et pour lui faire une existence à la cour il s'était hâté de la marier, mais à un homme qui n'était pas prévenu, le duc de Lauraguais. Richelieu, chargé de négocier ce mariage, avait obtenu du roi pour les futurs époux les avantages suivants: vingt-quatre mille livres pour frais de noces, quatre-vingt mille livres de rente sur les postes, et la pension de dame du palais.
Mais le duc de Lauraguais s'aperçut bien vite du rôle qu'on lui destinait; chose rare à cette époque, il n'eut point un seul instant l'idée d'en tirer parti; il rompit sans scandale avec sa femme, et depuis ne voulut jamais consentir à la revoir.
Habituée à partager le cœur de celui qu'elle aimait, madame de Mailly prit son parti de cette nouvelle maîtresse, et s'entendit avec cette seconde sœur aussi bien qu'elle s'était entendue avec la première. Son existence ne lui paraissait donc point troublée, lorsque la mort de madame de Mazarin vint rapprocher du roi ses deux dernières sœurs, les plus jeunes et les plus jolies, mesdames de La Tournelle et de Flavacourt.
Chassées littéralement par madame de Maurepas, héritière de madame de Mazarin, de l'hôtel où elles demeuraient, les deux sœurs eurent l'idée de venir demander l'hospitalité à Louis XV; il les reçut admirablement, leur donna l'ancien appartement de madame de Mailly, et leur promit deux places de dames du palais.
Ainsi se trouvèrent installées à Versailles les deux dernières demoiselles de Nesle.
Madame de Mailly, que deux cruelles leçons auraient cependant dû rendre défiante, fut enchantée de la réception faite à ses deux sœurs. Elle pensa que la conduite de son royal amant était une délicate attention, et elle le remercia avec effusion.
Louis XV ne tarda pas à s'apercevoir de la beauté des deux commensales qu'il devait à la dureté de madame de Maurepas, et bientôt il commença à faire la cour aux deux nouvelles venues.
Il s'était fait, ce semble, une douce habitude de prendre ses maîtresses dans la famille de Nesle.
Tout d'abord il s'adressa à madame de Flavacourt. Il fut repoussé. Madame de Flavacourt aimait son mari; ce mari lui-même était, dit-on, un homme d'un autre temps, piétre courtisan et peu disposé à partager sa femme, même avec le roi; ses conjugales et énergiques menaces exercèrent peut-être une influence sur sa femme et vinrent en aide à sa vertu attaquée. Quoi qu'il en soit, elle fit répondre au roi de façon à lui ôter tout espoir.
Repoussé de ce côté, Louis XV entreprit la conquête de madame de La Tournelle. Celle-là était veuve, et ne pouvait prétexter son amour pour son mari. Mais elle avait un amant, et qui plus est un amant adoré. Elle aimait à la folie, jusqu'à la fidélité, M. d'Agenois, fils du duc d'Aiguillon, neveu de Richelieu. Le roi était désespéré de ce contre-temps.
Enfin il eut recours au duc de Richelieu, qui jusqu'ici l'avait bien servi, pour détourner madame de La Tournelle du comte d'Agenois.
Richelieu se chargea de la commission. Il commença par capter la confiance de madame de La Tournelle, et, voyant qu'il ne parviendrait pas à la rendre infidèle, il tourna ses batteries contre l'amant.
Il dépêcha au comte d'Agenois une des sirènes de le cour, avec mission de le rendre infidèle à tout prix, et surtout de le faire écrire, afin d'avoir des preuves à montrer à madame de La Tournelle.
Richelieu n'avait pas trop compté sur l'adresse de sa messagère; quinze jours ne s'étaient pas écoulés que déjà on avait une lettre de M. d'Agenois. On en eut deux, puis quatre, puis bien davantage. Mais ces preuves d'abandon n'ébranlaient en aucune façon madame de La Tournelle; elle secouait la tête, et répondait que l'écriture de son amant avait été contrefaite. Enfin, elle dut se rendre à l'évidence, mais ne sembla point encore disposée à accepter l'honneur de l'amour du roi.
Cependant elle était décidée, depuis assez longtemps même; seulement, avant de s'engager, elle voulait être certaine du pouvoir de ses charmes. Habile, artificieuse, sa conduite, pendant que le roi brûlait d'impatience de la posséder, fut un véritable chef-d'œuvre de coquetterie. Elle se disait malade afin de se dispenser de paraître; et lorsque, cédant aux prières du roi, elle consentait à «embellir les fêtes de sa présence,» elle ne se «montrait que cachée à demi sous une baigneuse qui lui seyait à ravir. Le roi alors ne se lassait pas de la contempler, et vingt fois il venait l'admirer et l'embrasser.»
Madame de Mailly voyait tout cela; elle en souffrait, mais elle se taisait, pauvre femme! Elle aimait tant son ingrat amant! Peut-être elle se résignait d'avance à un nouveau partage, elle n'avait que la moitié du cœur du roi, elle n'en aurait plus que le tiers. Son sacrifice était fait; sacrifice douloureux, mais inutile. Madame de La Tournelle ne devait pas admettre de partage, elle voulait régner, mais régner sans rivale.
Instruite par l'exemple de sa sœur de Mailly, à qui le roi n'avait donné ni honneurs ni richesses, l'ambitieuse marquise voulut faire ses conditions avant de capituler, et certaine que le roi, emporté par sa passion, souscrirait à tout, elle demanda pour se conduire des conseils au duc de Richelieu, son ami et son confident.
Richelieu lui conseilla d'exiger le même état qu'avait eu, sous Louis XIV, madame de Montespan; puis, aidée de cet homme habile, elle rédigea l'acte de capitulation qui devait la faire maîtresse du roi. Les Mémoires du temps nous ont conservé ce curieux monument d'ambition, le voici presque textuellement:
«Mon titre de marquise sera changé en celui de duchesse, et le roi fournira tout ce qui sera nécessaire à la représentation pour soutenir mon rang.
«Madame de Mailly sera éloignée de la cour avec défense d'y reparaître jamais. Le roi m'assurera une fortune indépendante qui me mette à l'abri de tous les changements qui pourraient survenir.»
Ces démarches, ces négociations n'étaient point un mystère pour madame de Mailly; chaque soir, de charitables amis venaient la prévenir de ce qui se passait; et déjà, sur un air à la mode, elle avait pu entendre fredonner ce couplet satirique:
Madame Allain est toute en pleurs,
Voilà ce que c'est d'avoir des sœurs!
L'une, jadis, lui fit grand peur!
Mais, chose nouvelle,
On prend la plus belle.
Ma foi! c'est jouer de malheur!
Voilà ce que c'est d'avoir des sœurs.
Hélas! oui, voilà ce que c'est. Bientôt le traité fut ratifié et signé, dans l'alcôve bleue du pavillon de Choisy, et la pauvre madame de Mailly, honteusement chassée, se retira dans un couvent où, par son repentir, ses aumônes et son humilité, elle essaya de faire oublier le scandale de sa vie passée.
Les noëls injurieux, les chansons outrageantes saluèrent l'avénement de la nouvelle favorite; les courtisans s'indignaient de voir ainsi la faveur se perpétuer dans la même famille, et le peuple trouvait au moins étrange que quatre sœurs se succédassent dans la couche royale. L'épigramme qui résumait le mieux l'opinion fut un soir, on ne sait comment, trouvée par le roi sur le pied de son lit:
LES DEMOISELLES DE NESLE.
L'une est presqu'en oubli, l'autre presqu'en poussière,
La troisième est en pied, la quatrième attend,
Pour faire place à la dernière.
Choisir une famille entière,
Est-ce être infidèle ou constant?
Mais le roi ne faisait que rire, et n'en continuait pas moins à aimer madame de La Tournelle.
La mort du cardinal Fleury, qui seul pouvait encore retenir Louis XV sur la pente terrible de ses passions, vint mettre le comble à la puissance de la favorite. Poussé par elle, le roi déclara que, comme son aïeul Louis XIV, il voulait régner lui-même. Le règne des favoris et des maîtresses, le vrai règne de Louis XV, commençait.
Les commencements, à vrai dire, donnèrent bon espoir; madame de La Tournelle était ambitieuse; ce qu'elle aimait surtout en Louis, c'était la royauté, le prestige du pouvoir; elle entreprit de faire un héros de son amant. Peut-être eût-elle réussi, car son influence était grande, si grande, qu'elle décida le roi à travailler avec ses ministres et à s'occuper un peu plus du royaume que s'il eût été un simple particulier.
Pour elle, nommée duchesse de Châteauroux, riche de tous les revenus de France, elle avait une maison royale, un train de reine; les splendeurs du règne de Louis XIV étaient son rêve et son désir, elle força son amant à donner quelques grandes fêtes, à étendre le cercle des invitations pour les chasses et les promenades, enfin les voyages à Choisy et les petits soupers devinrent chaque jour plus rares.
Les ennemis de la favorite, M. de Maurepas en tête, étaient vaincus. M. de Maurepas se vengea en faisant courir des vers qui commençaient ainsi:
Incestueuse La Tournelle,
Qui des trois êtes la plus belle,
Le tabouret tant souhaité
A de quoi vous rendre bien fière....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ajoutons, pour l'intelligence de ces vers, que la dignité de duchesse donnait droit à un tabouret à la cour, inestimable faveur enviée des plus grandes dames.
En apprenant la nouvelle élévation de sa fille La Tournelle, qu'il n'appelait plus que sa fille préférée, le marquis de Nesle songea à en tirer parti. Il avait, disait-il, des prétentions fondées sur la principauté de Neufchâtel, et il pria sa fille de décider le roi à la lui acheter.
On trouvait à la cour que madame la duchesse de Châteauroux se comportait bien plus noblement, bien plus convenablement que ne l'avait fait sa sœur de Mailly.
Bientôt (mars 1744) on apprit que le roi était décidé à se mettre à la tête de l'armée de Flandres. Les fautes de l'homme furent aussitôt oubliées, on ne pensa plus qu'au noble dévoûment de ce souverain qui abandonnait les délices de la cour la plus voluptueuse, la plus aimable et la plus spirituelle de l'Europe, pour courir partager les fatigues et les dangers des soldats et des braves gentilshommes qui versaient leur sang pour la patrie.
On pensait alors que Louis XV n'emmènerait pas madame de Châteauroux; mais la favorite n'avait poussé son indolent amant à prendre le commandement des troupes qu'à la condition expresse qu'elle le suivrait. Elle connaissait trop bien la faiblesse du roi pour compromettre par une absence le crédit qu'elle devait à son adresse. Elle voulait la gloire du roi, mais avant tout le maintien de sa puissance.
«Enfin je l'emporte, mon cher duc, écrivait-elle à Richelieu, son dévoué confident, son conseiller intime, je l'emporte, le roi commande les armées. Je l'accompagnerai, non en héroïne, mais en femme dévouée. Le roi, loin de moi, occupé des grands intérêts de l'Etat et de sa gloire, entouré de ses ministres, pourrait oublier que c'est à mes conseils qu'il devra le titre de conquérant.»
Cependant le roi partit seul, mais quinze jours après le duc de Richelieu conduisait à Lille mesdames de Châteauroux et de Lauraguais.
La présence à l'armée de la favorite et de sa sœur produisit le plus mauvais effet. Les soldats les appelaient les coureuses, et jusque sous leurs fenêtres elles entendaient chanter les chansons les plus insultantes. Bientôt le scandale fut tel que le roi se décida à envoyer sa maîtresse à Dunkerque, où il alla la rejoindre après avoir pris Menin et Ypres.
Le 5 août le roi arriva à Metz. Le lendemain il apprit le succès du prince de Conti dans les Alpes, et, pour remercier Dieu de cette victoire, il fit chanter un Te Deum dans la cathédrale de Metz. Mais les fatigues de la marche, les excès de la table, les plaisirs de l'amour avaient échauffé son sang outre mesure, ses forces étaient dépassées. Il tomba malade, et trois jours après sa vie était en danger.
À la nouvelle de la maladie du roi, la consternation, comme un crêpe funèbre, s'étendit sur la France. Les populations, tremblant pour la vie du souverain, emplissaient les églises. On attendait avec une fébrile inquiétude les courriers qui apportaient les bulletins de la santé de l'auguste malade; la mort du roi semblait à toute la France la plus grande calamité que l'on eût à redouter.
À la cour il n'en était pas ainsi. Toutes les ambitions s'éveillèrent à la nouvelle de la maladie du roi, mille intrigues se nouèrent pour tirer avantage des circonstances qui pouvaient survenir. On ne désirait pas la mort du roi, on la prévoyait.
Autour du malade, cependant, trois partis étaient en présence:
Le parti des ministres, le parti des princes, le parti des favoris et de la maîtresse; le duc de Richelieu était le chef de ce dernier.
Aussitôt la maladie du roi, la duchesse de Châteauroux, madame de Lauraguais et le duc de Richelieu s'étaient établis dans la chambre royale. Sous prétexte que le roi n'était qu'indisposé et qu'un peu de repos l'aurait vite remis sur pied, Richelieu, en sa qualité de premier gentilhomme de la chambre, ferma la porte à tout le monde. Des domestiques intimes étaient chargés du service; vainement des grands officiers de la couronne, des princes du sang demandèrent à voir le roi, Richelieu s'obstina à leur refuser l'entrée.
Cette exclusion irrita le parti des princes du sang; ils s'unirent aux ministres, et il fut décidé que, coûte que coûte, on pénétrerait jusqu'au lit du roi, et que là, si la maladie du roi était vraiment grave, on en profiterait pour épouvanter le faible Louis XV et faire ignominieusement chasser les favorites. Il fut de plus convenu entre les princes, l'évêque de Metz et le premier aumônier, M. de Fitz-James, que l'on refuserait au roi l'absolution tant qu'il n'aurait pas accordé le renvoi de madame de Châteauroux.
Pour madame de Châteauroux, toute la question se réduisait à ceci: Le roi se confessera-t-il? Si le roi se remettait sans avoir besoin des secours de la religion, elle gardait toute sa puissance. Si au contraire sa maladie empirait, si besoin était d'appeler un confesseur, elle était perdue.
Ce jour-là même on était au 12, et le roi était malade depuis cinq jours; M. de Clermont se chargea de pénétrer jusqu'à la chambre royale.
Il se présenta chez le roi. Richelieu, avec son assurance habituelle, voulut lui interdire l'entrée; mais le duc de Clermont d'un coup d'épaule écarta les deux battants de la porte, et comme Richelieu essayait de lui faire obstacle, il le repoussa vivement.
—Depuis quand, s'écria-t-il, un valet refuse-t-il aux princes du sang l'entrée de la chambre de son maître?
Et s'avançant jusqu'au lit où Louis XV gisait accablé, il lui parla sans ménagement de la gravité de sa situation et de la nécessité des sacrements.
—Ah! s'écria-t-il, qu'un roi qui va paraître devant Dieu a de comptes à rendre! J'ai été bien indigne de la royauté. Ah! que ce passage est terrible!
—Sire, dit M. de Soissons qui était entré sur les pas de M. de Clermont, la bonté de Dieu est infinie.
La duchesse se sentit perdue. Sans donc essayer de lutter davantage, elle voulut se retirer sans bruit, sans scandale. Mais ce n'était pas là le compte de ses ennemis; ils voulaient, par un éclat terrible, rendre, si le roi revenait à la santé, son retour impossible.
Les deux femmes, mesdames de Châteauroux et de Lauraguais, séparées du duc de Richelieu, furent, non pas éconduites, mais chassées de la maison qu'occupait le roi, aux huées d'une populace qui leur attribuait la maladie du souverain. Elles coururent aux écuries du roi, mais de tous ces courtisans qui, la veille encore, se disputaient un regard de la favorite, pas un ne voulut les reconnaître. On leur refusa brutalement une voiture et des chevaux. Elles s'enfuyaient à pied, ne sachant où aller, poursuivies par des injures et des malédictions, lorsqu'elles rencontrèrent le maréchal de Belle-Isle. Plus humain ou plus courageux que les autres, il leur prêta sa voiture, et après mille difficultés, mille périls presque, tant était grande l'exaspération des populations, elles purent gagner une maison de campagne à trois lieues de Metz.
Mais tous ces tiraillements avaient épuisé les forces du roi, et bientôt on désespéra de sa vie. Déjà les courtisans désertaient les antichambres, les ministres et les princes faisaient préparer leurs voitures, quand une crise heureuse et inattendue détermina la convalescence. Et lorsque la reine, mandée en toute hâte, arriva à Metz, son époux était hors de danger.
—Me pardonnez-vous, madame? Telles furent les premières paroles de Louis XV à la reine.
Marie Leczinska n'y répondit qu'en fondant en larmes et en serrant son époux entre ses bras.
Mais avec les forces, le courage revenait à Louis XV. Toutes les scènes de sa maladie se présentaient vivement à ses yeux, et il avait honte de sa conduite. Une tristesse profonde avait succédé à sa maladie. Il regardait avec des yeux pleins de menaces tous ceux qui l'entouraient, il s'en prenait à eux de la faiblesse qu'il n'avait pas su cacher, et la reine voyait renaître l'ancienne froideur du roi pour elle.
Richelieu s'était hasardé à reparaître; timide d'abord, il s'enhardit de toute l'amitié que lui témoignait le roi, et elle était grande; la réaction commençait.
Rendu à la santé, Louis XV voulut reprendre le commandement de ses troupes; la reine, malgré ses prières, dut regagner Paris, et nonobstant la saison pluvieuse, le roi se rendit au siége de Fribourg, entrepris depuis le 30 septembre par le maréchal de Coigny. Le 1er novembre la ville capitula, et Louis XV, sans attendre la reddition des châteaux, regagna sa capitale.
Des transports de joie l'attendaient à son arrivée; trois jours de suite, il fut littéralement assiégé aux Tuileries par un peuple ivre d'allégresse. Le quatrième jour il se rendit en grande pompe à une fête préparée à l'Hôtel-de-Ville.
Mais depuis quatre jours madame de Châteauroux, cachée à Paris, guettait un regard du roi. C'est en se rendant à l'Hôtel-de-Ville que, pour la première fois, le roi l'aperçut, déguisée, à une fenêtre: il la reconnut. Les yeux des deux amants se rencontrèrent, et dans le regard du roi madame de Châteauroux lut tout un avenir d'amour et de puissance.
Louis XV l'aimait toujours en effet, et le soir même, n'y tenant plus, il se fit conduire incognito à l'hôtel qu'occupait madame de Châteauroux.
À cette heure, seule avec sa sœur Lauraguais, madame de Châteauroux cherchait un moyen pour reparaître à Versailles. On lui annonça le roi. D'un coup d'œil, elle embrassa la situation. Le roi venait se mettre à sa discrétion, c'était à elle de reprendre sa fierté et de poser des conditions. Elle dit qu'heureuse dans son obscurité, elle ne voulait pas reparaître à la cour.
Alors le roi supplia, se fâcha, finit par parler en maître et déclara à la duchesse qu'elle reparaîtrait à la cour, pour y reprendre avec éclat son rang, ses charges et ses dignités.
Alors aussi il fut décidé que toutes les humiliations de Metz seraient vengées.
Les ducs de Bouillon et de La Rochefoucauld furent exilés. Balleroi, ancien gouverneur du duc de Chartres, fut renvoyé dans ses terres. Fitz-James reçut l'ordre de ne plus sortir de son diocèse, et M. de Maurepas, dont le roi avait de la peine à se défaire, fut condamné à présenter ses excuses à la duchesse: il eut l'humiliation d'aller lui annoncer lui-même qu'elle était rappelée.
Lorsque M. de Maurepas se présenta de la part du roi chez la duchesse, elle venait de se mettre au lit, souffrante qu'elle était d'un violent mal de tête. Elle reçut cependant le ministre, accepta ses excuses, et lui donna sa main à baiser. Il fut convenu que madame de Châteauroux ferait sa rentrée à la cour le samedi suivant.
Mais les épouvantables alternatives de douleur et de joie avaient brisé l'organisation de cette infortunée, elle ne put résister à ces brusques secousses. La faveur du roi était revenue, mais la mort avait choisi cet instant pour enlever sa proie.
Belle, jeune, vaillante, glorieuse, aimée, toute parée pour un triomphe au milieu de la cour, madame de Châteauroux fut frappée par un mal étrange, sinistre, qui en quelques jours la mit aux portes du tombeau.
Elle se plaignait de douleurs d'entrailles intolérables, et se tordait sur sa couche en poussant des cris affreux.
Le roi désespéré envoyait cent fois le jour prendre de ses nouvelles. Il s'était enfermé dans sa chambre et refusait de voir personne.—Puis il faisait dire des messes pour le rétablissement de sa maîtresse.
Mais les prières du roi ne furent pas exaucées, et le 8 décembre 1744 madame de Châteauroux rendit l'âme entre les bras de sa sœur de Mailly, accourue à la première nouvelle du danger. Les deux maîtresses du roi de France, l'une triste et délaissée, l'autre aimée et triomphante, se réconcilièrent dans un fraternel baiser sur le seuil de l'éternité.
Cette mort causa au roi une profonde douleur. Réfugié à la Muette, il refusait plus que jamais de voir personne, il ne voulait accepter aucune consolation; ses valets de chambre étaient obligés de le contraindre à prendre quelque nourriture.—C'est ma faiblesse, disait-il, qui l'a tuée.
Madame de Lauraguais, qui n'avait joui que par ricochet de la faveur royale, n'attira plus les regards du roi.
Quant à madame de Flavacourt, cette dernière demoiselle de Nesle, une fois encore elle eut à repousser les négociations du duc de Richelieu qui, jaloux de distraire Louis XV dont la mélancolie augmentait de jour en jour, voulait absolument lui donner la dernière des filles de cette illustre maison qui lui avait fourni déjà quatre maîtresses adorables.
La dernière fois qu'il essaya près d'elle de ses séductions, il lui fit un admirable tableau de cette position de favorite d'un roi de France jeune et beau. Belle, jeune, riche de tous les trésors de son amant, elle aurait la France à ses pieds. Il essaya de lui faire comprendre les charmes du pouvoir, les plaisirs brûlants de l'ambition, les ravissements de la puissance.
Et comme la marquise ne répondait rien et souriait doucement:
—Connaissez-vous, lui dit-il, quelque chose qui vaille tout cela?
—Oui, répondit-elle simplement: l'estime.