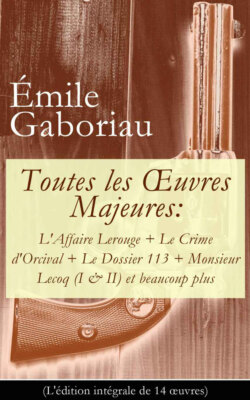Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 28
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VIII LA MARQUISE DE POMPADOUR.
ОглавлениеTable des matières
Il y avait grand bal à l'Hôtel-de-Ville, ce palais de la bourgeoisie. Paris, qui s'associait alors aux joies comme aux douleurs de la famille royale, prétendait célébrer dignement le mariage de monseigneur le dauphin. La fête devait être splendide et digne des hôtes illustres qui allaient l'honorer de leur présence.
C'était un bal masqué que donnaient à leur souverain MM. les échevins de la bonne ville de Paris. La fête avait «le caractère d'un grand concours de nations et de divinités de la mythologie. La terre et le ciel se donnaient rendez-vous pour distraire un instant le mélancolique Louis XV. Bourgeoises et grandes dames avaient fait assaut de toilette et d'imagination. Mais si la cour l'emportait par la richesse et la variété des costumes, la palme de la beauté restait aux mains des belles et fraîches jeunes femmes de la ville, dont le rouge et le blanc ne gâtaient point les ravissants visages.
Le roi, d'un air distrait, se promenait au milieu de cette foule immense, bigarrée, gracieuse, qui s'écartait et s'inclinait respectueusement sur son passage, insensible aux mille agaceries dont il était l'objet, lorsqu'il vit s'avancer vers lui, le carquois sur l'épaule, un arc d'argent à la main, une ravissante Diane chasseresse, à la jambe fine, aux bras blancs et ronds, à la démarche de déesse. La gracieuse Diane était masquée, mais d'admirables yeux brillaient sous son loup de velours noir, et ses lèvres roses, entr'ouvertes, laissaient apercevoir une double rangée de perles fines.
—Belle chasseresse, dit le roi surpris et charmé, les traits que vous décochez sont mortels.
Mais la coquette nymphe, après un gracieux salut, se perdit dans la foule pressée.
Le roi ne tarda pas à la rejoindre, et, après cinq minutes d'une conversation spirituelle et enjouée, étincelante de fines railleries, semée de flatteries ingénieuses, le monarque semblait avoir oublié son ennui. La belle Diane cependant ne s'était pas encore démasquée; lorsqu'à la prière de son royal interlocuteur elle eut ôté le loup de velours qui cachait son visage, le roi, amoureux déjà de la spirituelle sirène, reconnut une gracieuse chasseresse qui maintes fois, dans ses chasses de la forêt de Sénart, lui était apparue, tantôt vive et hardie, emportée au galop d'un cheval fougueux, tantôt nonchalante et paresseuse, à demi couchée dans une conque élégante de nacre et de cristal attelée de chevaux blancs.
Laissant le roi à sa muette admiration, une seconde fois elle se jeta dans la foule. Mais soit calcul, soit maladresse, elle laissa tomber le mouchoir de précieuses dentelles qu'elle tenait à la main. Le roi le ramassa, et ne pouvant atteindre la belle fugitive, avec cette grâce parfaite qu'il mettait à toutes ses actions, il le lui jeta.
—Le roi vient de jeter le mouchoir.
Ainsi dit un courtisan; et ce propos, comme un murmure confus, circula dans la salle; des groupes se formèrent pour discuter l'action du roi. Chacun voulait voir cette Diane charmeresse qui, dissipant le chagrin que Louis XV ressentait encore de la mort de la duchesse de Châteauroux, avait fait une si vive impression sur son cœur, qu'au milieu d'une fête, devant «la ville et la cour,» il n'avait pas hésité à lui faire une déclaration. Mais vainement les favoris du roi se répandirent dans les salons, fouillèrent du regard les longues galeries resplendissantes de lumières, pénétrèrent dans les bosquets où le jour était plus sombre; ils ne purent retrouver la nymphe fugitive. Son but était atteint sans doute, elle avait disparu.
La Diane chasseresse du palais de la Ville, l'amazone hardie de la forêt de Sénart, était la belle Jeanne-Antoinette Poisson, devenue la femme du seigneur d'Étioles.
Le nom de cette femme charmante n'était pas inconnu à la cour. Tous ceux qui dans les bois de Sénart suivaient habituellement les chasses royales, avaient remarqué la belle promeneuse. Ses costumes parfois étranges, mais toujours coquets, sa voiture de cristal et de nacre, avaient attiré les regards de Louis XV. Le roi, à différentes reprises, en avait parlé aux soupers qui suivaient toujours les chasses. Et ce nom d'Etioles jeté ainsi, par hasard, au milieu des vives et libres causeries des convives, avait toujours causé à madame de Châteauroux un étrange malaise.
Jeanne-Antoinette Poisson était née à Paris, en 1721.
Le mari de sa mère, un certain Antoine Poisson, avait eu une existence au moins aventureuse. Fournisseur des vivres de l'armée de Villars, poursuivi pour ses dilapidations par la chambre ardente créée par le régent pour faire rendre gorge aux financiers et aux fournisseurs, il n'essaya point de se justifier. Réalisant à la hâte tout ce qu'il put du produit de ses infidélités, il s'enfuit en toute hâte en Hollande. Bien lui en prit; il fut condamné, par contumace, à être pendu. Poisson resta plusieurs années à l'étranger. Enfin, grâce aux nombreux amis de sa femme, il put faire casser l'arrêt et rentra en France.
À son retour, il occupa chez les frères Pâris, ces heureux et riches financiers, le poste difficile et délicat de premier commis.
Il devint ensuite fournisseur des vivres et de la viande des Invalides, ce qui a fait dire à quelques pamphlétaires qu'il était boucher.
Madame Poisson, fille elle-même d'un riche financier, n'était rien moins qu'une vertu rigide. Jolie, galante, elle avait eu les mœurs faciles et relâchées des femmes de la Régence et avait empli les salons de la finance du bruit de ses amours. Deux de ses amants, un des frères Pâris, protecteur de son mari, et le richissime fermier-général Le Normand de Turneheim, se disputèrent longtemps la paternité de celle qui, devenue marquise de Pompadour, gouverna vingt ans durant et la France et le roi.
Ce fut, dès son enfance, une ravissante enfant que cette Antoinette, et ses heureuses saillies, ses mines enfantines, faisaient l'admiration de tous ceux qui fréquentaient les salons de sa mère et de M. de Turneheim. Mais plus que tous les autres, la mère Poisson admirait sa fille. «C'est un vrai morceau de roi, disait-elle toujours; vous verrez quand elle sera grande.»
C'est donc avec cette idée parfaitement arrêtée d'en faire plus tard un «régal de roi,» que cette femme galante éleva sa fille. Une éducation artiste et littéraire développa de bonne heure tous ses talents et toutes ses vanités. Dressée pour le plaisir, comme les courtisanes de l'ancienne Grèce, elle s'habitua peu à peu à regarder la position de maîtresse du roi comme l'idéal de l'ambition féminine.
À dix-huit ans, Jeanne-Antoinette Poisson était la plus délicieuse personne que l'on pût rêver; elle avait toutes les séductions, tous les enchantements. Elle ravissait par les charmes de son esprit, par sa conversation étincelante, par ses grâces inimitables, ceux que sa beauté ne fascinait pas au premier regard. Aussi tous les salons de la haute finance s'arrachaient cette fille sans rivale, et ses admirateurs lui faisaient comme une cour dont les louanges l'enivraient.
Plusieurs fois déjà on avait demandé sa main. Mais M. de Turneheim, auquel décidément le financier Pâris avait abandonné tous les droits de la paternité, s'était réservé le soin de lui trouver un époux digne d'elle.
Cet époux devait être un de ses neveux, Jean-Baptiste Lenormand d'Etioles, syndic de la ferme générale, et depuis longtemps amoureux d'Antoinette. La mère Poisson goûta fort ce mariage. Le jeune Lenormand avait un caractère paisible, les sens rassis, l'esprit facile, et le cœur bon. Elle pensa que si jamais sa fille avait besoin de toute sa liberté, ce serait un mari commode et d'humeur accommodante.
Aux premières ouvertures de ce mariage, la famille du jeune amoureux se récria. La réputation des époux Poisson était bien faite, en effet, pour dégoûter de toute alliance, mais M. de Turneheim insista. Il était sans enfant; il déclara que toute sa fortune reviendrait au mari d'Antoinette, et la crainte de voir un jour cette opulente succession enrichir une famille étrangère leva tous les scrupules des parents; ils donnèrent leur consentement.
Antoinette Poisson, richement dotée par M de Turneheim, devint donc madame Lenormand d'Etioles.
Aimée et adorée de son mari, adulée de tous ceux qui l'approchaient, la belle d'Etioles fit peu parler d'elle. Aux scandales de sa mère, elle ne voulait pas ajouter ses scandales; son démon familier lui parlait dans la nuit et dans le silence de hautes destinées, elle ménageait sa réputation comme on épargne un capital.
Elle aimait le roi. Oui, elle l'aimait à cette époque, quoi qu'en aient dit les faiseurs de libelles et les insulteurs de Belgique et de Hollande. Quel motif la portait à feindre, que lui manquait-il à cette femme idolâtrée, qui enchaînait au char de ses grâces et de sa beauté tous ceux qui la voyaient? Jeune, belle, immensément riche, reine de sujets d'élite, eût-elle sans son amour, échangé ces tranquilles bonheurs, ces caressantes voluptés pour les soucis brillants et les amers déboires de la faveur royale?
Elle aimait le roi. Et quoi d'extraordinaire à cela? Tant de femmes l'aimaient alors.
C'est qu'en ces temps d'enthousiasme, de dévoûment et de foi, le roi était pour tous un être presque surnaturel, un représentant de Dieu attardé sur la terre pour dicter aux hommes les volontés du ciel. Enfants d'un siècle incrédule et railleur, nous ne pouvons, froids sceptiques que nous sommes, comprendre toute la magie qu'avait autrefois ce mot: le roi!
Nul, d'ailleurs, n'était plus digne que Louis XV d'occuper le cœur d'une femme; il eût été aimé, même sans cette auréole que faisait à son front le pouvoir souverain.
Souvent, on le pense, il était question du roi dans les conversations du petit manoir d'Etioles. La jeune châtelaine s'informait minutieusement à tous les gentilshommes qui venaient s'asseoir à sa table, des moindres détails de l'existence du château. Elle suivait avec anxiété toutes les phases des amours royales, elle voulait bien connaître les favorites, madame de Mailly, madame de Vintimille, la duchesse de Châteauroux. Elle se faisait initier aux goûts du souverain, on lui disait ses plaisirs, ses amusements, ses caprices. Et elle se préparait, dans le recueillement de ses heures de solitude, au rôle qu'elle voulait jouer. Elle dessinait son plan, ourdissait sa trame. Car à côté de son amour se dressait son ambition. Elle voulait obtenir les faveurs du roi; mais elle ne voulait pas d'un caprice passager. Elle souhaitait ardemment le rôle de favorite; mais ce rôle, elle voulait le jouer toute sa vie.
Afin de pouvoir suivre Louis XV dans la forêt de Sénart, madame d'Etioles avait feint une grande passion pour la chasse; son mari, à genoux devant toutes ses fantaisies, ne s'opposait donc pas à ce qu'elle suivît de loin tous les brillants cavaliers qui, sur les pas du roi, couraient le cerf dans les grands bois. Elle montait hardiment à cheval ou conduisait elle-même un phaéton dans les allées les plus sinueuses, croisant le roi souvent afin d'attirer ses regards. Tant qu'avait duré la faveur de madame de Châteauroux, la belle d'Etioles avait dissimulé son amour et ses ambitieuses pensées; elle attendait son tour avec cette inaltérable patience que donne une immuable volonté. Mais après la mort de la favorite, la place était vacante dans la couche royale, elle pensa que son heure était enfin venue, et la scène du bal de l'Hôtel-de-Ville fut comme le couronnement de son œuvre de séduction.
Louis XV cependant, de retour à Choisy après les fêtes qui célébrèrent le mariage du Dauphin, ne pouvait détacher ses pensées de la belle chasseresse qui lui était un instant apparue. Vainement ses pourvoyeurs ordinaires, les valets de chambre, essayèrent d'attirer son attention sur quelques femmes qui se disputaient ses faveurs, «le roi n'avait de goût à rien.»
La marquise de Rochechouart elle-même, malgré son esprit et sa beauté, ne put vaincre la froide indifférence du monarque.
Un valet de chambre nommé Binet fut le premier confident que choisit Louis XV.
Ce Binet fut ravi de la confiance du roi. Il voyait devant lui s'ouvrir le chemin de la fortune. Justement, il était quelque peu parent des Poisson, il se chargea des premières démarches.
Les négociations ne furent ni longues ni difficiles. Madame d'Etioles n'était pas une grande dame pour dicter d'avance ses conditions. Elle accepta donc tout ce que lui proposa Binet.
La première entrevue eut lieu dans l'hôtel de M. de Turneheim, rue Croix-des-Petits-Champs.
À quelques jours de là, c'est-à-dire le 27 avril 1745, madame d'Etioles soupait à Versailles avec le roi, dans l'ancien appartement de madame de Mailly. MM. de Luxembourg et de Richelieu avaient été invités.
Le repas fut gai, la nuit fut longue, et le roi sortit fasciné des bras de l'enchanteresse. Huit jours après madame d'Etioles abandonnait son ravissant manoir pour un petit appartement à Versailles.
Tout cela avait lieu en l'absence de M. d'Etioles, qui était allé passer les fêtes de Pâques chez un de ses amis.
À son retour seulement, il apprit tout à la fois que sa femme avait déserté sa maison et qu'elle était maîtresse déclarée.
Cette nouvelle frappa M. d'Etioles comme un coup de foudre. Il aimait sa femme, cet homme. Sa première pensée fut de s'armer de ses droits d'époux outragé pour ramener l'infidèle. Aux premières démarches qu'il fit, on lui conseilla de se tenir tranquille. Et, comme il emplissait Paris de ses lamentations, comme trop de gens s'associaient à sa légitime douleur, il reçut l'avis de se rendre à Avignon et d'y rester jusqu'à nouvel ordre. Alors, dans la violence de son chagrin, il écrivit à sa femme un dernier adieu. C'était un suprême effort qu'il tentait pour la faire revenir à ses devoirs. Madame d'Etioles fut insensible au désespoir de son mari. Seulement elle fit lire cette lettre au roi, afin sans doute de lui montrer quel amour elle lui sacrifiait.
Le roi lut la lettre avec attention. Les plaintes de cet époux mortellement blessé dans ses plus chères affections le troublèrent et l'émurent.
—Ah! madame, dit-il à sa nouvelle maîtresse, vous aviez là pour mari un honnête et digne homme.
Cependant madame d'Etioles habitait désormais Versailles. Le roi lui avait donné l'ancien appartement de cette pauvre comtesse de Mailly, et chaque soir il y soupait avec elle. Les convives étaient alors Richelieu, Boufflers, d'Ayen, la marquise de Bellefond et madame de Lauraguais, dont la destinée fut toujours d'être l'amie des favorites qui se succédèrent dans la couche royale.
À l'exemple de madame de Châteauroux, madame d'Etioles poussa le roi à prendre le commandement de ses troupes; mais, plus habile que la duchesse, elle ne voulut pas suivre son amant. Elle lui fit promettre de répondre aux lettres qu'elle lui écrirait, et, sûre des séductions de son style, elle prit l'absence pour auxiliaire. Pendant toute la campagne, le roi lui écrivit presque tous les jours, et ses lettres étaient scellées d'un cachet qui portait ces deux mots: discret et fidèle.
Le 7 du mois de septembre, Louis XV faisait son entrée dans sa bonne ville de Paris, et pendant plus de huit jours, bals, fêtes, illuminations et carrousels célébrèrent le retour du vainqueur de Fontenoy.
Ainsi que l'avait prévu madame d'Etioles, l'absence avait augmenté l'empire qu'elle exerçait sur le roi; il revenait plus amoureux que jamais; son premier soin en arrivant à Versailles fut donc de fixer la position de la favorite.
Tout d'abord il fallait lui donner un nom: impossible de présenter à la cour mademoiselle Poisson devenue madame Lenormand d'Etioles! Il fallait d'abord dissimuler sa roture et effacer autant que possible toute trace du passé. On trouva pour la favorite le titre et le marquisat de Pompadour, qui avaient fait retour au domaine. Ce nom appartenait à une illustre famille du Limousin dont le dernier représentant était mort après avoir été compromis dans la conspiration de Cellamare.
C'est donc avec le titre de marquise de Pompadour que la fille de Poisson, le fournisseur infidèle, fut solennellement présentée à Versailles, le mardi 14 septembre 1745, à dix heures du soir, par la princesse douairière de Conti, qui avait vivement sollicité cet honneur.
«La foule abondait, curieuse de voir cette petite bourgeoise prendre rang au milieu de la cour; chacun cherchait à deviner quelles seraient les paroles que la reine lui adresserait; elle se borna à lui demander des nouvelles de madame de Seissac, qui jadis avait contribué à obtenir la révision du jugement qui condamnait le père Poisson à être pendu.
«Confuse, déconcertée, la nouvelle marquise de Pompadour balbutia sa réponse; on ne put saisir que les mots suivants:
«—Je désire passionnément, madame, accomplir tout ce que Votre Majesté m'ordonnera pour son service.»
Le lendemain on célébra à Choisy la présentation de la favorite; courtisans et grandes dames s'étaient disputé la faveur d'une invitation. Le roi devait revenir à Versailles le lendemain, mais il soupa si prodigieusement qu'il fut pris dans la nuit d'une incommodité assez grave.
La reine et toute la cour accoururent aussitôt à Choisy, et dans cette circonstance Marie Leczinska, à force de résignation, manqua de dignité. Elle consentit à manger avec madame de Pompadour. Toutes les dames invitées à cette résidence royale s'assirent à la même table que la concubine: leur délicatesse se trouvait sauvée par l'exemple de la reine.
À l'apparition à la cour de la nouvelle marquise, la cour se partagea en deux partis: les courtisans serviles, adorateurs quand même des caprices du maître, furent aux pieds de la favorite; ils se moquaient de ses manières, des locutions bourgeoises dont elle ne put jamais se défaire, mais ils se moquaient tout bas, résolus à tirer parti de son pouvoir. Les hommes honnêtes, ceux qu'un nouveau scandale indignait, ou qui croyaient encore la religion nécessaire à la conservation de l'ordre social, se rangèrent autour du Dauphin, afin de balancer autant que possible l'influence de madame de Pompadour, de la marquise, comme on l'appela dès le premier moment. Et ce nom que lui donnèrent ses ennemis, lui resta comme un sobriquet, comme un nom de guerre; madame de Pompadour fut en effet et sera toujours par excellence: la marquise.
Les gens habiles d'ailleurs ne s'y trompèrent pas. Ils s'aperçurent bien vite que c'était un ministre en jupons qui arrivait à Versailles.
Le séjour de madame de Pompadour pendant cette première période de sa liaison avec le roi fut le château de Choisy, cette petite maison sans étiquette qu'elle préférait à toutes les autres. Louis XV, encore dans l'ivresse de la possession, passait presque tout son temps auprès d'elle; il recevait ses ministres dans son salon, demandait son avis, et se conformait à ses conseils. Jeanne Poisson de Pompadour remplaçait le cardinal Fleury.
La belle favorite, on le voit, n'avait rien perdu à ne pas faire ses conditions à l'avance; à l'époque où nous sommes arrivés, c'est-à-dire six mois après ce premier souper avec le roi où assistait le duc de Richelieu, elle avait déjà de ses dons: 180,000 livres de rentes, un logement splendide à la cour, un appartement dans toutes les résidences royales, et le marquisat de Pompadour. L'année suivante, 1746, le roi devait lui donner: la terre de Selle, achetée cent cinquante-cinq mille livres, et dans laquelle on dépensa immédiatement soixante mille livres rien qu'en réparations; la terre et le château de Crécy, qui valaient sept cent cinquante mille livres, et enfin deux charges de cinq cent mille livres chacune. C'était ostensiblement plus de quatre millions en moins d'une année. Mais l'ambition de la favorite ne devait pas se contenter pour si peu.
À Paris, l'indignation était grande, et l'on chantait dans tous les salons:
Autrefois de Versaille
Nous venait le bon goût,
Aujourd'hui la canaille
Règne et tient le haut bout.
Si la cour se ravale,
De quoi s'étonne-t-on?
N'est-ce pas de la halle
Que nous vient le poisson?
L'avénement de madame de Pompadour fut le signal de changements dans le ministère: elle voulait des hommes qui lui fussent dévoués. Elle usa donc des prémices de sa faveur pour obtenir le renvoi du contrôleur général Orry, qui pendant seize ans avait administré avec habileté et intégrité les finances de l'État. Orry avait le malheur d'être l'ennemi des frères Pâris, et la favorite n'avait pas oublié ses anciens amis de la finance; de plus, il se plaignait des profusions de la maîtresse. Il fut remplacé par M. de Machault, lié aux intérêts de la ferme générale. C'était un homme probe et rangé, mais à genoux devant toutes les fantaisies de la favorite.
Avec madame de Pompadour, le parti philosophique essaya d'entrer dans les affaires; sous les jupons du ministre femelle, les poëtes et les beaux-esprits commencèrent à se glisser à la cour. Il était difficile de les faire accepter de Louis XV: ce roi, bien qu'essentiellement spirituel, n'aimait ni les artistes ni les gens de lettres, il détestait surtout les philosophes, ces raisonneurs qui allaient, comme on disait alors, apprendre à penser en Angleterre, et revenaient en France propager des idées nouvelles. Mais le roi ne savait rien refuser à madame de Pompadour, et l'on protégea bientôt tous les auteurs de l'Encyclopédie.
L'hiver de 1745 à 1746 fut des plus brillants à Versailles: la nouvelle favorite entreprenait cette tâche difficile d'amuser le plus inamusable des rois; elle réussit cependant. Elle multipliait les soupers et les fêtes, les voyages se succédaient, soit à Choisy, soit dans les châteaux qu'elle tenait des libéralités de son amant. La vie du roi était un perpétuel enchantement. «Comme les jours passent!» s'écriait-il quelquefois. Et le faible souverain s'endormait dans cette déplorable inertie, et le peuple s'indignait de l'empire qu'il subissait.
Bientôt ce fut le tour de Choisy. Choisy devint le séjour des plaisirs et des enchantements; chaque jour amenait quelque divertissement nouveau, quelque flatteuse surprise. Gentil-Bernard, l'auteur de l'Art d'aimer, secrétaire des dragons de Coigny, était l'ordonnateur de toutes les fêtes. Jamais, il faut le dire, la coquetterie des moindres détails ne fut poussée plus loin.
La marquise, alors dans tout l'éclat de sa beauté, réunissait l'esprit à la gaîté, elle amusait le roi par ses saillies, ses petites médisances. Elle chantait, ou bien elle dansait avec la spontanéité d'un enfant.
Madame de Pompadour commença par transformer Choisy. Au moins cette fortune royale qu'elle devait à l'amour du roi, et dont elle ne savait que faire, servit à encourager tous les arts. Vernet, Latour, Pigale, Boucher, Watteau devinrent les commensaux ordinaires de la favorite. L'art, grâce à elle, se modifia, elle avait sous la main de grands artistes pour reproduire toutes les fantaisies de son imagination, tous les caprices de ses rêves.
L'art descendit de ses hauteurs pour se prêter aux commodités de la vie; il se transforma: il n'était qu'agréable, il devint utile. Il se prêta aux moindres détails de l'ameublement. Ces mille futilités dont une femme s'entoure, ces mille petits riens qui réjouissent ses yeux, devinrent des choses d'art, et, aujourd'hui encore, nos femmes à la mode ont pris sous la protection de leur goût ce genre futile et coûteux auquel la marquise a donné son nom.
Tous les mérites avaient part aux libéralités royales dont la favorite était la dispensatrice; et tandis que Boucher enrubannait pour elle les moutons et les bergers, l'architecte Gabriel lui soumettait des plans, Leguay, l'éminent graveur, recueillait sur ses ordres les camées, les pierres gravées, précieux bijoux de l'antiquité, et Bouchardon, sous ses inspirations, façonnait les dragons et les chimères, des grandes pièces d'eau de Versailles.
Duclos et Marmontel étaient logés aux frais du roi dans l'hôtel des affaires étrangères, avec douze mille livres de pension; enfin Crébillon le tragique obtenait une pension de trois mille livres, un logement au Louvre, et le titre de bibliothécaire de Choisy avec cinq mille livres. Et cependant, dans ses contes licencieux, Crébillon fils, plus d'une fois, avait fait des allusions blessantes aux amours de la marquise.
Après une représentation brillante de Catilina, madame de Pompadour obtint encore, pour le vieux Crébillon, l'honneur d'une impression gratuite de ses œuvres à l'imprimerie royale.
Le lendemain, le vieux poëte, alors âgé de quatre-vingt-un ans, vint à Choisy remercier sa protectrice.
La marquise était souffrante, elle reçut néanmoins Crébillon et le fit asseoir jusque dans la balustrade de son lit. Tandis que le poëte embrassait avec effusion la main de la marquise le roi entra. Le vieux tragique eût alors un à-propos charmant.
—Ah! madame, dit-il, nous sommes perdus, le roi nous a surpris.
Louis XV rit beaucoup de cette exclamation du vieillard baisant la main de la marquise comme un amant en bonne fortune.
Mais de tous les hôtes de la marquise, artistes, poëtes, grands seigneurs, le plus cher à son cœur était assurément l'abbé de Bernis, l'ancien commensal du château d'Etioles. Les médisants disaient que l'abbé était mieux qu'un ami pour la favorite, et qu'elle lui donnait pour rien ce qu'achetait si chèrement Louis XV. Mais il la remboursait généreusement en madrigaux.
Sûre de sa puissance, la nouvelle favorite s'occupa de sa famille. Malheureusement sa mère n'était plus. Malade depuis longtemps, la dame Poisson était morte de joie en apprenant que sa fille était maîtresse déclarée. «Tous mes vœux sont comblés, dit-elle en expirant, je pars contente.»
Cent épitaphes circulèrent aussitôt, tant à Paris qu'à la cour, et voici celle qui obtint le plus de succès:
Ci-git qui, sortant du fumier,
Sut faire une fortune entière,
Vendit son honneur au fermier
Et sa fille au propriétaire.
Le fermier, c'était M. de Turneheim, le propriétaire était le roi.
Le père Poisson fut anobli. C'était ravaler l'institution, mais peu importait à madame de Pompadour; sa mission semblait être de saper l'ordre de choses établi, elle accomplissait sa mission sociale; elle conduisait la royauté à sa ruine et préparait la révolution.
Personne ne fut surpris de l'élévation du père Poisson, mais plus que jamais les chansons et les épigrammes circulaient; madame de Pompadour en trouvait jusque sur sa table de toilette. On disait à la cour que le père Poisson avait une chance de pendu.
C'était un homme impudent et grossier; il venait chez sa fille lorsqu'il avait besoin d'argent, c'est-à-dire souvent. Il forçait toutes les consignes, et la présence du roi ne l'arrêtait pas. En parlant de Louis XV il disait: mon gendre.
Certain jour, un valet voulut l'empêcher d'entrer chez la favorite.
—Maraud! s'écria le père Poisson exaspéré, ne sais-tu donc pas que je suis le père de la ... du roi.
Il dînait une autre fois avec des gens de la ferme, chez un financier enrichi depuis peu. La salle à manger était splendide, la chère exquise, les domestiques nombreux.
—Morbleu! dit tout à coup le père de la favorite que le vin mettait en belle humeur, ne dirait-on pas à nous voir une assemblée de princes? et cependant au fond nous ne sommes tous que....
Les convives crurent prudent de l'empêcher d'aller plus loin.
Tel est l'homme auquel Louis XV accorda des lettres de noblesse.
Le frère de madame de Pompadour était plus digne des faveurs royales. Nommé marquis de Vandières, il dut bientôt changer ce nom qui prêtait au ridicule, on ne l'appelait que marquis d'Avant-hier. Il prit le titre de marquis de Marigny.
Le roi aimait fort le marquis de Marigny, dont la conversation était instructive parfois, amusante toujours. Il l'admettait volontiers aux soupers intimes, et l'appelait son petit frère.
Un jour la favorite allait se mettre à table avec le marquis de Marigny. On annonce le roi, le marquis se retire.
—Mais, dit Louis XV à madame de Pompadour, il me semble que je vois ici deux couverts: avec qui donc dîniez-vous?
—Sire, avec mon frère.
—Mais qu'il reste alors, dit le roi; n'est-il pas de la famille? Qu'on mette un troisième couvert pour moi.
Tous les courtisans s'inclinaient devant le frère de la maîtresse du roi, les uns redoutaient son influence, les autres espéraient s'en servir. Un jour le marquis de Marigny disait au roi:
—Je ne saurais vraiment, Sire, comprendre ce qui m'arrive; je ne puis laisser tomber mon mouchoir, que vingt cordons bleus ne se baissent pour le ramasser.
Mais à ce marquis de fraîche date, d'avant-hier, comme disaient les courtisans, il fallait, pour avoir l'air d'un vrai marquis, les ordres du roi.
Louis XV hésita longtemps, la faveur était insigne.
—C'est que, disait-il, c'est un bien petit poisson pour le mettre au bleu.
Une prière de la favorite leva tous ses scrupules, et pour dispenser le marquis de Marigny de faire ses preuves, on le nomma secrétaire de l'ordre. Il eut un cordon bleu exceptionnel.
Cette fois au moins les faveurs pleuvaient sur un honnête homme.
Madame de Pompadour, heureusement pour la France, n'avait pas une nombreuse famille. Son parent le plus éloigné était un certain Poisson de Malvoisin, tambour au régiment de Piémont. Il voulut comme de raison profiter de la situation de sa cousine, et vint la trouver. On résolut de le faire avancer dans l'armée, mais ce n'est qu'après bien des peines et des démarches qu'on parvint à le caser. Les officiers des régiments consentaient bien à l'accepter, mais à la condition qu'il se battît avec eux tous.
De 1746 à 1748, c'est-à-dire jusqu'à la paix d'Aix-la-Chapelle, madame de Pompadour ne songea qu'à consolider sa puissance. Louis XV ayant été prendre le commandement de ses troupes, elle le suivit incognito, déguisée en page, à la suite du duc de Richelieu. Bien des dames suivaient alors leurs maris ou leurs amants à l'armée, et le maréchal de Saxe appelait cette partie de son bagage «son artillerie légère.» Le théâtre de madame Favart faisait campagne, cette année-là, et entre deux assauts, tandis qu'on assiégeait une ville, les officiers couraient au spectacle. À Tongres, la veille de la bataille de Raucoux, le directeur de la troupe annonça que le lendemain il ferait relâche pour cause de victoire.
Lorsque madame de Pompadour n'accompagnait pas son amant en Flandres, elle se retirait à Choisy, et toute la cour, grands seigneurs et grandes dames, venait l'y entourer d'hommages et savoir des nouvelles de l'armée, car elle était, on ne l'ignorait pas, parfaitement renseignée; elle était en correspondance avec les généraux, et le roi lui écrivait presque tous les jours.
Le dessin et la gravure la distrayaient aux heures de solitude; artiste habile, la marquise reproduisait les dessins de Boucher, de Vien ou de Leguay. Mais elle aimait surtout les pierres gravées imitées de l'antique. Elle gravait, elle sculptait elle-même l'onyx, la sardoine, l'émeraude, la cornaline et l'ivoire. La sollicitude des amateurs éclairés de l'art nous a conservé l'œuvre de madame de Pompadour, et toutes ces œuvres d'art, au bas desquelles se retrouve cette signature: Pompadour sculpsit, sont d'une perfection achevée.
Lorsque, la campagne terminée, Louis XV revenait à Versailles prendre ses quartiers d'hiver, la marquise continuait près de lui son rôle d'amuseuse, rôle ingrat s'il en fût jamais. Avec un art infini, elle multipliait les distractions les plus diverses. Le roi avait fini par adopter quelques-uns des goûts de sa maîtresse: il prenait intérêt aux œuvres des artistes dont la marquise était comme la reine; il se plaisait aux pompes du théâtre, et presque chaque jour l'Opéra venait donner des représentations à Versailles. Le roi chassait ensuite et soupait avec ses intimes.
Le second mariage du Dauphin, dont la première femme était morte en couches l'année précédente, avait été, à Paris, le signal de fêtes magnifiques. Le roi avait assisté à plusieurs bals masqués donnés à l'Hôtel-de-Ville. Ces fêtes faisaient trembler madame de Pompadour. Elle redoutait pour le roi, instruite par sa propre expérience, les dangers de ces bals où l'intrigue devient audacieuse sous le masque. Pour écarter ce danger, des hommes à elle entouraient inostensiblement le roi et ne le perdaient pas de rue. S'adressait-il à une femme, paraissait-il prendre plaisir à sa conversation, aussitôt la marquise était prévenue et accourait.
La paix générale, signée à Aix-la-Chapelle, amena un temps de repos et de joyeux loisirs pour la cour. Tous les brillants gentilshommes qui venaient de faire leurs preuves sur les champs de bataille, accoururent oublier à Versailles les fatigues et les dangers.
Cette période est la plus brillante du règne de madame de Pompadour. Sans être arrivée à la toute puissance, son influence n'a déjà plus d'obstacles, et elle est encore aimée du roi. La femme aimable n'a pas encore fait place à la femme d'État dont la responsabilité terrible assombrira le front; enfin elle est encore dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté.
Voici, d'ailleurs, le portrait de cette favorite, tracé par un homme qui certes ne l'aimait pas:
«On peut la citer encore comme une des très-belles femmes de la capitale, et peut-être comme la plus belle. Il y a dans l'ensemble de sa physionomie un tel mélange de vivacité et de tendresse, elle est si bien tout à la fois ce qu'on appelle une jolie femme et une belle femme, que la réunion de ces qualités en fait une sorte de phénomène.
«Cette femme dangereuse, cette habile comédienne, peut être tour à tour superbe, impérieuse, calme, lutine, sensée, curieuse, attentive, enjouée. Sa voix a un ton sentimental qui touche même ceux qui l'aiment le moins, et de plus elle possède ce qu'on a d'habitude le moins à la cour, le don des larmes.
«Elle met peu de rouge, la fraîcheur de son teint lui suffit. Ses yeux ont reçu d'ailleurs une telle vivacité, qu'il semble qu'une étincelle en jaillit quand elle donne un coup d'œil.
«Ses yeux sont châtains, ses dents très-belles, ainsi que ses mains. Sa taille est fine, bien coupée, de moyenne grandeur et sans aucun défaut.
«Elle connaît si bien ses qualités, qu'elle a grand soin de les aider de tous les secours de l'art. Elle a inventé des négligés, adoptés par la mode, et qu'on appelle les robes à la Pompadour, et qui font ressortir toutes les beautés qu'elles semblent vouloir cacher.»
Ce portrait, où l'on reconnaît la main d'un ennemi furieux d'être forcé de se rendre à l'évidence, ne suffit-il pas pour expliquer l'influence de madame de Pompadour?
Ne faisait-elle pas, d'ailleurs, tous ses efforts pour distraire l'insurmontable ennui d'un roi rassasié de tout? Chaque jour son imagination fertile lui suggérait quelque moyen nouveau. Louis XV avait cent femmes en une seule. Pour l'agacer et le surprendre, la marquise apparaissait chaque jour avec un travestissement nouveau: en grande dame aujourd'hui, demain en paysanne. Aucune mise en scène ne lui coûtait. Le roi avait un jour remarqué une religieuse fort jolie: il trouva le lendemain la marquise vêtue en sœur grise.
Toute jeune fille, madame de Pompadour avait joué avec succès la comédie et le petit opéra; devenue reine de Choisy, elle résolut d'y faire élever un théâtre et d'y jouer devant le roi, puisqu'il aimait à la retrouver dans des rôles toujours nouveaux.
Cette idée fut exécutée avec la rapidité que donne la toute-puissance: Gabriel construisit la salle, Boucher peignit des décors merveilleux; les répétitions commencèrent. Toute la cour s'arrachait les rôles. Jouer la comédie devant le roi, avec madame de Pompadour, la précieuse faveur!
Les principaux artistes du théâtre de Choisy étaient: la marquise d'abord, puis mesdames de Marchais, de Courtenvaux, de Maillebois, de Brancas, d'Estrades; MM. de Richelieu, de Duras, de Coigny, de Nivernais, d'Entragues.
Lorsqu'il y avait un ballet, le marquis de Courtenvaux, le duc de Melfort et le comte de Langeron étaient les premiers sujets.
Le duc de La Vallière était le directeur de cette noble compagnie. L'abbé de Lagarde soufflait: Gresset, Crébillon et l'abbé de Bernis dirigeaient les répétitions.
Le corps de ballet était insuffisant, et les chœurs laissaient à désirer; mais le roi ne s'en amusait que mieux.
—Ils chantent aussi mal que moi, disait-il en riant.
Et c'était une grosse injure à jeter à des chœurs d'opéra; le roi possédait la voix la plus fausse de son royaume.
Mais les distractions de la comédie ne suffisaient pas à l'ennuyé Louis XV; les petits voyages impromptus continuaient soit à Marly, soit à Crécy, chez la marquise, ou à Trianon, que l'on avait fait réparer à grands frais. Les chasses étaient plus fréquentes que jamais; on courait le cerf à Fontainebleau ou à Compiègne, le plus souvent dans la forêt de Sénart. La chasse, voilà la seule vraie passion de Louis XV, celle qu'il conserva jusqu'à la fin de sa vie.
À Choisy, après la comédie, après la chasse, au retour de toutes les excursions, on soupait. Le souper, c'était l'heure du repos, de la liberté, de la joie. Les pamphlets du temps nous ont laissé sur les soupers de Louis XV de longs et minutieux détails; mais tous sont empreints de la plus haineuse exagération. Ces soupers ne furent point, tant que régna la marquise, les crapuleuses orgies racontées avec complaisance par quelques libellistes obscurs.
Voici, d'ailleurs, comment les choses se passaient: le roi, l'heure du souper venue, désignait douze ou quinze convives, jamais plus, et l'on passait dans la salle à manger. C'était un charmant salon, meublé avec élégance, décoré par Watteau, Boucher ou Latour. Aucun apprêt de festin ne paraissait; seulement, au milieu du salon, le parquet dessinait une vaste rosace. À un signe du roi, la rosace s'élevait, et, comme dans les contes de fées, on voyait apparaître une table chargée de plats et de flacons, étincelante de cristaux et de porcelaines, éclairée par des centaines de bougies. Le roi s'asseyait, et les invités prenaient place; des pages de la petite écurie, fils de grande famille pour la plupart, servaient le souper rapidement, sans bruit; à chaque service, la table était renouvelée. Au dessert, les pages étaient renvoyés.
Alors seulement on oubliait l'étiquette. Mais les propos grossiers du libertinage ou de l'impiété étaient sévèrement bannis. Une ironie spirituelle, légère, superficielle, était la seule arme dont on se servît. On ne discutait pas, on se moquait. Les mots charmants éclataient de tous côtés, les anecdotes spirituelles circulaient autour de la table. La conversation était leste parfois, et même un peu grivoise, mais jamais ordurière; la langue avait d'ailleurs à cette époque une licence qu'aujourd'hui on ne tolérerait plus.
Alors s'échangeaient les joyeux défis de vins d'Aï ou de Tokai, les coupes s'emplissaient, se choquaient et se vidaient au bruit charmant des éclats de rire, et quelque poëte, l'abbé de Bernis, par exemple, improvisait d'anacréontiques couplets.
Le roi, en se levant, ne donnait pas le signal du départ; souvent les invités restaient après l'hôte; mais la liberté n'était pas plus grande, elle ne dégénérait pas en licence.
Le roi se retirait habituellement chez madame de Pompadour. Parfois le champagne frappé, dont il abusait, lui montait à la tête; la marquise en faisait alors ce qu'elle pouvait jusqu'au lendemain. On faisait lever quelque femme de chambre, mais dans le plus grand mystère, et on préparait du thé. Plus d'une fois la favorite eut sujet d'être inquiète, et madame du Hausset raconte que, certaine nuit, la vie de Louis XV fut en danger; mais on avait toujours un médecin sous la main.
—Que deviendrais-je, grands dieux, disait la marquise, si jamais le roi venait à mourir chez moi!!! Je serais massacrée; la populace me traînerait dans les ruisseaux.
Le premier médecin la rassurait alors, jusqu'à la prochaine mésaventure.
Au matin, le roi recevait les ministres chez la favorite, dont le salon était devenu la chambre du conseil. Le roi ne disait mot, il écoutait; la marquise prenait les décisions pour lui.
—Sire, disait-elle au roi, les discussions vous donnent la jaunisse.
Le roi la croyait sur parole, et la laissait faire. Elle s'exerçait et s'enhardissait au métier d'homme d'État. Afin de se perfectionner, elle travaillait avec chaque ministre en particulier. Mais la marquise était une artiste et non une femme politique; elle le prouva bien. La paix était faite, et quelle paix! et les affaires à l'intérieur n'en allaient pas mieux. Aussi, tandis qu'à la cour on dansait, on soupait après la comédie, le peuple murmurait. Mais le roi n'entendait pas le murmure de son peuple, le roi ne savait même pas le prix du pain à Paris. Et comme un jour un placet lui était parvenu par le plus grand des hasards, il voulut savoir. Alors un courtisan chercha à rassurer le roi.
—Sire, lui dit-il, le pain n'a jamais été meilleur marché.
—Malpeste, s'écria un grand seigneur qui était du parti du Dauphin, je suis bien aise de savoir cela; je vais de ce pas bâtonner mon maître d'hôtel qui a l'impudence de me le faire payer très-cher.
De toutes parts craquait l'édifice vermoulu de la royauté; il fallait un bras pour soutenir l'édifice, une tête pour diriger ce bras; il n'y avait ni bras ni tête, il y avait madame de Pompadour, une femme charmante, spirituelle, artiste, mais une femme. Ses petites passions, ses jalousies de favorite, ses impressions du moment, tel était son code politique. Le peuple sentait tout cela, et le peuple l'avait en horreur. D'ailleurs un vent s'était levé, qui n'était plus un vent de fronde, c'était le souffle puissant de la liberté. Il venait d'Angleterre et de Genève, de partout un peu. Les philosophes avaient allumé un bûcher pour y brûler toutes les institutions et toutes les croyances, le vent attisait ce feu terrible. Il y avait encore les parlements qui s'exerçaient à la rébellion, et le clergé qui, par ses divisions et son intolérance, poussait à la révolte.
Dans le public, on disait que le traité d'Aix-la-Chapelle était un traité honteux; madame de Pompadour pensait comme le public, mais qui savait ses pensées? Une des clauses secrètes de ce traité était l'expulsion de France du prince Édouard, le prétendant, ce prince infortuné pour lequel la France avait prodigué son or et versé son sang. Louis XV voulut tenir la parole donnée et écrite; un soir, au sortir de l'Opéra, le prince Édouard fut saisi, lié, jeté dans une chaise de poste, et conduit à la frontière. Le ministère d'alors semblait vraiment être à la discrétion de l'Angleterre. La marquise osa dire au roi ce que tout bas pensait le peuple:
—Sire, c'est une lâcheté!
Des pamphlets, des épigrammes, des libelles, seule arme du mécontentement, parurent aussitôt de tous côtés contre le roi, la favorite, les ministres, contre le régiment des gardes qui avait exécuté les ordres reçus et arrêté le prince Édouard:
Des gardes en un mot, le brave régiment,
Vient, dit-on, d'arrêter le fils du prétendant.
Il a pris un anglais. Ah Dieu! quelle victoire!
Muses, gravez bien vite au temple de mémoire
Ce rare événement.
Va, déesse aux cent voix, va l'apprendre à la terre,
Car c'est le seul Anglais qu'il ait pris à la guerre.
Une épître remarquable, dédiée: AU ROI, commençait ainsi:
Peuple jadis si fier, aujourd'hui si servile,
Des princes malheureux vous n'êtes plus l'asile.
Vos ennemis, vaincus aux champs de Fontenoy,
À leurs propres vainqueurs ont imposé la loi.
Des enlèvements d'enfants vinrent encore aigrir la population contre le roi et contre la favorite; la faute en est certainement à quelques misérables, agents subalternes de la police, qui outrepassèrent leurs ordres; mais le peuple ne s'arrête point à ces considérations.
Une ordonnance du roi avait défendu la mendicité et ordonné l'arrestation des gens sans aveu; à Paris, ils étaient arrêtés et dirigés sur Marseille où on les embarquait pour les colonies. Il arriva que des agents de police, pour rançonner quelques pauvres mais honnêtes familles, abusèrent de leur pouvoir et enlevèrent plusieurs enfants.
Un jour, un de ces misérables enlève et conduit au dépôt un jeune garçon, espérant forcer la mère à le racheter. Cette femme, au désespoir, croyant son fils perdu, mort, s'élance dans la rue et parcourt tout le faubourg Saint-Antoine, poussant d'horribles cris, invoquant la pitié du peuple. Sur ses pas, la population sort des maisons, des groupes se forment, les mères prennent parti pour la mère. Les rumeurs les plus étranges circulent: on dit que dans tous les quartiers des enfants ont ainsi disparu. Ce n'est plus un enfant qui a été enlevé, ce sont des milliers d'enfants. Tout à coup une imputation horrible, épouvantable, se répand dans la foule: on dit que les médecins ont ordonné des bains de sang au roi, pour rétablir sa santé usée par la débauche; on ajoute que c'est chez la Pompadour que les enfants sont conduits et égorgés pour ces bains réparateurs.
Ces rumeurs abominables accroissent l'agitation, les rassemblements augmentent, l'exaspération du peuple est à son comble. On se jette sur les agents de police, partout où on les reconnaît. Mais les agents ne sont que les instruments du crime, le coupable est le lieutenant de police qui ordonne. Aussitôt la multitude roule ses flots menaçants jusqu'à son hôtel pour le massacrer. Prévenu, il s'enfuit par les jardins. On va escalader les murailles, briser tout dans l'hôtel. Tout à coup les portes s'ouvrent par les ordres de la femme du lieutenant de police, moins craintive que son époux. Du moment où il peut entrer, le peuple hésite; il craignait un piége. Mais les troupes de la maison du roi accourent à toute bride; à leur vue l'insurrection se dissipe. On arrête ceux dont la fuite n'a pas été assez prompte, et le lendemain, sans jugement, sans information, coupables ou non, ils sont pendus sans miséricorde.
Le Parlement saisit avec bonheur cette occasion d'être désagréable à la cour. Une information fut décidée. On manda le lieutenant de police pour l'admonester. Mais ce lieutenant était une créature de madame de Pompadour; le Parlement le blâmait, elle le nomma, pour le récompenser, conseiller d'État; plus tard elle l'appela au ministère. Telle était sa politique.
Paris avait calomnié son roi par une horrible imputation; Louis XV prit en dégoût sa capitale, la ville autrefois des plaisirs et des fêtes, devenue la ville des insultes et des menaces. Depuis longtemps, le peuple lui avait retiré ce beau titre de Louis le bien-aimé; quelques années plus tard il disait avec justice:
Le bien-aimé de l'almanach
N'est plus le bien-aimé de France.
Le roi prit donc la résolution de ne plus traverser Paris pour aller de Versailles à Compiègne. Il voulait, dit-il, punir son peuple; le fait est qu'il en était réduit à le craindre. On fit, par ses ordres, un chemin de la porte du bois de Boulogne à Saint-Denis, en tournant la capitale. Cette nouvelle voie prit le nom de route de la Révolte, qu'elle a gardé depuis.
À l'occasion de cette émeute, le guet reçut une organisation militaire; on fit bâtir des casernes à Rueil et à Courbevoie, afin d'avoir toujours des troupes sous la main; enfin le maréchal de Lowendal fut chargé de dresser un plan de fortifications contre Paris.
Cependant le Parlement continuait ses remontrances, et la querelle des billets de confession menaçait l'Église d'un schisme.
Mais le mépris des Français pour Louis XV n'avait pas détruit encore dans leur cœur l'attachement au sang de leurs rois. Toute l'affection du peuple s'était reportée sur le Dauphin, dont la vie sérieuse et calme formait un contraste éloquent avec les goûts de son père. D'ailleurs, c'est surtout à la favorite que le peuple s'en prenait; on la disait la cause de tout le mal. Mieux que nous ne le pourrions faire, une simple chanson du temps expliquera la situation des esprits; elle est bien l'expression des sentiments de l'époque:
Les grands seigneurs s'avilissent,
Les financiers s'enrichissent,
Tous les Poissons s'agrandissent,
C'est le règne des vauriens.
On épuise la finance
En bâtiments, en dépense,
L'État tombe en décadence,
Le roi ne met ordre à rien,
Rien, rien, rien.
Cette chanson, qui dans l'original a neuf ou dix couplets, était destinée à faire fortune.
Assez de fautes graves, assez d'accusations méritées pèsent sur la mémoire de la marquise de Pompadour, sans qu'il soit nécessaire de la calomnier encore. Il est donc juste de la décharger d'une imputation odieuse et ridicule, fort accréditée par quelques romans historiques et un gros mélodrame, qui l'accusent d'avoir trente ans durant persécuté un malheureux prisonnier plus impudent et imprudent que coupable. On devine qu'il s'agit de Latude—ou trente ans de captivité. Rétablissons donc les faits:
Le 15 mai 1750, madame de Pompadour était à sa toilette, lorsqu'on lui remit une lettre apportée par la poste. On y dénonçait un complot contre ses jours, et on donnait la liste des principaux conjurés. Le nom des plus grands personnages de la cour y figurait. Cette lettre l'avertissait qu'avant peu elle recevrait une cassette renfermant des poisons si violents que les respirer serait mortel. La lettre était signée Henri Mazers de Latude.
La marquise, on le comprend, fut épouvantée, et fit aussitôt prévenir le lieutenant de police, un homme qui lui était tout dévoué. La cassette annoncée ne tarda pas à arriver. On l'ouvrit avec les plus grandes précautions; elle renfermait quelques paquets de poudre blanche, poudre complètement inoffensive. L'innocence de tous les personnages dénoncés résultant d'une information des plus sérieuses, on résolut de découvrir le mystificateur, et c'est bien le nom qui convient. Latude avait pris si peu de précautions, que les paquets de poudre blanche de la cassette étaient renfermés dans des papiers écrits de sa main; or, du premier coup d'œil, on s'était convaincu que l'auteur de la lettre et celui qui avait envoyé la cassette ne faisaient qu'un seul et même personnage. Latude ne se cachait pas, il fut arrêté comme calomniateur.
Interrogé par le lieutenant de police, il répondit que, se trouvant sans ressources et sans protecteurs, il avait trouvé ce moyen, dans l'espoir que madame de Pompadour, se croyant sauvée par lui d'un grand danger, lui accorderait sa protection.
Le lieutenant de police se contenta alors de le faire enfermer au fort de Vincennes.
Mazers de Latude était un petit gentilhomme gascon, né à Montagnac dans le Languedoc. Il avait fait en Hollande, près des réfugiés protestants, de remarquables études, et se destinait au génie militaire. C'est donc comme officier qu'il fut conduit à Vincennes.
Latude s'évada le second mois, mais il ne fut pas poursuivi; il eût été oublié sans doute, s'il ne s'était avisé d'une nouvelle plaisanterie dans le goût de la première. Il avait la monomanie de la dénonciation. Arrêté dans l'hôtel garni qu'il occupait, il fut cette fois conduit à la Bastille. On le traita convenablement; il avait un logement d'officier. Là il se lia avec un nommé d'Alègre, Gascon comme lui, et six mois après tous les deux s'évadaient avec une incontestable hardiesse.
Ils se sauvèrent en Hollande, où Latude s'affilia aux conjurations des protestants et des jansénistes réfugiés. Il fut enlevé et réintégré à la Bastille. Naturellement, on dut prendre à son égard certaines précautions de surveillance; mais il fut néanmoins bien traité. On lui accordait la permission d'écrire: les plans et les projets de génie militaire qu'il adressait au ministre en font foi. Homme supérieur, esprit d'élite, Latude avait des idées jeunes et fécondes; le ministre lui fit offrir la liberté à la condition de retourner à Montagnac. Sans refuser précisément, il prit occasion d'écrire à madame de Pompadour des lettres d'une extrême insolence. Or, ces lettres, qui devaient passer par les mains du lieutenant de police, n'arrivèrent pas à leur adresse. En novembre 1765, Latude s'échappait de nouveau, par un miracle inouï d'audace et de présence d'esprit. Repris, il fut enfermé à Bicêtre, et on ne le relâcha qu'en 1777, sous la condition expresse qu'il habiterait son lieu de naissance.
Où voit-on dans tout cela une vengeance personnelle de madame de Pompadour? Si cela était, n'eût-il pas recouvré sa liberté à la mort de la favorite? M. de Sartines, ennemi de la marquise, eût-il fait poursuivre en 1765 le prisonnier évadé? Le duc de Choiseul l'eût-il fait enfermer à Bicêtre? M. de Malhesherbes, visitant cet hôpital en 1775, n'eût-il pas fait droit à ses réclamations?
Louis XV cependant s'ennuyait toujours, et la marquise, malgré toute son imagination, se voyait à bout de moyens de distraction. C'est alors que l'idée lui vint d'inspirer au roi le goût des bâtiments et des constructions. On mit des ouvriers partout à la fois. Le public cria fort. C'était la moindre des préoccupations de la favorite. Les finances se trouvaient dans le plus déplorable état; mais telle était l'indifférence du roi et la toute-puissance de la marquise, que l'on put faire un incroyable abus des acquits de comptant. C'était tout simplement conduire l'État à la banqueroute. Quelques entreprises utiles furent cependant conseillées par madame de Pompadour, et l'on commença les bâtiments de l'École militaire et de la Manufacture de porcelaines de Sèvres.
L'établissement de la manufacture de porcelaines de Sèvres rendit le plus grand service à l'industrie française. Nous avions les Gobelins, la Savonnerie, les glaces, qui, par la supériorité de leurs produits, nous donnaient la première place; mais l'art céramique était resté en retard. Bien plus, il avait dégénéré, et depuis longtemps le secret était perdu de ces magnifiques poteries des XVe et XVIe siècles, si recherchées encore aujourd'hui des amateurs. Nos porcelainiers se bornaient alors à l'imitation mal réussie, à la contrefaçon grotesque des produits de la Saxe ou du Japon.
Sous les auspices de madame de Pompadour, cet art charmant fit les plus rapides progrès; on retrouva des couleurs et des nuances perdues, on eut le secret de la pâte tendre, si fine et si belle, et bientôt les produits de la Manufacture de Sèvres firent l'admiration du monde entier.
Les constructions de l'École militaire et de la Manufacture de Sèvres ne faisaient pas négliger d'autres entreprises beaucoup moins utiles, mais plus coûteuses: on travaillait à force à Choisy, à Crécy, à la Muette, et surtout au château de Bellevue, dispendieuse fantaisie de la favorite.
Madame de Pompadour allant un jour de Sèvres à Meudon, s'arrêta sur la colline qui domine la rive gauche de la Seine, au point où la route de Versailles traversait cette rivière.
—Voyez donc, Sire, dit-elle en s'adressant au roi, voyez donc la belle vue!
Et sur cette hauteur abandonnée aux bruyères, elle résolut de se faire construire un château. Artistes, architectes, peintres, sculpteurs, jardiniers, furent aussitôt convoqués, les plans furent arrêtés séance tenante, et les travaux commencèrent avec une magique rapidité. La marquise elle-même surveillait l'œuvre des architectes, et souvent le roi quittait la chasse pour venir déjeuner au milieu des ouvriers. Moins de deux ans après, le château de Bellevue était achevé. Les petits bâtiments, situés au bas de la rampe, presqu'au bord de la Seine, prirent le nom de Brimborion.
Bellevue, inauguré le 25 novembre 1760, par des fêtes magnifiques, devint bientôt la résidence favorite de Louis XV; il est vrai que la marquise avait prodigué les millions pour faire de ce château un véritable séjour des Mille et une nuits.
Le jour de l'inauguration, la marquise, après avoir promené son royal amant dans toutes les pièces de ce merveilleux château, après avoir joui de ses surprises et de son admiration, le conduisit dans un appartement qui s'ouvrait sur une serre immense éclairée de mille bougies. Là se trouvaient à profusion les fleurs les plus rares, les plus éloignées de la saison: roses, lilas, jasmins, œillets, renoncules et primevères s'épanouissaient «dans ce domaine enchanté de Flore,» comme on disait alors, et répandaient les plus suaves parfums. Le roi fut ébloui.
—Ne me donnerez-vous pas un bouquet, marquise? demanda-t-il.
—Venez vous-même le cueillir, Sire, dit l'enchanteresse, avec un ravissant sourire, venez.
Le roi y alla. Mais à la première fleur qu'il voulut détacher, il s'aperçut que la tige était froide et rigide.
Tout ce charmant parterre était en fine porcelaine de Saxe, et de suaves essences, dont les gouttes brillaient sur les feuilles comme autant de perles de rosée, remplaçaient les émanations de toutes ces fleurs.
Toute la cour, est-il besoin de le dire, s'arracha bientôt les invitations de Bellevue.
Mais le château était petit, le nombre des invités fut très-restreint. Il y avait beaucoup d'appelés et peu d'élus. Les ministres, quelques favoris intimes étaient les hôtes habituels. Ceux-là passaient la nuit au château. Les invités ordinaires se retiraient après les fêtes et allaient chercher un gîte dans les habitations des environs. On appelait ces convives de jour, des polissons; et cependant, aller à Bellevue, même en polisson, était une faveur insigne. Hommes et femmes devaient revêtir un uniforme choisi et dessiné par madame de Pompadour: elle-même avait distribué les étoffes et donné le calque des dessins que chacun devait faire exécuter; les broderies seules étaient une affaire de plus de douze cents livres. Les habits des hommes étaient de velours, les robes des dames de damas.
Les dépenses du château de Bellevue firent beaucoup crier; pamphlets et chansons faisaient rage. Un officier aux gardes, chevalier de Malte, pour quatre mauvais vers, fut condamné à un an de détention, puis exilé. Les flatteurs de la favorite trouvaient la punition bien douce.
Toute-puissante dans l'État, madame de Pompadour n'avait pas à la cour les honneurs du tabouret. Elle n'eut qu'un mot à dire, tout fléchit devant ses volontés, même l'étiquette, qui n'accordait cette prérogative qu'aux seules duchesses. Le roi saisit, pour lui accorder cette faveur, l'occasion du rétablissement du Dauphin, qui avait été si sérieusement malade qu'un instant on avait craint pour ses jours. La favorite eut donc le tabouret; vainement le parti du Dauphin s'opposa à son élévation, elle fut présentée.
Suivant le cérémonial des présentations, elle devait être embrassée par la reine, par le Dauphin et par les princesses. La reine et ses filles se soumirent à cette humiliation nouvelle que leur imposait le roi; mais le Dauphin ne put cacher son dégoût. Après avoir embrassé la nouvelle élue, il lui tira la langue, selon les uns, et essuya ses lèvres du revers de sa main, selon d'autres.
La marquise ne s'en aperçut pas sur le moment, mais ses flatteurs ne tardèrent pas à le lui apprendre. Grande fut sa colère contre le Dauphin, qu'elle n'avait jamais aimé: sa piété, selon elle, n'était qu'hypocrisie, sa charité, un moyen habile de se créer une popularité. Elle alla donc trouver le roi, se plaignant amèrement de cette insulte qui retombait sur lui. Louis XV partagea l'indignation de la favorite, et le Dauphin reçut l'ordre de se rendre au château de Meudon. Vainement la reine et ses filles intercédèrent pour lui, le roi mit pour condition à son retour qu'il ferait des excuses à la marquise.
Après quelque résistance, le Dauphin fut obligé de se soumettre. En présence de toute la cour, il déclara à madame de Pompadour qu'il était très-innocent de l'injure que des calomniateurs lui imputaient.
La favorite reçut cette déclaration avec la dignité d'une reine, et gracieusement elle lui répondit que jamais elle n'avait ajouté foi à tout ce qu'on était venu lui rapporter. Puis, comme gage de réconciliation, elle grava elle-même le portrait du Dauphin. Tel fut le dénoûment de cette aventure, qui faillit diviser le parti du Dauphin: les uns le blâmaient, les autres l'approuvaient d'avoir obéi au roi. Mais le Dauphin fit observer que toute la honte, si honte il y avait, retombait, non sur le fils qui se soumettait, mais sur le père qui avait donné des ordres.
Le tabouret ne satisfit pas encore l'ambition de madame de Pompadour, elle voulut être dame d'honneur de la reine. Sûre de l'approbation du roi, elle fit faire quelques démarches près de Marie Leczinska. La reine, toujours faible et soumise, n'osa refuser, mais elle objecta que, toutes les dames du palais faisant leurs pâques, la favorite ne pouvait être admise qu'à la condition d'approcher des sacrements.
La marquise s'occupa immédiatement de lever cet obstacle. Elle commença par déclarer que ses relations avec le roi n'étaient plus qu'amicales, ce qui était vrai, comme nous le verrons plus tard; elle sollicita ensuite de son mari une lettre de pardon, dans laquelle il devait dire que désormais, oubliant toutes les fautes de sa femme, il lui rendait son estime et lui rouvrait sa maison.
M. d'Etioles consentit à tout ce que lui demanda sa femme. Depuis longtemps il avait pris son parti de son abandon, et il s'était même décidé à user de son pouvoir, tant pour lui que pour ses amis. En 1754 il avait accepté la place vacante de fermier général des postes, au scandale de beaucoup de ses amis, qui pensaient que la retraite convenait à sa situation.
Munie de ses pièces justificatives, la marquise entra en négociations avec le père de Sacy, qui consentit à lui donner l'absolution et à lui administrer les sacrements. Elle fut donc nommée dame d'honneur. Elle se jeta alors pour quelque temps dans la dévotion, mais dès ce moment, assure-t-on, elle résolut la perte des jésuites, qui avaient osé, lorsqu'il s'était agi de ses pâques, résister à ses volontés.
L'expulsion des jésuites, due à madame de Pompadour et au duc de Choiseul qui voulait la destruction ou la réforme des ordres religieux, donna à la favorite une heure de popularité. Accepter la volonté des partis est un moyen habile qu'ont toujours adopté les ambitieux. On se grandit alors à peu de frais, et de tous les intéressés on se fait des créatures. Un instant on oublia la haine vouée à la favorite, on oublia la bassesse de sa naissance, son avidité, les traités honteux, et, pour cette proscription d'une société dangereuse, on l'adula plus que si elle eût donné une province à la France.
Dans le courant de l'année 1754, madame de Pompadour avait éprouvé le plus grand chagrin de son existence. Alexandrine, sa fille bien-aimée, mourut subitement pour avoir été saignée mal à propos au couvent de l'Assomption, où on l'élevait avec le plus grand soin. Elle avait alors onze ans.
Ici commence la seconde période de la vie de la marquise de Pompadour. La maîtresse charmante de Louis XV fait place à la femme d'État. L'ambitieuse incapable que flétrit l'histoire succède à l'artiste spirituelle, qui avait trouvé grâce.
La favorite règne désormais. Elle est duchesse de fait, sinon de titre, elle est dame d'honneur de la reine. Alors son orgueil devient immense, insatiable comme son ambition.
Dans son salon, elle affecte le ton et les manières d'une reine, elle trône, comme jamais, même après son mariage, ne l'avait osé faire madame de Maintenon. Elle reçoit tout le monde, assise dans une chaise longue, ne se levant jamais, même pour les princes du sang, obligeant tout le monde à se tenir debout.
Pour qu'on ne lui manque pas de respect, c'est-à-dire pour que nul n'ait l'idée de s'asseoir en sa présence, elle fait enlever les siéges, si bien qu'un jour le marquis de Souvré, sorte d'original qui avait son franc parler, vient, pour se reposer, s'asseoir sur un des bras de son fauteuil.
Cette familiarité lui semble monstrueuse, et elle se plaint au roi de l'outrage qu'elle a reçu. Louis XV demande une explication au marquis.
—Ma foi! sire, répond M. de Souvré, j'étais diablement las, et, ne sachant où m'asseoir, je me suis aidé comme j'ai pu.
Cette réponse cavalière fit heureusement rire le roi. Si le coupable avait essayé de se disculper, il était perdu.
Sous prétexte qu'elle est souffrante, la marquise ne rend de visites à personne, même aux duchesses titrées, et un noël de la cour fait allusion à ces prérogatives que la faiblesse royale donne à la favorite:
De Jésus la naissance
Fit grand bruit à la cour;
Louis, en diligence,
Fut trouver Pompadour.
Allons voir cet enfant, lui dit-il, ma mignonne.
Non, dit la marquise au roi,
Qu'on l'apporte chez moi,
Je ne vais chez personne.
Elle fait donner à ses domestiques des titres et des décorations; sa femme de chambre est une personne de qualité, et lorsqu'elle sort, il lui faut un chevalier de Saint-Louis pour porter la queue de sa robe.
Et l'on se demande lequel des deux l'emporte, de la vanité de la maîtresse ou de la bassesse du gentilhomme.
Les courtisans prenaient à tâche de justifier cette insolence par leur plate obséquiosité, et les plus grands seigneurs de France ne rougissaient pas de faire antichambre chez elle, attendant une audience pour solliciter quelque grâce.
Elle est roi désormais, président du conseil des ministres. C'est dans son cabinet que se fait le travail politique, les secrétaires d'État viennent lui soumettre toutes les décisions, elle assiste aux lits de justice, elle répond aux remontrances du Parlement. Richelieu, le grand ministre, sous sa robe rouge de cardinal avait caché Louis XIII; Louis XV disparaît sous les jupes amples de sa favorite. Un éventail, voilà le sceptre de la France.
La toute-puissance de la marquise de Pompadour ne tarda pas à se faire sentir d'une manière désastreuse.
Le traité d'Aix-la-Chapelle ne nous donnait qu'une paix boiteuse. C'était une trêve armée, chacun le sentait, mais nul alors ne prévoyait la guerre de Sept-Ans. Cette guerre impolitique, insensée, calamiteuse, elle fut l'œuvre de la favorite. De tout temps l'Autriche avait été considérée comme l'ennemie naturelle de la France: ainsi pensaient Henri IV et Richelieu, deux politiques au moins aussi forts que la maîtresse de Louis XV. On changea de conduite, et l'on tendit la main à Marie-Thérèse.
Cette guerre devait servir admirablement et les rancunes et les amitiés de madame de Pompadour, qui détestait Frédéric, le roi de Prusse, et affectionnait très-particulièrement l'impératrice d'Autriche.
La haine de la marquise contre le roi de Prusse datait de longtemps. Frédéric, sorte de tyran philosophe et bel esprit, accueillait avec distinction tous les mécontents que faisait la cour de France. Il professait une tolérance universelle. Il permettait de tout dire, de tout imprimer, lorsqu'il ne faisait pas mettre les libres penseurs en prison et brûler les livres par la main du bourreau. Son palais était une petite académie, un hôtel Rambouillet de l'Encyclopédie. Il écrivait à Jean-Jacques Rousseau et donnait à Voltaire la clef de chambellan. À ses soupers on raisonnait sur tout, et sur bien d'autres choses encore, mais surtout on critiquait, on se moquait. Versailles, on le devine, n'était point épargné, et la favorite de Louis XV était le point de mire de tous les traits d'esprit. Souvent à ses oreilles étaient venus les propos méchants, les piquantes épigrammes; on lui avait montré des vers, apporté des chansons. Enfin Frédéric l'avait surnommée, et elle le savait, Cotillon II.
L'amitié de madame de Pompadour pour Marie-Thérèse fut l'œuvre du comte de Kaunitz, ambassadeur d'Autriche. Politique habile sous des dehors frivoles, reconnaissant l'utilité de l'alliance de la France, il pensa que l'amour-propre de la favorite valait la peine d'être exploité. Il décida donc sa souveraine à écrire une lettre autographe à la maîtresse du roi de France. Marie-Thérèse, dans ses lettres, traitait la marquise d'égale à égale, elle l'appelait cousine, se disait son amie. L'orgueil faillit étouffer madame de Pompadour. Kaunitz ne s'était pas trompé, de ce jour elle voua une inaltérable affection à son amie et cousine Marie-Thérèse.
Les négociations avec l'Autriche commencèrent, et bientôt un traité d'alliance fut signé; c'était le signal de la guerre de Sept-Ans. La France va désormais, au profit de son ancienne ennemie, prodiguer son or et son sang. Frédéric sera plusieurs fois à deux doigts de sa perte, dans son désespoir il songera même au suicide; mais, général habile, roi vraiment grand et héroïque dans plusieurs campagnes, il tirera un admirable parti de toutes ses ressources, fera face de tous côtés à la fois, échappera à quatre armées qui le cernent, et sortira de cette lutte inégale, sinon vainqueur, du moins sans grandes pertes.
Marie-Thérèse, grâce à une habile administration, aidée d'ailleurs par la France, accroîtra son influence en Europe.
Tout le poids de la guerre retombera sur la France; durant ces sept années d'hostilité il périra neuf cent mille combattants, nous sacrifierons des millions, nous perdrons toute notre prépondérance, et le pacte de famille que M. de Choiseul considérait comme un chef-d'œuvre de diplomatie, nous fera perdre la Louisiane.
Pendant cette guerre désastreuse, de petits généraux conduisent à la mort de grandes armées, des rivalités mesquines éclatent entre les chefs et font échouer tous les plans, les flatteurs seuls de la favorite obtiennent des commandements; enfin des généraux français font construire, ô honte! des palais à Paris avec l'or de l'ennemi.
Insouciant et ennuyé, Louis XV apprendra toutes les turpitudes, il verra le mal et ne songera pas à y remédier; il a emprunté la devise de sa favorite: Après nous le déluge!
Voilà cependant où nous conduisaient les petites passions de la marquise de Pompadour. Sa politique ne rencontra aucun obstacle de la part des ministres, elle n'admettait au pouvoir, il est vrai, que des créatures à elle, et plus tard l'abbé de Bernis, son ami dévoué, un des auteurs du traité avec l'Autriche, fut exilé pour avoir osé résister.
Depuis longtemps déjà M. de Maurepas, le ministre aimé de Louis XV, le seul qui pût faire travailler le roi, entre un bon mot et une chanson, ce qui ne l'empêchait pas d'être un habile homme d'État, avait été renvoyé. Il avait fallu trouver un prétexte. La marquise l'accusa donc d'être l'auteur d'un abominable quatrain qu'elle avait, disait-elle, trouvé un jour sous sa serviette en se mettant à table.
Au dedans cependant les affaires n'en allaient pas mieux; les finances étaient obérées; le clergé et le Parlement mesuraient tour à tour la faiblesse du gouvernement et tenaient peu de compte de ses ordres; une division intestine partageait le sacerdoce et la magistrature. Il y avait débat entre toutes les juridictions. Bientôt, à la suite d'une mesure prise par le roi, cent-quatre-vingt membres du Parlement donnèrent leur démission.
«La douleur des Parisiens, dit l'auteur de l'Histoire philosophique du règne de Louis XV, se manifesta bientôt en expressions de colère. Le roi était hautement qualifié du nom de tyran. On se racontait la turpitude de ses mœurs. La favorite était couverte d'imprécations;» enfin les pamphlets et les placards les plus injurieux étaient chaque jour affichés jusque sur les murs du palais. L'exaltation était à son comble.
Le crime ne se fit pas attendre. Le 5 janvier 1757, vers cinq heures du soir, le roi qui, dans la journée, était venu à Versailles voir une de ses filles malades, se disposait à monter en carrosse pour retourner à Trianon. Il mettait le pied sur le degré de velours, lorsqu'un homme qui s'était glissé dans l'ombre au milieu des personnes qui l'entouraient, s'élança sur lui et le frappa.
—On vient, s'écria le roi, de me donner un furieux coup de coude.
Puis, passant la main sous son habit, il la retira pleine de sang.
—Je suis blessé, dit-il.
Alors, regardant autour de lui, et apercevant un homme qui gardait son chapeau sur la tête:
—C'est cet homme qui m'a frappé! Qu'on le prenne, mais qu'on ne le tue pas.
Des gardes du corps se précipitèrent aussitôt sur l'assassin, et l'arrêtèrent.
Il eût pu s'enfuir dix fois avant ce temps, se perdre dans la foule; mais, soit horreur de son crime, soit mépris de la vie, il était resté immobile.
Conduit dans la salle des gardes du corps, il fut fouillé. On trouva sur lui une trentaine de louis d'or et un couteau à deux lames. Il s'était servi, pour frapper le roi, de la plus petite, qui avait la forme d'un canif. Interrogé, il déclara se nommer François Damiens. Puis, tout à coup, et comme pris de remords:
—Qu'on prenne garde, s'écria-t-il, à monseigneur le Dauphin! qu'il ne sorte pas d'aujourd'hui!
Cette exclamation fit croire qu'il avait des complices, et, pour obtenir une révélation complète, les gardes du corps commencèrent à lui donner la torture.
Mais vainement on le tenailla avec des pincettes rouges, les soldats se lassèrent plus vite que lui; il ne poussa pas un cri, il n'avoua rien.
Bientôt le grand prévôt de l'hôtel vint s'emparer de l'assassin et le fit conduire à la geôle, pour commencer une instruction régulière.
Le roi cependant perdait beaucoup de sang. Il remonta l'escalier sans être soutenu. Il devait coucher à Trianon, en sorte qu'il n'y avait rien de préparé à Versailles. On coucha le roi sur des matelas, pendant qu'on disposait son lit; et tous ceux qui étaient autour de lui commencèrent à le déshabiller.
Un médecin était accouru. La blessure se réduisait à une forte égratignure. Le roi portait ce jour-là, à cause du froid plusieurs vêtements, ils avaient amorti le coup. La blessure pansée, le calme commençait à renaître, lorsque tout à coup un imprudent énonça la crainte que le couteau ne fût empoisonné.
Cette crainte frappa l'esprit du roi. Tout son sang-froid l'abandonna. Il voulut un prêtre à l'instant; et comme tous les aumôniers étaient absents, un simple chapelain remplit en tremblant la redoutable mission de le réconcilier avec le ciel.
La famille royale était accourue; la reine se précipita tout en larmes dans la chambre. Madame de Pompadour se présenta, mais la porte lui fut interdite, par ordre du roi, qui lui fit donner le conseil de se retirer de la cour. Ses terreurs de Metz le reprenaient. Puis il délégua tous les pouvoirs au Dauphin, qui prit le gouvernement des affaires.
Le ministre Machault, conformément aux intentions du roi, était allé trouver madame de Pompadour. Dans son intérêt, il lui conseillait de fuir. Jamais la position de la favorite n'avait été ainsi menacée, elle perdait la tête. Elle allait se décider à partir, lorsque madame de Mirepoix, présente à l'entretien, lui représenta que son départ la perdait à tout jamais.
—Il faut rester, lui dit-elle.
Et comme la marquise hésitait encore:
—Oui, ajouta madame de Mirepoix, mieux vaut être chassée, que de partir un jour trop tôt.
Bien en prit à madame de Pompadour de suivre ce conseil. Huit jours après, le roi était remis et redevenait son esclave.
Le procès de Damiens ne fit jaillir aucune lumière sur cet odieux attentat. Il resta cependant à peu près prouvé qu'il n'avait pas de complices.
Dans tous ses interrogatoires, il soutint qu'il n'avait voulu que blesser le roi. Les tortures les plus atroces ne lui arrachèrent aucune révélation.
Quelques jours après l'attentat, le ministère fut presque entièrement renouvelé.
Le roi, revenu de ses terreurs de la mort, rougissait-il de ses faiblesses, voulait-il en éloigner les témoins? Quelle que soit la raison, les ministres furent brusquement renvoyés et remplacés par des hommes complètement à la discrétion de la marquise, plus puissante que jamais.
Depuis longtemps déjà, la marquise de Pompadour n'était plus pour le roi qu'une amie; les sens n'étaient plus pour rien dans leur mutuel attachement. Tel était l'état de sa santé, que, de l'avis même du médecin, elle avait dû rompre entièrement toutes relations avec son amant. Sa déclaration au père de Sacy, à l'occasion de ses pâques, était donc vraie. Dans sa jeunesse d'ailleurs, au temps même où véritablement elle était la maîtresse du roi, madame de Pompadour avait toujours eu un tempérament très-opposé à celui de Louis XV, et on a peine à se figurer les expédients auxquels elle avait recours pour garder seule l'amour du maître et ménager son influence, lorsque l'amitié née de l'habitude succédait à l'amour dans le cœur du roi.
Voici une anecdote empruntée aux Mémoires de madame du Hausset qui peint admirablement le caractère de la marquise à cette époque, et cette anecdote ne peut être révoquée en doute, venant d'une femme qui lui fut toujours dévouée. C'est madame du Hausset qui parle.
«J'avais remarqué que, depuis plusieurs jours, madame de Pompadour se faisait servir du chocolat à triple vanille et ambré, à son déjeuner; qu'elle mangeait des truffes et des potages au céleri. La trouvant fort échauffée, je lui fis un jour des représentations sur son régime, qu'elle eut l'air de ne pas écouter. Alors je crus devoir en parler à son amie, la duchesse de Brancas.
«—Je m'en suis aperçue, me dit-elle, et je vais lui en parler devant vous.
«Effectivement, après sa toilette, madame de Brancas lui fit part de ses craintes sur sa santé.
«—Je viens de m'en entretenir avec elle, dit-elle en me montrant la duchesse, elle est de mon avis.
«Madame la marquise témoigna un peu d'humeur et se mit à fondre en larmes. J'allai aussitôt fermer la porte, et je revins écouter.
«—Ma chère amie, dit madame de Pompadour à madame de Brancas, je suis troublée de la crainte de perdre le cœur du roi en cessant de lui être agréable. Les hommes mettent, comme vous pouvez le savoir, beaucoup de prix à certaines choses, et j'ai le malheur d'être d'un tempérament excessivement froid. J'ai imaginé de prendre un régime un peu échauffant, pour réparer ce défaut, et depuis deux jours cet élixir me fait du bien....
«Elle pleura encore, et ajouta:
«Vous ne savez pas ce qui m'est arrivé il y a huit jours, le roi, sous prétexte qu'il faisait chaud, s'est mis sur mon canapé et y a passé la moitié de la nuit; il se dégoûtera de moi et en prendra une autre.
«—Vous ne l'éviterez pas, répondit la duchesse, en suivant votre régime, et ce régime vous tuera.
«Ces dames s'embrassèrent, madame de Pompadour recommanda le secret à madame de Brancas, et le régime fut abandonné.
«Peu de temps après, elle me dit:
«—Le maître est plus content de moi, et c'est depuis que j'en ai parlé à Quesnay, sans lui tout dire. Il m'a dit que pour avoir ce que je désire, il fallait avoir soin de se bien porter, et tâcher de bien digérer et faire de l'exercice pour y parvenir. Je crois que le docteur a raison, et je me sens tout autre. J'adore le roi: je voudrais lui être agréable, mais, hélas! quelquefois il me trouve plus froide qu'une macreuse.»
Mais l'influence de madame de Pompadour tenait à des sentiments plus nobles que ceux qu'elle désirait alors. Elle devait son empire à son adresse, à son dévouement constant à toutes les fantaisies du maître, au soin qu'elle prenait de courir au-devant de ses moindres désirs, aux charmes de son esprit, à sa grâce, à toutes ces qualités, enfin, qu'elle possédait dans la première période de ses relations avec le roi.
Plus tard, elle fut pour Louis XV comme un vieux ministre; il n'osait la renvoyer par cette même raison qui l'avait fait garder le cardinal Fleury: il tremblait de voir retomber sur lui seul tout le poids des affaires; il voyait bien que la royauté allait droit à sa perte. Il pressentait la ruine, mais il disait: «Bast! tout cela durera bien autant que moi.» Et il laissait faire le mal, pouvant l'empêcher, ce qui est le plus grand crime qu'un souverain puisse commettre.
Madame de Pompadour, cependant, tremblait toujours de voir surgir une rivale. Depuis longtemps, elle le savait, les valets de chambre du roi, corrupteurs subalternes, méprisables agents de la débauche, fournissaient aux caprices du maître de jeunes et jolies filles qu'ils allaient recrutant de tous côtés. Les intrigues des ennemis de la marquise pouvaient pousser dans la couche royale quelque femme de grande maison, belle, fière, spirituelle, hardie, comme l'avait été la duchesse de Châteauroux.
La favorite frémissait à cette idée; les infidélités passagères de son amant lui importaient peu, elle ne l'aimait plus; mais elle tenait au pouvoir plus qu'à la vie. Elle résolut donc d'être elle-même l'intendante des honteux plaisirs du royal débauché. C'était la première fois que cette idée venait à une favorite d'entourer son amant d'un sérail, mais cette idée assura la puissance de madame de Pompadour. Elle choisit pour le roi des maîtresses jeunes, jolies, gracieuses, mais d'une classe inférieure ou sans fortune et sans alliances, aussi peu spirituelles que possible, de façon à n'avoir rien à redouter du pouvoir de leurs charmes. Les pourvoyeurs habituels du roi devinrent ses créatures, et nulle ne put être admise près du roi sans son approbation.
Déjà, quelque temps auparavant, Louis XV était venu lui demander, avec un certain embarras, il est vrai, ses bontés pour une jeune fille prête à devenir mère, et sur laquelle il désirait que l'on veillât avec la plus grande sollicitude. Il était fort embarrassé de cette jeune fille; ne voulant pas trahir son incognito, et n'osant s'ouvrir à personne de peur d'une indiscrétion, il avait pensé à son amie.
La marquise se chargea elle-même de prendre soin de la mère et de l'enfant; elle pourvut généreusement à tous leurs besoins et leur assura un revenu honnête.
«—Que vous êtes bonne! lui disait le roi; que de gratitude pour vous, de vous charger d'une pareille mission!»
La marquise devait avoir bien d'autres complaisances: afin de favoriser les goûts de Louis XV, elle lui donna, dès 1753, sa charmante retraite de l'Ermitage, située dans le parc de Versailles, et admirablement disposée pour les débauches secrètes.
Le Parc-aux-Cerfs était inventé.
C'est là que désormais furent logées les jeunes filles qui attendaient les embrassements du maître. On donna à cette maison une organisation. Un chevalier de Saint-Louis sollicita l'honneur d'en être l'intendant général. Une ancienne chanoinesse fut chargée de la surveillance intérieure: elle avait sous ses ordres deux sous-maîtresses; enfin, un certain nombre de femmes de compagnie étaient chargées de l'éducation des jeunes élèves.
Le valet de chambre Lebel, M. de Lugeac, neveu de la favorite, et sa femme, la marquise elle-même, tels étaient les pourvoyeurs ordinaires de cet infâme sérail. La police s'en mêlait aussi, et lorsque quelque enfant de neuf à onze ans attirait par sa beauté les regards des agents, elle était enlevée ou achetée à ses parents et conduite à Versailles.
Le nombre des malheureuses qui passèrent successivement au Parc-aux-Cerfs est immense. À leur sortie, elles étaient mariées à des hommes vils ou crédules, à qui elles apportaient une bonne dot. On leur trouvait toujours un mari. La turpitude du chef de l'Etat provoquait ainsi la bassesse des sentiments. L'argent, au besoin, n'était pas épargné, on le prodiguait, on prodiguait aussi les places dans l'armée ou dans le clergé. Le roi était généreux, le trésor public fournissait à tout. Il est difficile d'évaluer les sommes englouties par le Parc-aux-Cerfs, mais on peut assurer sans exagération que pendant trente-quatre ans que subsista cet établissement, elles s'élevèrent au moins à cent cinquante millions.
Le peuple savait toutes ces infamies, son mépris et sa haine augmentaient.
Le traité de paix signé à Paris (10 février 1763) vint mettre le comble à l'exaspération générale. C'était cependant la fin de cette guerre absurde, entreprise en faveur de l'Autriche sous l'inspiration de madame de Pompadour. Mais ce traité nous faisait perdre toute notre prépondérance européenne, la France humiliée devenait une puissance de troisième ordre. Enfin, malgré la détresse des finances, il fallut payer à Marie-Thérèse, la bonne amie de la marquise, une somme de trente-huit millions qui l'aida à réparer ses pertes.
On trouva que les amitiés de la favorite coûtaient un peu trop cher. La nation fut frappée au cœur.
La majesté royale était avilie, et tous ceux qui entouraient le trône semblaient prendre à tâche de flétrir la couronne. Le bruit ne courut-il pas que, pour augmenter ses ressources, pour payer plus largement ses honteux plaisirs, le roi s'était mis à la tête du pacte de famine et créait pour s'enrichir des disettes factices!
La marquise, on le pense, n'était pas épargnée. Depuis longtemps déjà elle n'osait plus se montrer en public, elle était accueillie par des huées. On ne l'appelait plus que le fléau de la France. On disait hautement qu'elle avait ruiné l'Etat, et cette allégation ne manquait pas de fondement.
Sans compter les sommes fabuleuses englouties dans la guerre de Sept-Ans, la marquise avait dilapidé les finances pour enrichir ses parents, ses amis, pour se faire des créatures, pour satisfaire les passions du roi.
Sa fortune à elle-même était scandaleuse. Elle possédait le marquisat de Pompadour, le château de Crécy, en Brie, les châteaux de Bel-Air et de Bellevue, des Réservoirs, le marquisat de Mesnars, sans compter plusieurs autres magnifiques propriétés, entre autres l'hôtel d'Évreux, qu'elle avait fait reconstruire à l'extrémité des Champs-Elysées.
Enfin, pour se faire une idée de son luxe, on n'a qu'à jeter les yeux sur son livre de dépenses, qui ne dit pas tout, et l'on voit qu'elle paya de 1748 à 1754, pour la construction et les décorations intérieures seulement de sa maison de Bellevue, la somme de près de trois millions (2,983,047 francs). Le linge, pour draps et table de sa maison de Crécy, avait coûté 60,452 livres. Qu'on estime ce qu'elle avait dû dépenser pour Bellevue! Elle possédait pour près de deux millions de diamants, et elle estimait elle-même sa vaisselle d'or et d'argent à 687,600 francs. Ses seuls colifichets sont évalués à 394,000 livres; ses porcelaines, non compris celles de Sèvres, à 261,945 livres, sa garde-robe à 350,000 livres.
Les voyages du roi, comédies, fêtes données en ses différentes maisons, lui coûtèrent plus de quatre millions. Enfin, pendant ses dix-neuf années de règne, elle dépensa pour sa bouche la somme de trois millions cinq cent quatre mille huit cents livres.
Les tableaux, les objets d'art, les mobiliers splendides, les collections de camées et de pierres fines, ne sont pas compris dans cet état fort abrégé des richesses de la favorite. La vente seule de son mobilier dura plus d'un an.
Madame de Pompadour avait entrepris une tâche impossible, celle d'amuser Louis XV: elle succomba à cette tâche, elle y usa sa santé, sa vie.
Cette femme, partie de si bas pour s'élever si haut, n'avait pas été heureuse. Elle régnait, tous ses désirs semblaient remplis, mais une inquiétude profonde la consumait en secret. Son pouvoir tenait à si peu de chose! On se fait difficilement une idée de ce qu'il en coûta de peines, de soucis, de douleurs à cette favorite, pour conserver au milieu de tous ses ennemis sa haute situation. Sa santé s'altéra sous le poids des angoisses de son âme. La Providence allait être justifiée.
Hélas! elle n'était plus que l'ombre d'elle-même. Jeune femme, elle avait été menacée d'épuisement; sa maladie dégénéra bientôt en une langueur mortelle.
Longtemps elle réussit à cacher ses souffrances au roi, mais un jour, à Choisy, au milieu d'une partie de plaisir, elle fut terrassée par le mal. On crut d'abord que ce ne serait qu'une indisposition passagère, mais les symptômes devinrent vite menaçants, et on la transporta de Choisy à Versailles. Les médecins ne désespéraient pas, elle seule ne s'abusa point sur son état.
—Je suis perdue, dit-elle; qu'on aille me chercher un confesseur!
Louis XV vit sans émotion les progrès de la maladie. Il fut convenable, voilà tout. Chaque jour il envoyait plusieurs fois prendre de ses nouvelles, chaque matin un de ses favoris lui apportait un bulletin de la nuit.
Calme et résignée, elle vit approcher la mort. Au commencement de sa dernière journée, le curé de la Magdeleine, sa paroisse, était venu la voir et l'exhorter au courage; à onze heures il prit congé d'elle.
—Attendez encore un moment, monsieur le curé, murmura-t-elle, nous nous en irons ensemble.
Peu après elle expira (15 avril 1764); elle avait alors quarante-trois ans, et en avait passé près de vingt avec le roi.
Louis XV, jusqu'au dernier moment, lui laissa l'exercice de son pouvoir suprême, et elle eut cette dernière faveur de «rendre le dernier soupir dans la demeure des rois, quoique l'étiquette en bannisse la mort, cette messagère importune.»
Mais avec la vie de la favorite s'éteignirent toute sollicitude, toute commisération. Son cadavre, roulé dans un drap, fut placé sur une civière, et deux hommes de peine le portèrent hors du palais. Louis XV, de la fenêtre de ses appartements, vit passer dans la cour l'ignoble cortège. Le temps était sombre, il tombait une pluie fine et glacée.
—Pauvre marquise! dit le roi, elle aura bien mauvais temps pour son dernier voyage.
Ce fut tout. Louis XV n'eut pas une larme, un mot de regret pour cette femme qui, pendant vingt ans, avait été son amie.
Madame de Pompadour fut inhumée au couvent des Capucines de Paris, dans une chapelle qu'elle avait achetée un an auparavant. Le marquis de Marigny fut l'héritier de ses immenses richesses.
Son corps n'était pas refroidi encore, que d'ignobles épitaphes circulaient déjà à Paris et à Versailles. Enfin, dirent les Parisiens transportés de joie, Louis XV va donc régner.