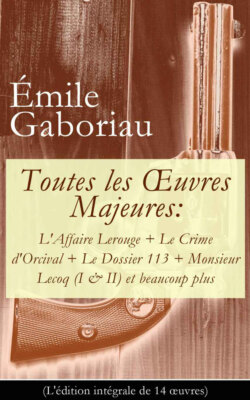Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 24
V MADAME DE MAINTENON.
ОглавлениеAvec madame de Maintenon commence ce qu'on est convenu d'appeler les sombres années du règne de Louis XIV; ceci, vrai pour les horreurs religieuses, est inexact quant au reste. Depuis 1670, la prospérité n'était qu'apparente, et chaque année les dépenses avaient été croissant. Le trésor était vide, les troupes sans solde, les routes étaient infestées de brigands. Le luxe dévorait la noblesse; enfin, les pierres, les bâtiments, Versailles, engloutissaient des sommes immenses. Il était bien évident que la débâcle arriverait, qu'un jour viendrait où tous les expédients du crédit et de l'emprunt feraient défaut.
Colbert avait prévu ces désastres, et il avait conjuré le roi de modérer ses dépenses. Louis XIV ne l'écouta pas; il était alors dans l'ivresse de la puissance et ne se doutait guère que vers la fin de son règne il en serait réduit, lui, le grand roi, le roi-soleil, à faire les honneurs de Versailles à Samuel Bernard, et à flatter l'importance du financier pour lui soutirer quelques pauvres millions.
Il est bien nécessaire d'insister sur cette pénurie des finances, parce qu'elle explique la révocation de l'édit de Nantes et les rigueurs des persécutions et des proscriptions religieuses. Le clergé n'eût jamais obtenu cela du roi sans la noblesse; la noblesse y poussa, parce que, complétement ruinée, elle savait trouver d'immenses avantages pécuniaires à ces rigueurs déployées contre les protestants. La révocation fut bien moins une affaire religieuse qu'une spéculation, le fait n'en est que plus odieux. Ce fut une confiscation générale. Les réformés eurent sous le règne de Louis XIV le sort des juifs au moyen âge; on les laissa prospérer, s'enrichir, et lorsqu'on jugea leurs coffres assez pleins, on les saisit à la gorge:—Halte-là! la bourse ou la vie! au nom du roi, au nom de Dieu! Tous y laissèrent leur fortune, beaucoup leur vie.
Il serait, on le voit, injuste de faire retomber toute l'atrocité de l'action sur madame de Maintenon, l'idée ne lui appartient pas, mais elle commit le crime déjà énorme de contribuer au succès, malgré elle, malgré ses convictions, prise entre son ambition et sa conscience.
Avec madame de Maintenon, le cotillon disparaît, mais il est remplacé par la robe noire du jésuite. Sous les guimpes dont s'enveloppe sa prude coquetterie, je distingue le père de La Chaise, dans sa manche je vois s'agiter le bras du fanatique Le Tellier. Aux caprices parfois désastreux, mais passagers, d'une maîtresse intrigante et coquette, se substitue le sombre plan d'une société ambitieuse, qui, froidement, lentement, par tous moyens, veut arriver et arrive à son but.
Les dévots ont jeté la veuve Scarron dans la place. C'est à la marquise de Maintenon de leur ouvrir les portes; elle entretiendra les démangeaisons de la conscience royale, les jésuites se chargeront de les calmer.
Et Louis XIV est dupe, et, malgré lui, il laisse faire; entouré, circonvenu, il perd cette audacieuse initiative qui fut sa force. Résiste-t-il, son confesseur entr'ouvre immédiatement une des trappes de l'enfer, et il se rend; son ignorance fait la force de ceux qui l'ont pris à leur toile; écoutons plutôt Madame:
«On avait, dit-elle, fait tellement peur au roi de l'enfer, qu'il croyait que tous ceux qui n'avaient pas été instruits par les jésuites seraient damnés, et qu'il craignait d'être damné aussi en les fréquentant. Quand on voulait perdre quelqu'un, il suffisait de dire: Il est huguenot ou janséniste; alors son affaire était faite. On ne saurait être plus ignorant en matière de religion que n'était le roi. Il croyait tout ce que lui disaient les prêtres, comme si cela venait de Dieu même. La vieille Maintenon et le père La Chaise lui avaient persuadé que tous les péchés qu'il avait commis avec La Montespan lui seraient remis, s'il tourmentait et chassait les réformés, et que c'était la voie du ciel. Il l'a cru fermement. Il était du moins de bonne foi, et ce n'était pas du tout sa faute que sa cour fût hypocrite; la vieille Maintenon avait forcé les gens à l'être.»
Louis XIV, en ses belles années, avait applaudi à l'exécution des faux dévots; il avait encouragé Molière, il ne s'en souvenait plus. Tartufe mit des jupons et des coiffes, alors il ne le reconnut plus. Que dis-je! il lui fit fête, le pauvre homme! il lui ouvrit son palais et son lit, et finalement l'installa à côté de lui sur le trône. Ce fut l'apothéose de Tartufe.
Jamais pouvoir ne fut moins éclatant et pourtant plus réel que celui de madame de Maintenon; elle eut la main à tout.—Elle fit des généraux et des ministres, plus nuls les uns que les autres, mais les uns et les autres ses créatures. Louis XIV n'avait rien à lui refuser; elle le dominait par le cœur, par les sens et par la conscience; seule elle était l'arbitre de son bonheur en ce monde et dans l'autre. Favorite d'un genre nouveau, elle tenait du directeur et de la maîtresse, et un confessionnal était le boudoir de ses glaciales amours.
Plus on étudie le caractère de cette femme froide, sèche, moins on a pour elle de sympathie; toute sa conduite est louche comme sa position. Rien de net, d'arrêté, de précis; elle hésite, elle tergiverse, elle ne sait dire ni oui, ni non. Tout est vague, ambigu, voilé; il n'y a de positif en elle que sa souplesse. Les péripéties de sa vie expliquent jusqu'à un certain point ce caractère. Ambitieuse, passionnée, la première moitié de sa vie n'est qu'une longue humiliation, sa jeunesse se passe, sa beauté se fane, avant qu'elle ait même l'espérance d'une situation dans le monde; admise un peu partout, mais en subalterne, elle ne sauve sa position qu'à force d'habileté et d'aménité insinuante; il lui reste de toutes ces épreuves quelque chose de vil et de bas, le sceau indélébile de la domesticité.
C'est dans la conciergerie de la prison de Niort que naquit, le 2 novembre 1635, d'une vieille famille calviniste, Françoise d'Aubigné, la future marquise de Maintenon. Constant d'Aubigné, son père, fils maudit et déshérité du vieil Agrippa, avait eu une triste vie, infamante à plus d'un titre, et était alors enfermé pour des intelligences avec le gouvernement anglais.
Rendu à la liberté, sur les sollicitations pressantes de sa femme, il partit avec toute sa famille pour la Martinique, où l'on commençait à fonder des établissements, et où il espérait rétablir promptement sa fortune follement dissipée.
«On aime à entourer de merveilleux l'enfance des personnes célèbres,» aussi la biographie de madame de Maintenon commence presque comme un conte de Perrault. Elle tombe malade sur le vaisseau, on la croit morte, on va la jeter à la mer, un mouvement qu'elle fait la sauve. Elle n'échappe à ce danger que pour en courir un plus grand encore. Des corsaires sont au moment de s'emparer du vaisseau qui la porte; par bonheur un ouragan éloigne les pirates. À la Martinique, une servante imprudente laisse seule sur le rivage la petite Françoise, et il s'en faut de rien qu'elle ne soit dévorée par un énorme serpent.
Mais des malheurs plus grands et plus réels l'attendaient. Son père refit en effet sa fortune, mais il la dissipa de nouveau au jeu, et il mourut comme il perdait son dernier louis, laissant sa femme et ses enfants dans un dénûment absolu.
Revenue en France avec la petite Françoise, alors âgée de dix ans, madame d'Aubigné, réduite à la plus profonde misère, fut obligée de travailler de ses mains pour vivre, tandis qu'elle poursuivait les débris de la fortune de son mari. Ses affaires l'ayant rappelée à la Martinique, elle confia sa fille à madame de Villette, qui eut pour elle une tendresse maternelle.
Ce bonheur dura peu; la jeune d'Aubigné fut arrachée de cette maison par madame de Neuillant, catholique zélée, qui, se fondant sur sa parenté, obtint par autorité de justice le droit d'élever et de convertir sa jeune parente.
C'est une des phases les plus terribles de la vie si agitée de mademoiselle d'Aubigné: elle tenait au culte réformé, et madame de Neuillant voulait absolument lui faire accepter la religion romaine. «On employa d'abord la douceur et les caresses, en vain. On voulut la vaincre alors par les humiliations et les duretés. On la confondit avec les domestiques, et on la chargea des plus bas détails de la maison. «Je commandais à la basse-cour, a-t-elle dit depuis, et c'est par là que son règne a commencé. Tous les matins, une gaule à sa main et un petit panier sous son bras, on l'envoyait garder les dindons, avec défense de toucher aux provisions du panier avant d'avoir appris cinq quatrains de Pibrac.»
Sa conversion n'avançait pas, malgré la dureté de ces traitements; madame de Neuillant la fit entrer aux Ursulines de Niort. Elle n'y resta que quelques mois; personne ne payant sa pension, les sœurs la rendirent à sa mère, qui la plaça à Paris aux Ursulines de la rue Saint-Jacques. «C'est là qu'on obtint son abjuration, après beaucoup de résistance de sa part.»
À peine sortie du couvent, mademoiselle d'Aubigné perdit sa mère, et de nouveau se vit forcée de recourir à l'hospitalité de madame de Neuillant «qui, dit Tallemant, bien que riche et quoique sa parente, la laissait nue par avarice.»
Sans ressources, sans expérience, sans famille, la pauvre jeune fille mangeait avec douleur le pain amer et souvent reproché de l'aumône, lorsqu'elle se trouva pour la première fois en relation avec le poëte Scarron.
Cet infortuné, qui doit sa réputation bien moins à ses vers burlesques qu'à la gaîté courageuse avec laquelle il railla ses douleurs et fit un jouet de son mal, était un raccourci de toutes les infirmités humaines.
Horriblement paralysé, contrefait, tordu par de continuelles souffrances, il n'avait de libre que la bouche et les mains. Seul, l'estomac était bon et avait conservé toute sa vigueur. On faisait cent contes de l'horrible torture du pauvre Scarron, et lui-même s'en plaint dans une de ses préfaces: «Les uns disent que je suis cul-de-jatte, les autres qu'on me met sur une table dans un étui où je cause comme une pie borgne, d'autres encore que mon chapeau tient à une corde qui passe dans une poulie, et que je la hausse et la baisse pour saluer ceux qui me visitent, je veux arrêter ces mensonges.» Sur ce, il fait son portrait, et assure qu'il n'est guère plus contrefait qu'un Z.
En ce triste état, n'ayant presqu'aucune fortune, Scarron sut tirer parti de son mal; il en vécut au moins autant que de ses vers. Il s'était déclaré malade de la reine, et touchait une petite pension pour remplir son office. Bien des gens lui venaient en aide, et il ne se faisait pas faute de se rappeler au souvenir de ceux qui pouvaient pour lui quelque chose, par de burlesques requêtes auxquelles il était bien difficile de ne pas faire droit.
Je suis, depuis quatre ans, atteint d'un mal hideux
Qui tâche de m'abattre;
J'en pleure comme un veau, bien souvent comme deux,
Quelquefois comme quatre.
Tel est le style des plaintes du pauvre Scarron, ce qui ne l'empêche pas de «bien manger et de bien boire, nous avoue-t-il, comme le plus grand glouton bien portant, surtout lorsqu'il n'est pas logé à l'hôtel de l'impécuniosité, ce qui lui arrive parfois.»
Tel est le malheureux qui prit en pitié le malheur de mademoiselle d'Aubigné, et lui offrit sa main. Elle accepta, «aimant mieux encore cet extrait de mari que le couvent,» et que la pauvreté, eût-elle pu ajouter; car tel était son dénûment, que le jour de sa noce elle fut réduite à emprunter un habit.
Fidèle à ses habitudes burlesques, Scarron reconnut par contrat à sa future: «Quatre louis de rente, une paire de belles mains, un très beau corsage, une jolie figure, deux grands yeux fort mutins et beaucoup d'esprit.»
Ce portrait n'est point flatté, si flatteur qu'il semble: mademoiselle d'Aubigné était, à dix-sept ans qu'elle avait alors, une des plus ravissantes personnes que l'on pût voir. On ne l'appelait que la Belle Indienne. Mademoiselle de Scudéry nous en a laissé dans sa Clélie un vivant portrait, sous le nom de Lyrianne, épouse de Scaurus (Scarron). «Lyrianne était de grande et belle taille, mais de cette grandeur qui n'épouvante point et qui sert seulement à la bonne mine. Elle avait le teint fort uni et fort beau, les cheveux d'un châtain clair et très-agréables, le nez très-bien fait, la bouche bien taillée, l'air noble, doux, enjoué, modeste, et, pour rendre sa beauté plus parfaite et plus éclatante, elle avait les plus beaux yeux du monde, noirs, brillants, doux, passionnés et pleins d'esprit.»
Chez Scarron, dont le salon s'emplissait chaque soir du regain de la Fronde, la jeune épouse, la garde malade plutôt, étendit le cercle jusque-là assez restreint de ses connaissances. Elle devint la reine de ce cénacle de beaux esprits et de grands seigneurs, et, toute jeune qu'elle était, imposa assez aux habitués de son mari pour qu'au moins en sa présence on s'abstînt des plaisanteries licencieuses qui avaient cours auparavant chez le poëte burlesque.
Madame de Maintenon a eu trop d'ennemis acharnés à essayer de salir son passé pour qu'il soit possible d'ajouter foi aux pamphlets qui racontent les mille et une aventures galantes de madame Scarron. Elle sut dans tous les cas sauver bien habilement les apparences. Rien ne prouve que Fouquet le surintendant ait eu autre chose que de l'amitié pour elle et de l'admiration pour les vers de son mari, d'où une pension. Rien ne prouve qu'elle n'ait pas repoussé et désolé tous ses adorateurs, Villarceaux comme les autres. Elle n'a qu'une chose qui puisse faire douter de sa vertu, sa liaison avec Ninon de Lenclos, liaison on ne peut plus intime, et un mot de cette même Ninon:
—Que de fois je lui ai prêté ma chambre jaune pour ses entrevues avec Villarceaux!
Je prendrais presque le parti de la sagesse de madame Scarron, en l'étudiant avec soin année par année; ses traits se tirent, son regard devient dur, sa physionomie est sèche, elle a tous les caractères de la vieille fille sortie victorieuse d'une lutte contre le célibat.
La mort de Scarron réduisit sa veuve à la mendicité; la reine-mère heureusement lui rendit la pension dont avait joui son mari, mais cette pension s'éteignit avec la reine-mère. Voilà la pauvre veuve de nouveau sans pain, et accablant Louis XIV de pétitions, bien inutiles, hélas!
Enfin un jour le roi lui accorda gracieusement, et lorsqu'elle y pensait le moins, ce que tant de fois elle avait demandé en vain; elle eut strictement de quoi vivre et parut s'en contenter. Elle était même si habile qu'elle paraissait riche avec ce qui n'eût pas suffi à une autre.—«Deux mille livres! s'écria-t-elle, c'est plus qu'il n'en faut pour ma solitude et mon salut.»
Déjà, on le voit, madame Scarron inclinait fort à la dévotion, ce qui ne l'empêchait pas de suivre ses anciennes relations et de fréquenter le monde où elle avait de vrais succès; elle soupait encore avec Ninon de Lenclos, mais elle avait pris l'abbé Gobelin pour directeur.
Ainsi elle vivait, ne sachant quelle direction donner à l'immense ambition qui la dévorait, lorsque madame de Montespan eut la très-malheureuse idée de lui confier l'éducation de ses enfants.
L'ambitieuse veuve accepta, avec de jésuitiques restrictions, il est vrai; elle voulut un ordre du roi, elle l'eut. Il est probable que, du premier jour où elle se trouva en relations directes avec Louis XIV, son plan de campagne fut fait. Tout d'abord, elle se fit l'amie de madame de Montespan, et ne redressa la tête que le jour où elle fut certaine de son empire sur le roi.
Quel chef-d'œuvre de patience, d'habileté et d'insinuation que cette victoire de madame Scarron! Détestée du roi d'abord, elle arrive à se faire tolérer comme une servante discrète, puis accepter comme une amie de bon conseil, puis aimer comme une confidente dévouée. Les premiers désastres du règne de Louis XIV lui furent d'un grand secours; elle devint la garde malade de l'orgueil du roi-soleil et pansa les blessures de son amour-propre.
Longtemps avant que sa puissance n'éclatât, on la pressentait à la cour; le roi avait pour elle une inimaginable déférence, et un noël fort répandu lui attribue plus de faveur qu'elle n'en avait encore; un provincial interroge le Messager fidèle qui revient de la Cour.
Que fait le grand Alcandre,
Tandis qu'il est en paix?
N'a-t-il plus le cœur tendre,
N'aimera-t-il jamais?
Le messager répond:
—On ne sait plus qu'en dire,
Et l'on n'ose parler.
Si son grand cœur soupire,
Il sait dissimuler.
—Est-il vrai qu'il s'occupe
Au moins le tiers du jour
Où son cœur est la dupe,
Ainsi que son amour?
—En homme d'habitude,
Il va chez Maintenon
Il est humble, elle est prude,
Il trouve cela bon.
—La superbe maîtresse
En est-elle d'accord?
Voit-elle avec tristesse
La rigueur de son sort?
—L'on dit qu'elle en murmure
Et que sans ses enfants
Elle ferait figure
Avec les mécontents.
Mais le messager fidèle s'abuse en cet endroit; les enfants de madame de Montespan ne sont plus rien pour leur mère, ou plutôt ils l'ont oubliée; la seule mère pour eux est leur gouvernante, l'habile veuve Scarron. Elle les a élevés avec un soin extrême, pour elle, pour ses desseins; elle en a fait de petits saints, dévots convenables, ambitieux, hypocrites, égoïstes surtout. «Le lien entre elle et le roi, image burlesque de l'Amour, est le petit boiteux, le duc du Maine, avorton de malheur, rusé buffon, Scapin fait Tartufe.» Aussi, le jour où madame de Maintenon obtient du roi le renvoi de madame de Montespan, est-ce le duc du Maine, le favori de Louis XIV, qui va annoncer à sa mère la décision du roi; cherchant ainsi, par sa bassesse, à mériter sa grandeur future.
Guidés par madame de Maintenon, encouragés par elle, ces bâtards deviennent une cause de ruine pour la France, de discorde pour la cour, et dans ses dernières années Louis XIV essaie de leur léguer le trône au détriment de ses descendants légitimes.
Souveraine absolue par le départ de madame de Montespan et par la mort de la reine, madame de Maintenon se trouva dans la plus difficile des situations. Tint-elle rigueur à ce monarque inamusable, qu'elle renvoyait toujours affligé, mais jamais désespéré, ou sacrifia-t-elle sa vertu au salut et à la conversion du roi? Cette dernière hypothèse est la plus probable. Au moins chacun était-il convaincu de la défaite de cette dévote austère, défaite imposée peut-être par un directeur; car à tout prix il fallait prévenir le retour de quelque Montespan, et le roi, plus adonné à la table que jamais, n'avait pas un tempérament à supporter les dures privations du cloître.
Sa position à la cour était louche, fâcheuse, peu assurée. Lorsque les dévots et la noblesse eurent besoin de sa voix pour la révocation de l'édit de Nantes, préparée depuis longtemps, et lui promirent en échange de son appui leur approbation à un mariage secret avec Louis XIV, elle n'hésita pas. Et le jour où les dragons se répandirent à travers la France pour prêcher le catéchisme à main armée, l'union du roi-soleil et de la veuve Cul-de-jatte fut décidée.
Ce mariage honteux fut la dernière chute de Louis XIV; à l'exemple des vieux célibataires libertins, il épousa sa servante, secrètement, dans une chapelle de Versailles, avec ses valets de chambre pour témoins, la nuit sans doute, pour dérober sa rougeur aux assistants et pour ne pas voir la leur.
Cette union souleva la réprobation universelle, et le sonnet suivant, parti de trop haut pour qu'on pût songer à punir celui qui l'avait mis en circulation, donne une juste idée de l'opinion de toute la cour:
Que l'Éternel est grand! que sa main est puissante!
Il a comblé de biens mes pénibles travaux.
Je naquis demoiselle et je devins servante;
Je lavai la vaisselle et souffris mille maux.
Je fis plusieurs amants et ne fus point ingrate;
Je me livrai souvent à leurs premiers transports.
À la fin, j'épousai ce fameux cul-de-jatte,
Qui vivait de ses vers comme moi de mon corps.
Mais enfin il mourut, et vieille devenue,
Mes amants sans pitié me laissaient toute nue,
Lorsqu'un héros me crut propre encore aux plaisirs;
Il me parla d'amour, je fis la Madeleine;
Je lui montrai le diable au fort de ses désirs,
Il en eut peur, le lâche!... Et je me trouvai reine.
Reine elle était en effet, mais non heureuse. Garde-malade du plus triste des rois, rivée à la même chaîne, elle expiait cruellement son ambition.
—«Que ne puis-je m'enfuir, disait-elle quelquefois,» et son frère d'Aubigné, qui connaissait bien son caractère, de lui répondre:—«Vous avez donc promesse d'épouser Dieu le père?»
Forcée de renoncer à l'espérance de faire déclarer son mariage, son ambition n'eut plus de but; et, cruellement désabusée, elle dut se contenter de gouverner mystérieusement du coin de sa cheminée. On ne prit plus une décision sans elle; et lorsque Louis XIV avait à trancher quelque lourde difficulté, c'est toujours à elle qu'il s'en rapportait.—«Qu'en pense, lui disait-il, votre solidité?»
Le peuple, qui s'en prenait à elle de tous les désastres, des défaites, du sang, de la ruine, la haïssait à ce point qu'elle n'osait plus se montrer dans Paris; on ne comptait plus les épigrammes blessantes, les noëls injurieux, et la fureur populaire s'en prenait autant au roi qu'à la favorite:
Créole abominable,
Infâme Maintenon,
Quand la Parque implacable
T'enverra chez Pluton,
Oh! jour digne d'envie,
Heureux moment,
S'il en coûte la vie
À ton amant.
Nous n'entreprendrons pas de retracer ici les dernières années du couple royal, nous ne suivrons pas le conseil des ministres chez madame de Maintenon; de ce moment elle appartient à la politique: cette figure de l'amie de Louis XIV est déjà bien sombre pour un livre si léger.
Disons seulement qu'après avoir échoué dans son projet de donner toute la puissance aux bâtards, elle assista impassible à la mort du roi, et se retira ensuite à la maison de Saint-Cyr qu'elle avait fondée.
Fidèle jusqu'au bout à son rôle d'hypocrisie, elle écrivit un livre sur l'éducation des filles, livre dont la morale peut se résumer en deux mots:—la dévotion bien entendue mène à tout.