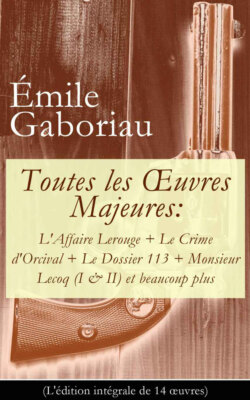Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 31
На сайте Литреса книга снята с продажи.
NOTES:
ОглавлениеTable des matières
[1] L'abbé Le Gendre très-instruit des choses du temps et confident d'Henri de Chauvallon, affirme que Louis XIV «savait à peine lire et écrire.» (Mag. de librairie, 1859.) Ce qu'on appelle la main de Louis XIV est, dit M. Michelet, le bonhomme Rose, son faussaire patenté, dont l'écriture ne peut se distinguer de celle du roi.
[2] Ce mot a été aussi attribué à un fils du maréchal de Villeroy, archevêque de Lyon.
[3] Louis XIV et la révocation de l'édit de Nantes. Paris 1860.
[4] Il est bon de se garder de toute exagération; les dépenses de Versailles n'ont pas été si fantastiques qu'on l'a dit longtemps. Saint-Simon parle de milliards, Mirabeau dit douze cents millions; Volney imagine quatre milliards six cents millions! On peut mettre tout un peuple sur la paille mais non lui prendre ce qu'il n'a pas; «Où il n'y a rien, le roi perd ses droits.» On arrive, pièces en mains, à établir que les dépenses de Versailles représentent environ six cents millions de notre monnaie. C'est déjà monstrueux!
[5] J'ai sous les yeux, en écrivant ce chapitre, le très-remarquable travail de M. Eugène Pelletan, Décadence de la monarchie, «un livre populaire, dit M. Michelet, très-piquant et très-véridique, qui, grâce à Dieu, ira partout et restera.»
[6] M. le baron Walckenaer, Mémoires touchant la vie et les écrits de madame de Sévigné.
[7] Saint-Simon, Mém., t. 1.
[8] Correspondance de Mazarin, t. 1, p. 179, 202.
[9] Le mariage de Louis XIV avec l'Infante donnait à la couronne de France ces fameux droits à la succession d'Espagne dont la poursuite coûta tant d'or et tant de sang, un des faits les plus désastreux de ce règne si fécond en désastres.
[10] Selon l'auteur des Mémoires de madame de Maintenon, «La Vallière, pendant son séjour à la cour de Gaston, avait agréé la main d'un gentilhomme de Normandie, auquel elle avait inspiré une passion sérieuse. Plus tard, à son retour de l'armée, cet officier, ignorant tout ce qui s'était passé en son absence, se rend chez Madame, demande en vain La Vallière, court à l'hôtel qu'elle occupait, ne comprend rien à ce qu'il voit, ne peut parvenir jusqu'à elle, sort la rage dans le cœur. Un ami lui apprend, la vérité sans ménagement.—Tout est perdu pour moi, s'écrie cet amant malheureux; et il se perce de son épée. Celle qu'il avait tant aimée le pleura.»
[11] Un manuscrit français de la Bibliothèque de Saint-Pétersbourg, dont il a été publié en France quelques fragments, trace un portrait infiniment moins flatteur de mademoiselle de La Vallière: «Cette fille est d'une taille médiocre et fort mince, elle marche d'un méchant air à cause qu'elle boite. Elle est blonde, blanche, marquée de la petite vérole; les yeux bruns, les regards languissants et passionnés, et quelquefois aussi pleins de feu, de joie et d'esprit. La bouche grande, assez vermeille, les dents pas belles, point de gorge, les bras plats qui font mal juger du reste du corps.»
[12] Parmi cette masse de pamphlets, plus ou moins injurieux, publiés à l'étranger, il en est qui certainement ont été écrits sous l'inspiration de Louis XIV ou de ses ministres. De ce nombre sont deux ou trois libelles contre Madame, fort injurieux quant à la forme, mais qui au fond la disculpent de cette grave accusation d'avoir trop aimé son beau-frère. Déjà avant «le grand roi,» on avait utilisé les pamphlétaires à l'étranger.
[13] Histoire de la vie et des ouvrages de La Fontaine.
[14] Courart, Mém., t. XLVIII.
[15] Fouquet, Défenses, t. II.
[16] La Fayette, Mém., t. LXIV.
[17] M. le baron Walckenaer, Mém. touchant la vie et les écrits de madame de Sévigné.
[18] L'abbé de Choisy (p. 586) prétend que Louis XIV était venu à Vaux avec cette intention.
[19] M. Michelet, Louis XIV.
[20] 20 décembre 1664, à la majorité de 13 voix contre 9; Journal ms. de d'Ormesson.
[21] Bussy-Rabutin, Discours sur les amours de mademoiselle de La Vallière.
[22] Oeuvres de Louis XIV, Instructions pour le Dauphin.
[23] Lemontey, t. V, p. 144. Les dernières années de Louis XIV montrent où peuvent conduire de tels axiomes. Les lettres de Colbert au roi prouvent que ce grand ministre n'approuvait pas cette façon ingénieuse et facile d'enrichir un peuple.
[24] Le justaucorps à brevet était une casaque bleue, brodée d'or et d'argent, semblable à celle que le roi portait lui-même. Il était un indice de faveur et nullement une récompense de services rendus. Ce fameux justaucorps donnait le droit de suivre le roi dans ses chasses et dans ses promenades à la campagne. Pour se parer de cette livrée, il fallait une autorisation spéciale ou brevet; de là le nom.
[25] Description du Carrousel de 1762. Bibl. impér.—Collection des gravures.
[26] Mémoires touchant les écrits de madame de Sévigné, 2e partie, p. 466.
[27] La Fayette, t. I et IV, p. 407.—Montpensier, Mémoires, t. XL, p. 174 et suiv.—Motteville, Mémoires.—Mémoires de Grammont, t. I.
[28] Revue rétrospective (juillet 1834). Extraits d'un manuscrit de Colbert intitulé: Journal fait par chacune semaine, de ce qui peut servir à l'histoire du roi, du 14 avril 1663 au 9 janvier 1665. On voit là le grand ministre présidant à deux accouchements de mademoiselle de La Vallière.
[29] Avec un roi comme Louis XIV, la garde des filles d'honneur devenant impossible, madame de Navailles eut l'héroïque courage de prendre sa retraite plutôt que de favoriser les amours du roi. Madame de Montausier, en lui succédant, prenait l'engagement tacite de fermer les yeux à propos; de ce moment, en effet, les entrevues du roi et de mademoiselle de La Vallière furent singulièrement facilitées.
[30] Ce nom de Dieudonné qu'avait reçu Louis XIV lors de sa naissance, trop inattendue pour ne pas être un peu miraculeuse, revient dans toutes les épigrammes du temps:
Ce roi, si grand, si fortuné,
Plus sage que César, plus vaillant qu'Alexandre,
On dit que Dieu nous l'a donné,
Hélas! s'il voulait le reprendre!
[31] Louis XIV, dans ses Mémoires (année 1667), prend la peine d'expliquer ainsi à la postérité «cet acte de sa toute-puissance.» «N'allant pas à l'armée, dit-il, pour être éloigné de tous les périls, je crus qu'il était juste d'assurer à cet enfant l'honneur de sa naissance, et de donner à la mère un établissement convenable à l'affection que j'avais pour elle depuis six ans.»
[32] «Le monument de cette agréable campagne est notre porte Saint-Martin, quoique datée d'une autre époque.» (M. Michelet, Louis XIV.)
[33] Mélanges historiques de la princesse de Bavière. Cette simple affectation de la princesse à donner toujours à La Vallière son titre de duchesse, tandis qu'elle appelle l'autre la Montespan, n'exprime-t-elle pas bien mieux son indignation que de longues tirades?
[34] Sévigné, Lettres, 12 février 1671.
[35] Sévigné, Lettres, 18 février 1671.
[36] Mém. de Mademoiselle.
[37] Oeuvres de Bussy-Rabutin.
[38] Amours du roi et de la marquise de Montespan.
[39] Correspondance de madame de Maintenon. Cette lettre est du 24 mars 1670; on n'en a pas l'autographe; elle est seulement citée par La Beaumelle, et M. le duc de Noailles, panégyriste déterminé de madame de Maintenon, ne semble pas la révoquer en doute.
[40] Les Maîtresses du Régent, 1 vol. in-18, E. Dentu, édit. 1860.
[41] Histoire-musée de la République Française, par Augustin Challamel, t. II, p. 14.
Imprimé par Charles Noblet, rue Soufflot, 18.