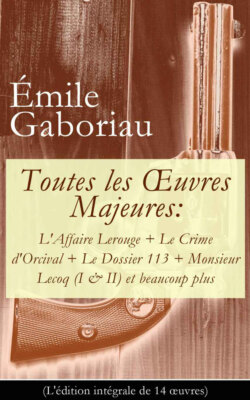Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 21
II PREMIÈRES AMOURS.
ОглавлениеÉlevé par une mère galante, sur les genoux des belles dames de la Fronde, sous les yeux d'un ministre qui pour l'éloigner des affaires favorisait tous ses penchants, Louis XIV, doué d'un tempérament de feu, fit pressentir dès son enfance qu'il marcherait glorieusement sur les traces de son aïeul Henri IV de galante mémoire.
Jeune, beau, élégant, Louis «avait tout ce qu'il faut pour réussir près des femmes,» et à tous ces dons de la nature il joignait «des grâces exquises» et une galanterie raffinée qu'il devait à madame de Choisy, son précepteur en belles manières.
La comtesse de Choisy, dont le mari était chancelier dans la maison de Monsieur, avait entrepris de faire du jeune roi ce qu'on appelait alors un honnête homme, c'est-à-dire un cavalier accompli. Cette femme d'esprit, «déjà sur le retour, possédait toutes les grâces de la politesse et du bon ton, toute la science du savoir-vivre, toutes les perfections d'une précieuse du beau temps de l'hôtel Rambouillet[6],» le jeune roi ne pouvait aller à meilleure école. L'élève fit honneur à son institutrice, et plus tard, il récompensa d'une pension de huit mille livres des leçons qui avaient fait de lui le gentilhomme le plus accompli de son royaume.
Les Mémoires du temps ont retenu les premiers bégaiements du cœur du jeune monarque, et nous savons les moindres détails de ses premières inclinations, badinages galants et enfantins, sans portée et sans conséquence. Tour à tour il sembla s'attacher à la duchesse de Châtillon, à Élisabeth de Ternau et enfin à Olympia Mancini, une des trop nombreuses nièces du cardinal Mazarin, et qui avait été la compagne de ses premiers jeux. Olympia, dangereuse Italienne, «âme et visage noirs,» fut mariée au duc de Soissons. On la retrouve à la tête de toutes les cabales organisées pour perdre Madame.
Une fille d'atours de la reine-mère, mademoiselle de La Mothe d'Argencourt, inspira à Louis XIV sa première passion sérieuse.
Cette jeune fille, que quelques mémoires nous peignent comme n'étant ni fort belle ni très-spirituelle, était en réalité d'une éclatante beauté. Elle avait de merveilleux cheveux blonds d'une richesse extrême, de grands yeux bleus pleins de feu, et, par une singularité piquante qui donnait quelque chose de saisissant à sa physionomie, des sourcils d'un noir d'ébène admirablement arqués. Avec cela une peau éblouissante de blancheur, des traits fins et réguliers, et «une taille à tenir dans une bague.»
Bientôt l'amour du jeune roi ne fut un secret pour personne. C'était son premier amour; ses regards, ses gestes, ses moindres actions le trahissaient, malgré toute sa naïve dissimulation, en dépit de toute la diplomatie si gauche et si charmante de son adolescence.
Il recherchait avec empressement tous les moyens de se rencontrer avec son amie, savait trouver des prétextes qu'il croyait habiles, et paraissait transporté de voir sa passion payée du plus tendre retour.
Mais Mazarin et la reine-mère, jaloux du pouvoir que leur laissait le jeune roi, veillaient avec sollicitude. Ils comprirent le danger. Une maîtresse pouvait prendre une terrible influence sur le royal adolescent; d'ailleurs ils entrevoyaient dans l'ombre toute la famille de mademoiselle d'Argencourt, impatiente de profiter de l'ascendant de la jeune favorite.
Anne d'Autriche résolut d'éloigner son fils. Louis était fort dévot; elle éveilla les susceptibilités de sa conscience, l'effraya de l'horrible péché qu'il allait commettre, et finit par le décider à fuir le danger. L'amant désolé de la belle d'Argencourt quitta donc Saint-Germain, et se réfugia à Vincennes près du cardinal Mazarin.
Cette éclipse du roi déconcerta si fort les belles espérances caressées par les parents de la jeune personne, «que madame d'Argencourt, qui croyait tout perdu, alla jusqu'à faire avertir la reine, que si elle le désirait elle consentirait aux relations de Louis et de sa fille, et cela sans condition.» Anne d'Autriche refusa cette offre obligeante.
Le jeune roi, arrivé à Vincennes, s'était mis en retraite sous la direction d'un confesseur choisi par le cardinal. Quinze jours durant, il pria, pleura, jeûna, se mortifia, se confessa, communia, et enfin se croyant complétement guéri, ou tout au moins en bonne voie de guérison, il revint à la cour. Il se défiait pourtant encore de son cœur, et, pour ne pas s'exposer à une rechute, il mit tous ses soins à éviter autant que possible sa charmante amie.
Cette affectation même à la fuir convainquit mademoiselle d'Argencourt qu'elle était toujours aimée, et, en fille bien instruite, elle fit naître cette occasion que redoutait le roi. L'occasion vint; la rechute fut complète.
En se trouvant près de celle qu'il aimait, Louis oublia toutes les remontrances maternelles, les pieuses exhortations de son directeur, les belles résolutions s'envolèrent: il se troubla, balbutia, rougit, et pour dissimuler sa rougeur, sans doute, cacha son front dans les belles mains de son amie.
Anne d'Autriche, à son tour, perdit tout espoir; elle avait lu dans les yeux de son fils une passion si grande, une résolution si énergique, que, renonçant à entraver cet amour, elle ne songea plus qu'à en tirer tout le parti possible et à s'arranger avec la grandeur future de cette favorite.
Malheureusement pour mademoiselle d'Argencourt, Mazarin n'avait pas dit son dernier mot. Beaucoup moins convaincu que la reine mère de l'efficacité d'une retraite, il avait cherché quelque autre moyen plus humain pour rompre ce grand amour, et il n'avait pas tardé à trouver.
Le cardinal, tandis que Louis était à Vincennes, avait mis en campagne trois ou quatre de ses plus habiles espions, et le résultat de cette enquête avait été de lui apprendre que mademoiselle d'Argencourt n'en était pas à faire ses premières armes. Un amant la vengeait de la timidité du royal néophyte, et, pour trouver la force de résister à la passion du roi, elle retrempait sa vertu entre les bras de Chamarante, le plus bel homme de la cour. Elle poussait même l'imprudence jusqu'à écrire les lettres les plus passionnées à ce favori de son cœur.
Fort de cette découverte, Mazarin manda le beau Chamarante, et lui fit comprendre qu'il donnerait un bon prix de cette correspondance amoureuse. Chamarante eut la lâcheté de trahir celle qui l'avait aimé, et, moyennant finance, la tendre prose de mademoiselle d'Argencourt passa aux mains du ministre.
Ces doux billets, le cardinal les avait précieusement conservés. Voyant que désormais le roi, emporté par la passion, n'écouterait aucune remontrance, il lui demanda un entretien.
Louis s'attendait à de longues exhortations, à une explication presque orageuse et, conseillé par sa charmante maîtresse, il s'était muni de tout son courage pour résister ouvertement et déclarer qu'il entendait être le maître. Peine perdue! le ministre parut. Calme et presque souriant, il ne dit pas un mot de mademoiselle d'Argencourt. Seulement, après quelques banalités générales sur la perfidie des femmes et sur le malheur des souverains qui sont si rarement aimés pour eux-mêmes, il tira de son sein les fameuses lettres, et les présentant au roi:
—Que Votre Majesté, dit-il, daigne prendre la peine de lire cette correspondance, elle lui en apprendra plus que je ne saurais lui en dire.
Les preuves étaient accablantes, le doute n'était pas possible: Louis fut accablé, son orgueil naissant recevait là un rude choc. Il pleura de dépit et de rage, mais il eut la force de dissimuler sa colère. Il ne témoigna plus qu'un dédain glacial à sa perfide et refusa d'avoir avec elle aucune explication.
Déchue de ses espérances, outrée de la conduite de Chamarante, brouillée avec sa famille, qui lui reprochait bien moins son amant que sa maladresse, mademoiselle d'Argencourt ne songea plus qu'à chercher une consolation. Elle s'éprit d'une passion folle pour le marquis de Richelieu.
Cette liaison fit tant de bruit et de scandale que la marquise de Richelieu vint se jeter aux pieds de la reine-mère pour la conjurer d'éloigner mademoiselle d'Argencourt, et que l'on conseilla l'air du cloître à la trop sensible jeune fille.
Elle se réfugia dans un de ces charmants couvents où les grandes dames dépitées allaient alors passer leurs accès de dévotion. Elle s'y trouva si bien qu'elle n'en voulut plus sortir et y passa sa vie, sans jamais cependant prononcer ses vœux. Plus tard Louis XIV paya pour elle une dot de vingt mille écus.
Refroidi par ce premier naufrage, le jeune roi hésitait à se rembarquer sur le fleuve du Tendre, lorsqu'il tomba aux mains de madame de Beauvais, la femme de chambre favorite d'Anne d'Autriche.
La Beauvais, pour parler comme les Mémoires, avait depuis longtemps déjà doublé le cap de la quarantaine lorsqu'elle mit son expérience au service de Louis.
Laide, borgne, ridée comme pomme en avril, l'affreuse vieille avait depuis plusieurs années jeté son dévolu sur le jeune roi. Elle guettait l'âge de sa puberté, sachant bien qu'alors le tempérament parle plus haut que le cœur, décidée à profiter de la première surprise et à en tirer parti pour l'élévation de sa famille. Son plan réussit à merveille.
La flamme de l'œil unique de la Beauvais alluma les sens du royal jouvenceau, et bientôt il n'eut plus rien à lui refuser. Mais l'enivrement fut de courte durée. Adresse et séductions échouèrent, l'élève s'échappa tout fier de son expérience nouvelle, impatient d'en tirer parti.
Les bons offices de la Beauvais eurent cependant leur récompense, on lui fit don de la seigneurie de Chantilly, et sa famille fut toujours protégée[7]. «Le roi, dit l'abbé de Choisi, ne perdit pas la mémoire de l'autel de ses premiers sacrifices.»
La Beauvais continua jusqu'à sa mort de rester à la cour, et on lit dans les Mémoires de la princesse Palatine: «J'ai vu encore cette vieille créature de Beauvais; elle a vécu quelques années depuis que je suis en France. C'est elle qui, la première apprit au feu roi ce qu'il a si bien pratiqué auprès des femmes. Cette affreuse borgne s'entendait fort bien à faire des élèves.»
Tout frais émancipé après ce premier amour borgne, le jeune Louis n'osa pas tout d'abord s'adresser aux grandes dames qui formaient la cour d'Anne d'Autriche. Peut-être était-il retenu par la crainte de sa mère, peut-être ne savait-il pas encore qu'un roi trouve bien rarement des cruelles. Au grand dépit de toutes celles qui si volontiers eussent accepté le mouchoir, il se contentait d'égarer son cœur dans les cuisines et dans les antichambres.
«Le feu roi, dit la Palatine, a été très galant assurément, mais il est allé souvent plus loin que la débauche. Tout lui était bon en sa jeunesse: paysannes, filles de jardinier, servantes, femmes de chambre, pourvu qu'elles fissent semblant de l'aimer.»
Beaucoup faisaient semblant, et les passions du jeune roi s'en arrangeaient à merveille. Il ne résulta rien de toutes ces liaisons obscures, rien qu'un enfant, une fille qui était, assure Saint-Simon, son portrait vivant. Il l'avait eue d'une jeune et fraîche jardinière de Saint-Germain. L'obscurité de la mère empêcha le roi de reconnaître l'enfant, mais il assura son avenir et la maria honorablement.
Nous sommes ici à l'époque des fredaines amoureuses du grand roi. Saint-Germain était le théâtre de ses exploits. À chaque instant il échappait à la surveillance de sa mère, et madame de Navailles, préposée à la garde de la vertu fragile des filles d'honneur, avait toutes les peines du monde à empêcher le loup de faire invasion dans la bergerie.
Il était temps cependant qu'un amour noble et élevé vînt mettre un terme à ces emportements de jeunesse et arrêter Louis sur la pente glissante de la débauche vulgaire: une des nièces du cardinal Mazarin se trouva là fort à propos pour accomplir cette œuvre.
Marie Mancini, qui n'était qu'un enfant lorsque déjà le roi courtisait sa sœur Olympia, était sortie du couvent et avait fait son apparition à la cour depuis un an environ.
C'était lorsqu'elle arriva se joindre à l'escadron des nièces du cardinal, des Mazarines, comme on disait alors, «une grande fille maigre, avec de longs bras rouges, un long cou, un teint brun et jaune, une grande bouche, mais de belles dents et de grands yeux noirs, beaux et pleins de feu.» Louis, bien qu'il préférât Marie à son autre sœur Hortense, une des plus belles personnes de son temps, fit fort peu d'attention à la nouvelle venue, et la regarda à peine.
Plusieurs mois seulement après, un entretien que le roi eut avec Marie commença le charme. Ces quelques mois, il est vrai, avaient profité à la jeune fille: elle avait gagné l'embonpoint qui lui manquait, sa taille gauche s'était assouplie, son teint s'était coloré, enfin ses grands yeux noirs, profonds et passionnés, donnaient un rare et singulier attrait à sa physionomie.
Elle regagnait d'ailleurs du côté de l'esprit ce qui lui manquait en beauté. Vive, spirituelle, railleuse, sa conversation brillante éblouit le roi, très-flatté en secret du soin que prenait de lui plaire une personne si accomplie.
Aussi hardie qu'ambitieuse, Marie profita en fille habile de ses premiers avantages, chaque jour plus avant elle enfonçait le trait dans le cœur de Louis, et bientôt il en vint à ne pouvoir plus se passer d'elle.
Prévoyant avec une perspicacité rare à son âge que la timidité d'un prince à peine sorti de tutelle, était ce qu'elle avait le plus à redouter, elle ne négligeait aucun moyen pour exalter le courage de Louis et faire passer dans son âme un peu de cette audace aventureuse qui animait la sienne.
Dans les longues après-midi qu'il passait à ses genoux, elle lui lisait des poésies passionnées ou des romans de chevalerie aux merveilleux exploits, agissant ainsi tout à la fois sur son imagination et sur son cœur.
Mais déjà son ascendant était immense. Puisant dans la violence de son amour une hardiesse qui lui eût semblé impossible quelques mois auparavant, Louis osa aimer Marie Mancini à la face de la cour, sous les yeux de sa mère et du cardinal Mazarin.
Alors, il lui accordait une préférence marquée; au bal c'est à elle la première qu'il offrait toujours la main; il affectait de s'entretenir tout bas avec elle, il la consultait sur tous ses projets, même sur les affaires de l'État. Enfin pour passer seul avec elle, ne fût-ce qu'une minute, il n'est pas de prétextes et d'expédients qu'il n'employât.
Un jour Marie Mancini sortait de chez la reine-mère, elle était seule dans son carrosse, «Louis monta sur le siége et lui servit de cocher jusqu'à ce que la voiture ne fût plus en vue; alors il y entra et vint se placer à côté d'elle.»
La cour s'agitait, l'Europe s'était émue. Une favorite pouvait inaugurer une politique nouvelle, et nul ne doutait que Marie Mancini ne fût bientôt maîtresse déclarée du roi. Mais l'ambitieuse visait bien autre chose. Elle rêvait un mariage et le titre de reine.
Ce projet n'était pas une chimère. «Cette sombre Italienne, aux grands yeux flamboyants avec un esprit infernal et l'énergie du bas peuple de Rome, avait un instant enveloppé le froid Louis XIV d'un tourbillon de passion.» Il était bien à elle corps et âme.
Bientôt on parla tout bas à la cour de la possibilité de cette union, mais non si bas que l'écho de ces propos ne vînt aux oreilles d'Anne d'Autriche. Elle fut saisie d'effroi. Un instant elle crut que Mazarin, ébloui par cette perspective de placer une de ses nièces sur le trône, était d'accord avec sa nièce, et dans son horreur «d'un mariage aussi monstrueux,» elle fit rédiger une protestation.
Plutôt que de souffrir une pareille infamie, disait-elle, je ferais un appel à la noblesse, j'armerais mon second fils contre son frère, et moi-même, à la tête de l'armée, je marcherais contre le roi.
Mais cette protestation était inutile. La reine-mère suspectait à tort les intentions du cardinal. Le ministre ne rêvait qu'une chose, l'alliance espagnole; et tandis qu'on l'accusait de traîner en longueur les dernières formalités du mariage de Louis XIV avec une princesse de Savoie, des agents habiles négociaient à Madrid et obtenaient du cabinet de l'Escurial la paix et la main de l'infante.
Pressé par son amante, le jeune roi avait osé déclarer au cardinal qu'il était résolu à faire mademoiselle Mancini reine de France.
—Moi vivant, avait répondu le ministre, jamais ce mariage n'aura lieu; je poignarderais plutôt ma nièce de ma propre main.
Ce qui diminue peut-être un peu le mérite du cardinal, c'est que depuis longtemps il avait pénétré l'ingratitude de sa nièce. Marie n'avait en effet usé de son ascendant que pour tâcher de perdre Mazarin, à qui elle devait tout, dans l'esprit du roi.
Et pourtant le moment approchait où Louis XIV allait avoir à prendre un parti. On avait rompu les projets de mariage avec la princesse de Savoie, et l'Espagne se décidait à offrir son infante. L'amour du roi pour Marie paraissait désormais le seul obstacle sérieux, et toute la cour suivait avec anxiété les phases diverses de cette grande passion, qui donnait aux combinaisons politiques d'ordinaire si froides tout l'intérêt d'un drame.
Qui l'emporterait dans le cœur du jeune prince, de la raison d'État ou de l'amour? Hélas! le parti de la sagesse eut raison.
Marie Mancini reçut l'ordre de quitter la cour et d'aller attendre à la Rochelle et au Brouage la fin des négociations avec l'Espagne. Louis XIV n'osa pas s'opposer au départ de son amie.
Les adieux des deux amants furent déchirants. Louis tout en pleurs conduisit son amie jusqu'au carrosse qui devait l'emmener bien loin de lui, et c'est alors que la jeune fille lui adressa ces paroles si souvent citées:—«Vous êtes roi, vous pleurez, et je pars!...»
À ces mots les larmes du roi redoublèrent, mais il n'osa pas révoquer l'ordre qu'avait donné le cardinal. Marie eût résisté, Louis céda.
Les deux amants n'eurent plus qu'une entrevue avant le mariage du roi. Comme la cour se rendait à Bordeaux pour attendre la fin des négociations, Marie Mancini eut la permission de venir saluer la reine-mère à son passage à Saint-Jean-d'Angely. C'était le seul moyen d'empêcher le roi de se détourner de son chemin pour aller voir son amie et d'éviter un scandale.
Cette entrevue raviva les espérances de l'orgueilleuse jeune fille et exalta si bien l'amour du roi que Mazarin, sérieusement inquiet, écrivit au roi pour le menacer de quitter la France avec ses nièces: «Aucune puissance humaine, disait-il, ne saurait m'ôter la libre disposition que Dieu et les lois m'ont donnée sur ma famille.»
Cette lettre du cardinal peint Marie sous les couleurs les plus sombres, il la traite d'extravagante, d'ingrate, d'ambitieuse, incapable d'aimer personne.
«Songez, je vous prie, écrivait-il au roi, s'il y a au monde un homme plus malheureux que moi, qui, après m'être appliqué avec ardeur à procurer par toutes les voies les plus pénibles, la gloire de vos armes, le repos de vos peuples et le bien de votre État, ai le déplaisir de voir qu'une personne qui m'appartient est sur le point de renverser tout et de causer votre ruine!...[8]»
Ces lettres ne servirent qu'à irriter la passion du roi. Les obstacles semblaient exalter son courage et l'affermir dans ses résolutions. Il menaçait de rompre les négociations avec l'Espagne, si avancées qu'elles fussent, et d'épouser, envers et contre tous, celle qui l'aimait et qui seule, disait-il, pouvait assurer le bonheur de sa vie, lorsque la jeune fille prit une résolution aussi héroïque qu'inattendue et trancha d'elle-même les difficultés de la situation.
Marie Mancini eut le courage de s'arracher à son beau rêve; elle cessa toute correspondance avec le roi et annonça qu'elle était décidée à ne le revoir jamais. «Action telle, écrit Mazarin, qui peut-être par ses intimidations avait contribué à la résolution de Marie, action telle qu'il eût été malaisé d'en attendre une semblable, d'une personne de quarante ans qui eût été nourrie toute sa vie avec des philosophes.»
Ainsi se termina ce roman d'amour, épisode important de la vie de Louis XIV.... Avec «moins de bons sens précoce, de sagesse et de politique,» il eût épousé Marie Mancini; et alors que de malheurs épargnés, à la France[9]!
Abandonné à ses propres forces, le jeune roi ne résista plus et, le 9 juin 1660, on célébra, à Saint-Jean-de-Luz, son mariage avec l'infante d'Espagne Marie-Thérèse. Après douze jours d'une marche triomphale à travers la France, le royal couple fit son entrée à Paris au milieu des acclamations d'un peuple qui dans cette union ne voyait que l'assurance d'une paix durable.
Marie-Thérèse avait du premier jour déplu au roi, elle était petite, replète, fort rouge, presque naine, et la passion admirative qu'elle eut toute sa vie pour son mari ne fut jamais payée de retour.
Louis XIV n'eut même pas pour elle les égards qu'il devait à sa femme légitime, à la reine. Presque au lendemain des noces, il déserta son salon pour aller chercher ailleurs de galantes distractions.
Lorsque plus tard la reine, entourée des maîtresses au milieu desquelles vivait le roi de France comme Bajazet dans son sérail, osa élever la voix et se plaindre de l'indignité de ces relations de chaque jour, le roi lui répondit aigrement:
—De quoi vous plaignez-vous, madame, n'ai-je pas toujours partagé votre lit?
Après comme avant le mariage, la question restait la même: quelle serait la reine de fait? d'où soufflerait désormais la faveur? On était fort indécis, et les courtisans les plus habiles s'abstenaient, ne sachant de quel côté encore tourner leurs adorations.
Le salon favori du roi était alors celui de la comtesse de Soissons, cette même Olympia Mancini, l'une des inclinations enfantines de Louis. Il était fort assidu chez elle, et les plus médisants assuraient que la comtesse, pour s'attacher le prince, n'avait pas reculé devant l'adultère.
Nulle influence ne pouvait être plus fâcheuse que celle de madame de Soissons, et cependant le roi semblait chaque jour s'attacher davantage à elle, lorsque l'arrivée d'Henriette d'Angleterre vint rendre inutiles toutes les séductions d'Olympia. Dès lors le charme fut rompu, le roi ne garda plus rien de son ancien faible pour la comtesse, et même il chargea de Vardes, son favori, de l'en débarrasser en se déclarant son galant.
Henriette d'Angleterre, dont l'arrivée à la cour de France marque l'aurore d'une ère nouvelle, était fille de la charmante et trop galante Henriette de France, et de Charles Ier, ce prince infortuné qui expia si cruellement ses fautes sur l'échafaud.
Nulle vie ne fut plus terriblement agitée que la sienne. Elle était le gage de la dernière réconciliation de Charles Ier fugitif et de sa trop infidèle épouse. «Née d'une larme et d'un baiser d'adieu,» elle vint au monde au milieu des horreurs d'un siége, sous le canon de l'ennemi.
L'épouse de Charles Ier eut le bonheur d'échapper aux puritains, elle s'enfuit entraînant ses enfants, appuyée sur le bras de son amant, ce bel Anglais qu'elle épousa plus tard.
Les fugitifs purent gagner la France, ils y trouvèrent un asile, mais non du pain; ils avaient un appartement au Louvre, mais l'hiver ils manquaient de bois et restaient au lit faute de feu.
La petite Henriette avait cinq ans lorsque son père fut décapité en Angleterre. Nul alors ne se souciait d'elle. On la laissait aux mains des femmes de chambre. Elle avait sous les yeux de déplorables exemples, le ménage illégitime et sans cesse troublé par des querelles de sa mère et de son amant. Personne près d'elle pour éveiller en ce jeune cœur le sens moral.
Plus tard, elle fut mise au couvent mondain de Chaillot, dirigé par mademoiselle de La Fayette, cet asile aimable «dont le galant parloir était un foyer d'intrigues politiques.»
Rien n'annonçait encore ce qu'elle serait à dix-huit ans; elle était maigre et n'avait d'autre attrait qu'une grâce sauvage que l'on ne comprenait guère alors.
Louis XIV la voyait quelquefois, les jours où on l'amenait à la cour pour essayer de la distraire un peu, mais il n'avait pour elle aucun penchant.
—J'ai peu d'appétit, disait-il, pour les petits os des saints innocents.
Mot cruel, bien digne, de ce prodigieux égoïste.
Henriette, suivit en Angleterre son frère Charles II, le jour où un serment qu'il ne tint guère lui rendit le trône de ses aïeux, et elle commençait à faire le charme de la cour d'Angleterre, lorsque, son mariage avec Monsieur, frère de Louis XIV, fut décidé.
Les passions qu'elle devait inspirer commencèrent sur le vaisseau même qui l'amenait en France; pour elle, Buckingham, ce fils séduisant de l'amant d'Anne d'Autriche, et l'amiral faillirent mettre l'épée à la main. On eut une tempête horrible, et la frêle et souffrante Henriette, cette ombre d'une ombre, cette fleur sortie du tombeau, faillit mourir.
Enfin, on la maria, et de ce jour datèrent ses plus cruels malheurs.
Monsieur était bien fait pour inspirer à une femme la répulsion et l'horreur instinctive qu'Henriette ressentit pour lui.
Élevé en jupons jusqu'à l'âge de dix-sept ans, Monsieur était une véritable fille, dans toutes les acceptions de ce mot. Il passait toutes ses journées à se parer et à se farder, avec trois ou quatre favoris «qui partageaient ses goûts, ou faisaient semblant pour lui plaire.»
Dès le lendemain les querelles les plus immorales divisèrent, ce ménage. Monsieur était jaloux de sa femme. Mais jaloux, entendons-nous, non parce qu'elle pouvait avoir des amants, mais parce qu'il craignait qu'elle ne lui enlevât le cœur de quelqu'un de ses favoris.
L'amour du roi pour Madame vint bientôt envenimer ces querelles et leur donner un éclat étrangement scandaleux.
Louis XIV s'éprit d'une passion violente pour l'épouse de son frère, pour cette femme charmante qu'il avait tant méprisée enfant, et il garda si peu de mesure que toute l'Europe en fut bientôt informée, et que tout bas, à la cour, on murmura ce mot terrible: Inceste.
Madame, il faut le dire, était digne de tous les amours, de toutes les adorations. Frêle et pâle, elle ressemblait à son père, le décapité; sa langueur maladive avait des grâces indicibles; un feu terrible, le feu de la fièvre éclatait dans ses grands yeux; enfin elle avait en elle cet attrait irrésistible de ceux qui ne doivent pas vivre.
Mais son âme avait une grandeur instinctive, une naïve générosité que la dépravation des deux cours les plus licencieuses de l'Europe ne put lui faire perdre. Dévouée jusqu'à la plus absolue abnégation, elle se sacrifia toujours pour ceux qu'elle aimait, et l'idée d'être utile à son frère qui avait besoin du secours de la France contribua sans nul doute à lui faire supporter les terribles assiduités de Louis XIV.
Il n'y a qu'une voix sur madame Henriette, tous l'aiment, tous l'admirent, et les nobles amitiés qu'elle inspira la défendront toujours et l'absoudront en quelque sorte des graves accusations qui pèsent sur elle.
Elle aima et ne sut pas toujours se défendre, elle-même l'avoue dans ses courageux Mémoires, qu'il faut longtemps étudier pour les comprendre, parce qu'ils ne disent rien, et cependant laissent tout deviner.
La cour était à Fontainebleau, lorsqu'éclata l'amour de Louis XIV pour sa belle-sœur. Le roi avait trouvé d'excellentes raisons pour laisser de côté ce que l'étiquette avait de plus gênant, et chaque jour, isolé par le respect, il pouvait se trouver seul avec madame Henriette.
C'étaient alors de longues promenades solitaires sous les ombrages les plus mystérieux de la forêt, promenades qui souvent duraient jusqu'au jour, et de longs tête à tête, que les fêtes de chaque jour ne pouvaient interrompre.
L'ascendant de Madame sur Louis XIV fut très-grand et très-réel, la passion que le roi ressentait pour elle, souvent contrariée, eut des intermittences, mais ne se démentit jamais, même aux jours de brouilles les plus graves, et par trois fois Henriette ressaisit une influence qu'elle eût pu toujours conserver, si elle l'eût voulu.
Il serait imprudent de soulever le voile transparent qu'on est convenu de jeter sur les relations de Madame et du roi de France, les chroniques n'ont que des insinuations et les Mémoires n'osent se prononcer.
Mais ce n'est pas au roi que doit revenir l'honneur de la demi-obscurité qui entoure ces amours. La pudeur, la honte et la morale étaient étrangères à Louis XIV. Et si fantaisie lui en eût pris, l'homme qui glorifia l'adultère eût également, et avec le même succès, glorifié l'inceste.