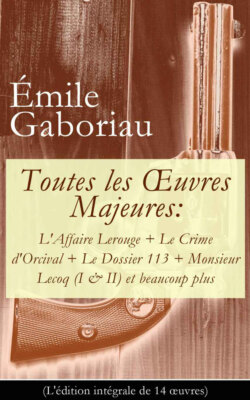Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IV MADAME DE CHATEAUBRIANT.
ОглавлениеTable des matières
Marié jeune encore, et lorsqu'il n'était que duc d'Angoulême, à la fille d'Anne de Bretagne, la faible et douce Claude, François Ier ne tarda pas à devenir un époux infidèle. Il n'attendit même pas pour délaisser sa femme, la fin de la lune de miel.
Peu scrupuleux dans le choix de ses «amies,» il aimait, à la fois, en haut et en bas lieu, ne rougissant pas «de partager avec les domestiques de sa maison les faveurs de quelque dame.»
—Notre maître, disait un gentilhomme de François Ier, a eu quelques bonnes fortunes et beaucoup de mauvaises.
C'est tout à fait l'opinion de Brantôme, mais le vieux seigneur de Bourdeilles s'exprime d'une façon bien autrement énergique.
Lorsque Charles VII, profitant des rares heures de répit que lui laissait l'Anglais, courait aux genoux d'Agnès Sorel, il y avait quelque chose de désintéressé et de chevaleresque dans cette folle tendresse d'un roi, malheureux et sans couronne, pour une belle fille de Touraine.
Agnès disait à son royal amant:
—Assez de temps avez perdu à faire l'amour, mon cher Sire, tirez l'épée derechef, chassez l'Anglais et reprenez votre royaume.
Et, docile aux conseils de la dame de beauté, Charles VII quittait à regret le manoir de sa mie et se mettait à la tête de ses troupes.
Rien de pareil dans les nombreuses passions de François 1er.
—Il était si fort chevalier, dit un vieux critique, qu'il lui fallait à la fois plusieurs dames dont il entremêlait les couleurs.
On perdrait son temps, en effet, à compter les liaisons passagères du roi-chevalier, et la liste de ses maîtresses était déjà bien longue lorsqu'il monta sur le trône.
La troisième épouse du bon roi Louis XII, la belle et frivole Marie d'Angleterre, soeur du roi Henri VIII, fut la dernière passion du duc d'Angoulême.
Mais cette fois, et ce fut peut-être la seule, l'ambition et l'intérêt arrêtèrent un prince qui sacrifia toujours tout à son plaisir.
Louis XII, déjà vieux et épuisé, s'en allait mourant, et comme il n'avait pas d'enfants, sa jeune veuve allait être contrainte, à sa mort, de quitter le trône, et la France peut-être, ce plaisant pays, pour aller tristement finir ses jours de l'autre côté de la Manche, au pays de la brume.
«Mais, si par adventure, de son mari ou de quelqu'autre plus jeune, un fils lui survenait, ce fils, au détriment du duc François, hériterait de la couronne; elle serait régente alors, et jouirait de tous les priviléges de ce beau titre pendant de longues années de minorité.»
La belle Anglaise avait peut-être calculé toutes ces éventualités, lorsque, pour la première fois, il lui fut impossible de ne pas s'apercevoir de l'amour du jeune et séduisant duc d'Angoulême.
Elle se montra fort sensible, «plus qu'il ne convenait,» aux empressements de l'héritier du trône. Ils étaient jeunes tous les deux, aimables, amoureux, le dénoûment de cette intrigue ne devait pas se faire attendre, lorsque tous les intérêts compromis vinrent se jeter à la traverse.
Un gentilhomme périgourdin, le sieur de Grignaux, découvrit, le premier, le gentil roman de la reine. Il prévint en toute hâte la mère de François, qui le chargea de désenchanter le jeune prince, en lui faisant apercevoir un calcul habile là où il ne croyait voir que de l'amour. Madame d'Angoulême se réservait de brusquer une rupture si les avertissements d'un ami ne suffisaient pas.
—Pasque-Dieu! Monseigneur, dit à François le prudent de Grignaux, voulez-vous toujours être simple duc d'Angoulême et jamais roi de France!
Et comme l'amoureux François feignait de ne pas comprendre:
—Jour de Dieu! continua l'excellent donneur d'avis, gardez-vous, monseigneur, des caresses de la reine; vous jouez là à vous donner un maître, un accident est tôt arrivé: êtes-vous si pressé de vous faire un roi?
Le jeune prince ne fit que rire des avertissements de Grignaux.
—J'aime autant, répondit-il, voir régner mes enfants que de régner moi-même.
Et il continua d'entourer de ses galantes prévenances la reine Marie, qui l'accueillait et lui faisait fête d'une façon vraiment inquiétante pour l'honneur du vieux roi, et si ouvertement que chacun à la cour s'en apercevait.
C'est alors qu'intervinrent Louise de Savoie et Claude de France, la mère et la femme du jeune prince.
Leurs exhortations réveillèrent l'ambition dans le coeur de l'héritier de la couronne; ses yeux se dessillèrent, l'illusion s'envola.
Il avait été l'amant de Marie, il devint presque son espion, tant il craignait de voir un autre que lui se charger du soin de donner un fils à Louis XII.
La reine était devenue l'objet d'une surveillance incommode pour ses goûts, lorsque la mort du roi la délivra de tous ces argus intéressés; elle épousa le duc de Suffolk, son ancien amant, qui l'avait suivie en France, et retourna avec lui en Angleterre.
Devenu roi, peut-être pour avoir une fois en sa vie su commander à ses désirs, François ne changea point ses habitudes galantes.
La cour était toujours accompagnée d'une troupe nombreuse de dames: c'étaient d'abord les maîtresses avouées du roi, elles avaient le pas sur toutes les autres; puis les princesses; les femmes des grands dignitaires, des favoris et des principaux officiers venaient ensuite.
Il y avait encore, au dire de Brantôme, la petite bande, troupe galante, choisie par le roi parmi les plus belles, les plus jeunes, les plus coquettes. Au dessus de toutes les autres, les dames de cette aimable confrérie étaient les favorites de François Ier, souvent avec elles il quittait la cour et se retirait, pour des semaines entières, quelquefois plus, suivant son humeur, dans quelqu'une des résidences royales. «Là, on courait le cerf, on dansait, on festoyait du matin au soir et du soir au matin.»
«Libre, jeune, tout-puissant, le roi aimait fort et trop; il allait, sans différence, embrassant qui l'une, qui l'autre, si bien que celle de la veille n'était jamais celle du lendemain.»
Le nombre même des maîtresses du roi leur ôtait toute influence durable, et les choses continuèrent ainsi jusqu'au jour où, pour la première fois, il aperçut la belle Françoise de Foix, comtesse de Chateaubriant.
Belle, spirituelle, aimable, la comtesse jouit bien vite à la cour d'une grande influence et, pendant plusieurs années, elle régna, souveraine maîtresse, sur l'esprit, sinon sur les sens de son royal amant.
Françoise de Foix, comtesse de Chateaubriant, était issue de grande et noble race: sa famille, alliée aux maisons royales de France et de Navarre, était, depuis plusieurs siècles, célèbre dans les fastes de la chevalerie.
Son père était ce Gaston de Foix, qui dut à la beauté de son visage et à ses longs cheveux blonds et bouclés le surnom de Phébus. C'était un «grand chasseur et beau savant,» lorsqu'il rentrait le soir après avoir passé la journée à battre les grands bois, il rédigeait les préceptes du grand art de la chasse, et il a laissé un livre précieux à bien des titres: le miroir de Phébus, avec l' art de faulconnerie et cure des lestes à ce propices.
La mère de Françoise-Jeanne d'Aydie, était la fille aînée et l'héritière d'Odet d'Aydie, comte de Comminges.
En l'an 1495, c'est-à-dire vingt ans avant l'avénement de François Ier au trône, il y avait grand émoi au castel héréditaire de la maison de Foix: la dame châtelaine touchait au terme de sa grossesse, et d'heure en heure on attendait sa délivrance.
Phébus de Foix, qui, en sa qualité de savant homme, croyait, avec tout son siècle, à l'influence des astres, avait mandé en son logis un astrologue fort en réputation dans le midi de la France.
—Or ça, maître, lui avait-il dit, vous devez savoir ce que j'attends de vous?
L'astrologue s'inclina.
—Ma dame et épouse va présentement me donner un enfant, et je souhaiterais savoir quelles destinées l'attendent, fille ou garçon. Mettez-vous en besogne et satisfaites ma curiosité.
—Ainsi je ferai, monseigneur, et la chose me sera facile.
—Ça donc, maître, usez de mon logis et de mes domestiques comme de vôtres, pour toutes choses nécessaires à votre art, chacun ayant reçu l'ordre de vous obéir comme à moi-même, et comptez surtout sur bonne récompense.
Le sire de Foix, sur ces mots, congédia le «savant homme» et se rendit, à l'appartement qu'occupait la châtelaine.
L'astrologue, lui, s'installa dans une des tourelles du château et passa la nuit à interroger le ciel, tandis que la dame de Foix mettait au monde une petite fille.
Le matin, à l'aube du jour, l'accouchée avait oublié ses souffrances, et reposait paisiblement dans le vaste lit à colonnes, entouré d'épaisses draperies, qui occupait presqu'entièrement un des côtés de la salle. La petite fille, «accorte, mignonnette,» dormait dans un riche berceau.
Monseigneur Phébus auquel le plaisir d'être père faisait oublier les émotions de la nuit, «il aimait tendrement sa femme,» chargea un page d'aller quérir l'astrologue.
Au bout d'un instant le page revint seul.
—Je n'ai point trouvé l'homme, monseigneur, dit-il, ni même aucune trace de son passage dans le réduit de la tourelle; mais sur un escabeau, placé en évidence au milieu de la salle, j'ai aperçu le parchemin que voici.
C'était une grande feuille bizarrement découpée, presqu'entièrement couverte de dessins étranges et de figures cabalistiques. Un clou avait sans doute servi à la fixer à l'escabeau, car on voyait au milieu une petite déchirure.
Messire de Foix prit avec empressement le parchemin que lui tendait le page, et non sans difficulté il parvint à déchiffrer cette obscure prédiction, rimée comme c'était l'usage alors:
Par beauté, et quoi qu'advienne[4] A l'encontre, tôt sera reine.
Un sourire de satisfaction éclaira la physionomie du bon seigneur.
—Je ne serais point surpris de cela, murmura-t-il, notre maison étant maison souveraine.
Il reprit sa lecture:
Aura la reine, de son fait,
Déplaisance dure et méfait.
Messire Phébus s'interrompit un instant, cherchant sans doute le sens de cette phrase obscure, mais ne le trouvant pas, il continua:
Du fait du roi aura grand heur
Las! puis grand malheur
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Là s'arrêtait la prédiction. Monseigneur de Foix eut beau tourner et retourner le parchemin, examiner avec attention chaque signe, il n'y avait rien de plus. Effrayé sans doute de ce qu'il avait lu dans les astres, l'astrologue avait jugé prudent d'en rester là. Une interruption semblable équivalait à l'annonce d'un grand malheur.
Telle fut du moins la pensée du vieux chevalier.
Il appela aussitôt et donna l'ordre de chercher partout l'astrologue et de l'amener en sa présence.
Écuyers, varlets et pages, se mirent sur l'heure en besogne. Mais vainement on fouilla tous les coins du château, vainement on battit la campagne aux environs, l'astrologue resta introuvable. Il s'était enfui sans laisser aucune trace, aucun indice, personne ne l'avait vu.
Si bien que quelques «bons écuyers» n'étaient pas fort éloignés de croire que leur maître avait eu affaire à messire Satanas en personne.
Cette singulière disparition ne laissa pas que d'inquiéter monseigneur Phébus, et, lors des fêtes qui suivirent le baptême de sa fille, il raconta cette histoire et montra l'obscur horoscope à un vieux chevalier, son compagnon.
Mais ce dernier, chose bien plus extraordinaire que la fuite de l'astrologue, était fort peu crédule de sa nature.
—Ce sont là dit-il, insignes menteries et si vous m'en croyez, vous jetterez ce grimoire au feu et n'y penserez plus.
Monseigneur Phébus n'écouta pas ce conseil. Il enveloppa, au contraire, le parchemin et soigneusement le déposa dans le coffre où il serrait d'ordinaire ses objets précieux.
La petite Françoise, tel est le nom qu'avaient donné à leur fille le seigneur et la dame de Foix, grandit rapidement à l'ombre du manoir paternel. Elle courait, tant que durait le jour, dans les grands bois des environs, s'exerçant à monter à cheval, à suivre les grandes chasses, et à lancer l'oiseau.
Telles étaient alors, avec la lecture des vieux romans de chevalerie, les uniques distractions des châtelaines du moyen âge. Seules en leur castel, entourées seulement de quelques suivantes, d'un petit nombre d'écuyers et de pages, elles restaient quelquefois des années entières sans nouvelles de leurs époux, occupés à guerroyer dans quelque province éloignée.
Françoise avait près d'elle de hardis chasseurs pour courre le cerf. Son père d'abord, ce Nemrod aux huit cents chiens de chasse, ses trois frères ensuite: Odet, vicomte de Lautrec; de Lesparre, qu'on appelait aussi d'Asparrot, et Lescun. Vaillants soldats tous les trois, ils avaient fait leurs preuves dans les guerres italiennes de Louis XII et allaient devenir les généraux de François Ier.
C'était un noble et grand séjour, que le château de monseigneur de Foix!
La cour n'avait pas encore attiré dans son rayonnement les représentants des plus illustres familles de France. Les grands seigneurs n'avaient pas pris l'habitude d'aller dépenser leurs revenus, plus que leurs revenus souvent, auprès du souverain, afin de concourir, par leur luxe, à l'éclat de la couronne.
Les rois n'appelaient à eux la noblesse qu'à l'heure du danger; lorsqu'il fallait ceindre le casque et tirer l'épée, elle accourait alors. Mais en temps de paix, les gentilshommes vivaient chez eux, au milieu de leurs vassaux, comme autant de petits souverains, et parfois, disons-le, de petits tyrans.
Chaque province possédait alors quelque seigneur qui, plus riche et plus puissant que les autres, attirait à lui toute la noblesse des environs et se formait ainsi une cour qui rivalisait avec celle du souverain. Il en était ainsi de monseigneur Phébus. Chaque jour arrivait à son logis quelqu'hôte nouveau, sûr d'y trouver une hospitalité royale.
Une foule de nobles hommes, de vaillants chevaliers, de hautes et puissantes dames, se pressait dans les cours du château lorsque venait l'heure de la chasse ou de quelque joyeuse chevauchée.
Les festins succédaient aux chasses, les danses aux festins. Puis venaient les joutes à armes courtoises, dans une clairière voisine, ombragée d'arbres séculaires et entourée d'estrades pour les dames. C'était la distraction suprême de l'époque, héroïque et dangereux passe-temps «d'où d'aucuns et des meilleurs revenaient souvent moulus et saignants de quelque bonne blessure.»
La gentille Françoise était la gloire et l'ornement de toutes ces fêtes; elle allait avoir quatorze ans et était, au dire de tous, un véritable miracle de beauté.
Souvent, lorsqu'il la voyait passer, si accomplie, si gracieuse sous son costume «merveilleusement riche,» le bon Phébus ne pouvait s'empêcher de murmurer les premiers vers de l'horoscope:
Par beauté, et quoiqu'il advienne
A l'encontre, tôt sera reine.
Reine elle était en effet, par sa beauté, par son esprit, par sa naissance; et si nul souverain encore ne lui avait adressé ses hommages, les plus vaillants et les plus nobles se disputaient ses regards et ses sourires, et sollicitaient sa main.
Jean de Laval, seigneur de Chateaubriant, en Bretagne, fut l'époux qu'au milieu de tous Phébus de Foix choisit pour sa fille chérie.
C'était un seigneur de haute et fière mine, que le comte de Chateaubriant, des plus dignes et des plus nobles, «passé maître en fait de vaillantise.» Il avait fait ses premières armes avec le connétable Anne de Montmorency, qui le tenait en grande estime.
Le mariage fut célébré en 1509. Françoise de Foix avait quatorze ans, Jean de Laval était de dix années plus âgé que sa jeune épouse.
Les fêtes et réjouissances des noces étaient à peine terminées, qu'il fallut songer aux préparatifs du départ.
Jean de Laval emmenait sa jeune femme en Bretagne, à ce manoir de Chateaubriant que, plus qu'une longue lignée de preux chevaliers, devait illustrer l'admirable auteur de René.
Le lendemain même de la cérémonie, Phébus de Foix avait mandé près de lui la nouvelle comtesse. Il tenait à la main, lorsqu'entra Françoise, un large pli lié avec un fil d'or et scellé à ses armes.
—Vous allez quitter votre père, ma fille, lui dit-il, gardez précieusement ceci en mémoire de l'affection qu'il eut pour vous.
Il lui remit en même temps le pli. Françoise, émue de l'air solennel du vieux seigneur, était près de fondre en larmes.
—Maintenant, continua Phébus, jurez-moi de ne jamais briser ce scel, à moins que dans votre vie advienne quelque grave événement qui vous trouble et vous inquiète.
Françoise fit le serment que lui demandait son père.
Cependant l'heure de la séparation était venue. Les chevaux et les mulets de bagage emplissaient les cours. Écuyers et pages achevaient en toute hâte les derniers apprêts, donnaient un coup d'oeil aux harnais, fixaient solidement les coffres.
Une dernière fois, monseigneur Phébus embrassa sa fille chérie.
—Vous emportez, comte, dit-il à Jean de Laval, mon plus cher trésor; je suis sûr que vous ne tromperez point la confiance que j'ai mise en vous.
Jean de Laval, pour toute réponse, se jeta dans les bras de son beau-père.
Or, c'était bien à la jeune comtesse que s'appliquait le titre de plus cher trésor; il n'y avait pas d'équivoque possible, la fille de la noble maison de Foix n'avait eu en mariage d'autre dot que son esprit et sa beauté.
Les yeux rouges de larmes, la belle comtesse de Chateaubriant monta sur sa blanche haquenée. Jean de Laval s'élança à cheval et toute la troupe se mit en route.
Phébus de Foix rentra tristement dans son manoir désert. Longtemps accoudé au parapet d'une de ses tours, il suivit des yeux à travers les sinuosités de la vallée Jean de Laval et Françoise qui chevauchaient lentement en tête de leur escorte. La vie de la comtesse de Chateaubriant s'écoula paisible et ignorée pendant les premières années de son mariage. Jean de Laval avait pris au sérieux ses devoirs de mari. Il possédait un trésor, il le savait, aussi veillait-il sur sa jeune femme avec une sollicitude inquiète que les voisins taxaient de jalousie.
Les femmes attachées à leurs devoirs n'ont pas d'histoire; celles-là sont heureuses.
Tant qu'elle habita le manoir de Chateaubriant, Françoise se contenta d'être la plus belle et la plus aimée des châtelaines.
L'amour de son époux lui suffisait: elle l'accompagnait partout, aux fêtes des châteaux des environs et aux grandes chasses qui se renouvelaient souvent.
La Bretagne était alors un merveilleux pays, pour courre, la propriété n'était pas morcelée à l'infini. Le pays n'était pas comme aujourd'hui coupé de fossés profonds et de talus de six pieds, qui font du champ de chaque propriétaire comme un camp retranché, inaccessible aux chevaux et aux chiens.
Pendant ces premières et trop courtes années, Louis XII était mort et François Ier était monté sur le trône.
Un des premiers actes du jeune roi avait été de nommer deux maréchaux de France, hommes de guerre fort en renom: l'un était Jacques de Chabannes, sieur de la Palice, l'autre, Odet de Foix, vicomte de Lautrec, frère de la comtesse de Chateaubriant.
On était alors à l'aurore éblouissante d'un règne nouveau. François Ier, dans la première ivresse du pouvoir suprême, ne songeait qu'à la joie.
Ardent au plaisir comme au danger, il avait aux jours de fête la même ardeur que sur les champs de bataille. «Qui m'aimera me suive!»
Et chacun suivait le roi à qui mieux mieux.
D'Amboise à Romorantin et à Vendôme, ce n'étaient, à ce moment que fêtes, bals costumés, petites guerres, grands repas et grande liesse. Tout l'or des impôts y suffisait à peine, mais nul n'en prenait souci. C'était une vie toute nouvelle.
C'est à cette époque, et pendant les fêtes du carnaval, que le futur protecteur des lettres provoqua, sans le vouloir, une révolution dans l'art de la coiffure.
Les longs cheveux, on le sait, étaient au xvie siècle la marque distinctive, le privilège exclusif de la noblesse. Les longs cheveux étaient interdits aux vilains, et c'est Pierre Lombard, l'illustre maître des Sentences, qui leva cette interdiction. Mais il n'y parvint pas sans peine, et la noblesse protesta toujours.
Elle eût protesté longtemps encore, et la révolution en question n'eût point été accomplie, sans l'accident survenu au roi de France.
La cour était alors à Romorantin et chacun fêtait le jour des rois. François Ier allait se mettre à table lorsqu'on vint lui dire que le comte de Saint-Paul avait fait en son logis un roi de la fève.
—Par ma foi de gentilhomme! s'écria-t-il, voilà un roi que je détrônerai tout à l'heure. Qu'on aille avertir Saint-Paul de bien veiller sur son élu.
Ainsi défié, le comte de Saint-Paul s'apprêta à faire bonne résistance. C'était un moyen sûr d'être agréable au roi. La terre était alors couverte de neige: il en fit transporter des monceaux dans l'intérieur de son hôtel, et tandis qu'une partie de ses amis et de ses gens préparaient des pelotes, les autres s'éparpillaient de tous côtés, en quête d'oeufs et de pommes, munitions ordinaires de ces simulacres de combats.
Lors donc que parut la troupe royale, elle fut accueillie par une grêle de projectiles. Un siège en règle commença aussitôt.
L'assaut était vaillamment et habilement mené, mais les assiégés se défendaient avec vigueur et le combat menaçait de durer longtemps encore, lorsque les pelotes de neige et les pommes vinrent à manquer dans l'intérieur de la place.
Les amis de Saint-Paul allaient ouvrir les portes de l'hôtel et se rendre faute de munitions, lorsque l'un d'eux, espérant retarder l'heure de la défaite, eut la malheureuse idée de prendre dans le foyer un tison enflammé et de le lancer au milieu d'un groupe d'assaillants.
Le dangereux engin de guerre atteignit François Ier à la tête et lui fit une profonde blessure.
A ces cris: «le roi est blessé!» assiégeants et assiégés se précipitèrent près du jeune souverain, il fut placé sur un brancard et transporté en son logis. Les médecins, déjà prévenus de l'accident, étaient accourus. Après un court examen, ils déclarèrent que la blessure n'offrait aucune gravité, mais sous leurs ciseaux tombèrent les beaux cheveux noirs du roi.
Dès le lendemain tous les courtisans étaient «tondus comme des oeufs.» Bourgeois et manants imitèrent les gentilshommes, et, dès lors, les longs cheveux furent déclarés ridicules.
«A dater de cet accident le roi laissa croître sa barbe, et chacun tenant à honneur de suivre l'exemple royal, on ne rencontra plus que têtes rases et visages barbus.»
La maladie de François Ier fut de courte durée, et bientôt les fêtes recommencèrent plus brillantes et plus nombreuses que jamais.
Cependant, le renom de la beauté de madame de Chateaubriant était venu jusqu'à François Ier, et ce roi, qui voulait que «sa cour fût comme un parterre où viendraient s'épanouir les plus rares beautés de France,» avait, plusieurs fois déjà, témoigné le désir de voir la comtesse.
D'ordinaire, ses moindres désirs étaient des ordres, presqu'aussitôt exécutés que donnés; mais cette fois, nul ne sembla en tenir compte.
Le seigneur breton avait bien été averti du désir du roi; plusieurs courtisans s'étaient fait un devoir de lui envoyer message sur message; mais tous ces avertissements n'avaient fait que le confirmer dans sa résolution de ne point paraître à la cour. La réputation du roi était, il faut l'avouer, de nature à conseiller ce parti à tout homme jaloux de son honneur.
Enfin, un jour, cédant à l'irrésistible attrait du fruit défendu, François Ier s'adressa directement à Odet de Foix, maréchal de France, frère de madame de Châteaubriant.
—J'ai ouï parler, Lautrec, lui dit-il, de la merveilleuse beauté de la comtesse votre soeur, pourquoi donc s'obstine-t-elle à rester tristement au fond de sa Bretagne, pourquoi ne la voit-on pas à la cour, comme toutes les grandes dames de France?
—Sire, le comte Jean de Laval, son mari, est, à ce qu'il paraît, le plus soupçonneux des hommes; il redoute pour sa femme les plaisirs et les fêtes de la cour la plus brillante du monde.
Le roi sourit à cette délicate flatterie.
—Cependant, reprit-il, je vois, ce me semble, des femmes de grande vertu à la cour, Lautrec, est-ce donc que je me trompe?
—Votre Majesté a parfaitement raison, Sire, et chacun sait que la reine est une femme sans égale et la princesse Marguerite une merveille à tous égards.
—Bien parlé, Lautrec, pour un homme de guerre. Raison de plus pour faire comprendre au sire de Laval qu'il n'a pas le droit de cacher, ainsi qu'il le fait, sa femme à tous les yeux.
—Je crains, Sire, que cela ne soit difficile.
—Pourquoi donc? il peut être tranquille. Par ma foi de gentilhomme! on aura pour la comtesse tous les égards qu'elle mérite.
C'était un ordre, et des plus formels. Lautrec se hâta d'écrire à son beau-frère que le roi le demandait, et l'engageait à amener sa femme.
Cette lettre ne surprit aucunement le comte, depuis longtemps il s'y attendait. Son parti fut vite pris.
—Madame, dit-il à la comtesse, je viens de recevoir une lettre de votre frère; il paraît que le roi a grand désir de nous voir à la cour.
—Et comptez-vous, messire, obéir aux ordres du roi? demanda timidement madame de Chateaubriant.
—C'est le devoir de tout loyal sujet, madame; et, avant qu'il soit trois jours, je veux me mettre en route.
—Ne dois-je point vous suivre?
—Non, madame, non certainement. Le séjour de la cour est dangereux pour une femme attachée à ses devoirs, surtout lorsque le maître est un roi comme le nôtre; j'ai donc résolu de vous laisser ici, où vous êtes en sûreté.
—Mais ne craignez-vous pas la colère du roi?
—La colère du roi m'affligerait grandement, répondit le comte d'un air sombre; mais je préfère ce malheur à celui qui pourrait advenir si, suivant le conseil de votre frère, je vous conduisais à la cour.
La comtesse se tut. Elle aimait son mari, le vaillant Jean de Laval; elle se plaisait en son beau château de Bretagne; les splendeurs de la cour, dont maintes fois elle avait entendu des descriptions, ne la tentaient nullement; mais c'est avec une secrète et indéfinissable angoisse qu'elle voyait s'éloigner le comte.
Soucieux et triste, le seigneur de Chateaubriant surveilla les préparatifs de son voyage; lorsqu'enfin tout fut terminé, que le moment des derniers adieux fut venu:
—Françoise, dit-il à sa femme, il se peut que, tandis que je serai près du roi, on vous tende des pièges pour vous attirer à la cour.
—Soyez certain, messire, que je ne veux obéir qu'à vos ordres.
—Je le crois, Françoise; mais il se peut encore que le roi me force de vous écrire moi-même de venir, sans que telle soit mon intention; d'un autre côté, il est possible que je veuille véritablement vous appeler près de moi.
—Mais alors, comment faire?
—J'ai pensé à cela, Françoise; il y a longtemps que je prévoyais ce qui arrive. Voici donc ce que j'ai imaginé: si véritablement je souhaite vous avoir près de moi, je vous enverrai la bague que je porte toujours au doigt et qui me sert de scel; et comme il pourrait encore y avoir erreur ou tromperie, je vous donne cette autre qui est absolument semblable; en comparant donc et la bague que vous recevrez et celle que je vous laisse, vous pourrez vous assurer de la vérité.
La comtesse prit les deux bagues, les examina un instant; puis, en rendant une à son mari, elle passa l'autre à son doigt.
—Vous avez sagement fait, dit-elle, et de cette façon, il sera vraiment impossible de me tromper.
—Je le crois comme vous, Françoise; et maintenant, quelque message, quelque lettre que vous receviez, même de moi, demeurez au château, faites répondre que vous êtes trop malade pour entreprendre un voyage; mais si vous recevez mon anneau, accourez.
Sur ces mots le comte embrassa sa femme une dernière fois et partit.
François Ier attendait avec la plus vive impatience la réalisation des désirs si nettement exprimés au maréchal de Lautrec, lorsqu'un soir on lui annonça le comte de Chateaubriant. Ce fut avec un empressement visible qu'il donna l'ordre de le faire approcher. Mais lorsqu'il vit que le comte était seul, il fronça le sourcil, et sans se soucier de contenir son dépit:
—N'avez-vous donc pas, comte, dit-il d'un ton bref, amené votre femme?
—Hélas! sire, balbutia le mari de la belle Françoise, la comtesse est fort malade à cette heure, et mon dévouement au roi a pu seul me décider à l'abandonner en si fâcheux état.
Le roi ne répondit rien, mais il tourna brusquement le dos au pauvre comte, et les courtisans aussitôt s'éloignèrent de cet homme qui venait d'encourir la disgrâce royale.
François Ier, cependant, ne se tint pas pour battu; il fit prendre des informations. Mais le comte avait si bien pris ses mesures, il avait lui-même si bien joué son rôle que tout le monde, Lautrec le premier, était convaincu de la maladie de la comtesse. Plusieurs fois déjà, M. de Chateaubriant avait, devant son beau-frère, écrit à sa femme de le venir rejoindre, le doute n'était presque pas possible. L'enquête secrète démontra que le comte avait dit vrai.
Certain qu'un obstacle imprévu, involontaire, avait seul arrêté le comte, le roi ne tarda pas à lui rendre ses bonnes grâces; il allait même l'engager à retourner en Bretagne, près de sa femme, lorsque la trahison d'un domestique vint rendre inutiles toutes les précautions prises par le malheureux époux.
Ce serviteur infidèle avait, par une porte entrebâillée, surpris le dernier entretien du comte et de la comtesse. Arrivé à la cour à la suite de son maître, et sachant la grande impatience qu'avait le roi de voir la belle dame de Châteaubriant, il songea à tirer parti du secret qu'il possédait, comptant avec raison recevoir un bon prix de sa délation.
Il alla trouver un des confidents du roi, et après s'être assuré une récompense honnête, raconta l'invention des deux bagues.
Une heure après, François Ier savait la vérité.
En apprenant qu'il avait été joué, l'impétueux monarque entra dans une furieuse colère; il voulait sur-le-champ user de son autorité, se venger de ce qu'il appelait une «déloyale traîtrise,» faire emprisonner le mari et enlever la femme, sa complice.
Heureusement ou malheureusement, les confidents du roi parvinrent à le calmer et à le faire renoncer à ses projets. Ils lui persuadèrent d'employer la ruse, et, à son tour, de tromper le trompeur.
Il fut décidé qu'à tout prix on enlèverait, pour quelques heures, la bague du comte; un ouvrier habile l'imiterait avec toute la promptitude et l'exactitude possibles.
Maître du gage de reconnaissance, le roi pourrait, lorsqu'il le voudrait, faire venir la comtesse, qui arriverait à la cour au moment où son mari l'attendrait le moins.
Ce plan fut exécuté de point en point, grâce à l'adresse du domestique de M. de Châteaubriant. Cet homme parvint à dérober la bague de son maître et à la lui restituer sans qu'il s'aperçût de cette disparition momentanée. Un orfèvre habile prit l'empreinte, se mit aussitôt à l'oeuvre, et moins de huit jours après, un messager galopait vers la Bretagne, porteur d'un gage de reconnaissance imité de façon à tromper l'oeil du mari le plus soupçonneux.
Certain de la réussite de son stratagème, le roi se réjouissait fort de voir arriver la comtesse, et d'avance se faisait une fête de la surprise et de la colère du comte de Chateaubriant.
Il allait justement y avoir de grandes fêtes à la cour. Un fils était né au roi, et le Pape, qui avait bien voulu être le parrain de ce nouveau-né, avait envoyé, pour le représenter au baptême du Dauphin de France, son neveu, Laurent de Médicis, duc d'Urbin.
On faisait au château d'Amboise de grands préparatifs pour les cérémonies, qui devaient être splendides: bals, festins, joutes, grandes chasses, le roi ne voulait rien épargner. Grands seigneurs, nobles dames, princes étrangers, ambassadeurs de toutes les puissances, accouraient de tous côtés. Le roi pensait avec orgueil que madame de Chateaubriant, cette beauté célèbre, ne serait pas insensible aux hommages d'un roi entouré de ce magnifique appareil de puissance et de grandeur.
En attendant, François Ier faisait au triste comte l'accueil le plus charmant. Il l'arrêtait, toutes les fois qu'il le rencontrait, et lui demandait, avec les marques du plus touchant intérêt:
—Comment se porte donc votre femme, comte? avez-vous de ses nouvelles?
—Hélas! Sire, répondait le malheureux époux, la comtesse va très-mal.
C'est avec une surprise profonde que madame de Chateaubriant reçut des mains du messager le faux gage de reconnaissance qui l'appelait à la cour. Elle eut un éclair de doute et compara les deux bagues; elles étaient bien exactement pareilles; il n'y avait pas à douter.
Quelle cause avait donc pu déterminer le comte à lui faire entreprendre ce voyage qu'il redoutait naguère si fort? La belle comtesse se perdait en conjectures; mieux que personne, elle connaissait le caractère jaloux de son mari, plusieurs fois elle avait eu à en souffrir, il avait fallu de bien graves motifs pour changer ainsi ses déterminations.
Enfin, elle allait voir la cour, le roi. Elle allait assister à ces fêtes splendides, qui trouvaient un écho jusqu'au fond des manoirs les plus reculés de la Bretagne.
Tandis qu'elle faisait en toute hâte ses préparatifs, le coeur serre par de vagues inquiétudes, elle se souvint de ce pli mystérieux, que le lendemain de son mariage lui avait remis son père et que la douce monotonie de son existence lui avait fait presque oublier. Elle se dit que le moment était venu de l'ouvrir, un grave événement bouleversant sa vie; d'une main tremblante elle brisa le fil d'or et lut:
Par beauté, et quoiqu'il advienne
A l'encontre, tôt sera reine.
C'était bien là l'expression des pressentiments qu'elle n'osait s'avouer à elle-même: serait-elle donc la maîtresse du roi?
Le comte de Chateaubriant assistait à un grand bal donné dans la cour d'honneur du château d'Amboise, transformée en une salle splendide, lorsqu'un serviteur vint l'avertir que sa femme l'attendait en son logis.
Le roi, prévenu quelques instants avant de l'arrivée de la comtesse, suivait des yeux le malheureux époux. Il le vit chanceler sous ce coup inattendu; rougir d'abord, puis pâlir affreusement; son oeil étincela, ses lèvres se contractèrent, enfin il s'élança dehors.
—Qu'on suive le sire de Laval, dit le roi à un de ceux qui étaient dans le secret, il est capable de faire quelque malheur.
Le comte, en effet, arrivé en présence de sa femme, laissa éclater sa colère, elle fut terrible.
Éperdue, tremblante, sans force pour prononcer une parole de justification, l'infortunée Françoise de Foix ne sut que tomber à genoux en élevant au-dessus de sa tête les deux gages de reconnaissance.
À la vue de ces deux bagues, si parfaitement semblables, le comte comprit tout; sa colère tomba subitement pour faire place à un calme plus effrayant encore.
Sans mot dire il ôta de son doigt la bague un instant dérobée par les ordres du roi et la présenta à la comtesse.
—Partons, oh! partons, messire, s'écria alors Françoise; quittons ce séjour de tromperie et retournons en notre manoir.
Mais le sire de Laval, après un instant de réflexion:
—Non, madame, non. N'essayons pas de lutter davantage; celui qui a employé la ruse est assez puissant pour employer la force. De ce jour je vous abandonne la garde de mon honneur, voyez ce que vous en voulez faire. Songez toutefois qu'un jour viendra où je vous en demanderai compte. Ce jour pourra être terrible pour vous.
La présentation de la belle comtesse fut un véritable triomphe. A chaque pas, dans les salles du château, à la promenade, le long des rues de la ville, le comte entendait cette exclamation qui redoublait sa jalousie et son effroi:
—Dieu! qu'elle est belle!
A sa vue, François Ier fut ébloui et il n'essaya pas de cacher l'impression que produisait sur son coeur cette merveilleuse beauté.
—J'ai enfin aperçu la comtesse votre soeur, disait-il à Lautrec, et ceux qui m'avaient vanté ses charmes étaient restés bien au-dessous de la vérité.
Aux cérémonies du baptême du Dauphin succédaient alors les réjouissances du mariage du duc d'Urbin, qui épousait Madeleine de La Tour, héritière du comte d'Auvergne. La belle Françoise de Foix était déjà la reine de toutes ces fêtes, l'amour du roi n'était plus un secret pour personne.
Vainement le sire et la dame de Laval essayaient de se perdre dans la foule, vainement ils se réfugiaient dans les salles les plus éloignées, François Ier, bien servi par ses familiers, finissait toujours par découvrir la retraite de la comtesse et bientôt il était auprès d'elle.
Chaque jour d'ailleurs elle recevait quelque présent du roi. C'était un collier d'or, une parure de perles, un bracelet délicatement ouvragé. Gages d'amant que le comte eût voulu renvoyer à celui qui les offrait, et qui soulevaient en son coeur d'horribles désirs de vengeance.
Pour comble d'infortune, le comte s'aperçut bientôt que sa femme n'avait pu voir, sans en être touchée, le roi de France à ses pieds. Jour par jour, pour ainsi dire, il put suivre les progrès de cet amour. La comtesse résistait encore, mais tôt ou tard elle devait succomber.
Le sire de Laval ne voulut pas être témoin de son malheur. Sa femme venait d'être nommée dame d'honneur de la reine, et cette charge désormais l'attachait à la cour. Mais rien ne l'y retenait, lui; aussi se décida-t-il à partir. Il courut cacher au fond de son castel de Bretagne, ce muet témoin des jours heureux, sa honte et son désespoir.
Sa femme essaya faiblement de le retenir.
—Allez-vous donc, messire, lui dit-elle, m'abandonner ainsi seule, au milieu des fêtes de la cour?
—Vous ne serez point seule, madame, répondit-il avec un rire amer. Un plus puissant que moi vous protégera désormais. Faites en sorte seulement que jamais le bruit de vos amours adultères ne vienne troubler la paix de ma solitude.
Et il partit, maudissant le roi de France et sa femme.
C'en était fait, la noble fille de Phébus de Foix était la maîtresse déclarée de François Ier.
Ce ne fut pas sans résistance et sans remords que la belle comtesse se donna à son royal amant. Elle se sentait glacée, au souvenir de son époux outragé, ses dernières paroles retentissaient menaçantes à son oreille. Souvent, lors de ses premières entrevues avec le roi, elle tressaillait au moindre bruit, et toute frissonnante elle disait:
—N'avez-vous rien entendu, Sire, j'ai cru reconnaître les pas du sire de Laval. Ah! quelque jour il voudra me ramener avec lui au château de Combourg.
—N'ayez aucune crainte, madame, répondait François, tant que mon coeur battra, je vous aimerai, tant que je vous aimerai vous me trouverez debout pour vous défendre.
Les douces paroles du roi rassuraient la comtesse. Bientôt elle n'eut plus le loisir de songer à sa faute. Son amant l'avait entourée d'un luxe vraiment royal, et tous les courtisans, tous ceux qui aspiraient aux bonnes grâces du roi étaient à ses pieds. Enivrée d'amour, elle se laissait aller au tourbillon des plaisirs de cette cour licencieuse et folle.
Le roi s'était hautement déclaré le chevalier de la comtesse de Chateaubriant. A la face de tous il avait mêlé ses couleurs aux siennes, la salamandre en feu à la pourpre et à l'hermine de Laval. Pour elle, il descendait dans la lice aux jours de tournoi, pour ses beaux yeux il rompait des lances, et s'il désirait remporter le prix, c'est qu'il voulait le déposer à ses pieds.
Alors François Ier avait essayé de rajeunir et de remettre à la mode tout le bric-à-brac des vieux romans de chevalerie, lui-même se piquait d'être le parangon et le modèle des preux présents et à venir.
On ne rêvait alors que choses héroïques, impossibles et merveilleuses; le réel, le vraisemblable étaient considérés comme choses plates et communes. Les exploits de Roland, d'Oger le Danois, de Renaud de Montauban, et de Lancelot du Lac, qui devaient troubler la cervelle du bon chevalier de la Manche, remplissaient alors tous les esprits. Les dames surtout, après avoir admiré les hauts faits de ces héros illustres, rêvaient les perfections d'Angélique, de Bradamante ou de Marphise.
La belle Françoise de Foix fut la reine des derniers tournois, de ces fêtes de la chevalerie qui devaient tomber sous les coups redoublés du ridicule, et dont Rabelais riait déjà de son gros rire.
L'influence de la comtesse de Chateaubriant fut bientôt très-grande à la cour. François Ier ne voyait que par les yeux de sa belle maîtresse, et, à son gré, elle disposait des places et des commandements.
Mais cette influence même fut plus tard une des causes de la disgrâce de la comtesse. La mère du roi, Louise de Savoie, habituée à gouverner sous le nom de son fils, ne put voir sans dépit la toute-puissance de la favorite; de ce moment, elle jura sa perte, et attendant une occasion favorable, elle aida à lui susciter des rivales. Mais le crédit de la comtesse n'en fut point ébranlé, et, après ses passagères infidélités, François revenait toujours aux pieds de sa belle maîtresse, plus épris que jamais.
Il faut rendre à la comtesse de Chateaubriant cette justice, qu'elle n'abusa jamais de son pouvoir sur le roi. Elle s'en servit pour faire la fortune de sa famille, de ses trois frères surtout, Lautrec, Lescun et Lesparre. Mais tous trois étaient de vaillants hommes de guerre et d'habiles capitaines, déjà en renom, les deux premiers surtout, avant que leur soeur fût devenue la maîtresse du roi.
Tous trois, il est vrai, jouèrent de malheur en Italie et compromirent singulièrement le pouvoir du roi: mais presque tous leurs échecs doivent être attribués à la lutte sourde de la favorite et de la mère du roi.
Lautrec se trouvait en Italie à la tête de soldats mercenaires braves à la condition d'être bien payés, et capables pour la moindre augmentation de solde de passer d'un côté à l'autre; et c'est un général commandant de pareilles troupes qu'on laissait sans argent! Madame de Chateaubriant obtenait 500,000 livres pour son frère, mais la reine mère arrêtait cet argent en route, il ne parvenait pas, les soldats désertaient, et Lautrec, après avoir sacrifié son bien et celui de ses amis, se voyait sans armée et était forcé de battre en retraite.
Ce que désirait Louise de Savoie faillit arriver: après la bataille de la Bicoque, Lautrec fut rappelé, mais la comtesse lui fit rendre son commandement. Il repartit pour l'Italie emportant... beaucoup de promesses que l'on ne tint jamais.
Lesparre, après l'impolitique attaque de Reggio, qui décida Léon X à se déclarer contre la France, fut également sauvé par sa soeur d'une disgrâce méritée. La comtesse sut détourner les effets de la colère royale.
On ne peut guère lui reprocher ces faits; malheureusement elle eut le tort d'aider à la disgrâce de Jacques Trivulce, qui après avoir, sous trois rois, rendu des services réels à la France, se vit privé de ses commandements et exilé de la cour.
Desservi par Lautrec et par la comtesse, ce vieillard, qui ne méritait que des récompenses, était devenu odieux au roi. Il voulut se justifier. Trop faible pour marcher, il se fit porter sur le passage de François Ier, et quand de loin il l'aperçut il s'écria: «Sire! Sire!»
Mais l'ingrat monarque ne daigna point s'arrêter, ni même tourner la tête, et le vieux soldat mourut de douleur.
Aimée du roi, adulée par les courtisans, enviée par la reine mère, reine au conseil comme au bal, la belle comtesse de Chateaubriant se flattait alors de conserver toujours cette haute position, en dépit de ses ennemis. Il n'était plus question de remords, ni même de regrets. Les chroniques nous apprennent même qu'elle ne fut guère plus fidèle au roi qu'à son mari et qu'elle se vengeait à l'occasion des nombreuses trahisons de son volage amant.
Le connétable de Bourbon et l'amiral Bonnivet furent, dit-on, très-avant dans ses bonnes grâces. Ce sont là, peut-être, des calomnies, mais ces calomnies eurent au moins à l'époque assez de vraisemblance pour donner des inquiétudes au roi.
On n'a d'autre garant de la bonne fortune du connétable de Bourbon avec la belle comtesse que les assertions de Bourbon lui-même. Peut-être se vantait-il? Quelques historiens cependant veulent voir dans ces relations un des motifs de la haine du roi contre son connétable, laquelle eut par la suite de si désastreux effets pour la France; mais cette haine fut bien plus l'oeuvre de la mère de François Ier, qui avait aimé Bourbon et en avait été repoussée.
Les heureuses aventures de l'amiral Bonnivet semblent un peu mieux prouvées, et l'on en retrouve des traces dans Brantôme, qui n'est pas, à vrai dire, une indiscutable autorité.
Favori de François Ier, l'amiral Bonnivet était une des plus parfaites copies du roi, «si hardi, si sage, dit Marguerite, que de son âge et de son temps il y a eu peu ou point d'hommes qui l'aient surpassé.»
Beau, spirituel, brave, généreux et magnifique, «quelle dépense, dit Brantôme, est impossible à un favori de roi.» Audacieux dans toutes les entreprises de guerre ou d'amour, l'amiral Bonnivet devait plaire à la belle favorite. Il la voyait souvent, tantôt ouvertement, tantôt en secret, et le roi était fort jaloux de lui.
Mais la comtesse de Chateaubriant savait si bien rassurer François Ier, que jamais l'amiral ne perdit un seul jour la faveur royale.
—Moi aimer ce fat! disait la belle comtesse, j'aimerais autant me jeter dans un puits.
D'autres fois elle disait en riant:
—Mais il est bon, le sire de Bonnivet, qui pense être beau. Et tant plus je lui dis qu'il l'est, tant plus il le croit. Je me moque de lui et j'en passe mon temps, car il est fort plaisant et dit de très-bons mots, si bien qu'on ne saurait s'en garder de rire quand on est près de lui, tant il rencontre bien.
Après de telles paroles, le roi eût été bien difficile s'il n'eût été complètement rassuré.
Il est une anecdote, cependant, qui prouverait que jusqu'à un certain point le roi n'était pas dupe des protestations de sa belle maîtresse.
C'était un soir d'été, la comtesse et l'amiral allaient se mettre à table pour souper; tout à coup on annonce le roi.
Grande frayeur. L'amiral n'a que le temps de se glisser dans la cheminée derrière des plantes et des arbustes qui servaient à cacher l'âtre, tandis que la favorite fait disparaître toute trace de sa présence.
François Ier entre, il remercie sa mie de l'avoir attendu, bien qu'il ne dût pas venir, et gaîment il se met à table.
Tant que dura le souper le roi, qui jamais n'avait été plus joyeux, prit un malin plaisir à lancer dans la cheminée tous les débris du repas. Vins, sauces, pelures de fruits, reliefs de viande, pleuvaient sur le malheureux amiral.
Enfin, dit le texte de la chronique, qu'il est ici nécessaire d'expurger, François Ier, après un entretien fort vif et fort animé, se tourna vers la cheminée et oublia qu'il n'était pas le long d'un des grands arbres des forêts de la couronne. Gulliver en pareille circonstance faillit noyer une foule de Lilliputiens; l'heureux amant ne fut que largement arrosé.
Le roi parti, la comtesse eut toutes les peines du monde à consoler l'amiral; il était resté près de trois heures dans la plus ridicule des positions, il voulait se venger; enfin sa belle amie réussit à lui prouver que le roi était encore le plus malheureux.
Cette leçon ne corrigea nullement du reste l'amiral Bonnivet; comme son maître il aimait les femmes à la passion; mais tandis que François Ier s'adressait à des femmes de toutes conditions, il ne rechercha jamais que les plus nobles, et les plus hautes, celles en un mot dont la conquête présentait le plus de difficultés.
Aimé de madame de Chateaubriant, il voulut l'être de la reine Marguerite, et une nuit il osa s'introduire dans son appartement, par une trappe qu'il avait réussi à faire pratiquer en secret.
La belle et sage(!!!) reine de Navarre a pris la peine de nous raconter cette aventure dans son Heptaméron. Bonnivet osa essayer de la violence, mais il fut repoussé avec perte, «si bien, dit la belle conteuse, que le galant se retira, portant sur son visage les marques sanglantes de la résistance qu'il avait rencontrée.»
Brantôme prétend que la tentative audacieuse de Bonnivet eut un tout autre dénouement, mais il est convenu que le vieux seigneur de Bourdeilles s'est toujours plu à calomnier la vertu.
Cependant le beau roman d'amour de Françoise de Foix touchait à sa fin; l'horizon politique s'assombrissait de tous côtés et la guerre s'était rallumée en Italie.
François Ier, qui rêvait la gloire d'un autre Marignan, partit avec tous ses gentilshommes, pour aller prendre le commandement de ses troupes.
—Revenez-moi fidèle, mon cher Sire, lui dit la comtesse de Chateaubriant, c'est là ce que je souhaite le plus au monde.
—Les femmes changent les premières toujours, répondit le roi, je vous reviendrai fidèle, et aussi, Dieu aidant, après avoir défait les ennemis qui ont iniquement envahi mon royaume.
Ces heureuses espérances ne se réalisèrent pas. Bientôt on reçut la nouvelle d'un immense désastre, la bataille de Pavie était perdue, le roi était prisonnier. François Ier en cette journée s'était conduit comme le plus vaillant de ses chevaliers; après avoir eu son cheval tué sous lui, il avait mis pied à terre, et bien que blessé au front et à la jambe, il avait combattu presque seul, sur les cadavres entassés de ses officiers qui s'étaient fait tuer autour de lui. Déjà il avait renversé sept hommes de sa main, ses forces étaient épuisées, ses armes faussées en mille endroits ne le protégeaient plus, lorsqu'un officier du connétable de Bourbon, Pompérant, vint se jeter à ses genoux, le conjurant de se rendre à son maître qui combattait près de là.
Mais François s'écria qu'il mourrait plutôt. Il fit appeler le vice-roi de Naples, Lannoy, et lui tendit son épée, que le lieutenant du roi d'Espagne reçut en lui baisant la main.
Bonnivet, l'imprudent auteur de cet immense désastre, ne voulut pas survivre «à cette grande désaventure et destruction.» Relevant la visière de son casque, il se jeta au plus fort de la mêlée, appelant Bourbon et le défiant au combat; mais il tomba, percé de mille coups, avant d'avoir pu rencontrer son ennemi.
Il est difficile de peindre la consternation de la cour à l'arrivée de la terrible nouvelle. François Ier lui-même avait voulu l'apprendre à sa mère, et le soir même de la bataille, sous la tente de Lannoy où il était gardé à vue, il avait écrit cette lettre devenue si fameuse, et que les faiseurs de mots après coup ont résumée en cette phrase chevaleresque: «Tout est perdu, madame, fors l'honneur.» Voici ce qu'écrivait le roi:
«Madame.
«Pour vous avertir comment se porte le ressort de mon infortune, de toutes choses ne m'est demeuré que l'honneur et la vie qui est sauve; et pour ce que en nostre adversité, cette nouvelle vous fera quelque peu de resconfort, j'ai prié qu'on me laissât vous escripre, ce qu'on m'a agréablement accordé...».
La nouvelle de la captivité du roi fut un coup de foudre pour la comtesse de Chateaubriant: le roi était son unique appui, avec lui elle perdait toute force, toute influence. Ses amis se retiraient d'elle, les ennemis seuls restaient, et à leur tête était la mère du roi, qui allait devenir régente jusqu'au retour de son fils.
Autant par douleur que par prudence, la belle favorite se renferma donc en son logis, refusant absolument de voir personne, sauf peut-être Clément Marot, le poëte, et la reine de Navarre.
Les ennemis de Françoise de Foix prétendaient que tous ses amants s'étaient donné rendez-vous à Pavie, mais qu'ils n'y avaient point eu de chance.
Le roi y avait perdu la liberté, l'amiral Bonnivet la vie, et le connétable de Bourbon l'honneur.
Cependant, Louise de Savoie, la mère du roi, avait pris la direction des affaires, que compliquait fort son impopularité, et l'on avait commencé les négociations relatives à la liberté du roi de France.
François Ier, en rendant son épée au lieutenant du roi d'Espagne, avait compté sur une de ces captivités dont on trouve de si charmantes descriptions dans les romans de chevalerie. Il s'était imaginé que Charles-Quint, en prince magnanime, devenu son ami par le seul fait de sa victoire, viendrait au devant de lui, les bras ouverts, et lui offrirait de partager son palais.
Malheureusement Charles Quint était un homme fort positif; ayant eu le rare bonheur de faire prisonnier son frère de France, il était parfaitement résolu à abuser de cette bonne fortune, et était décidé à ne lui rendre la liberté que sous de terribles conditions. Tout captif, à cette époque, devait une rançon. Le roi d'Espagne en voulait une en rapport avec ses intentions politiques.
François Ier fut donc conduit tout d'abord à la citadelle de Pizzitone, non loin du funeste champ de bataille de Pavie. Bientôt on le transféra à la forteresse de Sciativa, au royaume de Valence, au milieu d'un pays aride et désert, et qui servait à renfermer les prisonniers d'État.
François, qui avait repris espérance en touchant le sol d'Espagne, s'aperçut bien vite qu'il n'avait rien à espérer de la générosité chevaleresque de son vainqueur. Il était étroitement enfermé, gardé à vue, et il ne put même obtenir une entrevue avec l'empereur.
Le chagrin le prit alors, le mal du pays, il soupirait après le grand air, la liberté; bientôt sa vie fut en danger et on dut le conduire en un autre château, aussi près de Valence, entouré de forêts, de canaux et de jardins.
Cependant, à la nouvelle de la maladie de son frère, Marguerite de Navarre écrivit à Charles-Quint pour obtenir, avec un sauf-conduit, la faveur de partager la prison du royal captif. L'empereur accorda avec plaisir les autorisations nécessaires; il en était arrivé à trembler pour la vie de son prisonnier, et la mort du roi anéantissait tous ses projets. Marguerite partit donc, suivie de ses dames d'honneur, au nombre desquelles avait pris place la comtesse de Chateaubriant, impatiente de trouver son amant.
Des officiers de Charles-Quint escortèrent la reine de Navarre et les dames de sa suite; partout, sur leur passage, elles trouvèrent un accueil royal, et lorsqu'elles arrivèrent à Madrid, où, sur ses pressantes instances, François Ier avait été transféré, on mit à leur disposition une somptueuse demeure.
Ce fut un grand bonheur, pour le pauvre prisonnier, que l'arrivée de cette soeur bien-aimée, de cette Marguerite, si spirituelle, si enjouée, qui, pour charmer les ennuis de sa captivité, accourait, avec un essaim de jeunes femmes, belles et rieuses comme elle. François accueillit avec transport la comtesse de Chateaubriant; en pressant sur son coeur sa belle maîtresse, il put croire que tous ses malheurs étaient finis.
Ce n'étaient pas cependant les fêtes folles de Fontainebleau ou d'Amboise, mais ce n'était déjà plus la triste solitude de la forteresse de Valence.
François se sentait renaître, au milieu de cette petite cour aimable et dévouée, lui qui avait failli mourir d'ennui, au milieu du lugubre cérémonial de tous ces Castillans si fiers qui l'entouraient. Lui toujours si joyeux, si aisé, si familier, il avait été pris de marasme à la vue de tous ces grands d'Espagne, esclaves de la tradition et de l'étiquette, toujours huchés sur les prérogatives de leur grandesse.
Ne s'avisèrent-ils pas un jour de vouloir, comme c'était l'usage à la cour de Charles-Quint, que François les saluât avant de retirer leurs sombrero?
De ce jour le prisonnier n'avait plus voulu voir personne, et l'ennui avait jeté sur lui son manteau glacé.
François Ier racontait toutes ses tristesses à sa bonne Marguerite, il lui parlait des heures mortelles de la forteresse de Sciativa, il lisait les poésies composées alors qu'il n'espérait plus, et dont quelques-unes étaient adressées à madame de Chateaubriant. C'est les larmes aux yeux que la belle comtesse écoutait ces vers plaintifs, doux souvenir d'un amour royal:
O triste départie
De mon tant regretté
Deuil ne sera osté
Qui faict mon coeur parlé.
Sur moi laisse le fait,
Je t'en supplie, amie,
Car mort j'aurai pour vie,
Si autrement ne fait.
A ces vers obscurs et incorrects, la comtesse de Chateaubriant répondait par de douces paroles de consolation, et la reine de Navarre, pour chasser les derniers nuages de tristesse, racontait alors quelqu'une de ces nouvelles d'amour et de galanterie qui devaient plus tard former l'Heptaméron.
Charles-Quint surveillait, avec une visible inquiétude, la petite cour qui entourait son prisonnier; toutes ces fêtes intimes lui paraissaient cacher quelque projet d'évasion. François Ier ne songeait nullement à tromper la surveillance de ses gardiens; mais, réconforté par la présence de sa soeur Marguerite et de sa bien-aimée Françoise, il avait conçu un autre plan, beaucoup moins hasardeux, et tout aussi propre à tromper les ambitieuses espérances de son vainqueur.
Entre sa soeur et sa mie, François Ier écrivit un acte solennel d'abdication. Cet acte donnait au Dauphin le titre de roi de France, la reine nommée régente prenait la direction des affaires, et lui-même, devenu simple gentilhomme, ne présentait plus aucune garantie sérieuse à celui qui le retenait.
La reine Marguerite emporta, caché dans un des plis de sa robe, cet acte qui ôtait la couronne du front de son frère. Le temps accordé par le sauf-conduit venait d'expirer, et la belle reine de Navarre, toujours suivie de son escorte de dames, avait dû regagner la France.
Lorsque Charles-Quint apprit l'existence de l'acte d'abdication, il était trop tard, la soeur du roi de France avait passé la frontière.
Cette résolution, véritablement chevaleresque, ne fut jamais exécutée, les rigueurs de la captivité devaient avoir raison des projets de François Ier.
Après le départ de la reine Marguerite et de madame de Chateaubriant, la captivité du roi de France devint plus rigoureuse que jamais: Charles-Quint était décidé à obtenir toutes les concessions qu'il avait demandées, et il ne voulait plus attendre davantage. Le prisonnier était retombé malade, la régente se vit forcée de s'exécuter. Un traité minutieusement rédigé fut signé à Madrid, et après un an et un mois de captivité, le roi de France put revoir son royaume.
L'heure de la délivrance de François Ier, si impatiemment attendue par la comtesse de Chateaubriant, fut le signal de sa disgrâce. Elle avait compté, l'infortunée, sans l'inconstance de son amant, sans la haine que lui portait Louise de Savoie.
En arrivant à Bayonne, François Ier trouva sa mère, qui, «jalouse d'être agréable à son fils, avait amené avec elle un brillant cortège de dames et de demoiselles.» Il s'éprit aussitôt d'un fol amour pour la plus belle d'entre elles, la jeune de Heilly, qu'on appelait aussi Anne de Pisseleu et qui devint la duchesse d'Étampes.
Louise de Savoie joua en cette circonstance un assez triste rôle: dans son désir de renverser son ancienne rivale en influence, la comtesse de Chateaubriant, elle avait longtemps à l'avance stylé la belle de Heilly; elle la poussa, pour ainsi dire, entre les bras de son fils.
Sunt regum matres nonnunquam filiorum suorum leonæ, dit assez brutalement Corneille Agrippa, un rhéteur, alors astrologue de la reine mère; ce qui signifie qu'une mère de roi, lorsqu'il s'agit d'assurer son pouvoir, ne regarde pas à donner une maîtresse à son fils.
En apprenant qu'elle avait une rivale véritablement aimée, la comtesse de Chateaubriant fut saisie d'une douleur mortelle. Cependant elle ne voulut point s'avouer vaincue sans combattre: elle reparut à la cour, elle croyait pouvoir disputer le coeur de François Ier, mais elle n'arriva que pour être témoin du triomphe de mademoiselle de Heilly. Elle était à tout jamais sacrifiée.
Telle était déjà l'influence de l'adroite Anne de Pisseleu sur son amant, qu'elle fit commettre au roi-chevalier un de ces actes inqualifiables dont rougirait aujourd'hui le plus grossier bourgeois.
Au temps heureux de sa faveur, alors que reine et maîtresse elle voyait la cour à ses pieds, la belle Françoise avait reçu de son royal amant de riches bijoux, ornés d'amoureux emblèmes ou de galantes devises composées par la reine de Navarre.
Vaniteuse, jalouse, désireuse d'essayer son pouvoir naissant, mademoiselle de Heilly exigea du roi qu'il redemandât à son ancienne maîtresse tous les présents dont il l'avait comblée.
François Ier, dans l'aveuglement de sa passion, eut la faiblesse d'y consentir.
Il envoya vers la comtesse un de ses gentilshommes, chargé d'exiger la restitution de tous ces gages d'amour, souvenirs des heures de bonheur, mille fois plus chers à la favorite depuis qu'elle était délaissée.
«Madame de Chateaubriant, dit Brantôme, fit la malade sur le coup, et remit le gentilhomme dans trois jours à venir et qu'il aurait ce qu'il demandait.
«Cependant de dépit, elle envoya quérir un orfèvre et luy fit fondre tous ses joyaux, sans respect ni exception des belles devises qui y étaient engravées. Et après, le gentilhomme étant revenu, elle lui donna tous les joyaux converti lis et contournez en lingots d'or.
«—Allez, dit-elle, portez cela au roy, et dites-luy que puisqu'il luy a pleu de me révoquer ce qu'il m'avait donné, je le luy rends et renvoye en lingots. Pour quant aux devises, je les ay si bien empreintes et colloquées en ma pensée et les y tiens si chères, que je n'ay peu permettre que personne, en disposast, en jouist, et en eust du plaisir que moy-mesme.
«Quant le roy eut receu le tout, et lingots et propos de cette dame, il ne fit autre chose sinon:
«—Retournez-luy le tout; ce que j'en faisais ce n'était point pour la valeur, car je lui eusse rendeu deux fois plus, mais pour l'amour des devises; mais puisqu'elle les a fait ainsi perdre, je ne veux point de l'or et le luy renvoye. Elle a monstré en cela plus de courage et générosité que n'eusse pensé pouvoir provenir d'une femme.»
Et Brantôme ajoute en manière de moralité:
«Un coeur de femme généreuse dépité et ainsi dédaigné fait de grandes choses.»
Délaissée par le roi, persécutée par la reine mère qui voyait en elle une ancienne rivale de puissance et protégeait mademoiselle de Heilly, la belle, la tant aimée comtesse de Chateaubriant dut se résigner à quitter cette cour qui déjà l'avait oubliée pour la nouvelle favorite.
Elle ne songea plus qu'à rentrer en grâce près de son mari, homme infortuné qu'elle avait outragé dans ses affections les plus saintes. Elle connaissait le sire de Laval, elle espérait qu'à l'ardent amour qu'il avait jadis pour elle avait succédé un peu de pitié.
Elle partit donc pour la Bretagne.
Que de fois, le long de ce douloureux voyage, incertaine du sort qui l'attendait, elle répéta les derniers vers de son horoscope:
Du fait du roi aura grand heur,
Las! puis grand malheur!
Ici le roman prend la place de l'histoire.
Peu satisfait, sans doute, du vulgaire dénouement des amours de la belle maîtresse de François Ier, l'historien Varillas a jugé convenable d'y substituer un drame lugubre qui fait plus d'honneur à son imagination qu'à son amour pour la vérité.
Mainte fois répétée, amplifiée, tantôt en vers, tantôt en prose, la légende de Varillas a fini par prendre assez de consistance pour qu'il soit nécessaire de la mentionner, ne fût-ce que pour en démontrer l'invraisemblance.
Voici donc la tragique histoire qu'avec le plus beau sang-froid du monde raconte cet historien de François Ier.
Par une triste soirée d'hiver, une femme suivie d'un petit nombre de serviteurs vint frapper à la porte du manoir de Combourg; les domestiques se hâtèrent d'ouvrir.
Alors cette femme, qui n'était autre que la belle Françoise, insista pour voir, sur l'heure, le sire de Laval.
Le comte de Chateaubriant, prévenu, parut presqu'aussitôt.
En reconnaissant sa femme, il ne témoigna aucune surprise, son pâle visage ne trahit pas la plus légère émotion.
—Je vous attendais, madame, dit-il, et j'ai fait préparer votre appartement, vous êtes ici chez vous.
Offrant alors la main à la comtesse toute frissonnante devant ce calme impitoyable, il la conduisit à la chambre qui avait autrefois été leur chambre nuptiale.
—Voici, madame, dit-il, quelle sera désormais votre demeure.
Et il sortit implacable et froid comme la vengeance.
La comtesse était tombée évanouie sur le carreau, à l'aspect de la demeure que lui réservait son mari, et certes il y avait de quoi.
Aux riches tapisseries de l'appartement, on avait substitué des draperies noires, le lit était tendu de noir; les fenêtres avaient été murées, et une petite lampe d'église suspendue à une des poutres du plafond jetait seule quelques lueurs blafardes dans ce morne intérieur.
La comtesse vécut dix mois dans ce sépulcre, et chaque jour son mari venait se repaître de sa douleur et de ses larmes.
Lorsque parfois elle se jetait à ses genoux et les mains jointes lui demandait grâce:
—Avez-vous eu pitié de moi, répondait-il, lorsque vous m'avez abandonné, épouse déloyale, pour suivre votre amant?
D'autres fois l'infortunée comtesse suppliait ce barbare de lui permettre de revoir une fois encore la lumière du jour, de respirer, ne fût-ce qu'un instant, l'air pur du dehors.
Alors avec un rire effrayant il disait:
—Pourquoi le roi François, qui vous aimait tant, ne vient-il pas vous arracher à ce sépulcre? Où donc sont les belles fêtes de la cour? Que sont devenus vos amants? Pensez-vous que Clément Marot fasse encore des vers à votre louange?
Enfin, au bout du dixième mois, le comte, trouvant que sa femme ne mourait pas assez vite, pénétra un jour dans la chambre tendue de noir, avec six hommes masqués et deux chirurgiens.
—Faites votre devoir, dit-il.
Aussitôt ces maîtres bourreaux saisirent la comtesse et lui tirèrent tout le sang des veines. La vie s'exhala avec la dernière goutte.
Pour comble d'horreur, Varillas donne à la comtesse qui n'eut jamais d'enfants une petite fille qui partagea le tombeau de sa mère, mais qui, ne pouvant supporter cette horrible captivité, mourut au bout de deux mois, sous les yeux du sire de Laval.
Tel est le roman de Varillas, roman qu'accepte Sauval de la meilleure foi du monde; il ajoute que le comte de Chateaubriant tua sa femme pour pouvoir se remarier.
Malheureusement pour ce lugubre drame, une foule de preuves en démontrent la fausseté.
Depuis longtemps le sire de Laval avait pris son parti de l'infidélité de sa femme. Il dut à sa toute-puissance sur l'esprit du roi un avancement considérable qu'il accepta de la meilleure grâce du monde.
Ceci seul suffirait pour exclure la supposition de l'horrible vengeance; mais ce n'est pas tout. Plusieurs chroniques affirment que la comtesse de Chateaubriant reparut plusieurs fois à la cour après le triomphe de mademoiselle de Heilly. Après avoir été la maîtresse du roi elle sut rester son amie, et dans un recueil des lettres de François Ier, on trouve une réponse de la comtesse qui remercie son ancien amant d'une riche broderie qu'il a eu la galanterie de lui envoyer.
Enfin, il se trouve que, bien des années après celle où Varillas place son horrible drame, François Ier a visité le manoir de Chateaubriant, à deux reprises il y a passé quelques jours et y a même signé des édits. Or jamais le roi n'eût fait cette faveur à l'assassin d'une femme qui avait été sa maîtresse bien-aimée.
La vérité est que la belle Françoise de Foix, réconciliée avec son mari, vécut dans la retraite, jusqu'à l'époque de sa mort, qui arriva le 15 octobre de l'année 1537.
A la mort de sa femme, le sire de Laval fit éclater une grande douleur, et lui fit élever un magnifique tombeau dans l'église des Mathurins de Chateaubriant.
Clément Marot, qui se souvenait de celle qui avait été sa protectrice, fit pour elle, à la demande du comte, l'épitaphe gravée sur le socle de marbre qui soutenait sa statue: