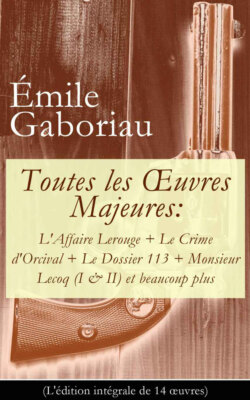Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VI LA BELLE FERRONNIÈRE
ОглавлениеTable des matières
Pour donner la vie au portrait de cette belle maîtresse de François Ier, il fallait toute la puissance d'un artiste de génie, de Léonard de Vinci, l'hôte bien-aimé du roi de France. Seul le pinceau d'un grand maître pouvait rendre la désolante perfection de cette tête charmante, ce col d'un dessin si ferme et si exquis, ce front blanc et pur, cette bouche divine qu'effleure un doux sourire, et ces grands yeux ombragés de longs cils, ces yeux adorables d'expression et de langueur.
Que nous reste-t-il aujourd'hui, cependant, de cette femme si radieusement belle? Un bijou, que les châtelaines portaient au front comme un diadème, et le portrait du Louvre, un chef-d'oeuvre.
N'est-il pas étrange que rien ne soit venu jusqu'à nous de l'histoire de cette femme si célèbre, rien absolument? A son égard, les histoires du temps se taisent, les chroniques sont muettes, ou prononcent à peine son nom, sans une anecdote, sans un détail. O poëtes, ô beaux esprits de la cour de François Ier, quelle école buissonnière faisait donc alors votre muse? à quelle étoile adressiez-vous vos hommages? Quoi! vous si prodigues d'ordinaire et d'encens et de rimes, vous n'avez pas trouvé une louange, pas un sonnet pour la plus radieuse de toutes celles qui devant leur beauté virent ployer le genou royal!
C'est que la belle Ferronnière ne fut point une femme politique, ses intrigues ne divisèrent pas les gentilshommes. On ne trouve pas un seul édit qui la concerne, pas une donation. Elle ne demanda la grâce d'aucun grand coupable, on ne lui accorda pas le brûlement d'un seul hérétique.
Nul donc ne peut dire ce qu'ont été les amours de François Ier et de la belle Ferronnière, on en est réduit à des conjectures, c'est-à-dire à rien. Il est impossible en effet d'ajouter la moindre foi aux cinq ou six versions mises en circulation depuis, et brodées sur un même thème, saugrenu, malpropre, invraisemblable.
Tel qu'il est cependant, ce thème a fait fortune, et des historiens extrêmement sérieux en ont tiré de surprenants aphorismes moraux et en ont fait le sujet de tirades aussi longues que fastidieuses.
Voici ce que dit Mézeray, un historiographe plus grave que si quatre têtes de docteurs en Sorbonne eussent logé sous son bonnet:
«En 1538, le roi fut grièvement malade d'un fâcheux ulcère. Ce mal, disait-on, était un effet d'une mauvaise aventure qu'il avait eue avec la belle Ferronnière, l'une de ses maîtresses. Le mari de cette femme, désespéré d'un outrage que les gens de cour n'appellent que galanterie, s'avisa d'aller en un mauvais lieu s'infecter lui-même, pour la gâter et faire passer sa vengeance jusqu'à son rival. La malheureuse en mourut; le mari s'en guérit par de prompts remèdes. Le roi eut tous les fâcheux symptômes, et comme les médecins le traitèrent selon sa qualité plutôt que selon son mal, il lui en resta toute sa vie quelques-uns.»
Saint-Foix adopte l'opinion de Mézeray, mais il dramatise considérablement le récit. Il met en scène un moine,—un affreux moine, retour de Naples, et il en fait tout à la fois le conseiller et l'instrument de la vengeance du mari outragé.
Enfin dans presque toutes les histoires de France, il est dit expressément que François Ier mourut des suites de cette abominable machination.
A tout ceci il n'y a qu'une objection véritablement inattaquable, mais elle est capitale:
Léonard de Vinci, l'inimitable auteur du portrait de la belle Ferronnière, est mort le 2 mai 1519. L'amour du roi pour le charmant modèle est par conséquent antérieur à cette date. Ce qui fait, nécessairement, remonter tout ce roman aux belles années du règne de François Ier, lorsqu'il était encore dans toute la force de la jeunesse, c'est à-dire avant sa captivité de Madrid, avant sa passion pour Anne de Pisseleu, avant son mariage avec la princesse Eléonore. François Ier est mort plus de vingt-cinq ans plus tard (1547). Il faut avouer que le poison, si poison il y eut, fut lent à agir.
Quelle était la condition de la belle Ferronnière? c'est ce qu'on ne saurait décider non plus. Etait-elle, comme on le prétend, la femme d'un avocat, ou d'un drapier, ou d'un certain Féron? avait-elle été baladine, avait-elle dansé et chanté dans les rues avant d'épouser un marchand de fers? Cette dernière hypothèse est la plus probable, son surnom lui viendrait alors de la profession de son mari. A Lyon, on appelait Louise Labé la belle cordière.
Au milieu de toutes ces contradictions, mieux vaut s'abstenir. Une seule chose est certaine, c'est qu'on ne sait rien: peut-être même douterait-on de l'existence de la belle Ferronnière, sans le beau portrait de Léonard de Vinci, chef-d'oeuvre que ne fait point pâlir l'admirable toile de la Joconde.
François Ier eut bien d'autres maîtresses encore, mais elles ne jouèrent aucun rôle, amours de hasard et de passage, caprices d'un jour, à quoi bon en parler? Ah! le roi-chevalier n'y allait pas de main morte. Ecoutons, pour finir, le seigneur de Bourdeilles, qui tient à donner une idée du caractère chevaleresque de ce roi dont il fut le courtisan:
«J'ai ouï parler que le roi François, une fois, voulut aller coucher avec une dame de la cour qu'il aimait. Il trouva son mari l'épée au poing, pour l'aller tuer; mais le roi lui porta son épée à la gorge, et lui commanda sur sa vie de ne lui faire aucun mal, et que s'il lui faisait la moindre chose du monde, qu'il le tuerait ou qu'il lui ferait trancher la tête, et pour cette nuit, l'envoya dehors et prit sa place.... J'ai ouï dire que plusieurs autres dames obtinrent pareille sauvegarde du roi.»
Et des panégyristes se sont trouvés pour faire l'éloge du caractère chevaleresque et de la galanterie raffinée de François Ier! Pourquoi pas de la protection qu'il accordait aux dames?
Si tels doivent être absolument les rois-chevaliers, à tout jamais le ciel nous en préserve!