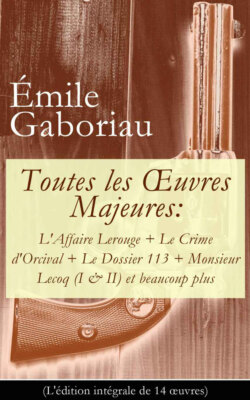Читать книгу Toutes les Œuvres Majeures - Emile Gaboriau - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
IX LE VERT GALANT
ОглавлениеTable des matières
Vive Henri-Quatre!
Vive ce roi vaillant!
Ce diable à quatre
A le triple talent
De boire et de battre
Et d'être un vert-galant.
Ce refrain d'une chanson dont la Restauration fit en quelque sorte une marseillaise royaliste ou tout au moins une antienne politique, nous représente admirablement le caractère de Henri IV.
Il y avait du soudard dans ce roi qui passa une partie de sa vie dans les camps, et qui après la bataille fêtait joyeusement avec ses compagnons le vin du crû, ou allait demander l'hospitalité à quelqu'une des maîtresses qu'il avait toujours dans les environs.
On attribue même à Henri IV le second couplet de la chanson:
J'aimons les filles,
Et j'aimons le bon vin.
De nos vieux drilles
Répétons le refrain:
J'aimons les filles,
Et j'aimons le bon vin.
Certes ce couplet ne dut pas coûter de grands efforts d'imagination au roi, mais il fit plus pour sa popularité que ses victoires et sa proverbiale bonté.
Nous sommes toujours les vieux Gaulois; gaîté et gaillardise sont des fleurs naturelles du terroir. Lorsque notre maître sent, pense, agit comme nous, ce n'est plus un maître, c'est un des nôtres. Il est à nous, nous sommes à lui.
Et ceci n'est point un paradoxe. D'ailleurs la thèse n'est pas nouvelle: le marquis de Belloy l'a soutenue dans un livre brillant[5] dont je vais sans façon détacher une page ou deux:
«Oui, la gaillardise est un instrument d'autorité, un moyen d'ascendant, et c'est là ce qu'ont méconnu les meilleurs de nos souverains, nobles coeurs, mais petits esprits, faibles tempéraments à qui le Diable-à-quatre a vainement enseigné l'art, le seul art d'être populaire en ce pays; car pour en revenir à Henri IV, à quoi doit-il d'être encore aujourd'hui
Le seul roi dont le peuple ait gardé la mémoire?
«A la poule-au-pot? mais il ne l'a jamais donnée cette fameuse poule-au-pot, que personne plus que lui ne donnera jamais au peuple: voyez le prix dont elle est maintenant.—A ses victoires, à sa bonté, à son génie? Pas davantage: saint Louis aussi, et combien d'autres ont été des victorieux! Louis XII fut le père du peuple, et qui le connaît ce père du peuple? Ah! s'il l'eût été comme ce bon roi d'Yvetot, passe encore.
«Non, le secret de la popularité d'Henri IV, demandez-le à la chanson, à la plus populaire de nos chansons: J'aimons les filles.... Mais tout le monde la sait par coeur, même les dévots, même les plus graves.
«Le fils du Vert-Galant égalait au moins son père en bravoure. S'il n'eut pas de génie, il sut se donner un ministre qui en avait, et bien qu'il le haït à juste titre, il le supporta, il s'effaça devant lui pendant tout son règne, par dévoûment pour ses sujets. Quel plus noble exemple de sagesse et d'abnégation! Personne cependant ne lui en sut gré. Pourquoi? Parce qu'il n'aima pas les filles et le bon vin, parce qu'il ne fut pas un diable-à-quatre, un joyeux drille, un gaillard; parce qu'il prit un jour des pincettes pour tirer un billet du sein d'une dame; et, en vérité, c'étaient bien des façons.—Je tiens de mon père, disait-il, je sens le gousset.—Il s'agissait bien du gousset!
«Louis XIV s'y était mieux pris: il avait débuté, tout jeune, par faire l'amour sur les toits pour que tout le monde le vît: c'était le programme du nouveau règne. Aussi, pendant longtemps, sa popularité fut-elle immense, d'autant plus que les suites répondirent aux commencements; mais il perdit par le confessionnal tout ce qu'il avait gagné de terrain par les gouttières.
«Tant qu'on lui crut encore une ou deux maîtresses au moins, on lui pardonna sa grandeur, on lui aurait même passé sa piété; mais dès qu'entre autres choses on sut que madame de Maintenon n'était que sa compagne légitime, au lieu de tout ce qu'on avait espéré, il n'y eut qu'un cri, pour le coup, du Rhin jusqu'aux Pyrénées. Quelle trahison en effet, quel détestable abus de confiance! Le tartufe! le faux gaillard! De ce moment la popularité du grand roi s'écroula, son nom tomba dans le mépris. Ses faiblesses ne lui furent comptées pour rien; on ne vit plus que sa vertu. Il perdit le coeur de son peuple.
«Poursuivons! L'histoire de France ne saurait trop être envisagée à ce point de vue.
«Parlez-moi du régent: en voilà un gaillard! et Dubois, son ministre, la gaillardise en chapeau rouge! et ce charmant roi Louis XV, Louis le bien-aimé!—Mais qu'ai-je donc fait à ce bon peuple pour qu'il m'aime tant? disait-il.—Ce que vous avez fait, Sire? Rien encore peut-être, vous êtes si jeune!—Il avait quatre ans,—mais on pressent ce que vous ferez. On lit dans vos yeux que vous ne serez pas comme votre aïeul Louis le Grand, Louis le délicat, Louis le dégoûté, dont le coeur était comme l'abbaye de Remiremont: pour y mettre il fallait prouver trente-deux quartiers de noblesse. Vous n'y regarderez pas de si près, ni de si loin. Vive l'égalité, morbleu! Vous prendrez vos maîtresses de toutes mains; la dernière fille du peuple, aussi bien que la plus grande dame, pourra être appelée à trôner un quart d'heure sur vos genoux: et si on la décrasse, si on la parfume pour la circonstance, volontiers direz-vous peut-être comme le bon Henri: Ah! les malheureux! ils me l'ont gâtée.»
Heureusement pour les plaisirs d'Henri IV, on ne lui gâta pas toutes ses maîtresses, surtout dans les commencements. Il aimait alors où il pouvait et quand il pouvait, des cuisines jusqu'aux combles; et Dieu sait les aventures, bonnes et mauvaises, mauvaises le plus souvent, autant vaudrait dire toujours. Il n'eut point de bonheur en amour, le roi vert-galant; mais il prenait gaîment son parti des trahisons, il était si disposé à trahir lui-même.
Aventureux en amour comme en guerre, il s'en allait contant fleurettes à toutes celles qu'il trouvait sur son passage, jolies ou laides. Au besoin il promettait mariage: ce n'est point pour rien qu'on le surnomma le roi prometteur. Il allait même jusqu'à donner des promesses écrites. Devenu roi, il conserva toutes les habitudes d'un soldat de fortune.
Lorsqu'il n'avait que la cape et l'épée, le rachat de ses promesses ne lui coûtait guère; il en fut autrement lorsqu'il eut échangé la couronne de France contre une messe: il fallait alors débourser de beaux écus. Sully grondait, mais il payait; c'était son métier d'être économe pour son maître, et il avait besoin d'être économe. Outre qu'Henri aimait le vin et les filles, il ne détestait pas le jeu, et il n'y avait pas plus de chances qu'en amour.
Alors il écrivait à Sully:
«Mon ami, j'ai perdu au jeu vingt-deux mille pistoles (plus de six cent mille francs de la monnaie de nos jours); je vous prie de les distribuer incontinent aux particuliers auxquels je les dois.»
Aux remontrances de Sully:
«Ventre-saint-gris, disait Henri IV, n'ai-je pas assez travaillé pour mes peuples, et ne puis-je pas prendre un peu de bon temps?»
De loin la bonhomie d'Henri IV ne paraît pas toujours d'un très-franc aloi. Il est à croire que souvent sa rondeur et sa rude franchise ne furent qu'un masque; il excellait à mettre en scène, et il ne sentait guère le besoin de promener ses enfants sur son dos que lorsqu'il devait recevoir l'ambassadeur du roi d'Espagne.—«Vous êtes père, monsieur l'ambassadeur?—Oui, Sire.—Alors, j'achèverai la promenade.»
Il promit toujours plus de poule-au-pot qu'il ne donna de pain; mais promettre est un grand art en ce beau pays de France. En attendant, on pendait les braconniers haut et court.
Il ne faudrait pas croire cependant qu'Henri IV se ruina pour toutes ses maîtresses. Au commencement, se ruiner lui eût été difficile; il n'avait pas alors toujours un pourpoint neuf pour remplacer son pourpoint déchiré; en ce temps il empruntait au lieu de donner, et deux de ses amies au moins contribuèrent puissamment à payer ses partisans et ses adversaires, ses adversaires surtout.
L'histoire ne nous dit point que le roi se soit jamais préoccupé de rendre ce qui avait été prêté au pauvre prétendant.
Le scandale de ses amours n'offensait d'ailleurs que quelques calvinistes austères ou quelques catholiques défiants. Les pamphlets pleuvaient alors; la langue latine se prêtant à toutes les licences, on dépeignait les abominations du huguenot converti. Jusque sur les murs du Louvre on osait afficher les placards les plus injurieux. D'autres fois c'était seulement des conseils un peu aigres:
Hérétique point ne seras
De fait ni de consentement;
Tous tes péchés confesseras
Au Saint Père dévotement;
Les églises honoreras,
Rétabliras entièrement;
Bénéfices ne donneras
Qu'aux catholiques seulement;
Ta bonne soeur convertiras
Par ton exemple doucement;
Tous les ministres chasseras,
Les huguenots pareillement;
La femme d'autrui tu rendras
Que tu retiens paillardement;
La tienne tu reprendras,
Si tu peux vivre saintement;
Justice à chacun tu feras,
Si tu veux vivre longuement;
Grâce ou pardon ne donneras
Contre la mort uniquement;
Ce faisant tu te garderas
Du couteau de frère Clément.
Ce funeste pronostic qui devait se réaliser n'épouvantait point Henri IV; il ne changea jamais rien à son genre de vie pas plus qu'à sa politique. Mais nous n'avons point ici à juger le roi ni l'habile homme de gouvernement qui, louvoyant entre les partis, sut arriver au trône et créer une France forte et une, et qui, au faite de sa puissance, rêva, dit-on, une fédération européenne et la paix universelle. Le gaillard seul est de notre compétence.
Henri de Bourbon avait été dans sa jeunesse un assez beau cavalier; sa taille au-dessus de la moyenne était bien prise; il avait l'air noble, le regard spirituel et fier, le teint et les cheveux bruns; son nez, d'une courbure un peu trop aquiline, donnait à son visage une expression de résolution, et son front haut et découvert dénotait une intelligence pratique que la finesse de sa bouche légèrement contractée aux commissures ne démentait point.
Les fatigues de la guerre le vieillirent de bonne heure; sa barbe en éventail se nuança de fils d'argent; le nez, ce trait saillant de sa physionomie, s'allongea et se recourba davantage, tandis que son menton se projetait en avant, effaçant de plus en plus la bouche dégarnie de ses dents sous ses moustaches raides et grisonnantes.
Mais s'il perdit, avec l'âge, la régularité et la bonne grâce de ses traits, en revanche sa physionomie s'empreignait d'un grand caractère de bonté sereine et de bienveillance sympathique; en somme le masque d'Henri IV est de ceux qui attirent, et Lavater lui pardonnerait la flamme égrillarde de ses yeux à cause de l'aménité de son sourire.
Naturellement simple, il poussait jusqu'à la négligence et presque à l'incurie le soin de sa personne et le détail de son habillement; sa garde-robe fut toujours des plus élémentaires, et ce n'est pas par ses agréments extérieurs qu'il dut jamais séduire ses nombreuses conquêtes.
Il est difficile, impossible même de suivre le Vert-Galant dans toutes ses équipées amoureuses. «Le roi avait un grand faible pour les femmes, dit hypocritement Bassompierre, et il en résultait des scandales.» Tallemant des Réaux prétend de son côté qu'Henri faisait plus de bruit que de besogne et qu'il n'était pas «grand abatteur de bois.» Mais Tallemant écrivait après les fatigues de la guerre.
On ferait un calendrier avec le nom de toutes les saintes que fêta ce dévot de la beauté. Son histoire amoureuse commence comme une idylle: il s'adressa d'abord à des déesses en jupons courts, vertus champêtres faciles à séduire: il inscrivait alors sur sa liste des noms obscurs de paysannes, de boulangères, ou de filles de service. «Il aimait le torchon,» dit avec amertume l'austère d'Aubigné.
De tous ces noms un seul est venu jusqu'à nous, sauvé de l'oubli par une légende naïve, celui de Fleurette. Les poëtes de mirlitons se sont emparés de l'histoire de la jardinière de Nérac et l'ont arrangée pour les besoins de la romance et de l'Opéra-Comique. Mais ces amours furent beaucoup moins poétiques, et le père de Fleurette, un homme brutal, obligea une fois le prince à sauter par la fenêtre.
Fleurette eut un enfant de Henri IV et le poëte Dufresny était arrière-petit-fils de la belle jardinière. Voltaire assure qu'il ressemblait à son bisaïeul, et que son origine était la véritable cause de la bienveillance de Louis XIV à son égard. Dufresny tenait de son grand-père. Le grand roi avait renoncé à l'enrichir, la France n'y eût pas suffi; le poëte finit par épouser sa blanchisseuse, seul moyen en son pouvoir d'acquitter la note de ses jabots et de ses manchettes.
Les voyages forment la jeunesse. Henri IV eut bientôt un champ plus vaste pour ses exploits galants. Dans ses courses aventureuses, nous le voyons chaque jour entamer le premier chapitre d'un roman nouveau, et quels romans! Le burlesque à chaque instant menace de tourner au tragique: on dégaîne les épées, il pleut des coups de bâton. Déguisé en palefrenier, le roi s'élance sur une échelle qui doit le conduire auprès de sa belle; mais les échelons ont été sciés à l'avance, et voilà le galant par terre. Heureusement quelques-uns de ses compagnons faisaient le guet.
Une autre fois il s'agit encore d'une fenêtre; elle était au rez-de-chaussée, il n'y avait pas besoin d'échelle. Notre prince d'aventures arrive au milieu de la nuit, pousse le volet entr'ouvert et saute dans la chambre. Il court au plus pressé, c'est-à-dire au lit; la belle n'y était pas, mais bien un galant plus favorisé, un galant qui avait le poignet solide. Pourtant, l'obscurité aidant, Henri put s'échapper sans esclandre.
Moins heureux dans une autre circonstance, il perdit à la bataille son pourpoint et son haut-de-chausses, et dut s'enfuir dans un appareil trop primitif, en criant à l'aide.
Tout n'était pas profit, non plus, dans le métier d'ami du prince, et à deux ou trois reprises de hardis compagnons qu'il avait envoyés en reconnaissance emboursèrent pour le compte de leur maître de bonnes volées de bois vert.
Mais à quoi bon s'appesantir sur ces amours vulgaires? Faut-il nommer toutes ces femmes inconnues qu'énumèrent des compilateurs plus inconnus encore: Catherine du Luc, mesdemoiselles de Montagu et de Tignonville, la fille du président Rebours, mesdames de Petonville Aarssen, de Ragny, de Boinville, Le Clein et tant d'autres?
Il en est qu'une anecdote, une circonstance fortuite détachent de la trame banale de la chronique scandaleuse: c'est d'Ayelle, cette charmante Cypriote, aussitôt délaissée que séduite; dame Martine, femme d'un docteur de La Rochelle, à qui il fit oublier ses devoirs et le bonnet carré de son époux, ce qui lui valut des réprimandes publiques au prêche, mademoiselle de la Bourdaisière, fille d'honneur de la reine Louise, veuve de Henri III, qui l'occupa quelque temps, dans l'intervalle d'une de ses brouilles avec la marquise de Verneuil; la comtesse de Limoux, dont la faveur dura également le temps d'une lune rousse; l'abbesse de Vernon, qui, dit Bassompierre, «le gratifia d'un Souvenez-vous de moi qui ne le rendit pas plus prudent;» Catherine de Verdun, autre religieuse, «vrai ragoût de huguenot;» Louise Marguerite de Lorraine, qu'il eût peut-être épousée, «s'il n'avait, dit Sully, appréhendé la trop grande passion qu'elle témoignait pour sa maison, et surtout pour ses frères;» mademoiselle Paulet, «qu'il allait voir à l'hôtel de Zamet quand il fut assassiné en la rue de la Ferronnerie,» prétend Sauval; etc., etc.
Mais ne nous occupons que des figures qui appartiennent à l'histoire. Celles des amours de Henri IV qui y ont leur place marquée ne commencèrent qu'après son mariage avec Marguerite de Navarre, et pendant qu'il était retenu prisonnier à la cour de France.
Ce fut une union singulière que celle de Marguerite et de Henri de Navarre. Belle, spirituelle, enjouée, la jeune princesse eût pu prendre un ascendant sans contrepoids sur le coeur de son époux, ou tout au moins le fixer pour toujours, mais elle ne le tenta même pas. Elle se maria pour obéir à la politique de sa mère et ne changea rien à son genre de vie; or chacun connaît le genre de vie de la docte Marguerite: ses aventures avaient été au moins aussi nombreuses que celles de Henri; on ne comptait plus ses amants, et on disait tout bas à la cour que ses frères eux-mêmes avaient eu part à ses faveurs.
Cette union n'eut point de lune de miel; tout au plus fut-ce une association politique, et Marguerite, on doit lui rendre cette justice, fut une alliée fidèle. Les deux époux, au lendemain de leur mariage, se regardèrent comme aussi libres que par le passé. Ils n'attendirent même pas au lendemain. Le soir même de la célébration des noces, Henri se contenta de conduire sa femme jusqu'à son appartement; après de cérémonieuses salutations, il se retira, et la porte était à peine fermée sur lui que la fenêtre de Marguerite s'ouvrait à l'élu du moment.
Henri aimait alors Charlotte de Beaune-Samblançay, dame de Sauves, marquise de Noirmoustier. Charlotte, dame d'atours de Catherine de Médicis, avait été élevée à son école. Autant par sa beauté que par sa coquetterie et son esprit, elle servait la politique de la reine-mère, qui n'eut jamais de plus aveugle instrument de ses volontés.
Les galanteries de madame de Sauves suffiraient à défrayer des volumes, et cinq ou six galants se partageaient ses faveurs. C'est cette femme cependant qu'aimait ou faisait semblant d'aimer le jeune roi de Navarre. Les chroniques n'ont point de mots assez forts pour peindre la violence de la passion de Henri; elles racontent que les coquetteries de madame de Sauves faillirent plusieurs fois armer l'un contre l'autre le Béarnais et le duc d'Alençon.
Les chroniques se trompent. Aussi rusé au moins que Catherine de Médicis, Henri ne se servit de l'espionne qu'elle avait jetée dans son lit que pour mieux tromper l'Italienne sur son caractère et sur ses véritables intentions. Cette liaison dura jusqu'au moment où le roi de Navarre put s'enfuir de la cour de France, c'est-à-dire vers la fin de février 1576. Plus tard madame de Sauves, qui avait conservé un bon souvenir de Henri, lui rendit d'importants services en l'avertissant des véritables intentions de la cour à son égard.
C'est dans la maison même de la reine sa femme que Henri devait trouver celle qui lui inspira sa première passion sérieuse. La petite cour du roi de Navarre s'ennuyait profondément à Nérac, quand l'époux in partibus de Marguerite s'éprit follement de Françoise de Montmorency, qu'on appelait la belle Fosseuse, suivant l'usage du temps de donner aux noms de femme une terminaison féminine, parce que son père portait le titre de baron de Fosseux.
Toute belle et toute bonne, au dire de la reine Marguerite, Fosseuse ne résista pas longtemps au roi; et bientôt, quelques précautions que prissent les deux amants, leurs rendez-vous ne furent un mystère pour personne. Loin de se fâcher, la reine Marguerite protégeait en secret les amours de son mari. Fosseuse lui rendait service. A cette époque la guerre des Amoureux venait d'éclater, et plusieurs fois Henri faillit être pris ou recevoir quelque arquebusade en allant voir sa belle maîtresse.
Il ne tarda pas à devenir impossible à Fosseuse de dissimuler; elle était enceinte. Le roi dut tout avouer à sa femme, et voilà comment Marguerite dans ses Mémoires s'explique sur cette aventure:
«Le mal prenant à Fosseuse au point du jour, étant couchée en la chambre des filles d'honneur, elle envoya quérir mon médecin et le pria d'avertir le roi mon mari; ce qu'il fit. Nous étions couchés en une même chambre, en divers lits, comme nous avions accoutumé. Lorsque le médecin lui dit cette nouvelle, il se trouva fort en peine, ne sachant que faire, craignant d'un côté qu'elle fût découverte, et de l'autre qu'elle fût mal secourue, car il l'aimait fort. Il se résolut enfin de m'avouer tout et de me prier de l'aller secourir, sachant bien que, malgré tout ce qui s'était passé, il me trouverait toujours prête de le servir en ce qu'il lui plairait. Il ouvre mon rideau et me dit:
«—Ma mie, je vous ai célé une chose qu'il faut que je vous avoue; je vous prie de m'en excuser et de ne point garder souvenir de tout ce que je vous ai dit pour ce sujet. Mais obligez-moi tant que de vous lever tout à l'heure, pour aller à l'aide de Fosseuse qui est fort mal. Vous savez combien je l'aime! je vous en prie, obligez-moi en cela.
«Je lui dis que je l'honorais trop pour m'offenser de chose qui vint de lui, que je m'y en allais et y ferais comme si c'était ma fille propre; que cependant il s'en allât à la chasse et emmenât tout le monde, afin qu'il n'en fût point ouï parler.
«Je fis promptement ôter Fosseuse de la chambre des filles et la mis dans une chambre écartée avec mon médecin et des femmes pour la servir, et la fis très-bien secourir. Dieu voulut qu'elle ne fît qu'une fille qui encore était morte.»
A son retour de la chasse, Henri trouva Fosseuse presque rétablie et toute souriante; il se confondit en remercîments envers la reine Marguerite, mais il ne put obtenir d'elle qu'elle gardât Fosseuse et continuât à lui témoigner la même amitié.
«—Je craignais, dit Marguerite, en lui obéissant, qu'on ne me montrât du doigt.»
Ce devait être le dernier chapitre des amours de Henri et de la belle Fosseuse. Une nouvelle passion allait s'emparer du coeur du frivole monarque, Corisandre d'Andouins.
Ce fut à Bordeaux que, pour la première fois, le roi de Navarre aperçut Diane de Louvigny, comtesse de Gramont-Guiche. La belle Corisandre, dont le nom rappelle ceux des héroïnes de d'Urfé, était la fille unique de Paul, vicomte de Louvigny, seigneur de Lescun; elle avait épousé très-jeune Philibert de Gramont, gouverneur de Bayonne, sénéchal de Béarn, qui, ayant eu un bras emporté d'un coup de canon au siége de la Fère, mourut, quelques jours après, de cette blessure, à l'âge de vingt-huit ans à peine.
De toutes les maîtresses d'Henri IV, la belle Corisandre est celle dont l'amour paraît avoir été le plus vrai et le plus désintéressé.
Pendant qu'il tenait campagne dans les provinces du Midi, elle vendait ses diamants et engageait tous ses biens, faisait la guerre pour lui à ses dépens et lui envoyait des levées de plusieurs milliers de Gascons. Le roi, de son côté, après chaque victoire de ses armes, se dérobait à son armée pour courir dans les bras de sa maîtresse. «L'amour, dit Sully, le rappelait aux pieds de la comtesse de Guiche, pour y déposer les drapeaux pris sur l'ennemi, qu'il avait fait mettre à part pour son usage.»
Il avait promis le mariage à cette belle veuve de vingt-six ans, qui portait un des plus grands noms des provinces méridionales. On lit même, dans les Mémoires de Gramont, qu'il voulut reconnaître le fils que Diane avait eu de Philibert. «Il n'a tenu qu'à mon père, dit le chevalier de Gramont, d'être le fils de Henri IV: le roi voulait à toute force le reconnaître, et ce diable d'homme ne le voulut pas; vois donc ce que seraient les Gramont sans ce beau travers, ils auraient le pas sur les César de Vendôme.»
D'Aubigné détourna le roi de ce projet d'union:—«Il faut, lui dit-il, que vous soyez aut Cæsar aut nihil.... Si vous devenez l'époux de votre maîtresse, le mépris que vous ferez rejaillir sur votre personne vous fermera sans ressource le chemin du trône.»
La correspondance du roi avec la comtesse de Guiche, dont nous avons quelques fragments, est toujours d'ailleurs du ton le plus tendre et le plus respectueux:
«J'arrivai hier au soir de Marans, lui écrivait-il, en 1588. Ah! que je vous y souhaitais! C'est le lieu le plus selon votre humeur que j'aie jamais vu.... L'on peut s'y réjouir avec ce que l'on aime, et plaindre une absence. Je pars jeudi pour aller à Pons, où je serai plus près de vous; mais je n'y ferai guère de séjour. Je crois que mes autres laquais sont morts; il n'en est revenu nul. Mon âme, tenez-moi en votre bonne grâce; croyez ma fidélité être blanche et hors de tache. Il ne fut jamais sa pareille. Si cela vous porte contentement, vivez heureuse.
«Henri.»
Oh! la fine fleur de Gascon qui parle de sa fidélité avec cette assurance! La comtesse savait à quoi s'en tenir sur ce point; moins de six mois après, le roi lui annonçait en ces termes la mort d'un fils qu'il avait eu de quelque maîtresse obscure:
«Mon cher coeur, renvoyez-moi Bryquesières, et il s'en retournera avec tout ce qu'il vous faut, excepté moi. Je suis fort affligé de la mort de mon petit, qui mourut hier. Il commençait à parler.»
La belle Corisandre avait des goûts mondains que lui reprochent les écrits satiriques du temps. Elle allait à la messe escortée de pages, de bouffons, de chiens, de singes, d'animaux privés de toute espèce. Son amant attentif à lui plaire lui écrit encore:
«Je suis sur le point de vous recouvrer un cheval qui a l'entrepas, le plus beau que vous vîtes et le meilleur, force panache d'aigrette. Bonnières est allé à Poitiers pour acheter des cordes de luth pour vous; il sera ce soir de retour.... Mon coeur, souvenez-vous toujours de Petiot.»
Petiot, c'est lui-même.
Plus tard, il lui offre encore un cadeau du même genre.
«J'ai deux petits sangliers privés et deux faons de biche; mandez-moi si vous les voulez.»
Madame de Gramont resta quelque temps encore la maîtresse en titre du roi, même après qu'il eut passé la Loire et fait sa jonction avec l'armée catholique et royale; mais la beauté de Corisandre s'altéra rapidement et le charme se rompit.
Cette rupture fut peut-être précipitée par une nouvelle passion inspirée à Henri par la comtesse de Guercheville. Pourtant cette passion ne fut point heureuse, et madame de Guercheville eut ce rare honneur de résister à l'amour du roi.
C'est pendant sa campagne de Normandie que Henri s'éprit à première vue d'Antoinette de Pons, marquise de Guercheville, veuve du comte de la Roche-Guyon. Tout aussitôt, il lui adressa les billets les plus passionnés; mais les billets restèrent sans réponse. Pour l'aller voir, «il faisait, dit Bassompierre, des traites et des équipées incroyables.» Peines et soins perdus.—«Je suis trop pauvre pour être votre femme, répondait la marquise, et de trop bonne maison pour être votre maîtresse.»
Aux billets cependant succédaient les présents. La marquise ne recevait pas plus les uns que les autres, et l'amour du roi croissait avec les difficultés. Il prit alors une résolution désespérée.
Un jour, à la chasse, il perdit ses compagnons et courut à toute bride demander l'hospitalité à la belle veuve. Il fut reçu comme un roi devait l'être; le cor sonna à son arrivée, le château s'illumina du haut en bas; un souper magnifique fut préparé; la marquise, en grands habits de cérémonie, en fit les honneurs. Henri, tout heureux de cette belle réception, croyait toucher au triomphe; il accablait madame de Guercheville de ses empressements et de ses flatteries, jurant que volontiers il échangerait sa couronne contre un tel trésor de beauté.
L'heure du coucher venue, le roi fut conduit en grande pompe à son appartement par tous les gens de Guercheville. Cet apparat commençait à l'inquiéter, lorsque tout à coup il entendit, dans la cour, un grand bruit de chevaux et d'équipages. La marquise donnait des ordres pour son départ.
Henri descendit tout éperdu, et courant à elle:
«—Quoi! madame, dit-il, je vous chasserais de votre maison!»
«—Sire, répondit madame de Guercheville, un roi est le maître partout où il se trouve; et pour ne vous désobéir en rien, vous trouverez bon que je me retire.»
Et, sans écouter davantage les supplications du prince, elle monta dans son carrosse et alla passer la nuit à deux lieues de là.
Le Gascon, maudissant les vertus provinciales, s'en fut rêver batailles et grands coups d'épée.
Ce mécompte pourtant ne le découragea pas; mais, après deux ou trois autres tentatives aussi infructueuses, il en dut prendre définitivement son parti, et trouva plus tard l'occasion de rendre un public hommage à l'héroïque résistance de la marquise de Guercheville, devenue madame de Liancourt. Il la nomma dame d'honneur de sa nouvelle épouse, Marie de Médicis.
—«Celle-là, dit-il, réhabilitera l'emploi; je connais son honneur, m'y étant frotté.»
Une jeune religieuse, Marie de Beauvilliers, se chargea de panser la blessure de son amour-propre.
Le roi assiégeait alors Paris. Aux heures d'ennui, il allait chercher quelques distractions au couvent de Montmartre, qui était devenu le lieu de rendez-vous de tous les galants de l'armée.
Le joli couvent que c'était là!
Les ribauds de l'armée royale avaient rimé des chansons sur madame l'abbesse et ses nonains. A Paris, les ligueurs hurlaient au scandale et se donnaient de la satire à coeur joie. Cajétan, le légat du pape, ce fougueux prélat qui organisait des processions armées et courait les carrefours en criant Guerra! Guerra! disait à M. de Mayenne, en faisant allusion aux passe-temps de Henri IV:
Con sempre estar en bordello
Ercole non se fato immortello!
S'adressant à une communauté religieuse et venant d'un prince de l'Eglise, le mot était piquant!
Marie de Beauvilliers, que la pauvreté, plutôt que la vocation, avait décidée à faire profession, saisit avec empressement l'occasion qui se présenta de jeter son béguin par-dessus les moulins de Montmartre. Henri IV, une belle nuit, la prit en croupe et la conduisit à Senlis; il lui avait juré amour éternel et lui promettait de la faire relever de ses voeux par le pape.
Ces huguenots ne doutaient de rien!
Mais cette passion ne dura qu'une campagne; ce fut un intermède entre deux batailles. Marie était encore dans la première ivresse de sa fortune que déjà le Vert-Galant songeait à bien autre chose. Décidément, il la trouvait plus jolie sous le béguin.
Triste et repentante, faute de mieux, la pauvre religieuse regagna le couvent de Montmartre; elle en devint abbesse avec la protection du roi; elle entreprit même de réformer les moeurs de ses nonnes; elles en avaient besoin. «Le couvent de Montmartre était alors dans un piteux état, dit Sauval;» les revenus étaient nuls; les plus jeunes religieuses gagnaient leur pain à la pointe de leurs oeillades, et les vieilles étaient réduites à garder les vaches. Marie de Beauvilliers perdit ses soins et ses peines; ses religieuses révoltées faillirent même l'assassiner.
Ici se placent les règnes successifs des deux femmes les plus aimées d'Henri IV, Gabrielle d'Estrées et la marquise de Verneuil; mais leur influence sur les affaires et la politique du temps fut trop grande pour que nous ne leur consacrions pas un chapitre à part. Nous passerons donc tout de suite à la comtesse de Moret.
Jacqueline de Bueil, se fiant à sa figure et à ses charmes, essaya de renverser la marquise de Verneuil, dont l'ambition et les tracasseries fatiguaient Henri IV; mais l'esprit lui manquait; toutes ses petites intrigues ne réussirent même point à lui donner une grande position à la cour. «Un fils qu'elle avait eu du roi, dit Bassompierre, aurait dû cependant lui donner un grand ascendant; elle était malhabile.»
Ce fils, qui fut légitimé sous le nom d'Antoine de Bourbon, et qui, plus tard, joua un rôle à la cour de Louis XIII, sous le nom de comte de Moret, était-il bien de Henri IV? C'est ce dont il est permis de douter.
La comtesse sa mère, en effet, était d'humeur plus que facile, et le roi avait beau monter la garde autour de sa vertu, l'ennemi emportait la place d'assaut; et quel ennemi! le Guise, cet éternel ennemi de Henri de Bourbon, qui, n'ayant pu lui ravir son royaume, s'en vengeait en lui soufflant ses maîtresses.
Nous voici arrivés à la dernière passion de Henri IV, la plus violente et la plus fatale. Vieillard à barbe grise, le Vert-Galant se prit d'un amour impétueux, irrésistible, extravagant pour une enfant de seize ans, Charlotte-Marguerite de Montmorency. Bassompierre, qu'elle aimait, avait dû l'épouser; mais le roi avait prévenu son favori.
—«Je suis, lui avait-il dit, non-seulement amoureux, mais furieux et outré de mademoiselle de Montmorency. Si tu l'épouses, et qu'elle t'aime, je te haïrais; si elle m'aime, tu me haïrais. Je suis résolu de la marier à mon neveu le prince de Condé, et de la tenir près de ma famille.»
Un bon averti en vaut deux; Bassompierre, en courtisan bien appris, se retira; mais le prince de Condé eut le courage de tenter l'aventure.
Chose rare à cette époque, le prince de Condé prétendit garder sa femme pour lui seul. Henri fut outré de ce manque de respect; il ne songea plus qu'à lutter de ruses avec son neveu. La belle Charlotte, il faut le dire, n'accueillait point mal le roi; elle semblait même assez disposée à se rendre, mais elle était gardée à vue.
Alors commence une série d'aventures qui, pardonnables chez un jeune homme, devenaient ridicules chez un barbon. Déguisé en garde chasse ou en reître, le roi de France allait rôder sous les fenêtres de sa belle; il avait perdu la faculté de penser à toute autre chose, et, pour attirer les regards de celle qu'il aimait, il n'est pas de folle entreprise dans laquelle il ne s'embarquât.
A Saint-Leu, le roi, accompagné de M. de Vendôme et des frères d'Elben, déguisés comme lui et porteurs de fausses barbes, fut poursuivi et arrêté: le prévôt les avait pris pour des voleurs.
Malherbe avait été nommé d'office pour chanter les amours de Henri IV; il avait alors à peindre son désespoir et ses angoisses:
0 beauté, reine des beautés,
Seule de qui les volontés
Président à ma destinée,
Pourquoi n'est, comme la toison,
Votre conquête abandonnée
A l'essor d'un autre Jason?
Les essors du vieux Jason n'aboutissaient à rien, tant était vigilant M. de Condé; il avait emmené sa femme loin de la cour et refusait obstinément de revenir; cadeaux, pensions, promesses le trouvaient inflexible. «—Le roi veut m'abaisser le coeur, disait-il, et me hausser la tête; nenni.»
Malherbe cependant chantait toujours:
Donc cette merveille des cieux,
Parce qu'elle est chère à mes yeux,
En sera toujours éloignée;
Et mon impatiente amour,
Par tant de larmes témoignée,
N'obtiendra jamais son retour.
Sully cherchait à consoler le roi, qui était inconsolable.
«—Ah! Sire, disait le vieux ministre, que n'avez-vous fait mettre M. de Condé à la Bastille! Vous lui eussiez pris sa femme bien plus facilement.»
C'était aussi l'avis de Bassompierre, dont la fertile cervelle ne trouvait cependant aucun expédient.
Les couches de Marie de Médicis, la seconde épouse de Henri IV, fournirent, pour attirer le prince de Condé à la cour, un prétexte auquel il ne put résister. Le roi était au comble de la joie de revoir sa bien-aimée, et Malherbe chantait:
Revenez mes plaisirs; ma dame est revenue,
Et les voeux que j'ai faits pour revoir ses beaux yeux,
Rendant par mes soupirs ma douleur reconnue,
Ont eu grâce des cieux.
Le roi était alors complètement métamorphosé. Jaloux du bien paraître aux yeux de sa dame, il s'habillait avec recherche, soignait sa barbe et s'inondait d'essence. Il avait à la cour tout le monde pour lui; on trouvait impardonnable M. de Condé, et, tandis que chacun conspirait contre lui, les bons amis de cour lui insinuaient qu'il jouait gros jeu à lutter contre le maître.
Se voyant hors d'état de résister à l'orage qui menaçait son front, le prince prit le parti de fuir, et bravement il enleva sa femme, presque malgré elle.
«Le roi était au jeu, dit Bassompierre, quand le chevalier du guet lui porta la nouvelle de cette fuite. J'étais le plus proche de lui. Il me dit tout bas à l'oreille:—«Bassompierre, mon ami, je suis perdu. Cet homme mène sa femme dans un bois, je ne sais si c'est pour la tuer ou pour la conduire hors de France.»
Il se retira aussitôt dans sa chambre, confiant le jeu et son argent à Bassompierre. Il n'avait plus la tête à lui. Chez sa femme, il se livra à tous les transports d'une colère furieuse et d'un désespoir insensé. Il fit mander ses ministres et leur déclara qu'à tout prix il voulait faire revenir en France le prince de Condé et sa femme.
Malherbe, lui, chantait encore cette grande désolation:
Quelles pointes de rage
Ne sent point mon courage
De voir que le danger,
En vos ans les plus tendres,
Vient menacer vos cendres
D'un cercueil étranger.
Il paraît que la douleur fit maigrir Henri IV, que l'embonpoint n'avait cependant jamais gêné, car le poëte ajoute:
Aussi suis-je un squelette;
Ainsi la violette
Qu'un froid hors de saison
Ou le soc a touchée,
De ma peau desséchée
Est la comparaison.
La douceur d'être comparé à une violette ne suffit pas à consoler le roi, ni même à le faire renoncer à l'espérance de revoir madame de Condé.
Le prince s'était réfugié dans les Pays-Bas; des émissaires de Henri IV tentèrent un enlèvement: ils échouèrent. La diplomatie ne réussit pas mieux que le coup de main, et le roi allait sans doute déclarer la guerre à l'Autriche, quand le couteau de Ravaillac, le mystérieux régicide, vint détourner le cours des événements.
Sully prête à son maître les plus vastes projets; cette lutte, qu'il allait engager avec la maison d'Autriche, devait avoir pour résultat le remaniement de la carte de l'Europe, à la tête de laquelle la France se fût définitivement placée.
Il ne nous appartient pas de discuter ici la valeur de ces assertions, et nous laissons à la sévère histoire le soin de résoudre ce grand problème politique.
Du reste, Henri IV était bien de taille à le poser. L'homme avait ses faiblesses, mais le monarque était bien capable de les faire servir à ses desseins.